Piquillo Alliaga/Texte entier

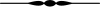
C’était jour de marché à Pampelune ; la foule qui se rendait à la grande place s’était arrêtée devant une pancarte affichée à la porte de la Gefatura, l’hôtel du corrégidor. Les paysans, déposant les bannes de légumes et de fruits ou les barils d’huile et de beurre qu’ils portaient sur leurs épaules, contemplaient cette affiche avec une attention si longue et si soutenue, qu’on aurait pu croire qu’ils la relisaient pour la seconde ou troisième fois, si aucun de ces braves Navarrais eût pu être soupçonné de savoir lire ; or, comme il y a dans la foule un aimant qui attire la foule, le flux devint bientôt si considérable, que le reflux s’étendit de l’autre côté de la rue des Dattiers, devant les carreaux de la boutique de Gongarello, le barbier, qui rasait alors une pratique, et qui, surpris de cette éclipse soudaine, fut obligé de s’arrêter, attendu que le jour lui manquait.
Aben-Abou, connu dans le quartier sous le nom de Gongarello, était un petit homme brun, joyeux, goguenard, comme les barbiers ses confrères, et de plus, intelligent et industrieux, comme tous ceux de sa nation ; il était Maure d’origine, et son activité contrastait singulièrement avec l’antipathie de ses graves voisins, pur sang espagnol, vieux chrétiens et descendants de Pélage ; aucun barbier de Pampelune n’avait plus de pratiques que lui ; aussi tous les mois était-il régulièrement dénoncé à l’inquisition par quelqu’un de ses confrères, pour crime de sédition, d’impiété ou de sorcellerie.
Gongarello, fendant la foule qui obstruait sa porte, s’approcha, non sans peine, de la pancarte officielle, et, sans attendre qu’on l’en priât, se mit à lire, à haute voix, l’affiche rouge et noire qui décorait la porte du corrégidor ; elle était ainsi conçue :
« Fidèles bourgeois de Pampelune ! notre bien-aimé seigneur Philippe III, roi de toutes les Espagnes et des Indes, veut, à son avénement au trône, visiter les provinces basques et ses bonnes villes de Saragosse et de Pampelune : il fera ce soir, aux flambeaux, son entrée solennelle dans nos murs ; nous chargeons les corrégidors, alguazils et familiers du Saint-Office des dispositions à prendre dans chaque quartier pour le passage du cortége royal,
comte de Lémos. »
Et plus bas :
« Le carrosse de Sa Majesté, celui de Son Excellence le comte de Lerma, les voitures de la cour, précédés du régiment de l’Infante et suivis du régiment des gardes, entreront par la porte de Charles-Quint, et suivront la rue de la Taconnera jusqu’au palais du vice-roi, où doit descendre Sa Majesté. Sur le passage du cortège, toutes les fenêtres seront illuminées, pavoisées, ornées de fleurs, ou porteront les armes d’Espagne et celles du comte de Lerma, premier ministre. Nous n’avons pas besoin d’engager la fidèle et loyale population de Pampelune à laisser éclater les témoignages d’enthousiasme et de dévouement qu’elle renferme en son cœur pour son bien-aimé souverain.
« Les contrevenants seront signalés au Saint-Office par nous, Josué Calzado de las Talbas, corrégidor. »
À peine Gongarello achevait-il cette lecture, que le corrégidor apparut un instant au balcon de sa maison, et, levant en l’air son feutre qu’ornait une large plume noire, s’écria : Vive Philippe III ! vive le comte de Lerma, son glorieux ministre !
Comme un écho fidèle, la multitude répéta le même cri ; quelques murmures partirent seulement d’un groupe qui était sous le balcon. Un homme grand et sec, qu’à sa moustache noire on eût pu prendre pour un ancien soldat de la vieille infanterie espagnole, et qui dans le fait n’était autre que Ginès Pérès de Hila, hôtelier au Soleil-d’Or, se mit à tousser d’un air d’autorité qui laissait entrevoir une nuance de mécontentement.
— Que nous recevions à Pampelune, dit-il, notre nouveau roi, la cour, et surtout le comte de Lerma, dont la suite est, à ce qu’on prétend, plus nombreuse que celle de Sa Majesté, je le veux bien ; le comte ne regarde pas à la dépense, ses gens tiennent à être bien servis, ils viendront dîner au Soleil-d’Or.
— Et commanderont quelques habits de gala pour les fêtes, ajouta maître Truxillo, le riche tailleur, qui venait d’arriver et de se mêler à la foule…
— Mais, continua Ginès Pérès de Hila en élevant la voix, à quoi bon ces deux régiments qu’on nous annonce, celui des gardes et celui de l’Infante ?
— Celui de l’infante ! dit Truxillo en pâlissant.
— Précisément, reprit le barbier Gongarello, celui qui a déjà séjourné ici l’année dernière, à telles enseignes que vous avez logé chez vous un brigadier de ce régiment, le seigneur Fidalgo d’Estrèmos, que je rencontrais parfois donnant le bras à la senora Pepita Truxillo, votre femme.
— Fidalgo d’Estrèmos, balbutia le tailleur, d’un air visiblement contrarié.
— Joli garçon, ma foi, que j’avais l’honneur de raser.
— Tout ce qu’il vous a dit n’était que mensonge ! s’écria le mari irrité.
— Il ne m’a rien dit, répondit tranquillement le barbier.
— Il n’en est pas moins vrai, reprit l’hôtelier en élevant encore plus la voix, que notre compère et voisin Truxillo a raison. Une foule d’inconvénients signalent toujours dans une grande ville le passage des troupes, sans compter que ces soldats seront tous logés et nourris chez le bourgeois.
— C’est vrai, c’est vrai ! crièrent plusieurs marchands.
— Et ceux qui ont le malheur d’avoir de belles maisons, continua l’hôtelier, de vastes boutiques ou de spacieuses hôtelleries seront accablés de billets de logement.
— Il faut pourtant bien, dit le barbier, que notre seigneur et maître, le nouveau roi, ait autour de lui des soldats pour le garder.
— Non, il ne le faut pas ! s’écria un homme aux larges épaules, à la barbe rousse et épaisse et à l’œil farouche, qui s’élança sur une borne, et de cette tribune improvisée domina l’assemblée : non, il ne le faut pas ! la loi et nos droits s’y opposent.
— Il a raison ! s’écria l’hôtelier.
— Très-bien ! plus haut ! cria le tailleur.
Vingt ou trente conversations particulières qui se croisaient alors s’arrêtèrent tout à coup. Un profond silence se fit dans le groupe. Il gagna les groupes voisins, et chacun prêta une oreille attentive à l’orateur, qui poursuivit avec véhémence :
— Lorsque le défunt roi Philippe II, sous prétexte de poursuivre Antonio Pérès, est venu à main armée détruire les fueros d’Aragon, il n’avait qu’un regret, c’était de ne pouvoir traiter de même les fueros de Navarre, et ce que n’a pas osé faire Philippe II, voilà son fils et successeur qui voudrait le tenter ! mais vous ne le souffrirez pas, si vous êtes des Navarrais !
— Nous le sommes tous ! cria l’aubergiste.
— Tous ! hurla le tailleur.
— Tous ! répéta la foule, qui, sans comprendre de quoi il s’agissait, commençait déjà à s’émouvoir et à s’agiter.
— Que disent nos fueros[1] ? Que la ville se jugera et se gardera elle-même par ses propres citoyens, et qu’aucun étranger armé n’y pourra pénétrer ! c’est le texte.
— C’est la vérité, cria l’aubergiste, qui ne l’avait jamais lu.
— C’est la vérité ! répéta de confiance le digne tailleur.
— Mais, hasarda le barbier à demi-voix, des soldats du roi ne sont pas des étrangers.
— Ce sont des Castillans ! répliqua l’orateur avec dédain ; eh ! qu’y a-t-il de commun entre le roi de Castille et celui de Navarre[2] ? Nous ne sommes pas comme le reste de l’Espagne ; nous n’avons jamais été conquis ; nous nous sommes donnés, à la condition que la Navarre conserverait les vieux fueros qu’elle possédait alors[3].
— C’est vrai ! c’est vrai ! cria-t-on de toutes parts.
— Et, plus forts, plus habiles que les Aragonais nos voisins, nous prendrons la devise qu’ils n’ont pas su défendre, et nous dirons :
« Le roi entrera dans nos murs sans autre garde que les bourgeois de Pampelune ! sinon… non ! »
Ce n’était pas sans dessein que l’orateur faisait ainsi allusion à l’ancienne formule des cortès aragonaises ; il avait toujours eu rivalité de priviléges entre l’Aragon et la Navarre ; aussi des acclamations bruyantes et chaleureuses retentirent-elles dans la rue.
— Vive le capitaine Juan-Baptista Balseiro ! crièrent plusieurs gens qui avaient l’air de le connaître, et qui, se précipitant dans la foule, augmentèrent encore le tumulte et le désordre.
Au bruit qui se faisait dans la rue, le corrégidor Josué Calzado parut de nouveau à son balcon, moins effrayé que satisfait d’une apparence d’émeute qui lui permettait de montrer son zèle, et surtout de haranguer le peuple. L’honorable corrégidor aimait à parler. Dans les provinces basques, où il était né, il avait fait autrefois partie des cortès, n’avait pas perdu une seule occasion de prendre la parole, et son éloquence filandreuse et incessante n’avait pas peu contribué à allonger d’une manière démesurée la durée de chaque session. Maintenant établi à Pampelune, dévoué au roi et aux ministres, il attendait impatiemment une place supérieure que le comte de Lerma lui faisait toujours espérer, et qu’il n’avait aucune envie d’accorder à une fidélité complétement acquise, réservant cette faveur à un dévouement moins sûr et qu’on aurait besoin de consolider. Chaque province se regardait alors comme un État séparé.
Mais si l’ancien orateur des cortès aimait s’entendre, il fut en ce moment cruellement désappointé ; à peine eut-il réuni toutes les forces de ses poumons pour crier : Fidèles Navarrais, que sa voix fut couverte par les cris de : À bas le corrégidor !
— Vive le roi ! vive son glorieux ministre ! continua-t-il, pour débuter par un raisonnement qu’il croyait sans réplique.
— À bas le comte de Lerma à bas le ministre !
— C’est ce que je voulais dire, mes chers concitoyens, écoutez-moi ; ma seule devise est celle-ci : Vive notre glorieux monarque !
— À bas le roi, s’il attente à nos libertés !
— C’est ce que je voulais dire, mes compatriotes… daignez m’entendre… Vivent nos libertés !
L’assemblée tumultueuse l’interrompit de nouveau : chacun lui adressait des apostrophes ou des reproches, et le peuple, excité par Ginès et Truxillo, avait déjà arraché la proclamation, dont on foulait aux pieds les lambeaux déchirés.
Cependant la guerre déclarée ne devait point s’arrêter là. Le corrégidor, placé sur son balcon, occupait une forte position, qui lui permettait de braver l’armée ennemie ; l’artillerie des injures qui se croisaient en tous les sens ne l’atteignait pas et l’inquiétait peu ; mais le voisinage du marché aux légumes fournit bientôt aux assaillants des projectiles autrement dangereux pour le corps de la place, et le corrégidor, regardant autour de lui avec inquiétude, avisait déjà aux moyens d’opérer la retraite la plus honorable et la moins désastreuse possible, lorsque cette voie de salut lui fut fermée. Le capitaine Juan-Baptista, en effet, qui avait toutes les allures et l’agilité d’un marin, venait de monter à l’assaut, en gravissant des pieds et des mains le long d’un des poteaux en bois qui soutenaient le balcon, et parut derrière le corrégidor au moment où celui-ci se décidait à abandonner le champ de bataille, l’enlevant d’un bras vigoureux du balcon pour le précipiter dans la rue. Le peuple, qui ne s’attendait point à ce coup de théâtre, fit tout à coup silence, comme dans les endroits intéressants, pour ne rien perdre du spectacle, Le corrégidor saisit ce moment pour s’écrier :
— Vous ne voulez pas m’entendre… je suis pour vous ! habitants de Pampelune ; je pense comme vous ! Vivent nos fueros !
— Vive le corrégidor ! s’écria le peuple tout d’une voix.
— Oui, oui, il mourra pour défendre nos fueros, ajouta le capitaine. Et sous prétexte de le présenter à la multitude, il le souleva en le serrant dans ses bras avec une telle vigueur que Josué Calzado, suffoqué à moitié, n’eut que la force d’étendre le bras en guise de serment.
Le peuple répéta avec admiration :
— Vive notre digne magistrat !
— Il va nous conduire lui-même chez le gouverneur, continua le capitaine, et portera la parole pour nous ; c’est lui-même qui vous le propose.
À ces mots, l’enthousiasme populaire ne connut plus de bornes. Le corrégidor, entraîné dans la rue par le capitaine Juan-Baptista, fut accueilli par les vivats redoublés de la multitude en délire. Avant qu’il eût pu ouvrir la bouche, il fut pressé, entouré, enlevé par mille bras et porté en triomphe. Une couronne de chêne fut placée sur son front, encore souillé par la trace des derniers projectiles, et le cortége populaire, conduit par Ginès Pérès, du Soleil-d’Or, et maître Truxillo, le tailleur, se mit en marche pour le palais du gouverneur, traversant la promenade de la Taconnera, déjà jonchée de feuillage et de fleurs, et où les drapeaux pavoisés aux armes d’Espagne, se balançaient à chaque croisée pour saluer la royale entrée de Philippe III.
Quant au capitaine Juan-Baptista, il avait disparu, et le barbier Gongarello rentrait prudemment dans sa boutique, disant à voix basse à plusieurs de ses compatriotes qui l’interrogeaient sur les événements :
— Que le roi ou le peuple l’emporte, nous autres Maures, baptisés par force, nous ne gagnerons rien à la victoire, et peut-être paierons-nous les frais de la guerre ; ainsi, croyez-moi, restez tranquilles, ne vous mêlez de rien…
Et Aben-Abou, dit Gongarello, reprenant son rasoir, se mit à raser deux de ses pratiques : un chrétien et un juif, qui l’attendaient dans sa boutique.
Pendant que ces événements se passaient au centre de la ville, errait dans la rue Saint-Pacôme, petite ruelle étroite et tortueuse, un pauvre enfant de dix à douze ans à peu près ; je dis à peu près, car personne, pas même lui, n’aurait pu dire son âge. Sa figure pâle et amaigrie portait les traces de la fièvre, et ses habits en lambeaux attestaient la plus profonde misère. Un air de douceur et de bonté se peignait sur tous ses traits, et un rayon d’intelligence brillait dans son œil noir presque éteint. Il marchait ou plutôt se traînait avec peine, et son plus grand mal en ce moment, la maladie dont il se mourait, c’était la faim. Il venait de traverser deux ou trois rues qu’à son grand étonnement il avait trouvées presque désertes ; en effet, aux premières nouvelles de l’émeute, toute la population s’était portée, comme d’ordinaire, du côté du bruit et du désordre, les uns pour y prendre part, les autres, et c’était le plus grand nombre, pour voir.
Le pauvre enfant vit venir à lui un conseiller à l’audience de Castille qui hâtait le pas ; il n’osa lui demander l’aumône, mais il tendit la main.
Le conseiller du roi ne regarda pas, et passa son chemin.
Un instant après apparut un hidalgo marchant lentement et enveloppé de son manteau. Le pauvre enfant ôta timidement son chapeau et le salua ; l’hidalgo s’arrêta, et pour toute aumône lui rendit son salut.
Le jeune mendiant, tombant de faiblesse, s’appuya contre une porte, et il entendit une voix de femme qui lui rendit l’espoir.
— Pablo !… Pablo !… criait une mère, venez ici, votre soupe vous attend.
À ce mot, l’orphelin frappa vivement à la porte, comme s’il eût été invité… mais inutilement : la mère était trop occupée de son enfant et ne l’entendit pas. Hélas ! se dit-il, moi, je n’ai pas de mère qui m’appelle… je n’ai pas de repas qui m’attende ! et il continua à suivre une grande belle rue qui conduisait au bord de l’Arga, n’espérant plus rien des hommes sans doute, car ses yeux étaient levés vers le ciel. En ce moment le soleil, sortant d’un nuage, vint éclairer un côté de la rue ; il courut s’adosser contre la muraille, et pendant que ses membres chétifs se réchauffaient, une expression de joie mélancolique errait en signe de reconnaissance sur ses lèvres décolorées ; il souriait au soleil ! le seul ami qui eût daigné lui sourire.
Puis, comme ses yeux fatigués et qui ne pouvaient supporter un éclat trop vif, se reportaient vers la terre, il vit près de lui, au coin d’une borne, deux ou trois côtes de melon qu’on y avait jetées. Dans la faim qui le dévorait, il se baissa pour les ramasser et les porta avidement à sa bouche ; il aperçut alors un enfant à peu près de son âge, une espèce de bohémien, aussi déguenillé que lui, qui s’avançait en chantant.
— Tu es bien heureux d’être gai, lui dit-il, et de chanter.
— Je chante parce que j’ai faim, et n’ai pas de quoi manger !
À l’instant, et sans proférer une parole, et par un mouvement généreux, il tendit à son nouveau compagnon les côtes de melon qu’il venait de ramasser.
Le bohémien le regarda d’un air étonné et reconnaissant.
— Quoi ! tu n’as pas d’autre dîner que celui-là ?
— Bien heureux de l’avoir trouvé… partageons.
Et les deux amis, s’asseyant au coin de la borne, commencèrent leur repas.
La salle à manger était vaste et spacieuse. C’était une rue en ce moment solitaire et qui ressemblait peu aux autres rues de Pampelune ; elle était propre, grâce à une fontaine dont les eaux roulaient près d’eux et leur offrait une boisson fraîche et limpide ; on voit que rien ne leur manquait. En face d’eux était une maison élégante, sur laquelle on lisait ces mots : Truxillo, maître tailleur. Les deux convives, établis à leur aise sur le pavé, avaient la borne entre eux, et de plus étaient adossés contre les murs d’un fort bel hôtel : c’était celui du Soleil-d’Or, dont les croisées s’ouvraient au-dessus de leurs têtes.
À table, la connaissance se fait vite, et le bohémien dit sur-le-champ à son amphitryon :
— Quel est ton nom ?
— Piquillo ! c’est ainsi qu’on m’appelait chez les moines où j’étais. Et toi, comment te nomme-t-on ?
— Pedralvi… Tes parents ?
— Je n’en ai plus.
— Moi de même… As-tu connu ton père ?
— Jamais.
— C’est comme moi… Et ta mère ?
— Ma mère, dit Piquillo, cherchant à rappeler ses souvenirs, devait être une grande dame. Il venait chez elle des seigneurs qui avaient de riches pourpoints et des plumes à leurs chapeaux ; elle avait un bel appartement avec des tapisseries. Je vois encore sur une table un miroir avec lequel je jouais. Il était doré et avait toujours un tiroir plein de dragées… Voilà tout ce que je me rappelle des soins et de la tendresse de ma mère, et puis un matin je me suis réveillé seul à la porte d’un grand bâtiment qu’on appelait un couvent ; on m’y a gardé… je ne puis dire combien de temps… puis on m’a renvoyé en me disant : Cherche ta vie, paresseux ! J’avais faim… j’ai mendié… et puis j’ai été malade… chacun me disait : Va-t’en, tu as la fièvre… cela se gagne ! tout le monde s’éloignait de moi.
Pedralvi lui tendit brusquement la main, que Piquillo serra avec reconnaissance.
— Et enfin, continua-t-il, je n’ai rien… je ne sais où aller… Voilà mon histoire.
— Moi, dit Pedralvi, je me rappelle ma mère… je la vois encore… elle était grande et forte, et me portait sur son dos. Un jour, nous venions de Grenade, nous descendions d’une montagne qu’on appelait les Alpujarras, et j’ignore comment cela s’était fait, mais des hommes en soutane noire s’étaient emparés de moi, malgré ses cris et les miens. Ils me jetaient de l’eau froide sur la tête, en proférant des mots barbares que je ne comprenais pas… et ma mère s’écriait : Il n’est pas chrétien… il ne le sera jamais… ni moi non plus, et elle essayait, en me frottant le front, d’effacer ce qu’elle nommait une tache, une souillure… et alors ils l’ont tuée !
— Tuée ! s’écria Piquillo avec effroi.
— Oui… en l’appelant hérétique et damnée.
— Hérétique ! répéta l’enfant, qu’est-ce que c’est que cela ?
— Je n’en sais rien… mais son sang coulait… je l’ai vu… et elle me disait en me le montrant : Pedralvi… mon fils, souviens-toi !… Puis tout à coup elle est devenue pâle… ses membres se sont roidis, et elle a cessé de parler. Ce qui a suivi… je ne me le rappelle pas. Je sais seulement que dans un bois j’ai rencontré des bohémiens… qui m’ont emmené avec eux… Puis un jour ils ont été attaqués… encore par des hommes en noir qu’on appelait des alguazils. Chaque mère s’est enfuie emportant son enfant… Moi qui n’avais pas de mère, je suis resté… sur la grande route ! Depuis ce temps je marche devant moi… je chante et je mendie… Voilà mon histoire.
Les deux orphelins, les deux amis se tendirent de nouveau la main en se disant : mon frère ! Et, en effet, dans leur teint basané, dans leurs yeux noirs et expressifs, dans la coupe de leurs traits, il y avait un air de parenté, de famille ou du moins de race et de tribu.
— Maintenant, dit Piquillo en regardant tristement la dernière côte de melon qui avait disparu, notre dîner est fini.
— Fini ! dit le bohémien, et j’ai faim.
— Moi aussi !
— Plus qu’auparavant, je crois ! et pas d’espoir d’un second service.
— Peut-être, dit une douce voix qui partait d’en haut, et à une fenêtre qui venait de s’ouvrir apparut une jeune fille en costume mauresque. C’était une petite servante de l’hôtel du Soleil-d’Or, Juanita, qui leur dit : Tenez, mes enfants ; et elle leur jeta un gros morceau de pain blanc et les restes d’un déjeuner que venaient de faire deux jeunes étudiants de Saragosse, arrivés de la veille à Pampelune pour assister à l’entrée du roi et de la cour.
Jamais banquet royal, jamais diner de ministre ne vit des conviés plus joyeux, plus ravis, plus enivrés. Stimulé par ces mets fortifiants, leur appétit, qui n’avait été qu’endormi, se réveilla jeune et splendide : tous les malheurs furent oubliés, et chacun dans ce moment n’eût pas troqué son sort contre celui du roi d’Espagne ; mais la reconnaissance de l’estomac n’excluait pas chez eux celle du cœur, et de temps en temps ils oubliaient de manger, et s’arrêtaient pour lever des yeux pleins de tendresse vers leur providence, vers la petite servante qui, restée à la croisée, jouissait avec bonheur de son ouvrage et de leur appétit. Ce riant tableau, que Pantoja de la Cruz, premier peintre de Philippe III, n’eût pas jugé indigne de ses pinceaux, fut tout à coup troublé par un cri que poussa la providence, je veux dire la servante navarraise, et auquel Piquillo répondit par un second cri en se sentant vigoureusement secouer l’oreille. C’était le seigneur Ginès Pérès de Hila, le propriétaire du Soleil-d’Or, que Juanita avait signalé la première du haut de son observatoire, et que, tout entiers à leur appétit, nos deux épicuriens n’avaient pas entendu arriver.
— Ah ! ah ! c’est donc ainsi qu’on me vole ! s’écria l’hôtelier d’une voix terrible, en lançant vers Juanita un regard menaçant dont l’effet fut perdu, car la pauvre servante avait déjà refermé la fenêtre. L’aubergiste furieux, tenant toujours d’une main l’oreille de Piquillo, voulut de l’autre ramasser les reliefs du festin ; mais le petit bohémien, plus leste que lui, avait déjà fait une râfle générale des provisions restantes, les avait entassées à la hâte dans une espèce de bissac qu’il portait sur son dos et qui n’avait pas l’habitude d’être rempli… Puis, jetant dans l’oreille de son compagnon ces mots prononcés rapidement et à voix basse : « À ce soir, derrière l’église Saint-Pacôme, » il disparut comme un éclair.
Piquillo eût bien voulu le suivre, mais l’une de ses oreilles était toujours en otage dans les mains du farouche hôtelier, et puis il lui semblait, par un sentiment instinctif de générosité et de justice, qu’il devait rester pour défendre leur bienfaitrice.
— Battez-moi, dit-il résolument à son adversaire, car le repas lui avait rendu ses forces, et la force lui avait rendu le courage. Battez-moi, si vous le voulez, mais ne grondez pas la jeune fille !
— Juanita ! s’écria l’aubergiste, c’est une petite friponne que je renverrai chez son oncle Gongarello, le barbier… J’avais consenti à la prendre pour rien ; mais je vois que, même à ce prix-là, elle me coûte cher, et que j’y perds encore ! Toute cette race de Maures ne vaut pas la corde qu’on emploie pour les pendre, ou le bois qu’on achète pour les brûler !
— Grâce pour elle ! reprit l’orphelin, et je vous servirai et je vous obéirai en tout.
— Soit, dit l’aubergiste, à qui il venait par hasard de naître une idée, et c’était pour lui une bonne fortune si rare qu’elle devait le disposer à l’indulgence. Soit, je te pardonnerai ainsi qu’à Juanita, et je te donnerai même un réal…
— Un réal ! fit Piquillo, tout étonné et en ouvrant de grands yeux, est-ce de l’or ?
— À peu près ! c’est vingt maravédis[4].
— Vingt maravédis !
Piquillo n’avait jamais possédé pareille somme.
— Que faut-il faire pour gagner ça ?
— Te promener d’ici à ce soir dans les rues de Pampélune, en criant : Vivent les fueros !
— Pas autre chose ? ce n’est pas difficile ; et j’aurai un réal ?
— Je te le paierai ici même… ce soir.
— Vous le jurez par Notre-Dame del Pilar ?
— Je te le jure, reprit l’aubergiste en ouvrant la main et en lâchant son captif.
Piquillo ne sentit pas plutôt son oreille libre, qu’il s’élança gaiement dans les rues qui s’ouvraient devant lui, et disparut en criant à tue-tête : Vivent Les fueros !
II.
le triomphe.
Dans une riche et antique maison de Pampelune, dont les fenêtres principales donnaient sur la Taconnera, au fond d’un appartement, et assis dans un grand fauteuil gothique qui portait les armes de la maison d’Aguilar, un vieux soldat de Philippe II était plongé dans de sombres réflexions. Sur une table étaient placés son chapeau, son épée et un parchemin scellé de trois cachets. Devant lui, et sans oser l’interroger, se tenait respectueusement un jeune et bel officier, que toutes les mères auraient envié pour fils, toutes les femmes pour cavalier. Dans ses yeux pleins de douceur, respirait l’insouciance de la jeunesse ; dans toutes ses manières, la galanterie espagnole, et sur son front, la fierté castillane. Sa lèvre encore imberbe souriait d’impatience, pendant que sa main caressait avec satisfaction le pommeau de son épée. Voyant que le vieillard continuait à garder le silence, il hasarda enfin ces mots d’une voix timide :
— Irai-je avec vous en Irlande, mon oncle ?
— Non, répondit le vieux soldat.
— Et pourquoi ?
— Vous n’avez pas fait encore vos premières armes, Fernand ; je voudrais vous voir débuter par une victoire, et nous serons battus.
— Quand c’est vous qui commandez, vous, don Juan d’Aguilar ! quand le roi vous donne six mille hommes de ses meilleures troupes pour débarquer en Irlande, quand il veut signaler la première année de son règne par une glorieuse expédition.
— J’irai… j’irai ! mais tout est arrangé pour que nous ne réussissions pas ! Entreprise mal combinée ! impolitique… inutile. Au lieu d’attaquer franchement Élisabeth et ses Anglais, susciter des troubles et des séditions et se mettre aux ordres des Irlandais révoltés… ce n’est pas là ce qu’il fallait faire. Mais on méprise nos conseils ; on ne nous écoute pas, nous vieux soldats, qui savons faire la guerre, et qui avons servi sous don Juan d’Autriche, L’Espagne était grande et glorieuse alors !…
— Et maintenant, mon oncle, dit le jeune homme avec fierté, elle n’a pas dégénéré !
— Oui, s’écria le vieillard en le regardant avec satisfaction, elle a encore des bras et des épées pour la défendre, mais c’en est fait de l’empire de Charles-Quint… c’en est fait de notre puissance ! son déclin a commencé et ne s’arrêtera plus.
— Un nouveau règne peut lui rendre ses splendeurs !
— Un nouveau règne ! murmura le vieux guerrier. Il poussa un profond soupir, et continuant à demi-voix : J’étais au lit de mort de Philippe II ; celui-là se connaissait en hommes… et ce prince, qui avait appris la victoire de Lépante sans que son visage exprimât un mouvement de joie, ce prince à qui plus tard la ruine entière de sa flotte n’avait pas arraché un regret… je l’ai vu pleurer… oui, pleurer devant moi, son vieux serviteur, sur l’avenir de la monarchie espagnole. Dieu, m’a-t-il dit, qui n’a fait la grâce de me donner tant d’États, ne m’a pas fait celle de me donner un héritier capable de les gouverner.
— Qu’importe ! s’il a un bon ministre, et l’on dit que le comte de Lerma a tant de talents.
Au geste d’impatience que fit son oncle, le jeune homme vit qu’il s’était avancé imprudemment.
— Le comte de Lerma, un bon ministre ! Où donc Gomez de Sandoval y Royas, aujourd’hui comte de Lerma, aurait-il appris la science du gouvernement ? Est-ce dans ses aventures de jeunesse ?… dans les tours qu’il jouait à ses créanciers, qu’il avait l’art de payer sans bourse délier[5] ?…
— Eh ! mais, mon oncle, dit le jeune homme en souriant, c’est déjà un secret qui n’est pas à dédaigner, et s’il peut l’employer contre les créanciers de l’État, cela rendra grand service à nos finances.
Mais don Juan ne l’écoutait pas, et poursuivait avec chaleur :
— Où aurait-il appris la politique ? Est-ce dans les antichambres de l’infant où le feu roi l’avait placé sous les ordres de la marchesana de Vaglio[6], pour distraire et divertir l’héritier de la couronne ? Voilà l’origine de sa faveur, de son mérite et de tous les talents qu’on lui suppose aujourd’hui. Aussi, le jour de la mort du vieux roi, tout a été fini pour nous, ses anciens conseillers ; le comte de Lerma est devenu non pas ministre, mais souverain absolu de toutes les Espagnes !… Oui, poursuivit don Juan, dont l’indignation ne faisait qu’augmenter, c’était peu, pour le nouveau monarque, de prodiguer le titre de comte et de ministre à son favori, sa première ordonnance royale, ordonnance sans exemple dans l’histoire des monarchies, portait que la signature du comte de Lerma devait avoir autant de valeur que la sienne, à lui, le roi !… à lui, descendant de Philippe II et de Charles Quint ! et depuis un an, un Sandoval signe : Yo el Rey !
— Mon oncle, calmez-vous…
— Un roi d’Espagne descendre du trône et abdiquer l’empire !… Charles-Quint l’a fait pour son fils ! mais non pour un de ses sujets… C’est une honte pour la noblesse du royaume ! Je le pense, et je l’ai dit ; aussi le favori me déteste.
— Vous voyez cependant, dit le jeune homme en montrant du doigt le parchemin scellé des armes royales, qu’il vous donne le commandement de l’expédition d’Irlande.
— Oui, il aime mieux me voir en Irlande qu’à Pampelune ! Pampelune lui semble encore trop près de Madrid et de la cour. Il a peur que je n’y revienne, et il m’en éloigne pour jamais.
— Eh bien, mon oncle, refusez !
— Refuser quand il y a des dangers !… J’irai, j’irai ! je me ferai tuer… mais tu ne viendras pas avec moi… il n’y a là que des périls sans gloire… Martin Padilla, qui commande la flotte, est mon ennemi ; Occampo, qu’ils m’ont donné pour lieutenant, est mon ennemi…
— Raison de plus pour que je sois près de vous.
— Et qui défendrait ma mémoire ?… qui soutiendrait l’honneur de notre maison ? qui soutiendrait Carmen, ma fille… que je laisserais orpheline !… Si jeune encore, elle n’aurait pour protectrice que sa tante, ma sœur, la comtesse d’Altamira, en qui j’ai peu de confiance ! Tu sais, Fernand, mes projets sur mon enfant et sur toi…… tu ne les trahiras pas… tu me le promets ?
— Oui, mon oncle, je vous le jure, s’écria le noble jeune homme, en étendant sa main, que le vieillard serra dans les siennes avec reconnaissance.
— Et puis, ajouta celui-ci en essuyant une larme qui roulait dans ses yeux, et puis, dans quelques années, lorsque ton âge te donnera entrée au conseil, car tu as le droit d’y siéger, tu es grand d’Espagne… tu es baron d’Albayda, premier baron du royaume de Valence… souviens-toi alors de ce que je te dis aujourd’hui. Défends notre faible monarque contre ses favoris et contre lui-même : fais respecter, en tout temps et contre tous, son autorité royale ; le roi, quoi qu’il fasse, c’est notre seigneur, c’est notre père ! Où est le roi c’est la patrie, et bientôt la patrie sera en danger. Trop d’ennemis menacent l’Espagne… trop de causes la poussent à sa ruine…
Comme il parlait ainsi, on entendit au dehors une rumeur lointaine et prolongée.
— Qu’est-ce ? dit le vieillard en s’interrompant.
— Rien, mon oncle, ce sont les fêtes qui commencent. Le roi et son ministre font ce soir leur entrée à Pampelune !
Le bruit augmentait peu à peu. Bientôt on distingua des vociférations, des menaces, et les cris prolongés de : Justice ! justice ! mort au comte de Lerma !
— Déjà ! dit froidement le vieillard. Vois donc ce que ce peut être.
Il n’avait, dans ce moment, qu’une crainte : c’est que le bruit du dehors ne réveillât son enfant chéri, Carmen, sa fille, qui alors faisait la sieste.
Fernand allait sortir pour obéir à son oncle ; mais au moment où il ouvrait la porte, entra vivement un homme dont les riches habits en désordre étaient, en plusieurs endroits, froissés et souillés. Son regard hautain respirait à la fois la crainte et la colère, et il cherchait à sourire pour déguiser son émotion, comme d’autres chantent pour cacher leur frayeur.
— Le comte de Lémos ! s’écria d’Aguilar avec étonnement.
— Le gouverneur de Pampelune ! dit Fernand avec respect.
Le comte de Lémos était beau-frère du comte de Lerma, qui l’avait nommé vice-roi de la Navarre, et c’était lui qui, dans ce moment, commandait dans la ville ; sa visite avait droit de surprendre d’Aguilar, qui, fort mal avec le ministre, n’était guère mieux avec sa famille. Lémos et d’Aguilar ne se voyaient pas d’ordinaire.
— Eh ! oui, c’est moi, mon cher, s’écria le comte avec un rire bruyant ; ils ont rencontré au milieu de la rue mon carrosse, qu’ils ont assailli de pierres… Il m’a bien fallu en descendre, et poursuivi par eux jusqu’à la porte de votre hôtel…
— De qui me parlez-vous, monsieur le comte ? dit froidement d’Aguilar.
— Vous ne savez donc pas ce qui se passe ?
— Nullement.
— Rien n’est plus divertissant… c’est une folie… un délire ! Ils ont tous perdu la tête, jusqu’à ce Josué Calzado, le corrégidor… que je croyais un homme raisonnable et paisible… un homme à nous. Voituré en triomphe sur les épaules du peuple… Il est venu à leur tête, à mon hôtel, avec un bruit et des cris… La comtesse de Lémos en aura la migraine… sans compter qu’ils ont commencé par casser les vitres.
— Mais que veulent-ils ?… s’écria d’Aguilar avec impatience.
— Ce qu’ils veulent ?… des absurdités !… Empêcher le roi d’entrer dans Pampelune… Le roi qui, justement, vient d’arriver aux portes de la ville.
— Fermer les portes au roi d’Espagne ! dit d’Aguilar avec indignation. J’espère, monsieur le comte, que vous avez pris des mesures vigoureuses.
— Certainement, j’ai envoyé sur-le-champ un exprès déguisé à mon beau-frère, le comte de Lerma… le premier ministre… Cela le regarde, c’est à lui de savoir ce qu’il a à faire…
— Mais vous, monsieur le comte ?…
— Moi ! que voulez-vous que je fasse ?
— N’y a-t-il pas à Pampelune une citadelle que Philippe II a fait bâtir ?
— Elle n’est pas seulement achevée… et pas un canon ! pas un soldat !
— Dans une ville frontière ! s’écria d’Aguilar, en regardant Fernand. Que te disais-je ? Voilà la prévoyance de ceux à qui on a confié l’Espagne. Pas de garnison !… pas un soldat !
— Fort heureusement ! répondit Lémos avec impatience, puisqu’ils n’en veulent pas… puisque c’est là la seule cause de l’émeute… Ils ne veulent, pour l’entrée du roi, que des soldats qui ne soient pas militaires… de la garde bourgeoise,
— Et vous avez cédé ?
— Non pas ! Voyant qu’il était impossible de s’entendre avec eux, j’ai fait atteler mes chevaux à une voiture sans armoiries, et, sortant par une porte de derrière de l’hôtel… j’espérais rejoindre le duc de Lerma et les deux régiments qui l’accompagnent… et alors nous aurions vu !
— Vous, le gouverneur ! dit don Juan d’Aguilar avec surprise, abandonner la ville…
— Pour y rentrer… Mais je n’ai pas pu ; ils m’ont reconnu, poursuivi !… Par bonheur, j’ai pu me réfugier chez vous, et je vous demande mille pardons, mon cher d’Aguilar, d’entrer ainsi sans cérémonie et sans être attendu.
En ce moment le tumulte redoubla au dehors, et un valet de l’hôtel accourut, tout effrayé, dire que le peuple demandait à grands cris, et avec d’horribles menaces, qu’on en fit sortir le gouverneur.
Le comte de Lémos pâlit. Le jeune Fernand se rapprocha de lui, comme pour le protéger, et don Juan d’Aguilar, sans quitter son fauteuil, dit en souriant :
— Répondez-leur que je suis trop honoré de la visite de monsieur le comte pour vouloir l’abréger. Il restera dans l’hôtel d’Aguilar tant qu’il le voudra bien.
Puis, avec toute la majesté castillane, il ajouta :
— Quant aux gens qui sont devant ma porte, dites qu’ils aient à se retirer.
Tel était le respect que don Juan d’Aguilar imposait à tous les siens, et la ponctualité avec laquelle il avait l’habitude d’être obéi, qu’il ne vint pas à son Valet l’idée de faire la moindre réflexion ; et sans penser qu’il courait risque d’être mis en pièces par le peuple, il descendit pour remplir son message ; mais cela ne fut pas possible, car, effrayés de voir la foule augmenter à chaque instant, les gens de l’hôtel avaient barricadé la grande porte, et, quoique don Juan d’Aguilar fût aimé et honoré de tous, ces mesures de défense avaient irrité la multitude, qui manifestait déjà des intentions hostiles.
Le malheureux corrégidor, chef, sans le vouloir, d’un mouvement qu’il ne pouvait arrêter, et d’une armée qui le faisait trembler de terreur, voulut vainement élever la voix. Au milieu du tumulte, on n’entendait pas ses cris, mais on voyait ses gestes, et le peuple, persuadé que son magistrat cherchait à l’encourager à l’animer, s’écriait : Le corrégidor a raison… À l’assaut ! à l’assaut ! Vive le corrégidor !
Les pierres commençaient à voler et les vitres à tomber en éclats À ce bruit, Fernand s’élança dans l’appartement dont les croisées donnaient sur la place publique, et d’Aguilar, que la goutte empêchait de marcher aussi vite, se leva pour le suivre.
— Que faut-il faire ? s’écria le comte de Lémos, dans le plus grand trouble.
— Arrêter le corrégidor et deux ou trois des plus mutins, dit d’Aguilar, et le reste se dissipera. Eh bien ! cria-t-il à son neveu, qui, appuyé sur une des croisées. regardait tranquillement la foule immense et furieuse qui environnait l’hôtel, eh bien ! Fernand, que dis-tu de cela ?
— Je dis, mon oncle, répondit froidement le jeune homme, qu’il y aura bien du malheur si nous n’en prenons pas quelques-uns, car ils sont beaucoup.
En ce moment on entendit au loin retentir ces cris : Mort au gouverneur !
Le comte de Lémos s’efforçait en vain de cacher son émotion ; et, malgré le sourire d’emprunt qui contractait ses traits, la sueur coulait de son front. Le vieux soldat le regarda de travers et lui dit :
— Ne craignez rien, mon hôte, vous avez encore du temps devant vous !
— Et lequel ?
— Le temps que ma maison soit démolie ou brûlée, et que nous soyons tous tués, n’est-ce pas, Fernand ?
— Oui, mon oncle.
— Alors seulement on arrivera à vous. Mais d’ici là, le duc de Lerma, puisqu’il est prévenu et qu’il a deux régiments, fera quelque démonstration énergique qui effraiera les rebelles.
— Vous croyez ? dit Lémos, d’un air de doute.
— Par saint Jacques ! c’est impossible autrement. Fermer les portes de la ville au souverain ! Après un pareil affront, il ne peut pas céder, on ne doit rien accorder à la révolte ; il y va de la majesté royale. C’est au commencement d’un règne qu’il faut montrer de la fermeté.
— Et si la rébellion se prolonge ?
— Qu’importe !
— Mais nous, pendant ce temps ?…
— Nous soutiendrons le siège… ici, dans cet hôtel, contre toute la population de Pampelune, s’il le faut ! n’est-ce pas, mon neveu ?
— Oui, mon oncle ! ce sera ma première campagne, et je suis ravi de la faire sous vos ordres.
Un nouveau bruit, plus fort, plus menaçant, retentit alors ; c’était celui des poutres et des leviers, à l’aide desquels on attaquait la porte principale. À l’idée d’un assaut à soutenir, le vieux don Juan d’Aguilar devint sublime ; semblable au cheval de bataille qui hennit et relève la tête au son de la mousqueterie et du clairon, il s’élança d’un pas ferme ; il avait oublié sa goutte, il avait retrouvé toute l’ardeur de sa jeunesse.
— À moi ! cria-t-il à ses gens qui accouraient. Des armes, du fer, des pioches… tout ce qui vous tombera sous la main ; démolissez-moi ces croisées !
— Que voulez-vous faire ? s’écria le conte de Lémos.
— Jeter le premier étage de l’hôtel sur ceux qui assiègent le rez-de-chaussée.
— Bien, mon oncle, s’écria Fernand en se mettant à l’œuvre, je vous comprends !
— Cela te servira ! Je vais te montrer comment on défend une place de guerre…
— Quoi ! dit le comte de Lémos, surpris de tant de générosité, vous exposer ainsi pour moi… le parent et l’allié… d’une famille hostile… à la vôtre.
— Raison de plus… s’écria le vieillard, je ne livrerais jamais un ami qui serait venu me demander asile ; à plus forte raison… un ennemi… parce qu’un ennemi, voyez-vous, c’est sacré.
Puis, il ajouta vivement :
— Prenez garde, monsieur le comte, ne restez pas devant cette croisée, c’est la plus exposée ; mais nous allons bientôt faire taire cette artillerie de cailloux. Écoutez ici, vous autres !
Et rêvant, ce que plus tard, et dans une position à peu près pareille, Charles XII réalisa à Bender, le vieux général voulait non-seulement repousser l’assaut, mais il méditait même de faire, avec son neveu et ses domestiques, une sortie sur les assiégeants ; il avait lui-même, en peu de mots, expliqué son plan à son état-major rassemblé autour de lui, et ordonné d’ouvrir toutes les fenêtres pour examiner, des hauteurs, la position de l’ennemi ; mais, à la grande surprise des assiégés, le calme avait succédé au tumulte : la rue était presque déserte, et à l’aide même de sa longue-vue, le général n’aperçut que l’arrière-garde, ou plutôt les traînards de l’armée assiégeante, qui avaient fait volte-face et paraissaient se diriger vers la porte Charles-Quint, celle par laquelle devait entrer le roi. Le comte de Lémos s’épuisait en conjectures, et d’Aguilar cherchait vainement quel hasard imprévu, quelle manœuvre stratégique ou quelle panique soudaine venait de lui dérober la victoire et de lui enlever ses combattants avant le combat.

Tout à coup on vit arriver du bout de la promenade un cavalier s’avançant au galop. D’une main il agitait un drapeau blanc, de l’autre il tenait une large lettre avec le sceau de l’État. Il s’arrêta devant l’hôtel d’Aguilar, et cria :
— Ouvrez, au nom du roi !
— À ce nom révéré, don Juan s’inclinant avec respect, fit signe d’ouvrir l’hôtel ou plutôt la forteresse qu’il avait juré de défendre, et le cavalier s’élança dans la place. C’était un brigadier du régiment de l’Infante, Fidalgo d’Estremos,
— On m’a assuré, dit-il, que monseigneur le gouverneur de Pampelune était dans cet hôtel.
— C’est moi, monsieur, dit le comte de Lémos en s’avançant.
— Une lettre du roi, monseigneur.
Il la lui remit. Le comte se hâta de la décacheter, et pendant ce temps don Juan interrogeait le brigadier.
— Où est le régiment dont tu fais partie ?
— Aux portes de la ville, avec le régiment des gardes wallonnes.
— À merveille.
— Vous accompagnez le roi ?
— Oui, monseigneur, et M. le comte de Lerma !
— Et vous n’êtes pas disposés, je l’espère, à reculer devant des bourgeois ?
Pour toute réponse, le brigadier porta la main à la poignée de son sabre.
— Bien ! s’écria d’Aguilar, avec des braves gens tels que vous, il n’y a ni ville ni remparts qui puissent tenir ! Eh bien ! dit-il au comte de Lémos, qui venait d’achever la lecture de la lettre, le comte de Lerma, votre beau-frère, a-t-il pris les dispositions nécessaires pour attaquer Pampelune, et pour y entrer de vive force ?
— Non, vraiment, répondit Lémos, avec quelque hésitation… cela devient inutile.
— Ah ! je comprends, dit d’Aguilar en riant, les rebelles se sont déjà soumis ; je vous le disais bien, avec un peu de fermeté… c’était immanquable ! cela ne pouvait durer !
— Oui… balbutia Lémos en rougissant, je crois qu’à présent tout est terminé.
— Ont-ils donné des otages ?
— Non pas…
— Au fait, ajouta d’Aguilar, on n’en a pas besoin, pourvu qu’ils demandent grâce… cela suffit. Ils ont donc imploré le pardon du roi ?
— Non, monsieur, dit Lémos, dans le plus grand embarras.
— Eh bien ! s’écria d’Aguilar avec impatience, qu’y a-t-il donc… et quelle nouvelle annonce-t-on à Votre Excellence ?
Pour toute réponse, le gouverneur de Pampelune tendit à d’Aguilar la lettre qu’il venait de recevoir, et dont voici le sens :
« Le roi avait appris avec peine les légers désordres dont son arrivée avait été l’occasion, et après en avoir délibéré en son conseil et pris l’avis de ses ministres ; vu les priviléges accordés aux fidèles habitants de la Navarre par tous les rois ses prédécesseurs, Sa Majesté déclarait que sa volonté et son bon plaisir étaient de n’avoir à son entrée solennelle d’autre escorte que les bourgeois de Pampelune ; de plus, Sa Majesté daignait leur octroyer, pendant son séjour dans leur ville, l’honneur de garder seuls sa personne et son palais. »
Cette ordonnance ne portait d’autre signature que celle-ci : « Pour le roi, notre seigneur et maitre, le comte de Lerma, premier ministre. »
Il était évident, vu la promptitude avec laquelle cette décision venait d’être prise, qu’elle l’avait été, à l’instant, par le favori. Il était douteux que le roi eût été consulté. Plusieurs mémoires du temps portent qu’il n’en eut connaissance que le lendemain.
Pâle et frémissant d’indignation, don Juan d’Aguilar lut deux fois cet écrit qui allait montrer aux yeux de tous à quel degré de faiblesse et d’avilissement était déjà tombée la royauté. Sans proférer une parole, il remit l’ordonnance au gouverneur, qui, empressé de la faire exécuter, se hâta de quitter le toit hospitalier où il avait trouvé refuge et protection.
Le vieux gentilhomme, resté seul avec son neveu, le regarda quelque temps en silence.
— Eh bien ! que t’avais-je dit ? Avais-je tort de trembler pour l’Espagne et pour mon roi !
Craignant de laisser voir toute son émotion, il se précipita dans l’appartement de Carmen, sa fille. L’enfant, tout effrayée, lui tendit les bras.
— Je t’attendais, lui dit-elle ; je ne te voyais pas revenir, et ne voulais pas m’endormir avant ton retour, mon père !
— Tu avais peur !
— Oui, de ne pas t’embrasser !
D’Aguilar pressa contre son cœur sa fille bien-aimée. Le père fit oublier un instant à l’homme d’État ses sombres prévisions, la révolte, les fueros et même le comte de Lerma, son ennemi ; puis, déposant un dernier baiser sur le front de Carmen qui s’endormait, il se rendit au palais du gouverneur pour y attendre l’arrivée du roi.
III.
les suites d’un triomphe.
La nouvelle de ces événements se répandit en un instant dans tous les quartiers de la ville. Les bourgeois de Pampelune, ceux mêmes qui étaient restés chez eux pendant l’action, se promenaient dans les rues avec un air de triomphe et de satisfaction !
Chacun était dans l’enchantement ; les lieux publics et les cafés regorgeaient de monde, et l’hôtel du Soleil-d’Or ne pouvait suffire à contenir les nombreuses pratiques qui arrivaient l’estomac à jeun ; c’était l’heure du dîner, et rien ne donne de l’appétit comme une victoire. Pérès Ginès de Hila, qui n’était plus le même homme, avait changé son large feutre noir, son ton menaçant et ses airs séditieux, contre un bonnet blanc, une mine affable et un sourire engageant. Le conspirateur avait fait place à l’hôtelier ; il était de l’opinion de tout le monde, ne repoussait personne, entassait vingt ou trente convives dans des salles de dix couverts, excitait le zèle de ses cuisiniers et de ses garçons : il avait même, en faveur de la circonstance, sursis généreusement à la punition de Juanita dont il avait besoin en ce moment.
Déjà il calculait l’impôt à prélever sur une telle masse de consommateurs ; il s’était même établi au comptoir pour surveiller avec l’œil du maître la recette présumée, et empêcher qu’aucune fraude ne se glissât dans la perception : tout à coup le brave corrégidor Josué Calzado de las Talbas parut dans le vestibule ; il était suivi d’une douzaine de bourgeois qui, portant le baudrier et la hallebarde, s’efforçaient de marcher dans un alignement quelconque, et d’obtenir cette précision si rare à rencontrer, même par hasard, dans toute espèce de garde civique.
— Honneur aux vainqueurs ! s’écria l’hôtelier.
— Honneur à vous ! répondit le corrégidor, à vous qui, le premier, avez réclamé en faveur de nos fueros ! Oui, seigneurs cavaliers, poursuivit-il en s’adressant aux convives, sans lui, nos libertés sommeillaient, personne n’y pensait ; le roi serait entré tranquillement dans sa ville de Pampelune, escorté de deux régiments de cavalerie castillane et aux acclamations générales, si ce digne hôtelier ne nous avait rappelé à tous qu’à nous seuls appartenait le droit d’escorter et de garder notre monarque.
Tous les convives se levèrent, et burent à la santé de Ginès Pérès de Hila, qui ôta son bonnet de coton et s’inclina sur son comptoir.
— Aussi, continua le corrégidor, nous lui devions une récompense, et ses concitoyens s’empressent de lui offrir le grade de sergent dans nos hallebardiers ; nous venons le chercher pour les commander.
— Moi, dit l’hôtelier en pâlissant.
— Vous-même, et il n’y a pas de temps à perdre !
— Mais c’est qu’en ce moment ma présence est nécessaire ici, dans ma maison.
— Elle l’est bien plus dans nos rangs.
— Mais les intérêts de mon commerce…
— Mais ceux de Pampelune !… Un patriote tel que vous !
— Certainement… Mais si tout autre pouvait me remplacer…
— Céder à un autre l’honneur d’exercer vos droits… ces droits que vous avez réclamés avec tant d’éloquence.
— Je le sais bien ! s’écria l’hôtelier en maudissant son éloquence et peut-être les fueros ! je voulais dire que je ne demanderais pas mieux, ou plutôt que je serais flatté de commander à mes concitoyens et de marcher à leur tête ; mais je n’étais point préparé à un tel honneur, et je vous demande quelques jours pour songer à mon équipement.
— Nous vous l’apportons ! le voici !
On présenta à l’hôtelier consterné un large baudrier galonné et une hallebarde ornée d’une frange en argent. En vain le nouveau sergent essaya-t-il de balbutier encore quelques excuses ; on l’eut bientôt, sans qu’il osât s’en défendre, arraché de son comptoir et affublé des insignes de son nouveau grade.
— Partons ! partons ! s’écrièrent les hallebardiers.
Et jamais Ginès Pérès n’eût désiré plus vivement rester en ses foyers ; car, en ce moment, les pratiques affluaient au comptoir pour payer, et le majordome du Soleil-d’Or, le seigneur Coëllo, adroit Asturien, dont la moralité n’avait jamais passé en proverbe, criait à son maître :
— Partez, partez, seigneur sergent, je me charge de tout !
C’était justement ce que craignait le malheureux hôtelier.
— Je reviens à l’instant !… je reviens ! s’écria-t-il.
— Non, répondit le corrégidor, votre consigne est de parcourir ce quartier, et maintenant que la tranquillité est établie, de vous opposer à tout ce qui pourrait la troubler, d’interdire toute espèce de cris et de manifestations généralement quelconques, n’importe dans quel sens, enfin de mettre sous bonne garde tout contrevenant.
— Très-bien ! dit l’hôtelier qui avait hâte d’en finir ; après cela, je reviendrai.
— Non vous irez avec votre compagnie vous placer en ligne à la Taconnera pour présenter la hallebarde au passage de Sa Majesté.
— Moi !… s’écria Ginès qui se modérait à peine.
— C’est à vous seul qu’appartient cet honneur… de là vous escorterez notre seigneur et maître le roi jusqu’en son palais… où vous avez le droit de monter la garde toute la nuit.
— Moi ! répéta l’hôtelier avec désespoir.
— C’est un de nos priviléges, et nul ne peut nous les ravir, vous l’avez dit ; partez maintenant, je ne vous retiens plus.
— Partons ! s’écrièrent les soldats, fiers d’avoir à leur tête un pareil chef ; et le désolé sergent, maudissant des dignités qui lui coûtaient si cher, s’éloigna pour veiller à la sûreté des maisons de Pampelune, jetant un regard de regret et d’effroi sur la sienne qu’il laissait livrée au pillage.
Cependant, fidèle aux instructions qu’il avait reçues, et tenant, en honnête garçon, à gagner la récompense qui lui avait été promise, Piquillo s’était élancé, comme nous l’avons vu plus haut dans les différentes rues qui s’offraient à ses regards et qui alors étaient presque désertes. Vivent les fueros ! criait-il en conscience et de toute la force de ses poumons ; vivent les fueros !… Personne ne lui disait le contraire ! les uns n’osant se prononcer encore, les autres ayant une opinion opposée, et le plus grand nombre n’en ayant aucune. Seulement, deux ou trois petits garçons qui étaient pour le moment sans occupation et qui erraient dans la rue en amateurs, population facile à entraîner et qui suit volontiers le premier tambour ou le premier spectacle qui passe, deux ou trois petits garçons s’étaient joints à lui et étaient venus en aide à son gosier déjà fatigué. Leur cortége s’était bientôt grossi de tous les enfants qui se trouvaient sur leur route, et le jeune général continuait sa marche, sans que rien ne l’arrêtât, criant toujours : Vivent les fueros ! lorsqu’au détour d’une rue, déboucha un autre corps d’armée à peu près de la même force et du même âge, mais non pas de la même opinion ; ceux-ci criaient résolument et à tue-tête : À bas les fueros ! Entre des partis si différents, le combat paraissait inévitable ; mais à la grande surprise des combattants, on vit tout à coup les deux généraux s’arrêter, se tendre la main et s’embrasser.
— C’est toi, Piquillo !
— Toi, Pedralvi !
— Que fais-tu là ?
— Je crie.
— Et moi aussi !… des gens qu’on disait appartenir au comte de Lémos distribuaient de l’argent pour crier : À bas les fueros ! J’ai touché pour ma part trois réaux, et je crie pour cette somme-là…
— Moi, dit Piquillo, d’un air modeste, on m’a seulement promis un réal !
— Il y a bien plus d’avantage avec l’autre ! s’écrièrent les soldats de Piquillo en passant sous les drapeaux opposés.
Et les deux armées combinées n’en firent plus qu’une, qui continua sa marche séditieuse aux cris mille fois répétés de : À bas les fueros !
Rien jusque-là ne leur avait fait concurrence dans leur jour promenade, et ils pouvaient se croire le monopole exclusif des rues de Pampelune ; mais tout à coup s’offrirent à eux de véritables soldats, avec un véritable sergent et de véritables hallebardes !
C’était, on l’a déjà deviné, le corps commandé par Ginès Pérès de Hila, qui s’avançait intrépidement sur eux et sans se laisser intimider par le nombre.
Les coalisés s’arrêtèrent, et les deux chefs tinrent conseil.
— Bas les armes ! cria le sergent en s’avançant toujours : bas les armes !
Vu que les alliés n’en avaient pas, cette proposition n’avait, pour eux, rien de déshonorant ; mais ce qui commençait à les inquiéter et à jeter de l’indécision dans leurs mouvements, c’est que le sergent avait ordonné à ses troupes de croiser la hallebarde. Pour dérouter cette manœuvre, les deux généraux, bien sûrs de vaincre leur ennemi à la course, s’écrièrent :
— Sauve qui peut !
Le commandement fut à l’instant exécuté, et les coalisés faisant volte-face, s’élancèrent dans une rue qui était derrière eux ; par malheur cette prétendue rue n’en était pas une et n’en avait que l’apparence : c’était ce que de nos jours on appelle une impasse et ce que nos pères nommaient franchement un cul de sac ! dans ce défilé étroit, où presque toute l’armée alliée était venue s’engouffrer, la résistance était inutile : il n’y avait plus rien à espérer… pas même une déroute… car la fuite devenait impossible, et la victoire de Pérès était complète.
Il en usa avec plus de modération qu’on n’aurait pu le croire dans l’enivrement du triomphe ; peut-être aussi l’embarras de garder tant de captifs contribua-t-il, autant que la clémence, au parti généreux qu’il adopta ; il se contenta d’emmener prisonniers Piquillo et Pedralvi, et renvoya dans leurs foyers respectifs ceux qui en avaient. Quant à ceux qui n’en avaient pas, on les laissa libres sur parole et sur le pavé du roi.
L’intention du sergent était de conduire lui-même en lieu sûr les deux jeunes chefs de l’insurrection ; mais le jour baissait, et déjà l’on entendait retentir par toute la ville le son des clairons et des tambours municipaux. Le roi se disposait à faire son entrée aux flambeaux, et il n’y avait pas de temps à perdre pour gagner la Taconnera et se mettre en ligne avec sa compagnie ! Pérès chargea donc deux de ses hommes d’armes de conduire les deux prisonniers chez lui à l’hôtellerie du Soleil-d’Or, de les enfermer dans une cave vide qu’il désigna spécialement à cet effet, et de revenir au plus vite le rejoindre à l’endroit où la compagnie devait se tenir pour le passage de Sa Majesté.
Chargés des instructions de leur chef, qu’ils promirent d’exécuter avec célérité et intelligence, les deux hommes d’armes improvisés partirent, emmenant leurs prisonniers, dont ils répondaient corps pour corps.
Quant à nos deux héros, vaincus mais non découragés, ils marchaient en silence, échangeant seulement des regards qui voulaient dire : que faire ? qu’allons-nous devenir ? comment nous sauver ? Et Piquillo, il faut lui rendre justice, ne pensait point à lui dans ce moment ; il ne rêvait qu’aux moyens de délivrer son compagnon ! Mais quoiqu’il ne manquât ni de sagacité, ni d’esprit, ni d’audace, l’entreprise était presque impossible ; leurs gardiens les avaient pris, non pas au collet, ce qui, vu l’état délabré de leurs vêtements, aurait offert peu de prise et surtout peu de sûreté, mais, grands, forts el vigoureux, ils tenaient et serraient par le bras les deux jeunes enfants, dont l’un était faible et maladif, et dont les petites jambes avaient peine à suivre les pas rapides de son guide. Cependant, et dans un endroit de la rue où le soleil avait changé la boue en poussière, Piquillo feignit de trébucher et tomba une main en terre ; nous avons dit que de l’autre il était retenu par son gardien, qui le releva brutalement et avec une rude secousse ; mais en touchant le sol, l’enfant avait ramassé une poignée de poussière, que sa main fermée serrait précieusement, et, au détour d’une rue, il la lança dans les yeux du hallebardier qui tenait Pedralvi, en lui criant : Sauve-toi, frère ! Celui-ci ne se le fit pas dire deux fois et s’élança rapidement, en jetant sur son compagnon un regard de reconnaissance et de dévouement qui semblait lui dire : À bientôt !
Cette généreuse action valut au pauvre Piquillo une grêle de coups, non-seulement de son gardien, mais de celui de Pedralvi, qui, après s’être frotté les paupières, n’apercevant plus qu’un seul prisonnier, fit retomber sur lui toute la colère qu’il destinait à l’autre. Surveillé désormais par deux gardes au lieu d’un, aucune chance de salut ne pouvait plus s’offrir à Piquillo, et il arriva au Soleil-d’Or, où, conformément aux ordres du sergent, il fut écroué dans une cave dont les portes massives furent fermées sur lui à double serrure.
Les hallebardiers coururent rejoindre leur chef et lui faire part du succès de cette dernière expédition, en mettant, comme c’est l’usage dans toutes les relations de batailles perdues, l’échec qu’ils avaient essuyé sur le compte d’un hasard impossible à prévoir.
En ce moment, le cortége royal venait de franchir la porte de Charles-Quint, et entrait dans la ville de Pampelune au son des cloches, aux acclamations de la multitude, à la lueur des flambeaux qui entouraient les voitures et des feux qui étincelaient à toutes les croisées.
Des trompettes ouvraient la marche ; puis venait une partie de la cour. Les dames en carrosse d’apparat, et les premiers seigneurs du royaume couverts de superbes habits, et suivis de tous les gentilshommes de leurs maisons. Tous ces grands d’Espagne qui, autrefois, ne vivaient que dans les camps et sous les armes, infidèles à leur origine guerrière, ne menaient plus maintenant qu’une vie molle et fastueuse. Le ministre avait rappelé auprès du roi toutes les grandes familles que Philippe II avait reléguées dans leurs terres et dans leurs châteaux. Elles n’étaient rentrées à la cour que pour rivaliser entre elles de luxe et d’éclat ; afin de plaire au ministre et au roi, elles dépensaient en magnificences les revenus de leurs maisons ; conservant leur fierté, perdant leur indépendance, mais donnant à la cour de Philippe II un éclat factice jusqu’alors inconnu, mélange de faste et de cérémonial qui fit longtemps l’envie de toutes les cours de l’Europe et que ne surpassèrent même pas, depuis, les splendeurs de Louis XIV.
La foule saluait à leur passage les ducs de l’Infantado et de Médina de Rioseco, d’Escaluona, d’Osuna, puis les Médina Sidonia el les Gusman, tous ces grands noms, autrefois soutiens de la monarchie, aujourd’hui ornements de la cour.
Paraissaient ensuite les rois d’armes ; puis venaient ou plutôt auraient dû venir les gardes espagnoles et wallonnes, qu’on avait remplacées ce jour-là par des ouvriers de Pampelune armés de piques ; puis le corps des bourgeois et notables commerçants, déguisés en hallebardiers, et salués par les cris frénétiques de la foule, composée de leurs parents, amis et concitoyens, qui les reconnaissaient, se les montraient du doigt et échangeaient avec eux des signes de tête et de main peu en harmonie avec la rigueur de la discipline militaire.
Derrière ce corps improvisé à la hâte s’avançaient des hérauts d’armes escortant le grand garde des sceaux.
Après celui-ci, marchaient deux mules qui portaient, sous un baldaquin aux armes de Léon et de Castille, une sorte d’estrade couverte d’une étoffe verte sur laquelle se trouvait une cassette de velours cramoisi qui renfermait le sceau du roi.
Quatre massiers portant leurs masses d’armes les suivaient ; puis enfin paraissaient le carrosse du roi et celui du ministre, entourés de tous les dignitaires du royaume qui lui servaient de cortége ; des alguazils et des familiers du saint-office fermaient la marche. C’est dans cet ordre que Philippe III arriva au palais du vice-roi, où le gouverneur et les magistrats de Pampelune l’attendaient. Il répondit aux acclamations de la foule par un salut de la main affable et gracieux, mais d’un air distrait qui fit supposer qu’il était en proie à quelque préoccupation, et il n’en avait aucune. Vrais ou faux, les témoignages de joie ou de dévouement dont il était l’objet ne lui causaient ni peine ni plaisir. Tout jusqu’alors lui avait été indifférent, rien n’avait excité ses désirs, et la suite seule pouvait prouver si le fond de son caractère était une haute philosophie ou une extrême indolence.
Philippe III était de petite taille, bien fait ; son visage était rond, agréable, blanc et vermeil ; il avait les lèvres de sa famille. On lui avait appris à montrer une certaine dignité dans sa démarche ; du reste son extérieur était agréable et sans prétention. On ne sait s’il connut jamais les causes de la mort de son frère don Carlos ; mais ce nom seul répandait sur sa physionomie une teinte de mélancolie et de terreur, et le respect qu’il portait au terrible Philippe II, son père, ressemblait beaucoup à de l’effroi ; aussi avait-il passé sa jeunesse dans une obéissance absolue et dans une complète oisiveté. Il était alors dans sa vingt-deuxième année, et le développement de ses forces physiques s’était fait avec tant de lenteur… que tout chez lui semblait en retard ; il ne connaissait encore ni la vivacité de la jeunesse, ni ses espérances, ni ses passions.
En descendant de la voiture, il s’appuya sur le bras de don Juan d’Aguilar, qui attendait au palais l’arrivée de son souverain. Celui-ci voyant l’air triste du vieux soldat, lui demanda avec bonté s’il ne souffrait pas, ne pouvant supposer qu’aucune autre peine put l’affecter en ce moment. Don Juan entendant le roi témoigner sa satisfaction au comte de Lémos, voulut hasarder quelques observations respectueuses sur l’état actuel des choses et sur la situation de Pampelune ; Philippe l’écoutait avec un embarras et une gêne visibles où respirait non le mécontentement mais la crainte d’avoir à soutenir un entretien sérieux ; aussi regardait-il autour de lui avec inquiétude, comme quelqu’un qui attend ou cherche du secours, et lorsqu’enfin il aperçut le comte de Lerma qui marchait derrière lui, il respira plus à l’aise, lui fit signe d’avancer, et semblait l’engager à prendre part à la conversation. Mais à la vue du ministre, don Juan d’Aguilar avait gardé le silence ; le roi l’en remercia par un sourire, et se hâta de gagner ses appartements, fatigué qu’il était du voyage et de la chaleur de la journée. En traversant la longue galerie qui conduisait à sa chambre à coucher, il découvrit dans la foule qui se tenait sur son passage un pauvre moine franciscain qui se haussait sur la pointe des pieds afin d’apercevoir le roi. Philippe quitta le comte de Lerma, le gouverneur et les courtisans qui l’entouraient, s’approcha du moine, s’inclina avec respect, et lui demanda sa bénédiction, que celui-ci lui donna en rougissant d’orgueil et de plaisir. Un murmure d’approbation accueillit cette nouvelle preuve de la piété du jeune monarque, et, après une journée si bien commencée et si bien finie, le roi des Espagnes et des Indes alla se livrer au sommeil.
Quant au comte de Lerma, qui, en présence du roi, avait accueilli don Juan d’Aguilar avec la plus grande distinction et le sourire sur les lèvres, il reprit tout à coup son air impassible et une figure de marbre qui sembla se refléter sur celle du vieux gentilhomme : celui-ci salua d’un air glacé, et tous deux se séparèrent.
Deux heures après, tout le monde dormait dans le palais. Le ministre seul veillait pour savoir ce qui s’était passé dans la journée, et, pour en avoir une idée bien exacte, il avait voulu ne s’en rapporter qu’à lui-même et lisait avec la plus grande attention les rapports qu’on venait de lui adresser, rapports détaillés et des plus véridiques, car ils avaient tous été rédigés par des témoins oculaires.
On y parlait d’abord du rôle important qu’avait joué le corrégidor Josué Calzado de las Talbas, homme dangereux par son caractère, par son crédit, par la haute influence qu’il exerçait sur le peuple, dont il était l’idole, et que dans la journée même il avait soulevé et apaisé à son gré.
Le ministre appuya sa tête dans ses mains, et après quelques instants de réflexion il murmura ces mots :
— C’est vrai, c’était un homme à ménager, que j’ai peut-être eu tort de faire attendre et de mécontenter ; il faut le gagner à tout prix et se l’attacher à jamais…
Et il écrivit sur ses tablettes : « Il y a une place de corrégidor-mayor vacante à Tolède… y nommer don Josué Calzado, en attendant mieux. »
Il poursuivit la lecture des rapports qui différaient, il est vrai, sur les causes de l’émeute ; mais presque tous s’accordaient à dire que le premier moteur avait été un certain barbier, Aben-Abou, dit Gongarello, Maure d’origine, qui avait commenté à haute voix et avec des paroles injurieuses l’ordonnance de police affichée dans les rues et qui concernait l’entrée de Sa Majesté à Pampelune.
— Ah ! cela ne m’étonne pas, s’écria le ministre avec un air de satisfaction orgueilleuse, je l’ai toujours dit ! C’est cette population mauresque qui fomente dans le royaume tous les troubles et toutes les séditions. Ce sont des ennemis qui habitent et possèdent nos plus belles provinces, et tant qu’ils n’en seront pas expulsés, il n’y aura pour l’Espagne ni repos, ni prospérité. Ce qu’aucun homme d’État n’a encore osé tenter, je le ferai, moi, don Sandoval y Royas… comte de Lerma.
Il s’arrêta, sourit orgueilleusement, et regardant autour de lui pour s’assurer qu’il était bien seul… il ajouta lentement et à voix basse : moi ! roi d’Espagne !
Puis, reprenant la suite des idées que ce mouvement d’orgueil et ce retour sur lui-même avait un instant interrompue,
— Oui, se dit-il, c’est une entreprise qui demande de l’habileté… de l’audace… du temps ! du temps surtout ! et j’en ai… oui, j’en ai, continua-t-il avec confiance, le roi est jeune, et nous régnerons longtemps !… J’y penserai, répéta-t-il plusieurs fois, j’y penserai ! et en attendant…
Il s’arrêta et écrivit sur ses tablettes : « Faire payer aux Maures de la Navarre les frais de la révolte… en les frappant d’un nouvel impôt… que l’on pourra étendre plus tard aux Maures de Valence et de Grenade… faire surveiller le barbier Aben-Abou, dit Gongarello, par l’inquisition, et, à la première occasion, le bannir de Pampelune et de la Navarre, peut-être mieux… si c’est possible, car il a des complices qui s’entendent et correspondent avec lui… la rapidité même de cette émeute le prouve évidemment. »
Puis, se levant et se promenant dans son cabinet, avec un air de contentement intérieur :
— Quel avantage pour un ministre, s’écria-t-il, de tout étudier, de tout compulser par lui-même… C’est ainsi, seulement, qu’on est sûr de ne pas être trompé… et que l’on peut, comme moi, tenir d’une main ferme les rênes du royaume.
Puis, jetant encore un coup d’œil sur les différents rapports, il vit une masse de plaintes adressées à tous les corrégidors de Pampelune par des bourgeois de la ville, curieux inoffensifs, se trouvant dans l’émeute pour leur plaisir, et réclamant leurs bourses, leurs chapelets, leurs chaines en or, ou leurs manteaux, qui avaient disparu à la faveur de la sédition : détails de police qui ne me regardent point, dit le ministre en souriant ; il poursuivit cependant et lut ce qui suit :
« On avait remarqué dans la foule plusieurs gens de mauvaise mine, agissant sur plusieurs points à la fois et ayant l’air de correspondre et de s’entendre avec un certain capitaine nommé Juan-Baptista Balseiro, qui leur donnait des ordres… gaillard d’autant plus suspect qu’au moment le plus chaud de la révolte, une entreprise audacieuse avait été tentée contre l’hôtel de Victoriano Caramba, trésorier de la couronne pour la ville de Pampelune. On a vu un homme dont le signalement ressemble beaucoup à celui du capitaine Juan-Baptista Balseiro sortir par le jardin de l’hôtel avec un de ses compagnons. Tous les deux portaient la caisse de Victoriano Caramba, qui heureusement était presque vide, grâce aux cent mille ducats que, l’avant-veille, Son Excellence le comte de Lerma avait fait tirer sur lui. »
— C’est vrai, se dit le comte, pour des dépenses à mon château de Lerma ; sans cela c’eût été pris ! j’ai sauvé cela à l’État.
Et, tout en s’applaudissant de ses talents politiques et financiers, le premier ministre de la monarchie fit comme le roi des Espagnes et des Indes, et se livra au sommeil.
Pendant ce temps, d’autres veillaient à sa porte et à celle du roi ; c’étaient les hallebardiers de Pampelune, militaires par hasard et bourgeois de leur état, qui n’osaient dire à quel point ils trouvaient disgracieux l’honneur de se promener dans le palais du roi, l’arme sur l’épaule, durant toute une nuit, au lieu de la passer tranquillement chez eux et dans leur lit.
Maître Truxillo surtout, de faction dans la grande galerie, semblait supporter avec plus d’impatience que tout autre la faveur dont il jouissait.
— De quoi vous plaignez-vous ? lui dit avec un accent goguenard une voix qui lui était bien connue, vous êtes dans l’exercice de vos droits.
— Quoi ! c’est vous ! s’écria le tailleur, vous, maître Gongarello, au palais !
— Moi-même, répondit le barbier avec résignation. Les honneurs sont venus m’atteindre malgré moi, et je les subis sans me plaindre.
— Vous, du moins, vous n’avez pas comme moi une femme que des dangers peuvent menacer en votre absence ; car je pense toujours à ma maison abandonnée !…
— N’est-ce que cela, répondit le malin barbier, rassurez-vous… vous avez des amis qui ne vous feront point l’injure d’aller loger ailleurs que chez vous !…
— Que voulez-vous dire ?
— Que c’est le brigadier du régiment de l’Infante, votre ancien hôte, Fidalgo d’Estremos, qui a apporté au gouverneur les ordres du roi…
Maitre Truxillo poussa un cri d’effroi, et voulut s’élancer hors du palais ; mais les portes en étaient fermées, et tous ses compagnons lui crièrent qu’on n’abandonnait point son poste quand il s’agissait de défendre les fueros et l’honneur du pays. Hélas ! en fait d’honneur, Truxillo ne pensait qu’au sien, et il poussa un profond soupir.
IV.
le capitaine juan-baptista balseiro.
Maitre Truxillo ne fut pas le seul qui passa une mauvaise nuit.
Piquillo était depuis plusieurs heures renfermé dans la chambre à coucher souterraine qu’on lui avait donnée à l’hôtellerie du Soleil-d’Or. L’hôtelier, retenu au palais par ses fonctions civiques, n’avait pu, à son grand regret, rentrer chez lui, et Coëllo son majordome, maître en chef en son absence, décida qu’il était convenable de boire à la santé du patron et à sa nouvelle dignité. Il avait donc convié tous les gens de l’hôtel à manger les reliefs de la journée, ce qui paraissait assez juste. Après avoir donné à dîner à tout le monde, il est bien permis de penser à soi. Mais nul ne songeait au pauvre Piquillo, qui, bien des fois déjà, avait fait le tour de la cave où il était retenu comme prisonnier d’État. Aucune issue, qu’une porte cadenassée et verrouillée ; point d’autre jour que celui qui venait d’un soupirail étroit, fermé par un barreau de fer ; enfin aucun meuble, si ce n’étaient deux vieux tonneaux, jadis pleins d’un assez bon vin de benicarlo, qui avait servi autrefois à l’hôtelier à faire six ou sept pièces de xérès ou d’alicante.
Après avoir cherché à ébranler la porte qui résistait à ses efforts, crié vainement et appelé à son secours, Piquillo s’était assis sur une des futailles, et là, s’il faut le dire, tout son courage l’avait abandonné ; notre héros s’était mis à pleurer ! Mais quel héros est sans faiblesse, et puis le nôtre n’avait pas soupé, et son déjeuner du matin était depuis longtemps oublié, grâce à l’exercice et aux manœuvres militaires de la journée. Il pleurait donc, et de plus, quoiqu’il ne fût pas peureux de son naturel, l’obscurité où il se trouvait lui inspirait une terreur dont il ne pouvait se défendre. Tout à coup il entendit de grands cris, et crut sa dernière heure arrivée ; c’étaient le majordome et les gens de la maison échauffés par la bonne chère et par le vin du patron.
Assis autour d’une grande table dans la plus belle salle de l’hôtel, ils se faisaient servir par Juanita, avec qui nous avons déjà fait connaissance, jeune fille d’une douzaine d’années, vive, accorte, et pas fière, commandée et grondée par tout le monde, et dans ce moment encore servante des serviteurs.
— Va nous chercher à la cuisine, lui cria le majordome d’un ton de maître, ces deux perdrix intactes qui sont revenues de la salle numéro 9 ; les convives devaient être des amoureux, car ils ne mangeaient pas.
Le moindre amphitryon a ses flatteurs, et cette saillie du majordome excita un long murmure d’approbation… C’est ce bruit qui avait effrayé Piquillo ; il tressaillit, et prêtant une oreille attentive, il écoutait encore. Soudain un rayon de la lune vint par l’étroite ouverture qui donnait sur la cour, éclairer son cachot, lumière soudaine qui fut un instant éclipsée par un corps étranger, lequel s’approcha doucement du soupirail, y resta un instant, puis s’enfuit rapidement, et une perdrix tomba, toute rôtie, aux pieds de Piquillo.
— Je vous jure, monsieur le majordome, disait un instant après, dans la salle à manger, une douce voix de jeune fille, je vous jure qu’il n’y en avait qu’une.
— C’est bien étonnant, dit Coëllo, j’en avais mis deux de côté… à moins que ces messieurs… et son œil défiant faisait le tour de la table ; mais parmi les garçons et marmitons du Soleil-d’Or aucun ne pouvait raisonnablement être soupçonné d’un trait d’indélicatesse et d’égoïsme pareil.
Piquillo eut donc à souper comme il avait eu à déjeuner, par les soins de Juanita et aux frais de l’ennemi, chez lequel il se trouvait ainsi logé et nourri. Il l’eût volontiers dispensé du logement, et son esprit inventif se mit à en chercher les moyens. Le soupirail était bien étroit et un barreau de fer le rétrécissait encore de moitié ; mais Piquillo était si maigre et si chétif, qu’il lui semblait pouvoir, sans beaucoup de peine, quoiqu’il eût soupé, passer par cette étroite ouverture ; le difficile était d’y atteindre, mais un bon repas et l’amour de la liberté doublent les forces, et le prisonnier parvint avec des efforts inouïs à placer les deux feuillettes vides l’une sur l’autre. Il monta alors à l’escalade, et, non sans se meurtrir rudement, non sans se déchirer la figure, il vint à bout de passer entre le barreau et le mur sa tête, qui bientôt entraîna le reste du corps. Le prisonnier se trouva ainsi dans la cour de l’hôtel.
Piquillo, mendiant et vagabond, n’avait aucune idée de religion et de morale ; il ne connaissait Dieu que par les jurons qu’il entendait chaque jour et où son nom se trouvait mêlé ; cependant, malgré lui et sans savoir pourquoi, un instinct ou un besoin de reconnaissance le fit tomber à genoux. Quoique ses lèvres ne proférassent aucune parole, quoique son cœur n’adressât au ciel aucune action de grâce, c’était là une prière, une prière ardente et pure, qui s’éleva sans doute jusqu’au trône de l’Éternel.
Le prisonnier était sorti de son cachot, mais non pas de l’hôtel, et la cour où il se trouvait était entourée de murailles si hautes qu’il ne pouvait espérer en atteindre le chaperon, encore moins redescendre de l’autre côté dans la rue.
Piquillo, déconcerté et découragé, ne trouvait rien, n’inventait rien. Il était de nouveau tombé dans l’abattement, et calculait avec désespoir qu’il n’avait fait que changer de prison, et que personne désormais ne pouvait lui venir en aide. Il se trompait… son cœur lui avait fait deviner Dieu ; sa générosité lui avait donné un ami, et lui, qui le matin n’avait rien, venait d’acquérir en un jour deux trésors, deux consolations : la religion et l’amitié.
Il vit tout à coup apparaître au haut du mur une ombre, puis, un rayon de la lune sortant des nuages éclaira une tête brune qui regardait dans la cour avec attention et prudence… Ô bonheur ! c’était Pedralvi ! Piquillo voulut crier ; un geste de son ami lui fit sigue de garder le silence, et un instant après le bohémien était à califourchon sur le mur, s’efforçant de tirer à lui une petite échelle longue et légère qui lui avait servi à gravir jusque-là. L’échelle enlevée, non sans peine, fut bientôt mise en travers du mur, puis descendue du côté de la cour, et Piquillo, après l’avoir assujettie, monta à son tour jusqu’au faite du mur où Pedralvi l’attendait. Voici donc les deux amis l’un près de l’autre, face à face, et tous deux à cheval sur le chaperon, s’embrassant, se félicitant et s’interrogeant.
— C’est toi, Pedralvi, toi qui viens à mon secours !
— Eh bien ! tu m’avais sauvé, j’en fais autant.
— Et si je n’avais pas été par bonheur dans cette cour ?
— Je t’aurais cherché ailleurs.
— Mais j’étais dans la cave.
— J’y serais descendu… Je te savais prisonnier dans l’hôtel, cela suffisait… et, n’importe comment, je t’aurais délivré.
— Et si on t’avait pris ou battu ?
— Cela me regardait ! Depuis le commencement de la nuit je suis là dans la rue.

— À quoi faire ?
— À rôder et à attendre…
— Quoi ?
— Une occasion, et il en est arrivé une… cette échelle.
— Où l’as-tu trouvée ?
— Ici en face, chez Truxillo le tailleur.
— Tu l’as été prendre ?
— Non… elle est descendue toute seule par la fenêtre d’un pavillon, et un instant après j’ai vu descendre, enveloppé d’un manteau…
— Un voleur ?
— C’est possible… un jeune voleur… il était jeune ; et une voix douce lui disait : Prenez garde… alors j’ai crié tout haut : À la Sainte-Hermandad !… La fenêtre s’est vivement refermée, le cavalier a sauté à terre et s’est enfui… Moi, j’ai saisi l’échelle, et me voilà. Maintenant descendons, car quoique l’on soit bien ici, nous causerons encore mieux en bas et de l’autre côté.
Et les deux amis, réunissant leurs efforts, enlevèrent facilement l’échelle, qui était restée plantée dans la cour du Soleil-d’Or. Ils la laissèrent glisser dans la rue, et Pedralvi voulant absolument faire les honneurs de son escalier à Piquillo, celui-ci descendit le premier.
En ce moment la lune disparaissait derrière un nuage épais. L’hôtel, le mur et la rue étaient rentrés dans une profonde obscurité, et Pedralvi n’apercevant plus son ami, lui disait à voix basse :
— Descends avec précaution, car il y a une vingtaine de pieds au moins… Es-tu en bas ? dis-le-moi.
— Oui, m’y voici !
Mais au moment où Pedralvi s’apprêtait à le suivre, une main vigoureuse renversa l’échelle, saisit fortement Piquillo, et on entendit une voix de basse-taille s’écrier :
— Aller sur nos brisées et nous faire concurrence… D’où venez-vous ainsi, petit drôle ?
Cette voix était celle du capitaine Juan-Baptista Balseiro, qui, dans la séance du matin sur la place publique, s’était prononcé avec tant d’énergie en faveur des cortès.

— Seigneur cavalier, s’écria Piquillo, seigneur cavalier, vous vous trompez ! je ne suis pas un voleur !
— Et quand ce serait !
— Je vous jure que non ; je ne fais pas un si vilain métier.
Et Piquillo sentit la main du capitaine serrer son bras comme dans un étau ; la douleur lui arracha un cri.
— Laissez-moi… laissez-moi, si vous êtes de la Sainte-Hermandad ou des hallebardiers de la ville.
— Ni l’un ni l’autre… Mais puisque tu sors de cette maison, tu pourras nous donner des renseignements dont nous avons besoin.
— Je n’en ai pas.
— N’importe, tu nous suivras.
— Je ne le peux pas… laissez-moi ; j’ai un ami qui m’attend.
— Où ça ?
— Au haut de ce mur.
Et Pedralvi s’écria :
— Oui, seigneur cavalier ; ne lui faites pas de mal, et relevez l’échelle pour que je puisse descendre, sinon je crie au secours.
Un des hommes qui accompagnaient le capitaine porta la main à un pistolet qu’il avait à sa ceinture ; Juan-Baptista l’arrêta en lui disant :
— Y penses-tu ? Un pareil bruit à cette heure… et pourquoi ?… De ces deux oiseaux de nuit, un seul me suffit et je l’emmène.
— À moi, au secours ! cria Piquillo.
— Au secours ! répéta Pedralvi qui, de sa position élevée, se faisait encore mieux entendre.
— Au secours répétèrent le majordome, les garçons et marmitons du Soleil-d’Or, qui passaient la nuit à table, et qui se mirent aux fenêtres de l’hôtel, ou se précipitèrent dans la cour.
Mais, à ce bruit et à ce déploiement de forces inattendues, le capitaine et ses gens s’étaient éloignés, entrainant leur capture.
Juan-Baptista Balseiro, qui avait porté en sa vie beaucoup d’autres noms, avait une origine aussi peu connue que son existence ; les uns le disaient Napolitain, d’autres Maure de naissance : il tenait peu à sa famille, qui le lui rendait bien ; il ne s’était jamais inquiété de son pays et n’en préférait aucun, les ayant à peu près parcourus tous, et pour des raisons à lui connues, n’en ayant jamais rencontré un où il lui fût permis de résider ! Depuis quelque temps il exploitait l’Espagne, et ce n’était pas sans motifs que lui, qui avait beaucoup vu et beaucoup étudié, trouvait que de tous les gouvernements de l’Europe, c’était celui qui offrait le plus d’avantages et de sécurité aux gens de sa profession. La police y était peu gênante, le désordre était partout, la surveillance nulle art, et Juan-Baptista, après une vie aussi agitée et aussi errante, s’était enfin décidé à se fixer dans ce beau pays, qui, d’ailleurs, s’il faut le dire, était presque le sien.
Le capitaine était en réalité d’origine portugaise ; il avait déjà quelques années, lorsque sous le règne du feu roi Philippe II, le Portugal avait été réuni à l’Espagne, par la grâce de Dieu, les constitutions du royaume, et une armée de trente mille hommes, commandée par le duc d’Albe.
Un des principaux seigneurs portugais, dom Henrique, de la famille de Villaflor, vendu secrètement à Philippe II, avait puissamment contribué à cette conquête, et, en récompense de ses services antinationaux, le roi l’avait créé comte da Santarem. Or, quelques années auparavant, et vers l’époque de la Saint-Jean, le comte de Santarem, parcourant dans une partie de chasse la Sierra Dorso, l’une des plus belles montagnes de l’Alentéjo, fut arrêté par l’orage et la pluie, et forcé de se réfugier dans une méchante hôtellerie, la seule qui s’offrit à lui. Géronima, femme d’un contrebandier, alors absent, lui en fit les honneurs. Géronima était jeune, coquette, pas trop belle et même un peu rousse ; mais en temps de pluie on n’était pas si difficile : le gentilhomme portugais fut aimable et galant par désœuvrement ; et moins d’une année après, il était dans son château sur les bords du Tage, lorsqu’on lui annonça qu’une montagnarde venant de l’Alentéjo demandait à lui parler, et il vit paraître la femme du contrebandier, Géronima, portant dans ses bras un petit garçon gros et fort qui criait et mordait sa nourrice : c’était le capitaine dont nous traçons la biographie, nommé par sa mère Juan-Baptista, en mémoire de saint Jean, heureuse époque de sa naissance.
Il parait que cette époque rappelait des souvenirs moins agréables au comte de Santarem, qui, lui-même, était marié ; car il tourna brusquement le dos à la Géronima, et lui fit donner par son intendant vingt-cinq ducats, avec défense formelle de jamais se présenter devant lui. Ce furent les seuls rapports qui existèrent jamais entre le capitaine et le noble auteur de ses jours.
Du reste, Juan-Baptista était grand, bien fait et ressemblait à son père, le gentilhomme, d’une manière effrayante pour l’honneur de son autre père le contrebandier Géronimo Balseiro ; mais celui-ci, moins jaloux de sa femme que de sa gourde d’eau-de-vie et de sa carabine, ne s’inquiéta guère de la figure de l’enfant, l’emmena avec lui dans la montagne aussitôt qu’il put marcher, et lui apprit, dès son plus jeune âge, à faire le coup de fusil, exercice dont Juan-Baptista s’acquittait à merveille. Bientôt se développèrent en lui avec une facilité prodigieuse une foule de mauvais penchants, provenant sans doute de ses deux natures réunies et combinées ; le sang qui coulait dans ses veines et l’éducation qu’il avait reçue. D’abord il battit sa mère, la pauvre Géronima, qui, depuis longtemps, était bien revenue de ses idées de grandeur et d’ambition, et qui, tous les jours, en voyant son fils, regrettait de s’être alliée à la noblesse ! Ensuite il vola son père, et s’enfuit de la maison paternelle et de l’Alentéjo, où il ne reparut jamais. C’est ainsi qu’il fit ses adieux à sa famille et à son pays.
Il serait difficile de le suivre dans la vie qu’il mena depuis, vie insouciante et joyeuse ; car le capitaine aimait le vin, la bonne chère, les dames, toutes les jouissances de la vie, et surtout les pistoles, doublons et lingots d’or et d’argent par qui on se les procure ; vie aventureuse, composée de bons et de mauvais jours, incidentée d’alguazils, de juges, de tribunaux, ornée d’évolutions et de combats sur terre et sur mer ; égayée de ruses et de tours d’adresse ; parsemée d’expéditions ingénieuses ou hardies dans les villes, dans les plaines, dans les montagnes. Une telle existence eût été, en un mot, le livre le plus varié, le plus philosophique et le plus instructif de l’époque, si le capitaine eût songé, comme tant d’autres, à nous laisser ses mémoires ; mais occupé chaque jour à en amasser les matériaux, il n’avait pas le temps de les écrire.
D’abord, et sous Philippe II, lors de la première révolte des Maures, au moment où le roi, l’inquisition et tout le clergé du royaume avaient posé en principe qu’il fallait les exterminer ou les convertir, le capitaine, jeune encore, avait spéculé sur la conversion ; et par une ruse adroite, que lui inspira sans doute saint Jean-Baptiste, son patron, il allait de province en province, se donnant pour un Arabe descendant des Maures de Grenade, pauvre infidèle, élevé dans l’idolâtrie, et dont les yeux ne demandaient qu’à s’ouvrir à la lumière ! Les curés, les évêques, les membres du saint-office, les grandes dames, dévotes et zélées catholiques, s’empressaient alors de l’instruire, en commençant au préalable par le loger, le vêtir et le nourrir dans leur palais ; puis chacun se faisait un honneur et un devoir de tenir le néophyte sur les fonts baptismaux. Le capitaine comptait parmi ses parrains et marraines les plus grands seigneurs et les plus notables dames du royaume. Enchanté d’une ruse si pieuse et si facile, qui lui réussissait si bien, il l’avait renouvelée sur tous les points les plus éloignés de l’Espagne ; il avait poussé le baptême jusqu’à l’abus, et l’inquisition, étonnée de cet hérétique éternel, toujours converti et toujours renaissant, commençait à prendre des informations que le capitaine ne jugea pas à propos de lui donner ; il gagna les montagnes, reprit le commerce paternel, celui de la contrebande, qu’il n’avait, comme on vient de le voir, jamais cessé d’exercer ! Il y a ici, dans son histoire, une lacune, un intervalle qu’on n’a jamais pu remplir… ce qu’on appelle dans l’histoire de tous les peuples les temps obscurs ! Le capitaine disparut, sans qu’on pût savoir ce qu’il était devenu… ses ennemis prétendirent l’avoir vu ramer pendant quelque temps à bord d’une galère ou caravelle catalane ; mais le capitaine n’en convint jamais, et ce qu’il y eut de certain, au contraire, c’est que lui et ses compagnons se trouvèrent, on ne sait comment, maîtres absolus du bâtiment catalan, dont l’équipage était mort subitement du scorbut, du typhus ou de quelque autre maladie auxquels sont sujets les gens de mer. Ce qu’il y eut de prouvé, c’est que Juan-Baptista, qui, depuis ce jour, prit le titre de capitaine, se mit à courir la mer comme défenseur de la foi, poursuivant et pillant tous les navires de Tunis et d’Alger. Si parfois, parmi les barbaresques, il se trouva quelques riches bâtiments marchands chrétiens, la faute de ce hasard ne put être attribuée au capitaine, qui, dans le doute, prenait toujours, imitant ce pieux prélat qui dans un massacre où l’on avait peine à distinguer les hérétiques, disait aux soldats : « Frappez toujours, Dieu reconnaîtra les siens ! »
Pour plusieurs faits de ce genre que des casuistes de l’amirauté avaient mal interprétés, le capitaine fut poursuivi par les vaisseaux du roi, comme pirate et écumeur de mer. Ne voulant pas s’amuser à discuter avec des gens qui ne répondaient que par deux ou trois cents bouches à feu, le capitaine renonça à la marine, vendit son bâtiment, garda son équipage qui lui était dévoué, et, rentrant dans la vie civile, s’établit pour le moment dans un endroit agreste et pittoresque, situé entre la Sierra d’Oca et la Sierra de Moncayo, chaînes de montagnes qui séparent la Navarre de la Vieille et de la Nouvelle-Castille. Une grande route les traverse, et tous ceux qui vont de Pampelune à Burgos ou à Madrid, sont obligés de passer par la Sierra de Moncayo, dont l’aspect sauvage, les âpres rochers et les sombres forêts excitaient alors l’admiration des peintres et des voyageurs.
Ces avantages et d’autres encore avaient séduit le capitaine ; il avait remarqué une hôtellerie de modeste apparence, fort bien située, isolée, solitaire, ombragée par un bois épais, non loin de la grande route. Il acheta et paya comptant cette posada, à laquelle il fit tous les changements et embellissements qu’il jugea nécessaires. Il se fit hôtelier pour son plaisir : c’était l’état de sa mère, et il s’y entendait à merveille, ce qui ne l’empêchait pas de faire des excursions à vingt ou trente lieues à la ronde, en bourgeois, pour affaire de son commerce ou pour toute autre spéculation, et nous l’avons vu, le jour même de la mémorable insurrection que nous venons de décrire, jouer à Pampelune un rôle important dans l’affaire des fueros de Navarre.
C’était en ses mains que le pauvre Piquillo était tombé. Le voyant descendre la nuit, par escalade, d’une riche maison, le capitaine avait eu d’abord trop bonne opinion de lui ; il l’avait pris pour quelque jeune confrère, pour un apprenti du moins. La candeur et la probité des réponses de Piquillo le détrompèrent bien vite : mais on pouvait le former, il était jeune, et Juan-Baptista savait par lui-même qu’en commençant de bonne heure, on arrivait à tout ! Le capitaine avait de la prévoyance ; c’était un homme d’invention autant que d’action ; il avait souvent pensé qu’un enfant adroit, intelligent, et dont l’âge éloignait toute défiance, pourrait rendre de grands services à la troupe qu’il avait l’honneur de commander, et Piquillo était à peu près ce qu’il lui fallait, moins ses principes, si toutefois on pouvait appeler ainsi quelques instincts honnêtes qui tenaient à si peu de chose, que le moindre orage devait les déraciner.
Le regret le plus grand de Piquillo était d’abandonner son compagnon. Qu’allait devenir ce pauvre Pedralvi, qui s’était exposé pour le sauver ? Mais bientôt il lui fallut penser à lui-même. Juan-Baptista et ses amis étaient sortis de la ville avant le point du jour ; quelques gens qui avaient l’air de marchands forains les attendaient hors des remparts avec des chevaux pour le capitaine et sa suite, et de plus avec deux mulets qui paraissaient pesamment chargés ; mais un troisième ne portait rien, le capitaine fit la grimace.
— Une affaire si bien combinée ! Victoriano Caramba nous a pris pour dupes !
— Ce n’est pas ma faute, capitaine, lui répondit un homme de petite taille, mais fort trapu, Martin de Barala, dit Caralo, qui paraissait jouir d’une grande autorité : c’était le confident et l’ami de Juan-Baptista, et le plus influent après lui. Ce n’est pas la faute du pauvre trésorier de Pampelune si sa caisse était vide.
— Si vraiment ; un trésorier est responsable des deniers du gouvernement, et il nous remboursera, à ses frais, ce dont il nous a fait tort.
— Vous ferez bien, capitaine, mais je crois qu’avec le comte de Lerma, il faut changer de batteries et ne plus s’attaquer aux caisses publiques.
— Tu dis vrai, il n’y laisse jamais rien !
— C’est un grand ministre des finances !
— Heureusement qu’avec lui, nous nous retrouverons sur autre chose ! à cheval, et puisque, par malheur, nous avons un mulet qui marche à vide, mettez à la place du bagage qui nous manque celui-ci, dit-il en montrant Piquillo, qui ne vaut pas l’autre. Mais n’importe, on verra à l’utiliser !… en route.
Et la cavalcade partit au petit trot, marcha tout le reste de la nuit ; traversa, au milieu du jour, un beau fleuve dont Piquillo sut plus tard le nom, c’était l’Èbre, et quelques heures après, on commença à gravir la montagne et à s’enfoncer dans la forêt.
Piquillo ne comprenait rien aux conversations qu’il entendait durant la route ; mais quand il rencontrait les yeux du capitaine ou de son lieutenant, il perdait toute envie de leur en demander l’explication. Comme déjà dompté et fasciné par eux, il n’osait ouvrir la bouche et se sentait saisi d’un sentiment de terreur inexprimable et invincible. Quand il arriva à la posada de Buen Socoro (l’hôtellerie de Bon-Secours), ce fut encore bien pis ; l’hôtellerie était située au milieu des bois et des rochers, et Piquillo ne concevait pas quelles étaient les pratiques qui pussent venir y demander à dîner ; il fallait s’être égaré pour s’y arrêter ; il y régnait surtout un silence effrayant que Piquillo comparait au bruit, à l’animation, au mouvement continuel qu’il avait remarqué à l’hôtel du Soleil-d’Or ; cet hôtel resta longtemps dans ses souvenirs, comme l’image du paradis terrestre, comme un lieu enchanté et magique où il pleuvait des perdrix toutes rôties ; il en vint même à regretter la cave qui lui servait de prison, et qui lui parut un séjour de délices, quand il la comparait aux appartements du capitaine Balseiro. Il est vrai que le souvenir de Juanita, si bonne et si gentille, et de son ami Pedralvi, si dévoué et si joyeux, lui rendait encore plus sombre la terrible société dont il était entouré ; non pas qu’on le laissât manquer de rien, la table du capitaine était toujours bien servie ; le bon vin y circulait, et surtout l’agua ardiente (l’eau-de-vie) ; mais ce qu’il voyait ou entendait confondait ses idées, et troublait sa raison à peine formée ; les orgies finissaient souvent par des jurements, des imprécations et des disputes que Juan ne prenait pas la peine d’apaiser : Vous n’êtes pas d’accord, mes enfants, disait-il parfois d’un ton paternel, battez-vous, et que cela finisse ; et les couteaux étaient tirés, et le sang coulait, et chacun d’admirer la douceur et la sage administration du capitaine. Quant à Piquillo, s’il criait, s’il tremblait, s’il pleurait à ce spectacle, chacun haussait les épaules ou se moquait de lui, et ce qui lui faisait horreur excitait au contraire les éloges et l’admiration de tous ceux qui l’entouraient ; pour un pauvre enfant qui n’avait aucune notion du bien ou du mal, et que rien ne pouvait éclairer ou guider dans les ténèbres, cette horrible taverne était l’antichambre de l’enfer.
Et cependant il était défendu à Piquillo d’en sortir ; c’était l’ordre du capitaine, et malheur à qui osait lui désobéir ; Piquillo en avait eu la preuve quelques jours auparavant par une scène d’intérieur dont il avait été témoin.
Juan-Baptista avait une caisse d’excellent rhum qu’un ami lui avait sans doute envoyé de la Jamaïque, et auquel il tenait beaucoup. Il se l’était réservé pour lui tout seul, et il s’aperçut qu’on osait le voler !… lui Juan-Baptista ! c’était un jeune bohémien nommé Paco, un nouveau camarade, qui, fidèle aux habitudes de la maison, voulait s’entretenir la main, et puis c’était son goût, il aimait le rhum, et il venait d’en déboucher une bouteille dont il offrait un verre à Piquillo, qui refusait, lorsque le capitaine entra !
— Que faites-vous là ?
— Je bois à votre santé, capitaine.
— Ce rhum est à moi !
— Tout est à nous ! ce sont nos lois !
— Mais la loi est de m’obéir ?
— Et quand par hasard on vous désobéit une fois… dit Paco en souriant avec ironie.
— On ne désobéit pas une seconde, répondit froidement Balseiro, et tirant un pistolet de sa ceinture, il fit feu.
Le bohémien tomba… Piquillo jeta un cri horrible.
— Qu’est-ce ? dit le capitaine en se retournant, je n’aime pas le bruit…
Et apercevant l’enfant qui tremblait de tous ses membres :
— Ah ! tu étais là, Piquillo… tant mieux ! Je ne t’avais pas vu ; que cela te serve de leçon.
Et il sortit.
Depuis ce jour, Piquillo avait pour son terrible maître une obéissance, ou, plutôt, il avait de lui une terreur telle qu’il se gardait bien de s’éloigner de la posada, et tout ce qu’il osait se permettre, c’était de regarder, de temps en temps, par une des fenêtres qui donnait sur le bois et sur les rochers.
Un jour cependant le temps était si beau, le soleil si brillant, personne que lui à l’hôtellerie !… Il ne put résister au désir de se promener un instant dans la forêt, et de respirer un air plus pur. Il n’avait pas fait une dizaine de pas qu’il se sentit renaître : la fraicheur du matin, le parfum des fleurs et des bois faisaient circuler la santé et la vie dans ce corps languissant ; un rayon de bonheur se glissait dans son cœur, un sourire de joie errait sur ses lèvres, quand soudain ses joues devinrent pâles et glacées. Se soutenant à peine, il s’appuya contre un arbre : il venait, au détour d’une allée, de se rencontrer face à face avec le capitaine.
V.
l’hôtellerie de buen socorro.
Le capitaine et son lieutenant Caralo fumaient tous deux et parlaient d’affaires, discutant une expédition projetée.
Juan-Baptista lança sur Piquillo un regard terrible, semblable à celui qu’il avait jeté au malheureux bohémien, et sans proférer une parole, fit un signe au lieutenant qui, de sa main vigoureuse, enleva le coupable tremblant.
Il le porta ainsi jusque dans la salle à manger, où plusieurs de leurs camarades venaient de rentrer : en un clin d’œil, Piquillo fut dépouillé de ses vêtements, couché sur le ventre, et Caralo détachant une courroie en cuir suspendue à la muraille, se mit à fustiger le patient avec un soin et une précision qui prouvaient avec quel plaisir il exécutait les ordres du capitaine. Les autres bandits s’étaient mis à déjeuner sans faire attention aux gémissements et aux cris que la douleur arrachait au pauvre Piquillo. Quant au capitaine, qui venait de rentrer, il s’était assis et comptait gravement les coups.
— Dix, douze… quinze… pas si vite, Caralo !… seize… dix-sept… ah ! regardez donc… qu’a-t-il là ? ce signe au haut du bras gauche.
— Rien, capitaine, disait Caralo en continuant de frapper… ne faites pas attention, ce sont des caractères arabes, des signes religieux ou diaboliques que les mères mauresques appliquent à leurs enfants qui viennent de naître.
— Cela prouve que ce petit misérable n’est pas même chrétien… dix-huit… dix-neuf… que c’est un païen… un réprouvé…
— Qu’on aurait tort d’épargner, continuait Caralo en frappant plus fort… il y en a comme cela un tas qui n’ont pas reçu le baptême !
— Oui, mais il y en a d’autres qui l’ont reçu cinq ou six fois, et cela compense ; moi, par exemple, s’écria le capitaine avec satisfaction… ah ! bravo, Caralo ! voilà un coup bien appliqué !…
Si bien, en effet, qu’il venait d’enlever un large lambeau de chair, et Piquillo, dont le corps ruisselait de sang, poussa un dernier cri, et s’évanouit.
— Assez ! assez ! dit Juan-Baptista, pendant que nous étions là à causer, j’avais oublié cet enfant… je ne pensais plus qu’il n’était pas de force à supporter autant de coups ; toi, à la bonne heure…
— Comment moi, capitaine ! s’écria Caralo indigné.
— Allons ! silence ! et vous autres, venez à son secours. Un peu d’humanité, que diable ! donnez-lui du vinaigre ! à la bonne heure ! le voilà qui revient à lui, dit-il en entendant les nouveaux cris de l’enfant ; car le lieutenant venait de jeter par compassion des flots de vinaigre sur ses plaies saignantes.
— C’est bien ! qu’on l’emporte, et toi, dit-il à Piquillo, s’il t’arrivait encore de me désobéir, tu n’en serais pas quitte à si bon marché ; songe à Paco le bohémien.
Depuis ce jour, Piquillo n’eut plus l’envie, ni l’audace de quitter la posada. Quand il en sortait, c’était avec le capitaine ou par son ordre, avec des instructions qu’il exécutait sans chercher même à les comprendre, tant la terreur et la servitude où il vivait avaient paralysé ses facultés, et éteint son intelligence.
On l’envoyait dans une ferme, dans un château comme un pauvre enfant égaré qui implorait l’hospitalité ; au retour on lui demandait ce qu’il avait vu, la disposition des lieux, le nombre des habitants, maîtres et domestiques. Piquillo racontait ; c’est tout ce qu’on exigeait de lui, et ces journées-là étaient ses plus heureuses ; car il les avait passées hors de ce repaire ; bien des fois il avait eu l’envie de dire à ceux qui le recevaient : gardez-moi, je vous en supplie ; mais y aurait-on consenti ? et puis, la vengeance du capitaine ne l’aurait-elle pas toujours retrouvé ; il se rappelait avec effroi qu’un jour, dans un riche domaine, touché par l’accueil bienveillant qu’il venait de recevoir, il allait se jeter aux pieds du maître et lui demander secours et protection, lorsqu’il avait aperçu, par une fenêtre du parc, une figure qui l’avait glacé de terreur, l’ombre de Juan-Baptista Balseiro, ou plutôt c’était lui-même qui, habillé en riche cavalier, venait marchander cette belle propriété qu’on disait à vendre !
Aussi, persuadé que cet homme était son mauvais génie, qu’il voyait tout et savait tout, Piquillo subissait en silence une domination contre laquelle il n’avait ni la force ni les moyens de lutter ; il y avait, en effet, dans la conduite du chef et des siens, une foule de problèmes que son esprit s’efforçait de résoudre, sans en venir à bout. D’abord, l’hôtellerie, isolée et un peu éloignée du chemin, n’était jamais fermée la nuit : ensuite il y avait sur la route royale, que le comte de Lerma entretenait à grands frais, un endroit défoncé, une espèce de précipice que l’on ne réparait jamais, et que l’on se contentait de couvrir de feuillages ; enfin, lorsqu’une chaise de poste se brisait dans ce mauvais pas, il se trouvait toujours, sur la lisière du bois, un bûcheron et son fils qui indiquaient aux voyageurs une excellente hôtellerie très-proche où l’on serait à merveille ; l’enfant se chargeait même de les conduire ; cet enfant, c’était Piquillo, qui avait le désagrément de voir les amis du capitaine lui servir, tour à tour, de père ; mais était-ce du moins pour obliger, et il était forcé de convenir que les voyageurs qui demandaient ainsi l’hospitalité étaient toujours les bienvenus, qu’on les accueillait avec les plus grands égards, qu’on les comblait des soins les plus délicats. Pour eux, le capitaine n’épargnait rien, pas même le rhum de la Jamaïque dont il était si jaloux, et après un excellent souper, on les conduisait dans une belle chambre, où jamais Piquillo n’entrait, mais par la porte entr’ouverte il avait vu un appartement tendu en damas rouge, deux grands lits à baldaquin, des meubles à l’avenant. C’était la seule chambre de la maison qui se distinguât par une pareille magnificence !
Seulement, Piquillo remarquait, en lui-même, que ces voyageurs devaient se lever tous de grand matin, car jamais il ne les voyait partir ; souvent même ils se remettaient en route sans emmener leurs voitures que l’on réparait, et laissaient à l’écurie leurs chevaux, qu’on leur renvoyait probablement quelques jours après ; du moins on ne les revoyait plus !
Plus de deux années s’écoulèrent dans cet esclavage et dans cet abrutissement, qui, peu à peu, exerçaient sur le pauvre Piquillo une influence dont il ne s’apercevait pas, et dont il ne pouvait se rendre compte. Quand on vient du dehors, quand on a longtemps respiré un air pur, et que l’on entre dans un endroit infect, dans une prison pestilentielle, on croit qu’on ne pourra pas y rester un jour, une heure, un instant ; on y résiste pourtant… on y reste, on s’habitue, non pas à y vivre, mais à y mourir. Le contact habituel du vice produit le même effet, même sur une bonne et honnête nature ; le dégoût qu’il inspire d’abord ne l’empêche pas de devenir contagieux et mortel. La fleur la plus belle et la plus suave dépérit dans la fange, et tombe en pourriture.
Piquillo ne voyant pas d’autres mœurs, d’autres exemples que ceux qui l’entouraient, commençait presque à se persuader que le monde était fait ainsi, que Juanita et Pedralvi étaient des exceptions qu’il ne rencontrerait plus jamais. Aussi, et quoique bien jeune encore, tout commençait à lui être indifférent ! Dans l’âge où l’on ne vit que d’espérance, il n’espérait plus ; son instinct même, à défaut d’autre guide, ne l’avertissait plus de ce qui était bien, ou de ce qui était mal, sauf de temps en temps quelques derniers souvenirs qui faisaient battre son cœur, tout chez lui se desséchait dans sa sève ; l’arbre existait encore, mais ses plus belles branches commençaient à mourir.
De mauvais instincts, des instincts de haine germaient en lui. Le lieutenant Caralo ne perdait pas une occasion de le gronder, de le dénoncer ; il en inventait même, et aussitôt le chef, qui était l’équité en personne, ordonnait le châtiment ; lorsque toutefois il ne s’en chargeait pas lui-même. Et Piquillo ne gagnait pas au change, car la main du capitaine était aussi lourde que celle du lieutenant ; mais celui-ci joignait aux mauvais traitements des plaisanteries comme il savait les faire, lesquelles excitaient la gaieté de la troupe, blessaient la vanité et l’orgueil de l’enfant. et éveillaient dans son cœur la vengeance, la colère, toutes passions qui se tiennent et qui, une fois qu’elles ont fait brèche, laissent entrer les autres. C’était surtout quand le lieutenant était ivre, et cela lui arrivait souvent, que le pauvre Piquillo était victime de sa mauvaise humeur.
Un jour, pendant qu’il buvait en jouant aux dés, il lui cria :
— Apporte-moi ma pipe.
Piquillo s’empressa de la lui présenter.
— Merci, lui dit-il en lui donnant un soufflet.
Piquillo furieux jeta la pipe par terre, la brisa et la broya sous ses pieds ; le lieutenant tenait beaucoup à sa pipe.
— Bravo ! s’écria le capitaine.
— Oui, bravo, dit le lieutenant en se levant de table, parce que cette fois il ne mourra que de ma main ; puis s’adressant à l’enfant, qui, debout et l’œil enflammé, le regardait fièrement, compte bien les morceaux de ma pipe (elle était brisée en mille pièces), et tu vas recevoir autant de coups de fouet.
Il alla à la muraille et détacha la courroie fatale ; Piquillo s’élança vers la table et saisit un couteau. Tous les bandits s’arrêtèrent étonnés, et firent cercle autour d’eux.
— N’avancez pas, s’écria Piquillo, et sa voix, si frêle d’ordinaire, était mâle et forte en ce moment ; j’en appelle au capitaine ; j’en appelle à ces seigneurs cavaliers ; vous m’avez donné un soufflet que je ne méritais pas, et je vous ai entendu dire à tous, qu’un soufflet voulait du sang ; n’avancez pas, ou j’aurai le vôtre.
— Bravo ! s’écria le capitaine en se frottant les mains.
Le lieutenant se mit à imiter le sifflement des torréadors au commencement des combats de taureaux, puis feignant de vouloir, comme eux, exciter encore l’animal furieux, il agita un mouchoir rouge qu’il tenait à la main gauche, et de la droite il faisait tournoyer la courroie autour de sa tête.
Tout le cirque applaudit par un éclat de rire à cette nouvelle et ingénieuse plaisanterie du lieutenant, et celui-ci, animé par les bravos de l’assemblée, se dirigea en chancelant sur Piquillo, et le frappa d’un revers de sa courroie.
Piquillo se jeta à son tour sur lui, et le frappa avec force de son couteau.
Le lieutenant tomba poussant un cri de rage. Les bandits se ruèrent sur Piquillo, le saisirent, le jetèrent sous leurs pieds ; dix poignards étaient levés et allaient le frapper.
— Arrêtez, s’écria le capitaine ! par tous les saints d’Espagne, arrêtez ! le combat est loyal et le coup est bon.
— Trop bon, répondit Caralo avec un hurlement.
— Bravo ! Piquillo, bravo ! continua le capitaine sans faire attention à son lieutenant ; et vous, messieurs, par saint Jean-Baptiste mon patron, gardez-vous bien de toucher à ce jeune camarade, qui vient de faire ses premières armes ; maintenant que le jeune tigre a léché du sang, je vous réponds de lui, il est des nôtres. Viens ici, Piquillo, et, vous, emmenez Caralo, qu’il aille se faire panser.
— Soit, répondit le lieutenant, mais je vous prends à témoin qu’il fera connaissance à son tour avec la lame de mon poignard.
— Cela vous regarde, répliqua froidement le capitaine ; c’est une affaire entre vous. Puis, pendant qu’on-emportait le lieutenant : Vois-tu, dit-il à Piquillo, d’un air amical, et comme un maitre qui donne des conseils à son élève, le coup était trop bas ; il fallait frapper plus haut.
À dater de ce jour, Juan-Baptista se montra ; non pas moins dur et moins brutal, cela lui était impossible, mais plus communicatif avec son jeune apprenti. Il en avait désespéré longtemps, et croyant voir qu’on en pourrait faire quelque chose, il le soignait comme un sujet précieux, qui devait un jour, sinon lui faire honneur, sentiment auquel il tenait peu, du moins rendre d’importants services à lui, Juan-Baptista Balseiro, seule personne au monde à qui le capitaine portât un peu d’intérêt ou d’affection.
Piquillo, malgré sa jeunesse et son inexpérience, commença donc enfin à comprendre quelle route il suivait, et quels guides lui étaient donnés. Une pareille découverte le remplit d’horreur, réveilla un instant dans son cœur tous les bons instincts que la nature y avait mis, et, comme dit l’Écriture, empêcha de croitre l’ivraie et les mauvaises herbes qui déjà menaçaient d’étouffer le bon grain.
Et cependant, on ne l’avait pas encore initié à tous les secrets de l’ordre ; seulement, et vu l’estime que le capitaine lui portait, on ne se cachait plus de lui ; on ne craignait plus de plaisanter en sa présence ; mais on ne lui confiait rien ; on exigeait toujours de lui une soumission aussi aveugle, une obéissance aussi passive ; et il aurait été pour lui d’autant plus dangereux d’y manquer, qu’il avait maintenant dans la troupe un ennemi mortel, décidé à ne lui rien pardonner.
Parfois, quand il arrivait, la nuit, des voyageurs, on l’avait chargé de préparer la belle chambre de damas rouge qui excitait toujours sa curiosité et son inquiétude ; car un soir il avait cru voir sur les meubles quelques taches de sang. Mais depuis, rien n’avait confirmé ses soupçons ; la chambre était belle, aérée, deux croisées donnant l’une sur le bois, l’autre sur la cour ; l’appartement était parfaitement clos et la porte même était fermée, en dedans, par de larges verrous, dont on entendait le bruit au dehors ; chaque voyageur, en entrant se coucher, ne manquait pas, en effet, de les pousser.
Cependant, comme nous l’avons dit, Piquillo avait beau se lever de bonne heure, et faire sentinelle du haut de la chambre qui lui servait de logement, et qui n’était autre que le grenier de la maison, il ne voyait presque jamais partir, le lendemain, les voyageurs arrivés la veille, surtout quand leur équipage, leur mise ou leur tournure annonçaient des gens riches ou distingués.
Piquillo avait fait encore une autre remarque. Le maître de la maison tenait compagnie à ses hôtes pendant leur souper le soir ; fini, ceux-ci se retiraient dans leur appartement, et le capitaine restait à boire ; puis, quand il avait bu une heure ou deux, au lieu de s’aller coucher, ce qui eût été tout simple, il descendait à la cave, et en remontait, peu d’instants après, sans rapporter ni bouteille, ni broc de vin.
Ceci n’était pas naturel, et désespérant d’expliquer ce mystère par les seules forces de son intelligence, Piquillo avait plusieurs fois guetté, de loin, sur l’escalier, le capitaine. Il l’avait vu descendre à la cave, en ouvrir la porte avec une des clés qu’il portait d’ordinaire, et laisser même son trousseau de clés à cette porte. Là, ses découvertes s’étaient arrêtées, et lui aussi. Un jour seulement, et tant sa curiosité était grande, il eut l’audacieuse idée d’aller plus loin, de descendre derrière le capitaine, et de le suivre presque au fond de cette cave mystérieuse ; il avait déjà posé la main sur la clé, et allait la tourner… mais le courage lui manqua ; croyant entendre du bruit, il remonta l’escalier à la hâte, et, rentré dans son grenier, il se jeta tout tremblant sur les bottes de foin qui formaient son lit et tout son ameublement.
Depuis, il n’avait plus osé renouveler cette tentative, et probablement ce mystère en devait toujours être un pour lui, car le capitaine se préparait à quitter sous quelques jours la posada, dont la réputation, qui n’était pas des meilleures, commençait à se répandre dans le pays.
Rêvant à de nouveaux projets, dont il avait fait part à ses amis, Balseiro soupait un soir avec tous les siens, moins toutefois le lieutenant Caralo. Celui-ci était à peu près guéri de sa blessure, et son retour effrayait beaucoup le pauvre Piquillo ; mais, quoiqu’il fût en pleine convalescence, le lieutenant avait préféré rester dans sa chambre ; il avait seulement demandé qu’on lui montât trois bouteilles de vin, promettant de n’en boire qu’une. Les trois bouteilles lui avaient été apportées, et Caralo, assis devant une table, buvait lentement, et à petits coups, comme il convient à un convalescent ; mais, malgré la liqueur vermeille qui riait dans son verre, l’air sombre du lieutenant prouvait qu’il tramait, à part lui, quelques projets de vengeance.
Le capitaine et les siens buvaient à la santé de leur camarade absent, et festoyaient rudement une olla podrida splendide, dont le parfum seulement charmait les sens de Piquillo, qui, debout, derrière eux, les servait ; c’étaient son habitude et ses fonctions ordinaires.
Tout à coup on frappa rudement en dehors, à la porte de la posada.
— Seraient-ce des voyageurs ? dit le capitaine, en ce cas, ils ne valent pas la peine qu’on se dérange, car je n’ai pas entendu de voiture.
— Seraient-ce des alguazils ? se demandaient les convives entre eux, vu la réputation dont commençait à jouir la posada.
— Eh ! par saint Jean et saint Jacques, reprit le capitaine, voyons qui ce peut être, avant d’ouvrir… allez-y… non, pas toi, Piquillo… tu ne peux pas tout faire à la fois, et pendant qu’il me verse à boire, vas-y, toi, Carnego.
Carnego se leva de table, sortit, et revint un instant après, avec un petit homme à la physionomie ronde et riante, lequel tenait sous un bras une modeste valise, et de l’autre une jeune fille de quatorze ans à peu près, brune, animée et piquante, dont les couleurs redoublèrent, et dont les yeux se baissèrent à la vue d’une si nombreuse assemblée.
— C’est moi, messeigneurs, c’est un pauvre voyageur dont la carriole vient de se briser, qui vous demande l’hospitalité pour lui et pour sa nièce Juanita, qui n’est pas trop déplaisante, comme vous voyez. Saluez donc, petite fille.
Juanita salua, et Piquillo, prêt à perdre connaissance, s’appuya sur la chaise du capitaine. Il ne pouvait dire ce qui se passait en lui, à ce nom, à cette vue, car, au moment où Juanita était entrée, Piquillo l’avait reconnue. Son souvenir et celui de Pedralvi étaient trop bien gravés dans son cœur, et malgré le changement que deux ans peuvent produire, surtout sur une jeune fille, il s’était dit : C’est elle ! la voilà ! Son premier mouvement avait été de courir à sa rencontre, de lui demander des nouvelles du petit bohémien, son seul ami ; mais une crainte, une honte indéfinissables, peut-être aussi l’instinct du danger qui la menaçait… tout l’avait retenu, et il était resté, comme nous l’avons dit, debout, immobile, derrière la chaise du capitaine, lequel ne quittait pas des yeux Juanita, qui maintenant était une jeune et belle fille, et valait la peine d’être regardée.
Quant à celle-ci, elle n’avait reconnu personne et se serrait seulement avec crainte contre son oncle.
— Prenez place, seigneur voyageur, et vous, senorita, dit le capitaine de sa voix la plus douce et la plus affable, asseyez-vous à côté de ces nobles cavaliers, qui, comme vous, m’ont fait l’honneur de venir souper et coucher dans cette posada. Allons, deux couverts de plus ! Oserais-je vous demander, continua-t-il en s’adressant à son nouvel hôte, qui j’ai l’honneur de recevoir, si toutefois il n’y a pas d’indiscrétion à vous adresser cette question ?
— Aucune, seigneur hôtelier. Je parle avec plaisir et facilité… Je suis barbier, jouissant, j’ose le dire, de quelque réputation parmi ceux qui ont manié la savonnette et le rasoir ; aussi, malgré l’envie qu’ils me portent, mes confrères me reconnaissent eux-mêmes pour le premier de Pampelune, Aben-Abou, dit Gongarello, dont il n’est pas que vous n’ayez entendu parler.
Le capitaine et les assistants firent un signe de tête affirmatif.
Gongarello y répondit par une salutation gracieuse, avala un verre de vin, et reprit avec volubilité :
— Imaginez-vous, messeigneurs, qu’il y à deux ans, le jour de l’entrée du roi à Pampeluue, il y eut, en faveur des fueros, une espèce d’émeute à laquelle personne n’a jamais rien compris, pas même ceux qui l’avaient inventée, et si vous vous étiez trouvés comme moi dans la foule…
— Nous y étions, dit le capitaine, en relevant sa moustache !
Le barbier lui fit une nouvelle salutation affectueuse, et continua :
— L’hôtelier Ginès Perès, un des fuéristes les plus enragés, en a fait une maladie comme sergent des hallebardiers, vu les fatigues que lui ont données, jour et nuit, les patrouilles de la ville et la garde du palais. Maître Truxillo, le tailleur, son voisin, en a été plus affecté encore, et ça continue toujours… enfin, il n’y a rien à dire… c’était leur faute, ils l’avaient voulu ; mais moi qui ne voulais rien, que rester tranquille dans ma boutique, c’est sur moi qu’est retombé le poids de tout ceci ; nous avons tout payé, moi et les miens ! D’abord on a demandé aux cortès un nouvel impôt, et l’assemblée, qui n’était composée que d’Espagnols, a décidé qu’il devait être mis à la charge des Maures, attendu qu’ils ont plus d’activité, d’industrie et de talents que les autres. L’esprit coûte cher en ce pays.
— Et vous deviez, seigneur barbier, être un des plus imposés ! s’écria le capitaine en le saluant.
— Je le sais bien ; c’est flatteur, mais ça ruine ! double droit, double patente… sans compter que, depuis deux ans, j’ai été, moi personnellement, en butte à toutes les persécutions. L’inquisition ne me laissait pas un jour de relâche ; obligé de quitter une pratique au milieu d’une barbe, pour aller devant quelques membres du saint-office répondre à des accusations de conspiration, d’hérésie et surtout de sorcellerie… ma foi, je n’y tenais plus. J’ai pris un grand parti, j’ai un parent à Madrid… un homme en crédit… Andrea Cazoleta, dont la femme est ma cousine, Cazoleta, parfumeur de la cour, rien que cela : je me suis dit : allons nous établir près de lui, et quittons pour jamais Pampelune. Ça n’a pas été long… j’ai retiré ma nièce de l’hôtellerie du Soleil-d’Or, où je l’avais placée comme servante. J’ai vendu mon fonds, le meilleur et le plus achalandé de la ville… deux cents ducats que j’ai dans ma valise… oui, je les ai là…
Piquillo, effrayé du tour que prenait la conversation, passa vivement derrière le barbier et le heurta brusquement comme pour lui dire :
— Imprudent, taisez-vous ?
— Mais prenez donc garde, seigneur page, ne me heurtez pas ainsi l’épaule avec votre bouteille, dit Gongarello, en s’interrompant et en apostrophant Piquillo.
Puis, reprenant gaiement son bavardage :
— Oui, messeigneurs, deux cents ducats en or !… tout autant !
— Ainsi donc, seigneur Gongarello, s’écria le capitaine, qui, ainsi que ses compagnons, n’avait pas perdu un mot du récit précédent, vous allez vous établir à Madrid, vous et vos capitaux ! Permettez-moi de boire un verre de ce bon vin à votre voyage, à votre santé et à celle de votre nièce.
— Ma nièce ne boit pas de vin…
Le capitaine parut contrarié.
— Mais, moi, je bois pour deux, reprit gaiement le barbier ; versez donc, seigneur hôtelier, et versez plein ! À vous et à toute l’honorable société, fit-il en s’inclinant. Puis, après avoir savouré quelques gorgées, il s’arrêta et reprit : Voilà un vrai nectar dont je n’ai jamais bu, moi qui croyais connaître tous nos vins.
— Aussi, celui-là n’est-il pas d’Espagne.
— Eh ! de quel pays ?
— De France ! vous ne l’aviez pas deviné… vous qu’on accusait d’être devin et sorcier ?
— Eh ! eh ! reprit le barbier d’un ait malin… je l’ai été parfois dans ma vie sans le vouloir ! Ma nièce Juanita avait une mère qui disait fort proprement la bonne aventure, Joanna, ma sœur, dont je suis l’élève ; et grâce aux leçons qu’elle m’a données, je ne me trompe presque jamais, pour mon malheur… c’est là ce qui m’a fait dénoncer !
— En vérité, s’écrièrent les convives, dont les discours du barbier maure excitaient la curiosité, vous ne vous trompez jamais ?
— C’’est comme un sort : j’avais prédit à maître Truxillo, mon voisin, qui voulait absolument épouser une jeune et jolie femme, qu’il lui arriverait malheur… ça n’a pas manqué. J’avais prédit un matin au corrégidor Josué Calzado qu’il serait blessé, on l’a rapporté le soir avec un bras cassé.
— Oui, mon oncle, dit timidement Juanita ; mais vous oubliez d’ajouter que le matin il était passé devant votre boutique sur une mule vicieuse.
— Qu’importe ! tous les jours on a des mules vicieuses, témoin celle qui était à notre carriole, et on n’a pas pour cela le bras cassé ; voyez plutôt, et il porta à ses lèvres son verre, qu’il vida gaiement.
— Par saint Jacques, s’écria le capitaine, que la bonne humeur du barbier avait mis en gaieté, je veux faire l’essai de vos talents. Dites-moi ma bonne aventure, à moi.
— Volontiers, seigneur hôtelier… votre main ?
— La voici.
Après l’avoir examinée avec attention, le barbier la repoussa en disant : Allons… votre vin de France m’a troublé la visière. Je vois de travers ou je calcule mal… car ce qui est écrit là, dans votre main, est trop invraisemblable, et je ne puis vous le dire…
— Allez toujours.
— Cela ne vous effraiera pas ?
— Rien ne m’effraie.
— Eh bien ! je suis dans l’indécision… Il y a là une ligne qui dit que vous mourrez brûlé… et une autre exactement pareille atteste que vous serez pendu ; or, comme l’un exclut l’autre, cela vous prouve, seigneur hôtelier, que ma prédiction ne signifie rien. Et il se mit à rire aux éclats.
Il fut le seul, car chacun des convives se regardait en silence et d’un air étonné, trouvant que toutes les probabilités étaient en faveur du barbier. Le capitaine seul ne parut point ému ; il versa un nouveau verre de vin à son hôte, et lui dit en souriant d’un air railleur : et vous, seigneur barbier, qui êtes si savant, pourriez-vous prédire le sort qui vous attend ?
— Je ne me suis jamais inquiété de l’avenir, dit Gongarello, qui était à la fois barbier et philosophe ; mais je puis vous dire, sans être bien sorcier, ce qui m’arrivera aujourd’hui et demain.
Piquillo tressaillit, et le capitaine pâlit ; mais se remettant promptement :
— Où voyez-vous cela ?
— Parbleu ! à votre physionomie. Je vois d’abord que j’ai fait, en très-bonne compagnie, un excellent diner, et que j’ai bu un vin exquis ; ce n’est pas là ce qui m’inquiète… c’est la suite…

Tous les traits du capitaine se contractèrent ; il était atterré du sang-froid, et surtout de la gaieté de Gongarello.
— Oui, continua le barbier… c’est la suite qui m’inquiète ! et je vois à votre air, seigneur hôtelier, que vous êtes un gaillard à nous faire payer cher ce repas… c’est tout simple ! c’est votre habitude, et celle de beaucoup de vos confrères… aussi vous trouverez bon que nous nous défendions… je vous préviens d’avance, que moi, je ne me laisse pas faire… je crie quand on m’écorche !
Et il se mit à rire de nouveau, d’un rire auquel le Capitaine trouvait quelque chose de satanique. Aussi, et pour la première fois de sa vie, il se sentait mal à l’aise, et déconcerté ; la sueur coulait de son visage, tout à l’heure pâle, et maintenant verdâtre.
— Ah ! dit le barbier, vous avez une mauvaise mine, seigneur hôtelier, nous vous faisons, sans doute, veiller trop tard, et nous ferons mieux de nous coucher.
— J’y pensais ! dit le capitaine d’un air sombre… Puis, se tournant vers Piquillo, plus mort que vif et que ses jambes soutenaient à peine : Piquillo, va préparer, pour le seigneur Gongarella et sa nièce, la chambre de damas rouge, et tu te hâteras de les y conduire !
Piquillo prit la lanterne sourde du capitaine et sortit ; mais à peine eut-il fait quelques pas dehors qu’il s’arrêta, se tordant les bras de désespoir, ne sachant quel parti prendre. Au prix de ses jours, il eût voulu sauver Juanita ; il y était décidé ! Mais à quel saint avoir recours ? La jeune fille et son oncle, qui ne se doutaient même pas du danger dont ils étaient menacés, n’avaient d’autre défenseur et d’autre gardien qu’un enfant, seul contre tous ces bandits, et surtout contre le terrible capitaine ; et pour se décider, pour trouver un moyen de salut, Piquillo n’avait devant lui que quelques instants !
Rassemblant toutes ses forces, d’une main tenant sa lanterne, de l’autre s’appuyant sur la rampe, il se mit à monter l’escalier qui conduisait à la chambre de damas rouge. C’était au premier, et la porte donnait sur un corridor long et étroit : il se mit à préparer la chambre, à faire les lits, la couverture, cherchant toujours, et ne trouvant nulle part apparence de danger. Dans ses mouvements ou dans son trouble, il heurta sa lanterne, qui, sans s’éteindre, roula à terre. En se baissant pour la ramasser, il crut voir dans le plancher une longue coupure qui encadrait chacun des lits. Il approcha la lumière, examina de près… Plus de doute, chaque lit était placé sur une espèce de trappe assez mal jointe, car on sentait un léger courant d’air, provenant sans doute de la pièce au-dessous. En rappelant ses souvenirs, Piquillo pressentait que le danger était là… Comment ? il ne pouvait se l’expliquer au juste ; mais il comprenait bien que, si Juanita et son oncle mettaient le pied dans cette chambre fatale, ils étaient perdus, qu’ils n’en sortiraient plus ; il en était certain… tout le lui disait, et c’était lui qui était chargé de les y conduire.
— Jamais ! jamais ! s’écriait-il, et le cœur lui battait avec violence, et sa tête était en feu, et rien ne lui venait à l’idée !… Il s’élança hors de la chambre, fit quelques pas ; mais quelle fut sa terreur, lorsqu’à la lueur de sa lanterne il distingua à l’extrémité de l’étroit couloir qu’il avait à franchir, le lieutenant Caralo, qui, descendant de l’étage supérieur, un poignard à la main, se plaça à l’entrée du corridor, lui fermant ainsi le passage et tout espoir de retraite.
Le lieutenant l’avait vu, il en était sûr, et Piquillo n’avait rien pour se défendre, pas même, comme lors de son premier combat, le couteau de table dont il s’était si bien servi. Il sentit ses cheveux se dresser sur sa tête… C’en était fait de lui : tout était fini ; et cependant dans l’angoisse terrible où il se trouvait, sa dernière pensée, son dernier regret fut pour la pauvre Juanita, sa première bienfaitrice, dont sa mort allait rendre la perte inévitable.
Il savait bien qu’il n’avait ni pitié, ni grâce à attendre de son farouche adversaire ; aussi ne lui vint-il même pas à l’idée de l’implorer ; mais, par un mouvement instinctif, il referma la lanterne qu’il tenait à la main, et le corridor se trouva dans l’obscurité. Le lieutenant avançait d’un pas sourd, lentement, à tâtons, et Piquillo, immobile, serré contre la muraille, calculait, par le bruit des pas, le moment où le lieutenant allait arriver sur lui et le joindre… Il lui semblait déjà sentir le froid de son poignard… Le lieutenant le touchait presque, et il tressaillit en entendant sa Voix.
— Ce démon de Piquillo… était là tout à l’heure… je l’ai vu… Mais il n’était pas seul… ils étaient deux… oui, deux ! murmura le lieutenant d’un ton rauque et saccadé. Moi qui croyais n’en avoir qu’un à tuer ! c’est plus d’ouvrage !… mais il y a aussi plus d’agrément.
Le lieutenant était dans l’état où l’on y voit double. Sa langue épaisse avait peine à articuler les mots ; il s’appuyait de chaque côte contre la muraille. Tout prouvait que le convalescent avait oublié la modération qu’il s’était promise. Les trois bouteilles y avaient passé.
Il était gris pour le moins ! Piquillo se rassura un peu, quoique le danger fût presque le même ; car le lieutenant, quand il avait bu, était encore plus féroce qu’à jeun. Il saisit Piquillo par le bras, et Piquillo se crut perdu ; mais il entendit à l’instant tomber à terre le poignard que tenait le lieutenant, et que celui-ci avait laissé échapper de sa main avinée. Piquillo se hâta de le ramasser, et cependant n’eut pas un instant la pensée de s’en servir ; il écouta le lieutenant qui continuait d’une voix rauque :
— Tu viens d’en bas ?
— Oui, dit son interlocuteur en grossissant sa voix.
— Piquillo y est-il ?
— Oui.
— Eh bien ! écoute, camarade, dit le lieutenant en se soutenant à peine, va me le chercher… et amène-le-moi dans ma chambre…
— Mais vous n’êtes pas dans votre chambre.
— Tu crois ? c’est possible ! continua le lieutenant en chancelant. Alors, camarade, aide-moi à la retrouver… parce que j’ai beau retenir ces murailles pour les empêcher de tourner… elles tournent toujours et ma chambre avec elles…
— Tenez… tenez… la voici, lui dit Piquillo, en le poussant dans la porte qui était vis-à-vis d’eux.
C’était celle de la chambre de damas rouge.
Le lieutenant fit quelques pas dans l’obscurité, mais n’ayant plus les deux murs du corridor pour le soutenir, il trébucha, et, prêt à tomber, il se retint contre un lit qui était près de lui et sur lequel il se jeta, en répétant :
— C’est singulier ; mon lit était tout à l’heure de l’autre côté… il aura tourné aussi… Tout tourne aujourd’hui !
Piquillo s’approcha, et écouta d’une oreille attentive. Le lieutenant continuait à proférer des mots sans suite et inintelligibles ; il finit par s’endormir.
— Maintenant, s’écria Piquillo, du courage !… il n’y a plus que ce moyen de les sauver !
Il s’élança hors de la chambre, dont il ferma la porte à double tour, et descendit bravement dans la salle à manger, où le capitaine, qui l’attendait, lui dit d’un air impatient :
— Eh bien ?…
— Eh bien, répondit Piquillo, la chambre du seigneur Gongarello et de sa nièce est prête, et je vais avoir l’honneur de les y conduire.
— À merveille ! s’écria le barbier ; car je tombais de sommeil. Nous sommes à vous, seigneur page.
Et il se mit à prendre son chapeau et sa valise, tandis que Juanita cherchait sa mantille.
Pendant ce temps, Piquillo, pâle, immobile et glacé, ressemblait à une statue de marbre. Le capitaine, qui s’aperçut de son trouble, s’approcha de lui. Piquillo tressaillit, et crut tout perdu ; mais, au lieu du ton brutal qu’il avait d’ordinaire, le capitaine lui dit avec douceur :
— Tu commences donc à savoir de quoi il s’agit ? C’est bien. Seulement il faudra à la prochaine occasion que nous ayons un peu plus d’aplomb et d’assurance ; mais pour une première fois, ce n’est pas mal.
— Nous voici prêts et disposés à vous suivre, mon jeune ami, dit gaiement le barbier Bonsoir, messeigneurs. À demain, seigneur hôtelier ; demain nous compterons.
— Demain, dit gravement le capitaine, tous les comptes seront réglés. Votre appartement vous attend, bonsoir. Quant à moi, je reste encore avec ces messieurs pour achever quelques bouteilles.
Il salua ses deux hôtes de la main ; puis dit à voix basse à Piquillo :
— Conduis-les à leur chambre, et monte te coucher… C’en est assez, on ne t’en demande pas davantage pour aujourd’hui, le reste nous regarde.
Piquillo, tenant sa lanterne, passa devant Gongarello et sa nièce. La porte de la salle à manger se referma. Tous trois se trouvèrent sur l’escalier… Piquillo, dont le cœur battait encore de frayeur autant que de joie, se mit à monter si rapidement que le barbier s’écria à haute voix :
— Eh bien ! où va-t-il, où va-t-il, ce jeune étourdi ?
— Qu’est-ce ? dit le capitaine, qui rouvrit la porte de la salle à manger ; qu’y a-t-il ?
À cette voix, Piquillo, comme foudroyé, s’arrêta.
— C’est moi, maitre, moi qui montais trop vite, tant j’avais hâte d’arriver !
— C’est bien, dit froidement le capitaine. Et il referma la porte.
En l’entendant retomber, Piquillo respira, et cette fois il eut le courage de monter lentement l’escalier.
Arrivé au premier, et en passant près de la porte de damas rouge, il ne put se défendre d’une nouvelle frayeur, et il s’arrêta.
— Est-ce ici ? dit le barbier.
— Non, lui répondit Piquillo en cherchant à cacher son trouble, et il continua à monter.
Le barbier, surpris, ainsi que Juanita, de l’air silencieux et de la physionomie bouleversée de leur guide, garda le silence et le suivit, non sans s’étonner de monter aussi haut.
Ils arrivèrent ainsi au grenier qui servait de chambre à coucher à Piquillo. Il les fit entrer, ferma sa porte, et, mettant sa main sur la bouche du barbier qui voulait parler :
— Silence ! silence !… S’écria-t-il, ou vous êtes perdus !
Le barbier sentit à l’instant sa gaieté et son sang-froid l’abandonner.
— Perdus ! perdus ! s’écria-t-il en balbutiant.
Il n’en put dire davantage et n’eut même pas la force d’ajouter : Comment ? Et pourquoi ? Ses dents se choquaient horriblement l’une contre l’autre.
— Juanita, continua Piquillo, vous ne me reconnaissez pas ?
— Non, fit celle-ci, en le regardant attentivement.
— Vous avez oublié les deux pauvres petits mendiants qu’il y a deux ans, près de l’hôtel du Soleil-d’Or, vous avez empêchés de mourir de faim ?
— L’ami de Pedralvi ! s’écria la jeune fille en rougissant,
— Oui… Pedralvi.. mon ami, mon camarade. Qu’est-il devenu ?
— Resté depuis ce temps près de moi comme garçon hôtelier… il pleurait en me quittant, et disait bien qu’il nous arriverait malheur.
— Non, tant que je serai près de vous… Écoutez-moi.
Et le fidèle compagnon de Pedralvi se mit à leur apprendre, en peu de mots, en quelle espèce d’hôtellerie ils étaient tombés, quels étaient la profession et les projets du capitaine, et les seules chances de salut qui leur restaient.
— Ils sont tous allés se coucher, leur dit-il, et dormiront d’ici à une heure. Selon son habitude, le capitaine descendra probablement à la cave… Nous aussi, alors, nous descendrons, et nous chercherons à sortir de cette maison infernale. Par quels moyens ? je n’en sais rien encore. Nous verrons quand nous y serons. Attendez, je vais faire le guet.
Il laissa le barbier et sa nièce plus morts que vifs, et descendit quelques marches de l’escalier. Il se coucha le ventre à terre, et il écouta, épiant dans l’ombre et recueillant le moindre bruit. L’attente fut longue. Enfin il entendit tous les bandits rentrer successivement dans leur chambre. Il descendit quelques marches de plus, s’arrêta au premier, et écouta encore tremblant et respirant à peine. Au rez-de-chaussée, la porte de la salle à manger s’ouvrit. Le capitaine sortit, tenant une lanterne à la main. Il se mit à descendre les marches qui conduisaient à la cave, dont il laissa derrière lui la porte toute grande ouverte. Piquillo, lentement et de loin, se hasarda à le suivre. Il referma cette porte à double tour, retira le trousseau de clés et remonta quatre à quatre les marches qui conduisaient à son grenier.
— Maintenant, dit-il à ses deux amis, il n’y a plus de temps à perdre… Venez… Parmi ces clés, nous en trouverons bien une pour ouvrir la porte qui donne sur le bois. Si cela nous manque, nous n’aurons plus rien à faire.
— Qu’à nous recommander à Dieu ! dit Juanita.
Quant au barbier, il ne disait rien.
— Et notre mule et notre carriole ? s’écria la jeune fille.
— Il ne faut plus y penser ! Si nous pouvons sortir, nous irons au hasard ; nous marcherons toute la nuit dans le bois, et demain nous trouverons peut-être aide et protection.
— Ah ! vous êtes notre sauveur, s’écria Juanita, en lui jetant ses bras autour du cou.
— Il n’est pas temps encore de me remercier… je n’ai encore rien fait pour vous ; venez vite.
— Oui. Mon oncle, venez donc ; il y va de nos jours, et vous restez là !
Gongarello aurait bien voulu faire autrement, mais cela lui était impossible. Sa tête était pesante, ses yeux se fermaient ; pressé par la terreur, il avait hâte de fuir, et ses jambes lui refusaient le service, et des bâillements précurseurs du sommeil l’empêchaient de parler Enfin, après une lutte de quelques instants, vaincu et succombant sous l’effort, il tomba sur des bottes-de foin, et à la surprise, au grand effroi de sa nièce et de Piquillo, il s’endormit.
Tous leurs efforts pour le réveiller et le relever furent inutiles. Il balbutiait quelques mots… il faisait quelques pas à peine et retombait dans son sommeil.
— Ah ! s’écria Piquillo ! c’est ce vin étranger… ce prétendu vin de France ! Pour ne courir aucun danger, pour n’avoir rien à craindre de leur victime, ils commencent par l’endormir, et par lui ôter l’usage de ses sens.
— Je comprends… je comprends, s’écria Juanita épouvantée, qu’allons-nous devenir ?
— Quand nous le voudrions, il nous serait impossible de porter votre oncle, même à nous deux… il ne faut donc songer qu’à vous ! à vous, ma bienfaitrice ! venez donc ! hâtons-nous de descendre, car déjà nous avons perdu trop de temps !
— Non, dit la jeune fille avec résolution, quoi qu’il puisse arriver, je n’abandonnerai pas mon oncle.
— Et moi, Juanita, quelque danger qui me menace, je ne vous quitte pas ! nous mourrons tous les trois ensemble.
Et il s’assit à côté d’elle sur le foin.
Alors Juanita, qui s’était rapprochée de son oncle, croisa ses bras sur sa poitrine, baissa la tête, et se mit à prononcer avec ferveur des mots inconnus.
— Que fais-tu ? s’écria Piquillo étonné.
— Je prie le Dieu de mes pères, le Dieu de Mahomet, car mon oncle descend, comme moi et Pedralvi, des Maures de Grenade.
— Et moi aussi, s’écria Piquillo avec joie, ces bandits me l’ont dit en apercevant des signes arabes tracés sur mon bras.
— Eh bien, dit Juanita, en lui tendant la main… eh bien, pauvre enfant d’Ismal, tu mourras avec tes frères !
— Cela vaut mieux que de vivre seul, répondit Piquillo.
En ce moment, un grand tapage retentit dans la maison.
Il paraît que, dans la cave et au milieu de l’obscurité, un combat acharné se livrait entre le capitaine et son lieutenant. Celui-ci, bien qu’il fût gris, s’était réveillé en sentant descendre son lit ; et quoiqu’il eût à peine recouvré sa raison, il avait compris aisément qu’on voulait l’étrangler. Il s’était élancé lui-même à la gorge de l’assaillant, qui, ne s’attendant à aucune résistance, avait été renversé, lui et sa lanterne, par cette attaque aussi vigoureuse qu’imprévue. Les deux combattants roulaient à terre, et comme leurs forces à peu près égales étaient doublées par la rage, ils se déchiraient des ongles et des dents, le lieutenant n’ayant plus son poignard, et le pistolet que Juan-Baptista portait à sa ceinture ayant glissé à terre pendant leur lutte acharnée.
Aux hurlements des combattants, au bruit effroyable qui se faisait dans la cave, tous les bandits s’étaient réveillés. Au secours ! leur criait Carnego, une troupe d’alguazils ou de familiers du saint-office assassinent le capitaine… à nous, mes amis, brisez cette porte !
Les uns, armés de pioches, les autres de leviers et de pinces de fer, attaquaient la porte et la muraille qui ne pouvaient longtemps leur résister ; c’était là la cause du bruit effroyable que venaient d’entendre les deux prisonniers ; quant au troisième, il n’entendait rien.
— Il n’y a plus d’espoir, s’écria Piquillo, qui venait de se hasarder au haut de l’escalier, et qui avait deviné ce qui se passait. Nous voudrions fuir maintenant que nous ne le pourrions plus. Tous ces brigands sont sur pied ! les voilà dans l’escalier, parcourant toute la maison… et s’ils venaient ici me réveiller et me chercher !
Il regarda Juanita avec effroi, et la pauvre fille, saisie d’une horrible crainte qui ne s’était pas encore offerte à sa pensée, se précipita vers Piquillo, en s’écriant involontairement : Sauvez-moi ! sauvez-moi ! puis elle regarda son oncle, et dit en laissant tomber ses bras : Folle que je suis !… c’est impossible !
— Non, non, s’écria Piquillo, frappé d’une idée soudaine… non, ce n’est pas impossible !…
Le grenier où se trouvaient renfermés les trois prisonniers, n’avait qu’une fenêtre pratiquée dans le toit et donnant sur la forêt… Piquillo poussa le volet, et aux rayons de la lune, Juanita aperçut de loin le sommet des arbres agités par le vent.
— Vous voyez, s’écria son jeune compagnon, qu’il nous reste encore un moyen de salut.
— Je comprends, dit la jeune fille en s’approchant de la fenêtre élevée à pic au-dessus du sol à une hauteur effrayante ; oui, grâce au ciel, c’est bien haut… et s’ils viennent, on peut se jeter…
— Non pas se jeter, répondit Piquillo, mais descendre !
— Et mon oncle ?
— Lui aussi, je m’en charge.
— Et comment ?
— Tenez ! ne voyez-vous pas ?
Et il lui montra au-dessous du toit qui avançait en saillie, la poulie et la corde avec lesquelles on montait le foin et la paille dans le grenier où ils étaient.
— Si vous n’avez pas peur, si vous vous fiez à moi.
— Oui, répondit intrépidement la jeune fille. Alors, et par un nœud coulant, il lui passa la corde autour du corps et sous les bras !
— Ne regardez pas l’abîme où je vais vous descendre, lui dit-il, fermez les yeux jusqu’à ce que vous sentiez la terre sous vos pieds, et alors renvoyez-moi la corde.
Et il se mit à descendre la jeune fille lentement et avec précaution.
Bientôt elle disparut à ses yeux en tournoyant dans l’espace ; quelques secondes après, la corde ne tourna plus et s’arrêta. Sans doute Juanita était arrivée saine et sauve, car la corde, à laquelle il donna une légère secousse, remonta seule.
C’était le tour du barbier, et c’était plus difficile ; il se réveillait, et s’aidait à peine. Mais, sans le consulter sur le voyage périlleux qu’il allait lui faire entreprendre, Piquillo le mit en route de la même manière que Juanita, se contentant de retenir de toutes ses forces ce fardeau, que son poids seul entraînait vers la terre par une force d’attraction toute naturelle.
Il entendit un choc assez pesant : c’était le barbier qui arrivait à sa destination sans avaries ; et la corde, détachée par Juanita, remonta de nouveau. Cette fois et se voyant seul à opérer sa descente, Piquillo attacha fortement à une poutre du grenier un bout de la corde, et se lança intrépidement dans les airs, en se laissant glisser jusqu’à terre.
— Êtes-vous là, mes amis, et sans accident ? leur dit-il à voix basse.
— Oui, brave jeune homme, oui, mon sauveur, répondit Gongarello, que Piquillo fut étonné d’entendre parler aussi distinctement ; mais, par une heureuse révolution, quand il était arrivé à terre, le barbier se trouvait mieux, du moins pour quelques instants. Le mouvement de balancement et d’oscillation qu’il venait d’éprouver dans son voyage aérien avait produit sur lui, et grâce à cette crise salutaire, le même effet que les voyages maritimes sur ceux qui n’en ont pas l’habitude. Soustrait ainsi en partie à l’influence de l’opium que contenait le vin du capitaine, le barbier avait donc en ce moment retrouvé sa tête, et par conséquent sa langue.
— Je n’oublierai jamais le service que vous venez de nous rendre, mon jeune ami…
— Silence ! lui dit Piquillo, qui, interrompant les élans de sa gratitude, lui fit observer qu’ils étaient hors de l’hôtellerie, il est vrai, mais encore devant la porte ; qu’on pouvait sortir et les poursuivre ; qu’ils n’avaient guère de temps d’ici au point du jour, et que ce qu’il y avait de plus prudent était de s’enfoncer dans la forêt, et de s’éloigner le plus possible.
Le barbier se rendit sans peine à la justesse de ces observations, car la crainte lui était revenue avec la raison, et on entendait dans l’intérieur de l’hôtellerie un redoublement de cris et d’imprécations qui n’avaient rien de rassurant pour les fugitifs. Ils se précipitèrent donc tous les trois dans la forêt, et marchèrent devant eux au hasard pendant près d’une heure ; mais au bout de ce temps le barbier déclara qu’il ne pouvait aller plus loin, que les jambes lui manquaient, et que le sommeil le reprenait malgré lui.
— Encore ! s’écria Piquillo, avec désespoir.
Le barbier ne répondit pas, s’étendit sur la mousse, et Piquillo le secoua vivement par le bras en lui répétant :
— Quoi ! dormir encore ?
— Oui, mon garçon !… Un bien mauvais rêve… murmurait le barbier, mais c’est plus fort que moi.
Et fermant les yeux sur tous les dangers qui le menaçaient. le barbier s’endormit.
— Écoutez ! écoutez ! dit Juanita en serrant la main de Piquillo, n’entendez-vous pas ?… Ce sont eux !
— Oui, dit Piquillo en prêtant l’oreille, un bruit de chevaux.
— Et ils viennent de ce côté ! dit la jeune fille avec effroi.
VI.
le carrefour de la forêt.
Revenons à l’hôtellerie de Bon-Secours, où, après de grands efforts, on était parvenu à briser la porte de la cave. La troupe s’était précipitée vers l’endroit d’où partait le bruit, et à la lueur des torches un spectacle horrible s’offrit à leurs yeux : c’étaient le capitaine et son lieutenant, sanglants, défigurés, et qui, épuisés par une lutte aussi furieuse et aussi longue, tous deux renversés et se roulant à terre, n’avaient pas encore lâché prise. Aussitôt que la clarté des flambeaux se fut reflétée sur les murailles sombres et humides de la cave, un cri de surprise s’éleva, et les combattants eux-mêmes s’arrêtèrent.
— Toi ! s’écria le capitaine furieux, toi, Caralo, qui oses porter la main sur moi !
— Vous, capitaine ! répondit le lieutenant dégrisé, vous ! qui vous permettez de m’étrangler et de m’assassiner… pour qui me prenez-vous ?
— Je te prenais pour un de nos hôtes, lui dit le capitaine en lui tendant la main avec bonhomie ; mais c’est ta faute.
— C’est la vôtre.
— Pourquoi n’es-tu pas chez toi ?
— Au fait, dit le lieutenant en regardant autour de lui avec surprise, c’est singulier.
— Pourquoi as-tu été te coucher dans la chambre d’honneur, qui ne t’était pas destinée ?
Caralo eut beau chercher dans ses souvenirs, il ne se rappelait rien ; il ne pouvait rien expliquer.
— Et le barbier et sa nièce ? s’écria le capitaine, d’autant plus furieux qu’il comprenait moins.
— Et l’on s’élança en tumulte vers la chambre rouge… personne ! On chercha dans les autres pièces de la maison… personne… aucune trace !
— Qu’est-ce que cela signifie ? répétait le capitaine dans le dernier paroxysme de la colère.
— Je vais vous le dire, répondit gravement Carnego, en s’avançant au milieu du cercle. Ce maudit Maure était, comme tous les siens, un hérétique et un sorcier.
— Allons donc ! fit le capitaine en haussant les épaules.
— Ne vous rappelez-vous pas la mine qu’il avait en vous disant : Demain, nous compterons ensemble ? Il a tenu parole : il est parti sans payer.
— Parti ! Et comment ?
— Que sais-je ! comme tous les sorciers ! disparu avec sa nièce dans les airs.
Et Carnego ne croyait pas si bien dire.
— C’est lui, continua-t-il, qui a ensorcelé la maison ; c’est lui qui nous a fait battre les uns contre les autres, et veuille le ciel que, pour nous être attaqués à lui, il ne nous arrive pas de plus grands malheurs !
Et Carnego fit le signe de la croix.
Le capitaine était confondu, et, se rappelant l’air ironique du barbier, il commençait presque à croire aussi à la sorcellerie, solution la plus naturelle, explication la plus simple de tout ce qu’on ne comprend pas ; mais bientôt il poussa un cri en disant :
— Et Piquillo !… C’est lui qui a conduit le Maure dans la chambre rouge ; lui seul peut nous aider à découvrir la vérité.
L’on monta à la chambre de Piquillo. Elle était fermée. On frappa vainement ; on enfonça la porte… Personne.
Carnego s’écria :
— Que vous disais-je ? Le Maure l’aura aussi enlevé.
Après une heure de recherches infructueuses dans tous les recoins de la maison, chacun commençait à croire que Carnego pouvait bien avoir raison, et se disposait à regagner son lit ; mais en ce moment on frappa rudement à la porte principale, qui donnait sur la forêt. On entendit en même temps un piétinement de chevaux et un bruit sourd de voix.
— Qu’est-ce que ce peut être ? dit Juan-Baptista étonné.
En effet, sous l’administration du duc de Lerma et malgré mille plaintes répétées, on n’avait guère l’habitude d’inquiéter les gens de la profession du capitaine, et la sûreté des grandes routes était la chose dont on s’occupait le moins.
— Encore quelque sorcellerie du Maure ! murmura Carnego.
— Impossible, répondit le maître de l’hôtellerie ; et avançant sa tête par une lucarne, il demanda : Qui va la ?
Une voix jeune et fière répondit ;
— Régiment de la Reine.
— Soyez les bienvenus, seigneurs cavaliers. Vous voyagez à la fraiche ; c’est sagement vu.
— Ce qui l’est encore plus, c’est, chemin faisant, de purger la route de tous les coquins qui l’infestent, à commencer par vous, seigneur hôtelier.
— Je suis reconnu, se dit le capitaine, qui ne voyait plus moyen de garder l’incognito.
— Descends vite, « dit-il bas à Caralo, son lieutenant, et dispose notre bagage pour que dans un instant nous partions tous les deux par la petite porte secrète. Les autres s’arrangeront comme ils pourront.
Et il se remit à parlementer par la fenêtre avec le jeune officier.
— Je crois, seigneur cavalier, que vous vous méprenez. Vous en serez convaincu, si vous daignez, vous et vos gens, accepter chez moi l’hospitalité.
— Elle coûte trop cher, répondit le jeune officier. Vous nous devez compte avant tout du barbier Gongarello, votre hôte de la nuit dernière ; où est-il ?
— Vous voyez bien, répéta Carnego à demi-voix, toujours ce maudit Maure.
— Cette fois, tu peux avoir raison. Puis élevant la voix et s’adressant à l’officier : J’ignorais que le seigneur barbier fût de vos amis, dit Juan-Baptista d’un air goguenard.
— C’est assez. Ouvrez à l’instant ; vous êtes mes prisonniers.
— Oui, ouvrez, s’écria un brigadier, ou sinon… quoique notre commandant Fernand d’Albayda, officier du régiment de la Reine, n’ait pas l’habitude d’avoir affaire à des bandoleros tels que vous, et qu’il laisse un pareil soin à la Sainte-Hermandad, ouvrez sans résistance, sinon pas un de vous n’échappera !
En ce moment le lieutenant venait de remonter, et disait au capitaine à voix basse :
— Toute la maison est cernée par des cavaliers ; il n’y a qu’un parti à prendre, celui de se rendre. C’est mon avis.
— Ce n’est pas le mien, répondit froidement le capitaine. Et se remettant à la fenêtre : Mille pardons, seigneur Ferdinand d’Albayda, officier du régiment de la Reine, d’avoir fait attendre aussi longtemps Votre Seigneurie, qui sans doute est pressée. Vous me faites l’honneur de me demander une réponse : la voici.
Et il tira sur le jeune officier. La balle effleura la plume de son chapeau, et alla derrière lui blesser à l’épaule le brigadier Fidalgo d’Estremos, qui était très-aimé de don Fernand. Celui-ci, alors, montrant à ses soldats les bandits qui s’embusquaient derrière les fenêtres :
— Feu ! leur dit-il, et pas de quartier !
En même temps, et par son ordre, une partie de ses gens mit pied à terre, escalada le petit mur d’une cour que don Juan-Baptista n’avait pas eu le temps de fortifier. L’assaut commença, et l’hôtellerie de Buen Socorro, dont la garnison se défendait avec vigueur, se vit bientôt attaquée sur tous les points.
Disons maintenant, comment, et par quel hasard le capitaine, jusque-là si tranquille, s’était ainsi vu assiégé à l’improviste.
Piquillo et sa compagne avaient entendu distinctement le pas de plusieurs chevaux qui se dirigeaient vers eux. Ils étaient alors sur la lisière du bois, dans un carrefour où aboutissaient plusieurs routes. Ils auraient pu s’éloigner et disparaître dans le taillis ; mais peut-être n’auraient-ils plus retrouvé Gongarello, et ils ne voulaient pas l’abandonner à la vengeance de leurs ennemis. Persuadés que cette fois rien ne pouvait les sauver, Juanita et son jeune défenseur s’appuyaient l’un contre l’autre, tous deux tremblants de crainte. Piquillo entendit même la jeune fille, non pas prononcer, mais murmurer à demi-voix ces mots : Adieu, Pedralvi ! La frayeur qui troublait leurs sens et leurs yeux, les avait empêchés de s’apercevoir que cette troupe si nombreuse qui les poursuivait se bornait à deux cavaliers ; mais la lune, en sortant d’un nuage, leur permit de les distinguer parfaitement au moment où ils traversaient le carrefour de la forêt.
Ils venaient sans doute de faire d’une seule traite une course longue et rapide, car, au moment où ils sortirent de la route obscure qu’ils suivaient, ils mirent leurs chevaux au pas. L’un d’eux marchait en avant ; l’autre, d’un âge mûr, suivait à distance et avec respect. Il était évident que le premier était le maître. C’était un jeune homme dont la taille était gracieuse et élancée, la figure douce et mélancolique. Son habillement ne ressemblait point au costume espagnol d’alors.
Un sabre suspendu par une chaîne d’or tombait à son côté ; il montait un cheval arabe magnifique qui était couvert de sueur ; il le flattait de la main ; et le cheval, joyeux des caresses de son maître, relevait la tête avec fierté, et, frappant le sol du pied, semblait dire : Allons, repartons. Mais le jeune homme lui dit en arabe : Non, Kaled, non, mon bon compagnon, reposons-nous un instant ; il y a loin d’ici chez mon père.
À ces mots, Juanita rassurée, dit bas à Piquillo :
— Ne crains rien, il a parlé la langue du pays c’est un Maure.
Et Piquillo quitta la clairière du bois, s’élança au milieu du carrefour, se jetant à genoux au-devant du cheval, mais l’animal se renversa sur ses pieds de derrière, comme s’il eût craint quelque danger, et qu’il voulût en préserver son maître.
— Je comprends, dit le jeune homme en causant toujours en arabe à son cheval, c’est une race que tu n’aimes pas, un mendiant espagnol ; puis s’adressant à Piquillo en pur castillan : Il est bien tard pour demander l’aumône, lui dit-il froidement. Si tes compagnons sont cachés dans ce bois, dis-leur que, le matin, j’ai de l’or pour ceux qui en demandent… mais qu’à cette heure-ci… je n’ai que du fer. Et portant la main à son sabre, il ajouta avec fierté : Va-t’en ! pendant que son vieux domestique, s’approchant de lui, couchait en joue Piquillo avec un tromblon dont le vaste canon contenait au moins une demi-douzaine de balles.
Juanita effrayée s’élança, s’écriant en arabe.
— Ami ! ami ! et enfant du même Dieu !
À ces mots, le jeune homme sauta à bas de son cheval, qu’il confia à son domestique. Il courut à Piquillo, encore à genoux au milieu du carrefour, et lui tendant la main, il lui dit dans la langue de leurs pères :
— Me voici, frère ; que me veux-tu ?
Et il l’embrassa.
Juanita lui raconta alors en peu de mots les dangers auxquels ils venaient d’échapper, grâce à Piquillo. Pendant ce temps, le jeune Maure regardait avec attention et en silence ; puis, frappant sur l’épaule de Piquillo, il lui dit avec un son de voix qui lui alla au cœur :
— C’est bien, mon enfant, continue, tu deviendras un honnête homme.
Piquillo tressaillit de joie. C’était la première fois qu’on lui disait : Courage ! c’est bien.
Il regarda le jeune homme avec reconnaissance.
— Ah ! si l’on m’avait toujours parlé ainsi ! s’écria-t-il. Mais quand vous n’y serez plus, que deviendra le malheureux mendiant ?
— Tu ne seras plus mendiant… Ce sont les Espagnols qui mendient ! Mais toi, continua-t-il, en écrivant quelques mots sur des tablettes qu’il lui donna, tu viendras me trouver là où je te l’indique, et tu apprendras de nous à travailler pour continuer à être honnête homme ; mais avant tout, et pour faire le voyage, tiens, frère, prends cette bourse et compte sur moi.
Piquillo, attendri, lui baisa les mains, et le jeune Maure, se tournant vers Juanita :
— Quant à toi, mon enfant, il faut que je te sorte de cette forêt, ainsi que ton oncle le barbier. Une affaire importante m’appelle. On m’attend. Mais n’importe ! je vous mènerai jusqu’au premier endroit habité, et de là nous trouverons les moyens de vous faire conduire où vous voudrez. Le seigneur Gongarello peut-il se soutenir sur ses jambes ?… Oui, il me semble qu’il se réveille, et qu’il nous comprend. Hassan, dit-il à son domestique, tu t’en chargeras. Place-le sur ton cheval. Pour peu qu’il ait seulement assez de force pour se tenir contre toi, Akbar vous portera bien tous les deux, j’en réponds, et si doucement, qu’Aben-Abou, notre frère, pourra, s’il le veut continuer son sommeil.
— Non, grâce au ciel ! cela commence à se dissiper, s’écria le barbier, qui, quoique dormant à moitié, avait entendu à peu près toute la conversation. J’ai cru, il y a deux heures, mourir de sommeil, ce qui était fort heureux, car sans cela je serais mort de peur ; mais maintenant, et en si bonne compagnie, je ne crains plus rien, et, par Mahomet ! continua-t-il avec satisfaction, heureux de pouvoir employer en ce moment en plein air, une formule proscrite, dont sa prudence habituelle l’empêchait de se servir ; par Mahomet ! je serai sur votre cheval aussi bien que sur la jument du Prophète ! Il ne s’aviserait pas de jeter par terre un compatriote, n’est-ce pas ? lui dit-il en langage maure, en le caressant de la main ; tu es trop bon Arabe pour cela.
Le cheval se prit à hennir, et le barbier, persuadé qu’il l’avait compris, n’eut plus aucune frayeur.
— Quant à Juanita, continua le jeune homme, il faut bien qu’elle me permette de la placer devant moi, en travers de mon cheval ; je lui jure qu’elle n’à rien à craindre ; elle est si légère que Kaled ne s’apercevra pas de ce surcroit de fardeau, Pour vous, dit-il à Piquillo, il nous est impossible de vous emmener ; mais bientôt le jour va paraître : vous pourrez, sans danger, sortir du bois. N’oubliez pas ce que vous recommandent ces tablettes. Dans huit jours je vous attends. Adieu, adieu, frère.
Il accompagna ces derniers mots d’un salut si élégant et d’un sourire si gracieux, que Piquillo se sentait tout ému, et d’avance se vouait corps et âme au jeune étranger.
Celui-ci, lâchant la bride à son cheval, qui piaffait d’impatience, disparut en un instant.
Il fut suivi par Hassan, portant Gongarello en croupe.
Le barbier ne parlait plus ; mais, soit frayeur, soit reconnaissance, il serrait vivement dans ses bras son compagnon de voyage.
Piquillo seul, resté au milieu de la forêt, suivait toujours des yeux l’inconnu qui venait de disparaitre, et dont le son de voix, dont les paroles retentissaient encore à son oreille !…
Après une heure de marche, Yézid, Juanita et Gongarello étaient arrivés sans accident au village d’Arnedo. Quoiqu’on fût encore au milieu de la nuit, le jeune Maure et son vieux serviteur Hassan, que des soins plus chers réclamaient ailleurs, continuaient leur route, et le barbier et sa nièce, laissés par eux à la porte d’une posada, frappaient à grands coups pour se faire ouvrir. Gongarello, qui ne dormait plus, réveillait tout le monde, et, pendant que l’hôtelier et ses gens se mettaient aux fenêtres, pendant que le barbier, avant même d’être entré, racontait déjà son histoire, et les périls auxquels ils venaient d’échapper, un bruit d’hommes et de chevaux se faisait entendre dans la rue : c’était une compagnie du régiment de la Reine qui se rendait à Madrid pour les fêtes, et qui faisait route la nuit pour éviter la grande chaleur du jour.
Dans une pareille marche, les strictes règles de la discipline militaire n’étaient pas rigoureusement observées. Les soldats causaient entre eux, laissant tomber négligemment la bride sur le cou de leurs chevaux, qui en profitaient pour conduire à leur tour leurs cavaliers et marcher à leur guise. Les officiers riaient, parlaient de leurs dernières garnisons, c’est-à-dire de leurs dernières bonnes fortunes. Il n’est donc pas étonnant que l’avant-garde, ayant vu les fenêtres de l’hôtellerie illuminées, et le barbier pérorant dans la rue, se fût arrêtée un instant pour l’écouter, au risque de faire encombrement, ce qui ne manqua pas d’arriver.

Aussi Fernand d’Albayda, qui commandait la compagnie, étonné de voir le centre de la colonne refluer sur l’arrière-garde, s’était porté en avant, et avait trouvé le barbier au milieu d’un auditoire à pied et à cheval.
À la vue d’un officier supérieur, le barbier recommença pour la troisième fois son récit, qui, grâce à l’imagination naturelle aux Maures et aux Arabes, s’embellissait chaque fois de quelques nouveaux détails. Des cris d’indignation s’élevaient de la foule ; chacun avait été plus ou moins exposé à se trouver dans une position pareille, et l’on avait beau s’adresser à tous les alcades et corrégidors de la Castille et de la Navarre, ils n’y pouvaient rien. Les alguazils, gens établis et mariés, avaient peur des bandits, et quant aux gens de la Sainte-Hermandad, ils buvaient avec eux.
— Oui, seigneur officier, criait le barbier, que sa nièce voulait en vain retenir, mais dans cette occasion il avait eu trop peur pour être prudent ; oui, seigneur officier, disait-il en s’adressant à Fernand d’Albayda, puisque vous allez à Madrid, portez au roi les justes plaintes d’une population éplorée, ou faites que son ministre, en allant à son château de Lerma, veuille bien passer une seule fois la nuit dans la sierra de Moncayo, que nous venons de parcourir, et si nous sommes assez heureux, ce qui ne peut manquer d’arriver, pour que la voiture de Son Excellence soit aussi arrêtée, il est probable que nous aurons justice.
— Vous l’aurez sans cela, mes amis, dit Fernand d’Albayda en souriant, je vous le promets ; et, après avoir demandé au barbier quelques nouveaux renseignements qui lui étaient nécessaires, il se retourna vers ses soldats : À vos rangs… leur dit-il, et se mettant à leur tête, le jeune officier s’était dirigé vers la forêt.

Nous avons vu leur arrivée devant l’hôtellerie de Buen Socorro et le commencement du siége ; mais pendant que se livrait le combat dont nous ignorons encore l’issue, et dont Piquillo ne se doutait pas, le pauvre garçon était resté dans l’extase, dans le ravissement.
Il pensait à son nouvel ami, au jeune Maure si distingué, si élégant, qui lui avait dit : Mon frère ! et qui, en lui frappant sur l’épaule, avait répété plusieurs fois : C’est bien ! Jamais il n’avait éprouvé de semblables émotions ; c’était une joie douce et intérieure ; c’était comme un rayon projeté sur lui-même, qui l’éclairait enfin et le guidait dans l’obscurité ; jusque-là il n’avait été honnête qu’au hasard et à l’aventure. En sauvant Juanita et son oncle, il n’avait obéi qu’à un instinct dont il ne se rendait pas compte ; mais c’était une bonne action, c’était bien, car l’inconnu l’avait dit !
Pedralvi n’avait été pour lui qu’un ami, un camarade ; l’inconnu lui paraissait bien plus… c’était comme un être supérieur, une divinité ! Aussi avait-il peine à se persuader que tout ce qu’il avait entendu n’était pas un songe. Il ne pouvait croire qu’il y eût désormais une main tutélaire qui se chargeât de le conduire et de le protéger… et pour mieux s’en convaincre alors, il pressait contre son cœur les tablettes que lui avait remises l’inconnu. Il est vrai (et seulement alors il y pensait) qu’il ne savait pas lire ; mais qu’importe, il s’adresserait à un autre, dès qu’il ferait jour et qu’il pourrait sortir de la forêt.
Accablé par toutes les fatigues de la journée et bercé des plus douces espérances, il choisit un endroit bien épais du bois, et, tenant son trésor serré dans ses mains, il s’endormit sur l’herbe en pensant à l’inconnu ! pendant que la fraicheur du soir, le frémissement du feuillage et le parfum d’une nuit d’été enivraient tous ses sens et faisaient passer devant lui les rêves les plus riants et les plus doux.
Le matin l’air était lourd et pesant. Tout annonçait une chaleur plus brûlante encore que celle de la veille ; le ciel, chargé d’électricité, permettait à peine de respirer, et Piquillo haletant, oppressé, se réveilla tout à coup en sursaut. Il faisait grand jour. Une main forte et vigoureuse le secouait vivement, et en ouvrant ses yeux à moitié endormis encore, quelle fut sa surprise, ou plutôt le vertige qui vint le saisir, quel froid soudain circula dans toutes ses veines ? c’était sortir du ciel pour retomber dans l’enfer ; car le démon, la bête fauve qui était là devant lui, le serrant d’une étreinte mortelle, c’était Juan-Baptista Balseiro !… c’était le capitaine lui-même.
Il était dans un affreux désordre… couvert de sang, noirci par la poudre et ses vêtements déchirés. Il tenait à la main la bourse et les riches tablettes qu’il venait d’arracher à Piquillo endormi, et le regardant avec un contentement et un rive féroces :
— Ah ! ah !… tu pensais m’échapper !… tu me croyais déjà mort… tu as appris bien vite à trahir ceux qui t’ont nourri, à les dénoncer, comme un espion… comme un alguazil !
— Moi ! s’écria Piquillo tremblant.
— Oui… cet officier et ces cavaliers que tu nous as envoyés voulaient déjà réaliser la prédiction de ton complice, de ce damné hérétique et sorcier, le Maure Gongarello, que nous retrouverons.
— Seigneur capitaine, j’ignore ce que vous voulez dire.
— Bien… bien… nous allons faire nos comptes, comme disait le barbier ! Envoyés par toi et guidés par les instructions que tu leur avais données, ils ont cerné l’hôtellerie de Buen Socorro ! et comme je refusais de me rendre… ils y ont mis le feu, les soldats du roi, oui, entends-tu bien ? ils ont mis le feu à ma maison, à ma propriété ; le Maure Gongarello avait prédit que je serais brûlé, et il s’était arrangé avec toi, pour que la prédiction ne tardât pas à s’accomplir !
— Écoutez-moi, monsieur le capitaine,
— Est-ce qu’ils ont rien écouté ? est-ce qu’ils n’ont pas tiré sur nous pendant que nous cherchions à nous sauver des flammes !… Que l’enfer les extermine, eux et mes compagnons qui se sont laissé tuer où prendre comme des renards dans leurs terriers… tous braves gens, qui valaient mieux que toi et moi. Les soldats du moi comptaient bien me prendre… mais je suis le seul, où à peu près, qui leur ait échappé au milieu des balles… et je ne serai pas pendu ! et c’est toi, Piquillo, toi, qui vas l’être à l’instant, et de ma main.
— Je ne suis pas coupable, seigneur capitaine, je vous le jure ! s’écria Piquillo tremblant, écoutez-moi !
— Est-ce que tu me prends pour un corrégidor, ou pour un conseiller de justice ? est-ce que tu crois que je vais m’amuser à t’écouter ? J’ai juré que toi, ton satané barbier, et surtout cet incendiaire, don Fernand d’Albayda, vous ne finiriez vos jours que de ma façon, et je vais commencer par toi, en attendant les autres.
Et tenant toujours Piquillo vigoureusement serré de la main gauche, il arrachait de la droite quelques branches jeunes et flexibles pour en faire un lien. Quand il en eut détaché ainsi une demi-douzaine des plus belles et des plus longues, il se mit tranquillement à les tresser, après avoir d’abord et sans efforts renversé le pauvre enfant, l’avoir couché à terre et s’être assis sur lui. Dans cette position et loin de pouvoir s’échapper, Piquillo courait plutôt risque de rester sur la place, étouffé par le poids énorme qui pesait sur lui ; mais le capitaine, qui, sans doute, prenait plaisir à ce nouveau supplice, continuait son travail, sans avoir l’air d’y faire attention, et en fredonnant un petit air catalan.
— Grâce ! monsieur le capitaine, grâce ! murmurait Piquillo d’une voix sourde et étouffée.
— Grâce, dis-tu ? grâce à toi ! Par ma mère, la Géronima, et le noble gentilhomme qui fut mon père, je veux bien t’octroyer une faveur, parce que tu sais, Piquillo, que je l’ai toujours aimé. Je voulais te faire aller loin, et ce n’est pas ma faute, pauvre étourneau, si tu ne t’élèves pas plus haut que la première branche d’un chêne… Mais, du moins, je te laisse le choix, et de tous les arbres qui nous environnent, désigne toi-même celui sur lequel il te sera le plus agréable de percher.
Piquillo ne répondit pas, voyant bien que tout espoir était perdu et que rien ne pouvait fléchir ce cœur de tigre.
— Tiens, Piquillo, ajouta le capitaine en continuant de donner la dernière main à son travail, auquel il semblait se complaire, tiens, là-bas, au bord de la grande route, vois-tu ce chêne qui s’élève si haut et s’étend si loin… Il me semble que son ombrage te garantira du soleil… toi surtout qui es délicat et coquet… Hein ? Piquillo, qu’en dis-tu ? Celui-là me semble réunir tous les avantages désirables.
Piquillo ne répondit pas.
— Il a surtout à cinq pieds de terre une branche courte qui avance et paraît faite exprès pour y suspendre un fardeau… C’est commode… Et puis, si ce bel officier ou quelqu’un de tes amis passe par là, il aura le plaisir de te rencontrer sur la route et d’apprendre par toi comment se venge le capitaine Juan-Baptista. Cela me détermine, et Dieu aidant…
Piquillo comprit qu’il allait mourir, et il adressa en lui-même au jeune inconnu sa dernière pensée et son dernier adieu.
En ce moment un coup de feu se fit entendre dans la forêt.
Quoiqu’il fût bien éloigné du lieu où se passait la scène que nous venons de décrire, et quoique personne ne parût, par un mouvement involontaire, par un instinct de défense personnelle, le capitaine se leva brusquement et écouta d’où venait le danger. Mais en même temps, et plus rapide que lui encore, Piquillo, débarrassé de son fardeau, s’était relevé, et quand Juan-Baptista se retourna, son captif était déjà à quelques pas derrière lui. Se trouvant alors près de cet arbre élevé et touffu que le capitaine venait de mettre à sa disposition, Piquillo saisit le premier moyen de salut que lui présentait le ciel. Il avait fait plus d’une fois l’épreuve de ses talents ; et certain de son adresse en ce genre, leste et agile comme un chat sauvage, il s’élança sur l’arbre, et de branche en branche se trouva en un instant à dix, quinze, vingt pieds de terre. Son seul raisonnement, si toutefois il avait eu le temps de raisonner, c’est que dans ce chemin difficile et élevé le capitaine ne pourrait le suivre, attendu que son physique fortement prononcé, et surtout le développement qu’avait pris son abdomen, lui défendaient tout mouvement et tout exercice ascensionnels.
En effet, le capitaine arriva furieux au pied de cette forteresse inexpugnable, tandis que son adversaire, haletant, essoufflé, mais enfin en sûreté, respirait tout tremblant encore, semblable à l’oiseau qui vient d’échapper au piége, et qui, sous l’abri du feuillage protecteur, loin de la vue et des poursuites du braconnier, s’arrête et répare son plumage endommagé.
— Descends, petit misérable ! lui criait le capitaine en tirant de sa ceinture un long pistolet, dernière arme qui lui restât ; descends, et je t’accorde ta grâce, sinon je fais feu sur toi !
Piquillo comprit sur-le-champ tout le danger de sa nouvelle position ; mais ce danger, quelque effrayant qu’il fût, l’était moins que celui auquel il venait d’échapper. Et, d’ailleurs, se fier à la bonne foi ou à la clémence du capitaine, était de tous les partis le plus désespéré, et le dernier auquel il fallût s’arrêter. Aussi était-il décidé à périr plutôt qu’à se rendre ; mais, aguerri maintenant, il était résolu à défendre ses jours, et il ne pouvait le faire que par l’adresse.
Le capitaine tournait en rugissant autour de l’arbre, et Piquillo, ne perdant pas des yeux son terrible adversaire, suivant tous ses mouvements, épiant ses moindres gestes, se retranchait et s’abritait derrière les plus grosses branches du chêne chaque fois que le capitaine étendait les bras pour l’ajuster. Enfin, celui-ci saisit le moment favorable, il aperçut à travers le retranchement du feuillage un jour qui lui livrait son ennemi, le coup partit, un cri retentit… Piquillo tomba, et Juan-Baptista, triomphant, poussa un hurlement féroce.
C’est ainsi que doit rugir la hyène quand elle va saisir sa proie… Mais cette proie, le capitaine l’attendit vainement ! la balle avait brisé la branche élevée sur laquelle était placé Piquillo, et celui-ci, retenu quelques pieds plus bas par les rameaux inférieurs qui lui présentaient leurs larges éventails de feuillage, était resté sans danger et sans blessure, suspendu à une quinzaine de pieds de terre. Au cri de joie que le capitaine avait poussé, Piquillo, cédant à son tour à un mouvement de colère, répondit avec un accent d’exaltation qui semblait prophétique :
— Juan-Baptista, tu as été sans pitié pour un pauvre enfant, et cet enfant, qui deviendra homme, sera un jour sans pitié pour toi. En attendant, va-t’en ; car maintenant tu ne peux plus m’atteindre, et jusqu’à ce soir, jusqu’à demain, s’il le faut, mes cris appelleront les voyageurs et te désigneront à leur justice, toi assassin, toi bandit ! qui n’es qu’un lâche, car tu auras lutté contre un enfant et tu auras été vaincu par lui !
— Ah ! la guerre ! la guerre ! s’écria le brigand avec un éclat de rire qui fit retentir la forêt, c’est lui qui me déclare la guerre ! Eh bien ! nous l’acceptons, et c’est toi qui en paieras les frais. À moi, d’abord, cette bourse que j’ai gardée, et qui était garnie de nombreux doublons ; à moi ces élégantes tablettes, dit-il en les ouvrant, qui ne renferment qu’un nom et qu’une adresse… celle sans doute d’un protecteur qui t’offre son pouvoir et son crédit… Eh ! par l’enfer ! tu n’avais pas si mal choisi… un des plus riches propriétaires de toutes les Espagnes. Je suis heureux de savoir qu’il te protégeait. Pour lui et pour tous les siens, ce sera un arrêt de mort !
Piquillo, à cette idée, poussa un cri de désespoir.
— Quant aux projets que je pourrai former contre lui ou contre sa famille, tu te flattes vainement de l’en prévenir ou de l’en préserver, tu ne le reverras plus : ton heure a sonné… Tu as choisi cet arbre pour dernier asile ? Suit, je te l’accorde ; mais tu n’en descendras pas vivant, je l’ai juré ! Tu n’as pas voulu qu’il te servit de potence, il te servira de bûcher !
Piquillo ne comprit pas d’abord ce que le bandit voulait dire ; il en eut bientôt l’explication.
— Ah ! tu m’as déclaré la guerre, continua le capitaine en ramassant autour de lui tout le bois sec qu’il rencontrait sous ses pas. La guerre ! la guerre ! tu l’as voulue ! Eh bien ! sois tranquille !… et il riait de son rire infernal, elle sera bientôt allumée !
Pendant que Piquillo suivait d’un œil inquiet et alarmé tous ces préparatifs, son ennemi entassait au pied de l’arbre un amas de feuillages desséchés et de bois mort, qui s’élevait déjà à plusieurs pieds de hauteur. Alors, avec une joie indicible, il sortit de sa poche un briquet et se mit à le battre, toujours en regardant Piquillo, et en soufflant, avec variations, son petit air catalan.
Enfin l’étincelle jaillit.
Un instant après, le bois mort était embrasé, et en quelques minutes, l’incendie, dont le foyer était au pied de l’arbre, commença à monter en spirales ondoyantes. Longtemps le rameau vert résista, et la sève humide qu’il contenait lutta contre l’ardeur du feu ; mais le capitaine ranimait à chaque instant et attisait l’incendie, ou lui donnait de nouveaux aliments, et un vent rapide qui se leva en ce moment ne seconda que trop bien ses efforts.
L’arbre s’était d’abord couvert d’une sueur noire et visqueuse, puis avaient bouillonné des flots d’écume qui avaient bientôt disparu ; le feuillage, flétri et corrodé, se desséchait ; des branches faisaient entendre un pétillement sourd, tandis que d’autres déjà se fendaient et laissaient pénétrer au cœur de l’arbre l’ennemi dévorant.
Ce qui était plus terrible encore, d’épais nuages s’élevaient dans les airs et enveloppaient le feuillage. Le capitaine espérait que cela seul suffirait pour étouffer son ennemi. Il crut y avoir réussi ; car déjà il ne l’apercevait plus, et pas un cri ne se faisait entendre ; rien ne troublait le silence de la forêt, si ce n’était le craquement des branches et le bruissement de l’incendie qui s’élevait lentement, et, comme un serpent, se glissait autour du tronc en dardant au milieu du feuillage sa langue de flamme.
— Mort, dit tranquillement le capitaine ou s’il ne l’est pas encore, le feu achèvera mon ouvrage, et se chargera, de plus, d’en faire disparaître les traces.
Il regarda de nouveau avec complaisance et satisfaction le brasier ardent qu’il avait allumé. Tout le tronc de l’arbre était en feu, et maintenant eût-il permis à Piquillo de descendre, celui-ci ne l’aurait pu sans être brûlé vif. Il réfléchit alors qu’un arbre centenaire, qui formait à lui seul un immense bûcher, serait longtemps encore à se consumer entièrement, que le feu allait prendre probablement aux arbres voisins, et quelques touffes de taillis commençaient déjà à brûler, grâce aux branches et aux charbons enflammés qui retombaient de toutes parts. La lueur de l’incendie devait d’ailleurs avertir et amener du monde des environs.
Le capitaine, dont la vengeance était assouvie, se souciait maintenant aussi peu de Piquillo que de ses compagnons défunts ; pour lui, tous ces souvenirs-là étaient de la fumée. Il se trouvait seul, il est vrai, mais grâce aux subsides que Piquillo venait de lui fournir, il avait de l’or dans sa poche, du courage au cœur, et de hardis projets en tête. Il jeta un dernier regard sur la pyramide de feu qui s’élevait toujours, et se dit en haussant les épaules avec mépris :
— La guerre à moi !… la guerre !
Puis s’élançant sur la grande route, il s’éloigna sans regret, peut-être même sans remords.
Pendant ce temps, et au moment où sa demeure avait commencé à être incendiée, Piquillo avait successivement cherché un asile sur des branches plus élevées, et c’est là qu’il tenait conseil. L’arbre était immense, sa cime se perdait dans la nue ; mais le feu gagnait à chaque instant de l’espace, et la fumée surtout était incommode. Il est vrai qu’elle n’était point, comme dans nos maisons, renfermée dans un étroit conduit, elle s’élevait en plein air, et arrivée à une certaine hauteur, elle s’étendait chassée par le vent, et se dissipait promptement. Piquillo avait eu soin de se maintenir dans une région supérieure ; mais sa situation n’en était pas moins terrible. Il avait vu toute la population ailée qui l’entourait, tous les autres habitants de l’arbre, s’enfuir à l’approche du danger et chercher un asile au fond de la forêt. Hélas ! il ne pouvait les suivre ; lui seul était resté sur ce bûcher vert, pour y subir un affreux supplice, pour y mourir dans une longue et horrible agonie, qu’il ne voyait aucun moyen d’éviter.
De loin il avait bien aperçu son ennemi disparaître dans la forêt ; mais le capitaine avait, en partant, trop bien assuré sa vengeance, pour craindre que désormais elle pût lui échapper, et Piquillo essaya vainement de redescendre.
Tout le premier tiers de l’arbre était en feu, et contemplé ainsi de haut, offrait l’aspect d’une large fournaise. Le pauvre captif voulut alors se glisser à l’extrémité d’une des branches qui s’étendait le plus au loin, pour se précipiter au delà et en dehors de l’incendie. Inutile espoir. Il était à quarante ou cinquante pieds de terre, et il devait se broyer dans une pareille chute.
Pour comble de malheur, le chêne antique où il était emprisonné, en plein air, était isolé et trop éloigné de tous les autres arbres pour qu’il fût possible de s’élancer sur quelques branches voisines. Ce chêne était placé, il est vrai, au bord de la route ; mais personne ne paraissait, et les cris du malheureux ne pouvaient se faire entendre ; quand même quelques voyageurs fussent passés par hasard, ils n’auraient pu porter secours à Piquillo, ni arrêter les progrès de l’incendie.
Alors le pauvre enfant, regardant autour de lui et voyant sa mort certaine, inévitable, se prit à pleurer. De qui pouvait-il attendre consolation ou pitié ? Il était seul au monde ! seul. Non !… un rayon d’espérance venait de glisser dans son cœur : il se rappela que, prête à mourir, Juanita avait prié le Dieu de ses pères !
— Je ferai comme elle ! s’écria-t-il en levant les yeux au ciel.
Et il se mit à prier pendant que la flamme montait toujours.
— Mon Dieu ! mon Dieu ! disait-il, mourir si jeune ! quand la vie s’ouvrait devant moi, quand je la connaissais à peine ! quand, cette nuit encore, de si doux rêves berçaient mon sommeil, et tout est fini, et je meurs ! et cette vie qui va m’être enlevée, je n’ai pu l’employer, mon Dieu, qu’à une bonne action, à une seule ! Laissez-moi vivre encore.
Et la flamme montait toujours !
— Vous m’avez tout refusé, mon Dieu ! jusqu’à l’amour et aux baisers d’une mère ! pauvre enfant abandonné par elle, mendiant et vagabond, ayant la rue pour patrie et le pavé pour demeure, demandant mon pain au travail, et forcé de le recevoir d’un bandit ; si j’ai été coupable en le suivant, si par lui j’ai fait du mal, si j’ai aidé à commettre des crimes, laissez-moi le temps de les réparer ; laissez-moi vivre !… pitié, mon Dieu, ayez pitié de moi !
Et la flamme montait toujours !
— Ah ! si vous me permettiez d’échapper à ce danger qui m’environne ; si vous veniez m’arracher à ces flammes qui déjà m’atteignent, à ces torrents de fumée qui me suffoquent et m’oppressent… je croirais en vous, mon Dieu, et je vous servirais ! et ces jours que vous m’auriez conservés seraient les jours d’un honnête homme. Je les emploierais, non pour moi, mais pour mes amis, pour mes frères. Je ferais pour eux ce que vous auriez fait pour moi… mon bras ne s’étendrait que pour leur porter secours… et pour les sauver… je le jure, mon Dieu, je le jure… recevez mon serment !
Et la flamme montait toujours !
VII.
la délivrance.
La flamme montait toujours !
Mais la prière du pauvre enfant montait plus haut encore. Dieu l’entendit, sans doute, et voulut qu’elle fût exaucée. Le ciel, obscurci depuis le matin par de lourdes et d’épaisses vapeurs, commença à se sillonner d’éclairs, puis un éclat terrible ébranla le chêne où priait Piquillo… Une longue traînée de feu parcourut l’horizon et déchira le nuage immense qui couvrait la forêt ; à l’instant toutes les cataractes du ciel parurent s’ouvrir, l’eau tomba par torrents, et Piquillo, sur la cime de l’arbre, et les yeux levés vers le ciel, s’écriait dans l’extase de sa joie :
— Dieu m’a exaucé ! Dieu veut que je sois un honnête homme !
Pendant une heure, l’orage continua avec la même force, et Piquillo le bénissait ! Avec quelle joie, avec quelle reconnaissance il contemplait ce nouveau déluge et la pluie qui, tombant en retentissant sur les feuilles desséchées, formait déjà un large ruisseau au pied du chêne, et à l’endroit même, où, tout à l’heure encore, éclatait le foyer de l’incendie ! toutes les branches enflammées venaient successivement de s’éteindre ; leurs bras à demi consumés dessinaient de longues lignes noires au milieu des feuillages verts que l’élément destructeur avait épargnés ; aucune lueur de feu n’apparaissait plus.
Piquillo se hasarda avec précaution à descendre, un à un, les degrés dangereux de l’édifice dont il habitait le faîte. La descente n’était pas facile : là, il cherchait vainement à saisir une branche que la pluie avait rendue glissante ; là, il s’appuyait sur une autre que le feu avait consumée, et qui se brisait sous son pied ; celle-ci, quoique éteinte en apparence, était encore brûlante ; enfin le voyageur était à la moitié de sa course ; encore quelques instants, et il allait toucher la terre, lorsqu’au milieu de l’orage qui grondait toujours, il entendit marcher dans la forêt. Un homme s’avançait avec peine au milieu de la terre boueuse et détrempée, et s’appuyait, de temps en temps, pour franchir des flaques d’eau ou des fossés, sur une longue carabine à deux coups, qu’il tenait à la main.
Épuisé de fatigue, il s’arrêta près du chêne où séjournait encore Piquillo, et tout à la fois pour respirer et pour essuyer la sueur qui, ainsi que la pluie, coulait de son front, il ôta un instant son chapeau en proférant une horrible imprécation !… Cette voix que Piquillo ne connaissait que trop bien, cette voix était celle de Caralo le bandit ! Caralo échappé au massacre de tous les siens !
Le malheureux captif, qui déjà rêvait la vie et la liberté, s’appuya tremblant contre une touffe de feuillage, à peu près la seule qui restât intacte, et sentant son cœur défaillir, il se dit en lui-même : Je m’étais trompé ! Dieu n’a pas pardonné ! Dieu ne veut pas que je vive !
Le bandit restait toujours debout contre l’arbre, l’oreille au guet et sans remuer ; Piquillo ne comprenait pas cette précaution et cette immobilité, qui, du reste, le sauvait, car elle empêchait son ennemi de lever les yeux au-dessus de lui ; mais bientôt, et du haut de l’observatoire où il était placé, il aperçut, à travers les arbres de la forêt, un carrosse qui arrivait par la grande route, conduit par un postillon et traîné par quatre bonnes mules, qui avançaient aussi vite que le permettait le mauvais état de la route, rendue presque impraticable par l’orage.
Il était évident, d’après la courbe du chemin, que, dans quelques minutes, la voiture passerait au pied de l’arbre où était Piquillo, et celui-ci délibérait en lui-même, s’il crierait, s’il appellerait du secours. C’était le moyen de salut le plus naturel qui s’offrit à lui et cependant il y avait de graves inconvénients ; en effet Caralo ne pouvait manquer de le reconnaître, et de cette carabine à deux coups il était probable qu’un au moins, et peut-être tous les deux, lui seraient destinés ; Caralo pouvant après cela disparaître dans la forêt sans le moindre danger, grâce à l’orage, qui ôterait aux voyageurs les moyens et l’envie de le poursuivre.
Il fut tiré de ses réflexions par un bruit qui le fit tressaillir sur son arbre. Caralo, qui, d’ordinaire, ne perdait pas de temps à délibérer, venait de prendre sur-le-champ un parti décisif. L’équipage n’était plus qu’à quelques pas, et à travers les glaces le bandit avait vu, d’un seul coup d’œil, qu’il ne renfermait que trois personnes, deux petites filles et un vieillard, et que les malles qui garnissaient la voiture avaient un air de plénitude du plus favorable augure.
Il n’y avait donc de redoutable que le postillon, vigoureux Gallicien, le seul capable de quelque résistance ; mais pour lui en ôter l’envie, Caralo, abaissant sa carabine, venait de le mettre en joue, à vingt pas de distance, et de le renverser roide mort du haut de sa mule ; puis continuant de mettre en joue la voiture, qui se trouvait alors vis-à-vis de l’arbre :
— Votre bourse ! cria-t-il au vieillard, et les parures de ces jeunes dames ?
La portière s’ouvrit : un gentilhomme à cheveux blancs, à la figure grave et sévère, parut, et, malgré la goutte dont il avait l’air de souffrir, il descendit, fit quelques pas, se plaça devant la voiture, comme pour faire aux jeunes filles un rempart de son corps, et tira du fourreau un couteau de chasse qu’il portait à sa ceinture.
— Bas les armes !
— Jamais ! répondit le gentilhomme.
— La résistance est inutile ; votre bourse, et bas les armes, ou je tire.
— Tire si tu veux ; don Juan d’Aguilar ne rendra pas les armes à un bandit tel que toi !
— C’est vous qui le voulez, dit Caralo en baissant lentement sa carabine.
— Mon père ! mon ami ! s’écrièrent à la fois les deux jeunes filles effrayées, en voulant se précipiter hors de la voiture.
— Ces enfants ont raison, répondit froidement le bandit. Que diable ! vous ne valez pas la dernière poudre de ma carabine. Je ne vous demande pas des réflexions, ni de la morale, mais l’or et l’argent que vous avez sur vous. Quant à ce fer, qui m’est inutile et à vous aussi, commencez par vous en défaire, et dépêchons, car je suis pressé.
Pour toute réponse, le vieux gentilhomme fit un pas en avant.
— Allons ! il faut en finir ! s’écria Caralo impatienté. Et s’appuyant contre l’arbre, il allait lâcher la détente de son arme… lorsque, d’une des branches placées au-dessus de sa tête, une masse, c’était Piquillo lui-même, tomba soudain sur le bras qui tenait la carabine, détourna le coup et fit chanceler le bandit, qui, tout entier aux affaires d’ici-bas, ne se mêlait guère de ce qui se passait au-dessus de lui et ne pensait avoir rien à démêler avec le ciel.
Étourdi d’abord de cette attaque d’en haut et du secours céleste qui arrivait à son adversaire, il se remit bientôt et serra dans ses bras nerveux son nouvel et faible antagoniste, qui criait au vieillard : Sauvez-vous ! sauvez-vous ! Et en même temps, Piquillo, étreignant de ses deux mains l’arme que tenait son ennemi, s’efforçait de ne pas lâcher prise ; mais en un instant Caralo l’eut renversé, jeté rudement à terre, et poussant un cri de surprise et de rage à la vue de Piquillo :
— C’est lui, lui que l’enfer me renvoie !… Cette fois enfin il ne m’échappera pas !
Et tenant un pied sur le corps palpitant de son ennemi, il allait lui casser la tête avec la crosse de sa carabine, lorsqu’une main, vigoureuse encore, enfonça jusqu’à la garde le couteau de chasse dans le ventre du brigand. Caralo, frappé à mort, poussa un cri de rage et tomba.
— Ah ! ce fer m’est inutile, et je ne sais pas m’en servir ! cria le vieux gentilhomme, qui s’était traîné jusque-là. Tombée ! tombée la bête fauve ! J’en ai autrefois chassé dans ces bois, mais jamais d’aussi dangereuses. Eh bien ! mes enfants, Carmen, ma fille… Elle s’est évanouie ! elle est sans connaissance ! Aïxa, toi qui es brave, toi qui es forte, ne t’avise pas d’en faire autant ; fais-la revenir à elle… il faut que j’aille au secours de notre défenseur… de ce mendiant déguenillé qui a plus de courage que de force.
Et il se traîna comme il put jusqu’à l’endroit où avait roulé Piquillo, qui, meurtri et froissé, venait de se relever, et offrait lui-même son bras à don Juan d’Aguilar.
— Ah ! ah ! je venais à ton secours, et c’est encore toi qui viens au mien, Qui es-tu ?
— Piquillo.
— Ton état ?
— Je n’en ai pas.
— Tes parents ?
— Pas davantage.
— D’où viens-tu ?
— De cet arbre.
— C’est là que tu demeurais ?
— Depuis ce matin.
Juan d’Aguilar regarda le chêne, dont le tronc et la moitié des branches avaient été dévastés par l’incendie, et dit en souriant :
— L’habitation me semble en assez mauvais état, et tu aurais pu mieux choisir. Mais je t’en offre une autre, une autre chez moi, à Pampelune, si cela te convient.
La joie et la reconnaissance brillèrent dans les yeux de Piquillo, qui, pour toute réponse, se contenta de porter à ses lèvres la main de son nouveau maître.
En parlant ainsi, ils étaient arrivés près de la voiture ; Carmen avait tout à fait repris ses sens ; elle sauta au cou de son père ; elle ne pouvait se lasser de le regarder et de l’embrasser, et le vieillard partageait ses caresses entre les deux jeunes filles, avec tant de bonté et d’effusion paternelles, qu’on n’aurait pu dire laquelle des deux était son enfant.
Piquillo, debout, immobile près de la portière, contemplait ce spectacle si nouveau pour lui, ces douces tendresses, ces joies intérieures, et ce bonheur de famille, dont il n’avait pas même l’idée. Jamais rien d’aussi frais, d’aussi gracieux, d’aussi joli que ces deux jeunes filles n’avait encore frappé ses yeux. Juanita, qui jusqu’alors avait été pour lui le type de la beauté et de l’élégance, lui semblait en ce moment d’un autre pays, d’un autre monde. Juanita, c’était la terre, et ce qu’il voyait là lui semblait le ciel ; c’en était du moins les anges.
Et quand les deux jeunes filles, attachant sur lui des regards pleins de douceur et de bonté, se mirent à le remercier, à le féliciter de son courage, à lui parler de leur reconnaissance, Piquillo sentit ce qu’il n’avait jamais éprouvé… une fierté et un contentement de lui-même qu’il n’aurait pu définir.
Apprenant qu’il était sans parents, sans ressource, sans asile :
— Ah ! que c’est heureux ! s’écria Carmen.
— Oui, dit Aïxa, il nous devra tout !
— Nous l’emmenons, dit Juan d’Aguilar… Il est désormais de la maison ; ce sera mon page. Mais, en attendant, poursuivit le vieux gentilhomme, en regardant le Gallicien étendu sur le gazon, notre pauvre postillon ne se relèvera plus ; notre jeune page peut-il le remplacer ?
— À l’instant, s’écria Piquillo, en refermant la portière et en s’élançant sur l’une des mules ; les animant de la voix et du geste, il les mit au galop, traversa la forêt, suivit la grande route, et le lendemain, plus heureux que n’était le roi d’Espagne, trois années auparavant, Piquillo le bohémien, l’air fier, le cœur joyeux, et le pourpoint déguenillé, faisait son entrée dans la ville de Pampelune,
— Où faut-il aller ? demanda-t-il à ses nouveaux maîtres.
— Au palais du vice-roi ! crièrent les deux jeunes filles.
VIII.
la consulta du roi.
Pendant les deux ou trois années qui venaient de s’écouler, et que Piquillo avait passées à l’hôtellerie de Buen Socorro, dans la compagnie de Caralo et du digne capitaine Juan-Baptista, d’autres événements un peu plus importants étaient survenus en Espagne, et nous demanderons à nos lecteurs la permission de jeter un regard en arrière.
Philippe II avait légué à Philippe III, son fils, la guerre contre l’Angleterre, et le comte de Lerma, qui avait voulu signaler les premiers jours de son ministère par un succès éclatant, fit équiper une flotte de cinquante vaisseaux, et chargea don Martin Padrilla de tenter une descente en Angleterre.
Les expéditions maritimes de l’Espagne, quoique entreprises dans l’intérêt de la religion et de la foi catholiques contre une souveraine et une nation hérétiques, n’ont jamais été favorisées par le ciel, quelque droit qu’elles eussent à sa protection ; la flotte du comte de Lerma ne fut guère plus heureuse que la fameuse Armada. À peine les vaisseaux eurent-ils gagné la haute mer, qu’ils furent dispersés par la tem-pête et forcés de regagner les ports d’Espagne, sans avoir rencontré l’ennemi[7].
Pour se consoler de ce revers, le ministre aurait pu dire, comme Philippe II : « J’avais envoyé mes vaisseaux combattre les hommes et non les éléments », mais loin de se résigner, il y mit de l’obstination, et s’empressa de profiter de la première occasion de revanche qui s’offrit à lui, sans que son esprit superficiel et léger se donnât la peine d’en bien examiner et d’en peser toutes les chances.
L’Irlande venait de se révolter contre Élisabeth, et sous prétexte de porter secours aux insurgés, le nouveau ministre de Philippe II résolut de s’emparer de cette île. Sa grande étendue, son extrême fertilité, la commodité de ses ports, qui pouvaient assurer une retraite aux vaisseaux espagnols et mettre l’Espagne en état de disputer l’empire des mers à l’Angleterre et à la Hollande, étaient les raisons qui le déterminaient à tenter cette conquête.
De vieux conseillers de Philippe II, des généraux expérimentés, entre autres don Juan d’Aguilar, qu’on voulait charger de l’expédition, prétendaient que l’on se trompait gravement, en s’imaginant détacher aussi facilement l’Irlande de sa légitime souveraine, pour la ranger à tout jamais sous la domination espagnole : qu’une révolte passagère n’était pas une révolution ; qu’on ne trouverait point dans les insurgés tout l’appui qu’on espérait ; que, pour tenter la conquête de ce pays et lutter contre toutes les forces de la Grande-Bretagne, six mille hommes ne suffisaient point.
À cela, le comte de Lerma répondait, que les finances actuelles de l’Espagne ne permettaient pas d’équiper une armée plus considérable ; que la valeur suppléait au nombre, et que si don Juan d’Aguilar avait peur, d’autres que lui se chargeraient de défendre l’honneur des armes espagnoles.
D’Aguilar avait accepté ; c’était un défi qu’on lui adressait, et la fierté castillane avait parlé plus haut dans son cœur que les conseils de la raison et l’évidence des faits ; il était parti.
Seulement il avait demandé que, cette fois, la flotte ne fût pas commandée par Martin Padilla, son ennemi mortel et tout dévoué au comte de Lerma ; il avait choisi un brave officier, don Juan Guevara, avec qui il avait servi dans une expédition en Bretagne.
La traversée avait été heureuse ; le général en chef avait débarqué dans le port de Kinsalle avec quatre mille soldats, s’était emparé de la ville et s’y était fortifié. C’était un abri, un refuge en cas de revers. En même temps Occampo, son lieutenant, entrait à Baltimore avec son armée, et tous deux allaient marcher en avant, quand ils avaient appris que les insurgés venaient d’être vaincus et dispersés par le vice-roi d’Irlande ; que le comte de Tyronne, leur chef, s’était échappé avec les débris de ses troupes, formant à peine quatre mille paysans mal armés et découragés, et que le vice-roi, qui s’avançait rapidement à leur poursuite, commandait trente mille hommes d’excellentes troupes.
— Je l’avais prévu, avait dit froidement d’Aguilar, n’importe ! Allons à leur secours. Et il avait marché en avant.
Cependant le comte de Lerma, qui ne doutait point du succès d’une expédition imaginée et préparée par lui, regardait l’Irlande comme annexée désormais à la couronne d’Espagne, et s’occupait déjà de lui nommer un gouverneur. Il hésitait entre son oncle Borja et le comte de Lémos, son beau-frère, qu’il ne pouvait guère laisser à la vice-royauté de Navarre, où il était assez mal vu. Le système du ministre était d’appeler aux fonctions importantes du gouvernement tous ses parents d’abord, la monarchie espagnole n’étant considérée par lui que comme une maison, une famille dont il était le chef, et dont tous les siens étaient les principaux membres.
C’est ainsi qu’il avait nommé Bernard de Sandoval, son propre frère, à la fois archevêque de Tolède et grand inquisiteur, deux dignités, dont l’une donnait une grande considération auprès du clergé, et l’autre un pouvoir immense dans le pays.
Bernard de Sandoval était encore plus dangereux que son frère à la tête d’un gouvernement.
Le duc de Lerma, léger, insouciant, changeant facilement d’idées et de principes, selon les circonstances, n’avait, à proprement parler, aucun caractère. Bernard y Royas de Sandoval, son frère, croyait en avoir un : c’était une vertu tout espagnole, qu’en homme d’État il décorait du nom de fermeté, et qui n’était au fond que de l’entêtement, entêtement stupide et souvent féroce ; en effet, il n’abandonnait jamais une idée qui lui était venue, et il ne lui en venait presque jamais que de mauvaises.
— Je romps, disait-il, et ne plie pas ! et moi, disait le comte de Lerma, je plie pour ne pas rompre.
Du reste, il faut le dire, chacun avait les vertus de ses défauts. La légèreté du duc de Lerma n’excluait ni la bonté, ni la clémence, ni la générosité. Il était excellent pour tous les siens, pardonnait aisément les injures, accablait de présents et gorgeait d’or ceux même qu’il destituait. Quant à sa magnificence et à ses libéralités, odieuses au peuple espagnol, qui payait, elles semblaient naturelles au ministre, qui, regardant le royaume comme à lui, ne croyait donner que son bien.
Chez Bernard de Sandoval, au contraire, la dureté de caractère avait fait naître la sévérité et la régularité de mœurs ; il était pur, il était chaste, aussi économe que son frère était libéral, et n’ayant jamais eu aucune faiblesse ; il n’aimait rien, n’accordait rien, ne pardonnait rien ; au demeurant, fort estimé comme inquisiteur, et ayant toutes les qualités de l’emploi.
Le premier, il avait eu, sous Philippe II, la grande idée de l’expulsion des Maures et l’avait fait partager au comte de Lerma, qui maintenant la regardait comme sienne et considérait ce projet comme devant illustrer son ministère, en même temps qu’il consoliderait à jamais la foi catholique.
Restés, en effet, mahométans au fond du cœur, la plupart des Maures ne se conformaient qu’extérieurement aux pratiques de la religion chrétienne ; ils n’assistaient au sacrifice de la messe que pour éviter les peines qu’ils auraient encourues en y manquant ; ils présentaient leurs enfants au baptême, mais ensuite ils les lavaient avec de l’eau chaude, pour insulter au sacrement des chrétiens ; ils se mariaient à l’église, mais de retour dans leurs maisons ils en fermaient les portes et célébraient la noce avec les chants, les danses et les cérémonies particulières à leur nation. Conservant toujours l’espoir d’une prochaine délivrance, ils avaient entretenu pendant longtemps des intelligences avec les Turcs et avec les Maures d’Afrique. Quand les corsaires d’Alger débarquaient sur les côtes d’Andalousie, jamais les Maures, qui habitaient le rivage ne sonnaient la cloche d’alarme, ni ne prenaient les armes ; jamais aussi les Algériens ne pillaient les villages ou les habitations des Maures, tandis qu’ils réduisaient en esclavage les chrétiens qui tombaient entre leurs mains[8] ; il n’en fallait pas tant pour exciter, sous le règne précédent, les soupçons et armer la vengeance de Philippe II ; il avait résolu de proscrire leur culte et jusqu’à leurs costumes. Il leur avait ordonné de renoncer au langage moresque et de cesser entre eux tout commerce, toute relation ; il leur avait défendu de porter les armes, et, sous peine de mort, de se battre, même en duel, avec des chrétiens ; enfin il avait forcé les femmes à paraître en public, le visage découvert, et fait ouvrir les maisons qu’ils tenaient fermées. Ces deux règlements avaient paru insupportables à un peuple jaloux de conserver les usages de ses ancêtres. On les menaçait toujours, à la moindre révolte, de prendre leurs enfants pour les faire élever en Castille. On leur interdisait l’usage des bains, qui servaient à leur propreté autant qu’à leur plaisir. Déjà on leur avait défendu la musique, les chants, les fêtes, tous leurs divertissements habituels, toutes les réunions consacrées à la joie[9].
Les Maures, exaspérés, avaient pris les armes, dans les montagnes des Alpujarras, et s’étaient défendus avec tant de vigueur, qu’il avait fallu, pour les soumettre, l’élite des troupes d’Espagne, commandées par le frère du roi, par don Juan d’Autriche, le vainqueur de Lépante. Des flots de sang avaient coulé de part et d’autre, et il en avait coûté la vie à soixante mille Espagnols, rude leçon qui avait rendu les vainqueurs moins rigoureux et les vaincus plus résignés.
Ainsi, au commencement du dix-septième siècle, à l’époque où nous nous trouvons, et dans les premières années du règne de Philippe III, les Maures, autrefois conquérants, et, pendant huit cents ans, souverains de l’Espagne, qu’ils avaient éclairée et civilisée, les Maures avaient perdu successivement leur indépendance, leur religion, leurs mœurs et leurs coutumes. Il ne leur restait plus que le sol de la patrie conquise par leurs ancêtres ; mais ce sol, fécondé par leurs sueurs et enrichi par leurs travaux, ils commençaient à s’y attacher.
Les Arabes et les Maures avaient apporté en Espagne la culture du sucre, du coton, de la soie et du riz[10] ; grâce à eux, rien n’égalait la fertilité de la province de Valence. Elle fournissait à l’Europe tous les fruits des pays méridionaux. On y faisait trois récoltes par an ; à peine une moisson était-elle terminée, qu’on ensemençait de nouveau, et la douceur du climat faisait mûrir les grains toute l’année ; le travail le plus assidu, les moyens les plus ingénieux entretenaient et renouvelaient cette admirable fécondité.
Venus de l’Égypte, de la Syrie, de la Perse, pays essentiellement agricoles, les Arabes avaient apporté dans le royaume de Valence des procédés de culture qu’une pratique de trois mille ans avait perfectionnés.
L’industrie et le commerce ne leur devaient pas moins. Grâce à eux, Tolède, Grenade, Cordoue, Séville, possédaient des manufactures de cuirs et de soieries ; les draps verts et bleus que l’on fabriquait à Cuenca étaient recherchés sur les côtes d’Afrique, en Turquie et dans les échelles du Levant. Les lames de Tolède, les soies de Grenade, les harnais, les selles, les maroquins dorés de Cordoue, les épiceries et les sucres de Valence, étaient renommés dans toute l’Europe ; et contents du bonheur et des richesses que procure le travail, les Maures s’accoutumaient peu à peu à oublier le passé, à jouir du présent et à ne plus rechercher d’autres succès que ceux de l’industrie.
Ce peuple conquérant était devenu fabricant et agriculteur, et consentait à enrichir ses maîtres actuels, à leur payer d’énormes impôts, à leur donner toutes les jouissances du luxe et de la civilisation, ne demandant en échange que paix et protection pour les vaincus, pour leur famille et pour leur industrie.
C’est là ce que Bernard y Royas de Sandoval, le grand inquisiteur, et son frère le comte de Lerma ne pouvaient comprendre. Ils avaient mis en avant don Juan de Bibeira, patriarche d’Antioche et archevêque de Valence, connu par sa haine contre toute espèce d’hérésie ; et ce fougueux prélat avait présenté au faible monarque un mémoire secret, où il le suppliait de chasser du royaume tous ses sujets infidèles, lui conseillant de ne retenir que les adultes, pour travailler, comme esclaves, aux galères et aux mines, et les enfants âgés de moins de sept ans, pour les élever dans la religion chrétienne.
Le roi avait communiqué ce mémoire à son ministre et au grand inquisiteur. Le ministre était d’avis d’attendre une occasion favorable ; Bernard de Sandoval pensait qu’on ne pouvait trop se hâter ; mais il trouvait les mesures proposées par l’archevêque de Valence insuffisantes et surtout trop douces. Son avis était qu’on exterminât tous les Maures en masse, une seconde édition de la Saint-Barthélemy, où l’on n’épargnerait ni les femmes ni les enfants.
Cependant un semblable projet demandait de grandes précautions, un déploiement considérable de forces, une réunion imposante de troupes, et dans ce moment l’élite des troupes espagnoles était occupée dans les Pays-Bas et dans l’expédition d’Irlande.
Il fut donc convenu que le plus grand secret serait gardé. L’inquisiteur et le ministre en sentaient la nécessité ; il était plus difficile de la faire comprendre à l’archevêque de Valence, qui, fanatique de bonne foi, ne pouvait retenir les excès de son zèle et ne parlait ou n’entendait parler de ce projet qu’avec des transports de rage pieuse qu’il prenait pour des inspirations d’en haut.

On parvint cependant, et non sans peine, à lui faire entendre qu’à la première nouvelle d’un tel coup d’État, les Maures, qui couvraient tout le royaume, pouvaient se soulever et appeler à leur aide quelques nations voisines, ennemies de l’Espagne.
D’ailleurs, le roi allait se marier, et une époque de grâce et de clémence était mal choisie pour un acte de rigueur et d’extermination. On convint donc que, dans la consulta du roi, on ne parlerait que du prochain mariage de Philippe.
La consulta du roi était un conseil secret qui se tenait au palais, en présence du monarque, et sous la présidence du ministre.
On n’y admettait, dans les occasions importantes, que le grand inquisiteur, le confesseur du roi, et quelques favoris qui dirigeaient la volonté du monarque et lui faisaient adopter ou rejeter les propositions des autres conseils ; mais, dans des circonstances comme celle-ci, on accordait, pour la forme et comme marque d’honneur, le droit d’assister, et même de prendre part aux délibérations, aux jeunes seigneurs appartenant aux premières familles d’Espagne, à ceux qui devaient arriver un jour à la grandesse d’Espagne et à l’audience de Castille.
Ce jour-là, le comte de Lerma, que le roi venait de créer duc, à l’occasion de son mariage, et en récompense des services qu’il n’avait pas encore eu le temps de rendre, mais qu’il rendrait immanquablement à la monarchie, le duc de Lerma présenta au roi le comte d’Uzède, son fils ; à son tour, le marquis de Miranda, chef de la maison de Zunica et président du conseil de Castille, réclama le même honneur pour son parent, don Fernand d’Albayda, un des principaux barons du royaume de Valence, et neveu de don Juan d’Aguilar, commandant les troupes de Sa Majesté en Irlande.
Le jeune homme, avec la timidité naturelle à son âge, s’inclina, en rougissant, devant son seigneur et roi, et devant le conseil suprême, dont il s’était fait d’avance une idée si majestueuse et si imposante.
Plusieurs membres disputaient entre eux sur la couleur de l’habit qu’ils devaient porter le jour de l’arrivée de la reine.
Don Sandoval, le grand inquisiteur, remuait entre ses doigts les grains de son chapelet ; le ministre traçait avec un crayon une couronne de duc sur le parchemin d’une ordonnance royale, et Philippe II, la tête renversée dans un grand fauteuil, comptait les rosaces dorées du plafond. Un seul, don Juan de Ribeira, archevêque de Valence, paraissait enfoncé dans de profondes méditations et ne prendre aucune part à ce qui se passait autour de lui.
Quant au jeune comte d’Uzède, fier de sa naissance, et comptant au nombre de ses mérites la position de son père, il promenait autour de lui un regard plein d’assurance et de fatuité, qu’il arrêta plus d’une fois, avec dédain, sur Fernand d’Albayda, car celui-ci, plus jeune que lui, partageait un honneur qui n’eût dû appartenir qu’au fils du premier ministre.
Le duc de Lerma, après avoir pris les ordres de Sa Majesté, exposa avec complaisance qu’une nouvelle alliance allait unir plus étroitement encore les descendants de Charles-Quint. Sa Majesté Très-Catholique allait épouser la fille de l’archiduc Charles, la jeune Marguerite d’Autriche. Il ajouta que la jeune princesse, partie de Graetz pour l’Italie, était arrivée à Gènes.
Ce qu’il ne dit pas, c’est que la lenteur espagnole avait mis si longtemps à terminer les immenses préparatifs ordonnés pour sa réception, que la flotte équipée pour la transporter en Espagne n’avait mouillé à Gènes que plusieurs mois après l’arrivée de Marguerite en cette ville.
Le duc entretint ensuite le conseil des fêtes brillantes qui attendaient la princesse à Valence, où elle devait débarquer, et où le mariage devait se faire.
La magnificence de ces fêtes, qui convenait aux goûts fastueux du ministre, était si extravagante qu’elle devait coûter un million de ducats (huit millions de notre monnaie) ; mais le duc avait commencé par déclarer au roi et au conseil que la situation prospère des finances permettait de déployer, pour ce mariage, une splendeur digne du plus grand roi et du premier royaume de l’Europe.
D’ordinaire, en pareille occasion, et après le rapport fait par le ministre, personne ne prenait la parole. Le roi approuvait de la tête, et il était loisible à tout le monde de suivre l’exemple du monarque ; mais ce jour-là, désirant faire briller son fils, qui, pour la première fois, avait entrée au conseil, et que, pour des raisons secrètes, il voulait déjà pousser dans la faveur royale, le duc, s’adressant à Uzède et à Fernand d’Albayda, leur dit d’un air gracieux :
— Eh bien, mes jeunes seigneurs, que pensez-vous de ce que vous venez d’entendre ? Nouveaux conseillers du roi, dites-nous votre avis. Je suis persuadé que Sa Majesté sera charmée de le connaître.
Le roi approuva de la main, et le ministre continua :
— Allons, seigneur Fernand, pourquoi rougir ainsi et vous intimider ? Remettez-vous… nous ne vous demandons que votre pensée, votre opinion et surtout la vérité… Uzède va vous donner l’exemple.
Et il fit signe à son fils de commencer.
Celui-ci, dans un discours qu’il feignit d’improviser, et qui longtemps d’avance avait été préparé par lui, et peut-être revu par son père, adressa au roi un compliment élégant et flatteur sur son auguste mariage, sur ses hautes qualités comme monarque, et sur la profonde intelligence qui dirigeait tous ses choix.
De là venait naturellement l’éloge du ministre, l’approbation complète du rapport qu’il venait de faire, et le tout finissait par un tableau enivrant de la prospérité actuelle et future de l’Espagne.
Un murmure d’approbation suivit ce discours.
Quand ce fut au tour de Fernand d’Albayda, il commença par s’excuser avec modestie sur sa jeunesse et son insuffisance ; mais à son souverain, mais à des conseillers si habiles et si éloquents, il ne devait que la vérité : c’était la seule manière de répondre dignement à l’honneur qu’ils lui faisaient en daignant l’écouter.
Et entrant sur-le-champ en matière avec une franchise et une noblesse toutes castillanes, il avoua qu’il aimait à croire à la fidélité du tableau que l’on venait de dérouler à ses yeux, qu’il ne lui appartenait pas d’en contester l’exactitude, mais que, sur un point seulement, il croyait que l’on avait surpris la religion du ministre, et qu’il demandait à rétablir les faits.
Il expliqua alors nettement la situation de la province de Valence, dont il était un des premiers barons et des plus riches propriétaires ; il prouva que les villes et les campagnes étaient surchargées d’impôts ; que non-seulement ceux de deux années d’avance avaient été exigés et perçus, mais qu’en ce moment, pour subvenir aux fêtes du mariage, on demandait le paiement d’une troisième année, excitant ainsi le mécontentement de la population, à l’occasion d’un événement qui ne devait faire naître que sa joie ; qu’il s’empressait de signaler ce fait au roi et au ministre, qui l’ignoraient sans doute ; car il serait injuste et impolitique, quand tout le reste de l’Espagne jouissait d’une si grande prospérité, de vouloir en excepter et en exclure la seule province de Valence, celle où justement allait se célébrer le mariage de Sa Majesté.
Ces derniers mots, prononcés avec fermeté, jetèrent le duc de Lerma et tout le conseil dans un embarras difficile à décrire, et qui redoubla encore, lorsque le roi, se tournant vers son ministre, lui dit avec une naïveté charmante :
— Ce jeune homme a raison : il faut que nos fidèles sujets du royaume de Valence participent au bonheur et à la prospérité dont vous faites jouir l’Espagne. Ne pourrait-on pas leur déclarer, à l’occasion de mon mariage, qu’ils seront, pendant deux ans, exemptés d’impôts ?
Puis, étonné du silence qui se faisait autour de lui, le monarque craignit de s’être trop avancé, et demanda timidement au duc de Lerma et aux conseillers qui l’entouraient :
— N’est-ce pas là votre avis, messieurs ?
Le duc de Lerma, qui plusieurs fois avait voulu et n’avait osé interrompre Fernand, jeta sur lui un regard de colère, et dit au roi avec un ton d’impatience qu’il cherchait vainement à déguiser sous un sourire moqueur :
— Si ce jeune seigneur, don Fernand d’Albayda, premier baron du royaume de Valence, connaît quelques moyens d’administrer les finances et de remplir les coffres de Votre Majesté sans l’impôt que je demande en ce moment, il nous obligera beaucoup en nous en faisant part. En connaissez-vous, don Fernand ?
— Oui, Excellence, et je me fais fort (toujours dans le royaume de Valence, je ne connais que celui-là) de faire payer à l’instant, non-seulement l’impôt que vous demandez, mais, d’ici à quelques jours, le quart des sommes que vous demandez pour les fêtes du mariage.
Le ministre, étonné, leva la tête, pour voir si don Fernand parlait sérieusement, et celui-ci continua avec gravité :
— Bien plus, ceux qui vous apporteront ces sommes vous prieront de les accepter et vous en remercieront ; et depuis Valence jusqu’à Madrid, ils escorteront le roi et la reine de leurs cris de joie et de leurs bénédictions.
Le roi et tout le conseil s’écrièrent :
— Parlez ! parlez !
Il se fit un grand silence. Le duc d’Uzède se mordit les lèvres avec colère, et Fernand se recueillit quelques instants.
— « Sire, vous avez une population fidèle et industrieuse qui, dans ce moment, fait la richesse des royaumes de Valence et de Grenade. Nous en savons quelque chose, nous autres barons et propriétaires, dit-il en regardant le duc de Lerma, car s’ils s’éloignaient, nos terres seraient sans culture, nos fabriques seraient désertes, la misère et l’abandon succéderaient à l’opulence. Votre Majesté devine que je veux lui parler de ses sujets, les Maures d’Espagne. »
Don Sandoval et le duc de Lerma tressaillirent ; mais Ribeira, qui jusque-là avait gardé le silence, comme s’il eût été étranger à tout ce qui se passait, bondit sur son siége, et malgré les signes de l’inquisiteur, eut peine à modérer son impatience. Don Fernand continua :
— « Des bruits, des rumeurs vagues, et dont on ignore l’origine, ont circulé depuis quelques temps. »
Ici, l’inquisiteur jeta sur Ribeira un regard de reproche.
— « Et, malgré leur peu de vraisemblance, ces bruits ont déjà répandu la défiance et l’effroi parmi toute cette population qui, tranquille jusqu’alors, ne s’occupait qu’à fertiliser nos campagnes, ou à répandre par le commerce les produits de son industrie. Des craintes, chimériques sans doute, se sont emparées de tous.
« N’ayant plus foi en l’avenir, et inquiets sur le présent, ils s’arrêtent et attendent ; leurs travaux languissent, et bientôt peut-être vont cesser.
« Je suis persuadé, sire, qu’à votre royale parole tout se ranimerait, tout renaitrait. Qu’une déclaration formelle de Votre Majesté soit publiée en Espagne, promettant que les Maures ne seront jamais inquiétés dans leurs personnes ni dans leurs biens, et toutes les sommes qu’exigera votre ministre lui seront apportées à l’instant, non à titre d’impôts, mais de don volontaire, mais de présent de noce offert avec joie par ses fidèles sujets à Sa Majesté la reine d’Espagne, Marguerite d’Autriche ; et ce que je dis, je l’atteste et m’en rends garant, moi, don Fernand d’Albayda. »
— Vous êtes donc leur ami et leur protecteur, s’écria Ribeira avec agitation, et au lieu de convertir les Philistins, ce sont eux qui vous ont gagné… vous l’entendez, Seigneur, la contagion s’étend sur Israël !
— Rien ne me fera jamais oublier ce que je dois à Dieu et au roi, répondit le jeune homme avec fermeté ; mais ni mon Dieu, ni mon roi ne m’ordonnent de trahir la vérité, et je la dis tout entière. Je n’ai vu parmi les Maures de Valence que des amis de l’ordre et du travail, des sujets industrieux et actifs.
— Qu’il faut craindre, s’écria Ribeira, car ils posséderont bientôt toutes les richesses du royaume, car ils ont l’industrie en partage, ils ont le travail et l’économie. Exclus de l’honneur de servir dans nos armées, et privés du bonheur d’avoir des couvents, leur population augmente chaque jour, et la nôtre diminue… Ils ont le temps d’étudier, d’être plus savants… plus éclairés que nous.
— Vous faites leur éloge, monseigneur, dit respectueusement Fernand d’Albayda.
— Non, répondit vivement le prélat, mais je veux et je dois prémunir Sa Majesté et le conseil contre les avantages, ou plutôt contre les maléfices qu’ils tiennent de l’esprit des ténèbres, pour la perte de l’Espagne.
— Le projet dont je parlais n’est donc point une chimère ! s’écria Fernand avec terreur… vous y pensez donc ?
— Non, s’écria vivement l’inquisiteur, tout effrayé du tour que prenait la discussion ; non, personne ici n’y pense que vous, jeune homme !
— Moi ! répondit Fernand rassuré, comment Votre Excellence pourrait-elle croire que j’eusse jamais eu l’idée d’un projet non-seulement aussi barbare et aussi désastreux… mais je dirai même aussi absurde ?
— Absurde ! s’écria l’archevêque de Valence, blessé dans ce qu’il avait de plus cher ; absurde ! Votre Majesté souffre que l’on blasphème devant elle, et que des hérétiques, non contents de repousser la parole de Dieu, viennent la tourner en dérision ! Malheur à nous tous ! malheur à l’Espagne ! Dieu, qui m’inspire, me le prédit : quelque grand danger la menace, et la main du Très-Haut va s’éloigner d’elle, puisque déjà l’impiété triomphe et se glorifie de ses œuvres !
— Mon Dieu ! qu’ai-je donc fait ? se dit en lui-même Fernand épouvanté.
Le roi, étourdi de tout ce qui venait d’arriver, se faisait presque la même question ; mais sur deux mots que le duc de Lerma lui dit à voix basse, il s’écria gravement :
— Rassurez-vous, mon père, et vous aussi, seigneur Fernand, nous aviserons à loisir sur ce que nous venons d’entendre.
— Et nous y ferons droit s’il y a lieu, ajouta le ministre ; mais l’intention de Sa Majesté est que, dans ce moment l’on ne donne point de suite à cette discussion. Nous avons à lire les dépêches qui nous arrivent, dit-il en montrant un paquet cacheté de noir qu’apportait un messager d’État.
Le ministre ouvrit les dépêches, les lut tout bas, et, moins maître de son émotion que Philippe II, qui ne se laissa jamais surprendre par la joie ou par la douleur, il ne put cacher à tous les yeux attachés sur lui la pâleur qui couvrit un instant ses traits.
— Sa Grâce avait raison, dit-il gravement, la main de Dieu s’appesantit sur l’Espagne ; l’expédition d’Irlande n’a point réussi ; les Anglais sont vainqueurs.
— Mon oncle est mort ! s’écria Fernand avec désespoir.
— Notre armée est détruite ? demanda gravement Sandoval.
— Ce qu’on m’annonce est plus terrible encore pour l’honneur des armes espagnoles, poursuivit le ministre en baissant la tête : don Juan d’Aguilar et toute son armée ont capitulé sans combattre.
— Ce n’est pas possible ! s’écria Fernand. D’Aguilar est innocent, d’Aguilar est calomnié.
Le ministre remit la lettre au roi en lui disant froidement :
— C’est du comte de Lémos, mon beau-frère.
— Le comte s’est trompé, continua Fernand avec chaleur.
— Mon oncle de Lémos est toujours bien renseigné, dit le comte d’Uzède avec un sourire amer ; il ne se trompe jamais, et, pour moi, j’ai toute confiance en lui.
— Moi, j’ai confiance en l’honneur d’un d’Aguilar, répondit Fernand, et sans avoir besoin d’autres renseignements, je soutiens qu’un gentilhomme, un Espagnol, n’a pu se rendre sans combattre… Qui peut le croire, l’aurait fait.
— Mais j’ai annoncé que je le croyais ! s’écria Uzède en pâlissant.
— Et moi, je soutiens mon dire ! répondit Fernand en portant la main sur la garde de son épée.
— Devant le roi ! s’écria le duc de Lerma indigné.
Philippe et tous les assistants se levèrent.
— Pardon, sire, pardon ! s’écria Fernand en pliant le genou devant son souverain.
Le roi lui fit signe de sortir.
Fernand s’inclina, fit quelques pas vers la porte, et, prêt à la franchir, il dit à demi-voix au comte d’Uzède, qui n’était pas loin de lui :
— Sortirai-je seul, monsieur ?
Le comte fit un pas pour le suivre ; le duc de Lerma le retint d’un regard, et Fernand s’éloigna furieux et désespéré.
En arrivant à son hôtel, il y trouva son ami, son compagnon d’enfance, Yézid d’Albérique. Yézid était fils d’Alami Delascar d’Albérique, le plus riche des Maures de Grenade et de Valence. Yézid descendait de la tribu des Abencerages et du sang des rois. Il avait fait ses études à Cordoue avec Fernand ; tous deux étaient venus habiter les belles campagnes du royaume de Valence, Fernand, dans le château de ses aïeux, Yézid, dans l’élégante habitation et dans les champs cultivés par son père. Fernand, en noble gentilhomme, se destinait à la profession des armes ; Yézid, à qui cette carrière était interdite, s’était consacré aux sciences et aux arts, que les Arabes, ses ancêtres, avaient cultivés avec tant de succès.
Grâce aux trésors de son père, son existence était opulente ; le travail et l’étude la rendirent utile, et puis vint l’amitié, qui la rendit heureuse. Fernand était devenu son frère ; Fernand était aimé de tous les Maures de Valence, car le noble Espagnol était l’ami de Yézid, et Yézid était leur culte et leur idole : c’était le sang d’Abdérame et d’Almanzor ; tous les deux semblaient revivre en lui.
Yézid, qui était alors à Madrid avec son ami, venait de recevoir de son père, resté à Valence, une lettre pour Fernand, et il la lui apportait au moment où celui-ci, encore animé de la scène qui venait de se passer au conseil du roi, la racontait à Yézid, tout en décachetant sa lettre. Cette lettre était de son oncle don Juan d’Aguilar, et ne contenait que ces mots :
« Je suis en Espagne et caché en lieu sûr ; car il faut que je me justifie, que je confonde mes ennemis, et je ne le pourrais pas si je tombais entre leurs mains. L’ami généreux et dévoué qui s’expose pour moi et par qui cette lettre te parviendra, connaît seul le lieu de ma retraite ; pars, va le trouver. »
— Cet ami généreux, c’est ton père, s’écria Fernand, je cours à l’instant près de lui à Valence.
— Et moi aussi, répondit Yézid, je ne te quitte pas.
Fernand lui serra la main avec reconnaissance, puis il s’arrêta et dit :
— Et d’Uzède que j’ai défié, et qui va venir sans doute m’en demander raison. Puis-je partir ainsi, m’enfuir en secret sans dire où je vais ? N’est-ce pas mériter à ses yeux ce titre de lâche que je lui ai donné ?… Non, non, il faut rester, et cependant mon oncle qui m’attend, qui me réclame !
En ce moment on frappa avec force à la porte de l’hôtel.
— C’est d’Uzède et ses amis, dit Yézid.
— Tant mieux, cela se trouve à merveille, nous partirons après, battons-nous d’abord ; le tout est de se hâter.
— Je crains d’Uzède et la gravité espagnole ; avec lui il faut tant de cérémonie pour recevoir ou donner un coup d’épée… Ah ! avant tout, déchirons cette lettre.
Il venait de la mettre en morceaux lorsque la porte s’ouvrit. Parut un officier du palais, suivi de plusieurs soldats des gardes ; l’officier ôta gravement son chapeau et demanda :
— Lequel de vous, messeigneurs, est le baron Fernand d’Albayda ?
Fernand prévint Yézid, qui allait dire : « C’est moi. » Il se désigna vivement lui-même de la main.
— Que me voulez-vous, seigneur officier ?
— Vous demander, de la part du roi, votre épée, vous déclarant que vous êtes mon prisonnier et qu’il faut à l’instant me suivre. Toute résistance serait inutile, ajouta-t-il, en voyant Fernand jeter à son ami un regard d’hésitation et de désespoir.
Celui-ci le comprit, et lui dit :
— Je partirai pour toi, et ce que tu aurais fait, je le ferai, frère, je te le jure !
Fernand alors se retourna vers l’officier, et lui dit :
— Monsieur, je suis prêt à vous suivre ; mais un mot encore. Auriez-vous appris quelque chose de don Juan d’Aguilar, qui commandait l’armée espagnole en Irlande ?
— Je ne connais, seigneur cavalier, que les bruits répandus à ce sujet.
— Et quels sont-ils ?
— Que le général est condamné à mort et ses biens confisqués.
Accablés de douleur à cette nouvelle, les deux amis s’embrassèrent, et Yézid murmura tout bas :
— Tant que je vivrai, compte sur moi et ne désespère de rien.
Fernand, entouré de soldats, descendit l’escalier de l’hôtel. L’officier monta près de lui dans une voiture qui roula vers les prisons de Valladolid. Quant à Yézid, suivi du fidèle Hassan, il s’élança sur Kaled, son bon cheval arabe, et prit au galop le chemin de Valence.
IX.
l’habitation du maure.
Le vieil Alami Delascar d’Albérique était dans l’endroit le plus reculé de son habitation : C’était une pièce souterraine dont lui seul et son fils connaissaient le secret. Près de lui était un noble vieillard, à la chevelure blanche, au front cicatrisé, qui, triste et silencieux, tenait sa tête baissée, tandis que de grosses larmes roulaient dans ses yeux.
— Mon hôte et mon ami, lui dit d’Albérique en lui prenant la main, ne pourrais-je donc calmer votre douleur, et vous donner quelque espoir ? Votre neveu va venir. Vous combinerez avec lui les moyens de faire arriver votre justification jusqu’à votre souverain ; il faudra bien, qu’une fois en sa vie, le roi d’Espagne connaisse la vérité.
— Je crains bien que non.
— Eh bien ! si c’est impossible… à moins d’un miracle ! Dieu fera pour vous ce miracle, il vous le doit. Si ce n’est pas sur-le-champ, ce sera plus tard ! prenez patience ! si nous en avions manqué nous autres, que serions-nous devenus, nous qui attendons toujours l’heure de la délivrance ? D’ici là qui vous inquiète ? restez ici près de moi.
— Cacher un proscrit, c’est vous exposer à la proscription, vous et les vôtres ! Il y va de vos biens, de vos jours peut-être.
— Qu’importe ? Quoi qu’il arrive, nous voulons partager vos peines, vos dangers et même vos ennemis, qui dès ce jour sont les nôtres. Ils ont cru vous laisser sans asile, en voici un ! Ils vous ont pris vos biens, les miens sont à vous, mon vieil ami, vous qui jadis dans les Alpujarras, avez empêché les soldats de don Juan d’Autriche de massacrer le pauvre Albérique, prisonnier et sans défense. Je connais mal mon fils Yézid, ou il vous dira, comme moi : prenez tous mes biens, ils sont à vous, car je vous dois mon père.
— Merci, merci, dit le vieux soldat en cherchant à cacher son émotion… mais ma fille, mais Carmen !
— Elle sera notre enfant d’adoption… je la marierai… je la doterai.
— Lui rendrez-vous l’honneur qu’on a enlevé à son père ?
— On ne vous l’enlèvera pas ! Votre innocence sera reconnue ; on vous rendra votre épée, et de plus on vous récompensera comme vous le méritez. Nous plaiderons votre cause… Il y a des juges à Madrid !
— Ils seront inexorables.
— On les attendrira.
— Ils sont tous vendus.
— Eh bien ! on les achètera, et plus cher que personne, plus cher que le duc de Lerma lui-même.
— Ce n’est pas cela que je veux.
— Et que voulez-vous donc ?
— Voir Fernand, mon neveu… lui parler !
— Écoutez ! écoutez ! s’écria le vieillard… Entendez-vous au-dessus de notre tête le galop d’un cheval ? Il a henni. Je le reconnais ! C’est Kaled… c’est le cheval de mon fils ! Yézid nous arrive, et Fernand avec lui. Courage ! courage !
La porte s’ouvrit et Yézid parut. Il était seul.
Il avait fait en moins de deux jours les soixante lieues qui séparent Madrid de Valence, et il raconta aux deux vieillards ce qui s’était passé.
Seulement il leur laissa ignorer ce qu’il avait appris depuis, c’est que, pour avoir manqué de respect au roi, en son conseil, pour avoir défendu et peut-être partagé les opinions d’un gentilhomme déclaré traitre à son souverain et à son pays, pour d’autres raisons encore dont le duc de Lerma et le grand inquisiteur ne parlaient pas et qu’il était facile de deviner, Fernand d’Albayda était privé de l’honneur de servir désormais son pays, et condamné à subir, dans la prison de Valladolid, une captivité dont rien ne faisait prévoir le terme.
De pareilles nouvelles auraient porté le coup de la mort à don Juan d’Aguilar, et Yézid se contenta de lui dire que son neveu était gardé à vue, pour avoir soutenu l’honneur de leur maison, et pour avoir voulu le défendre, les armes à la main, envers et contre tous, même contre le fils du ministre.
— Bientôt, ajouta Yézid, il sera libre, il viendra ; d’ici là, qu’attendez-vous de son amitié, ou plutôt de la mienne ? car moi, c’est lui ! ainsi donc parlez, dites tout à votre neveu !
D’Aguilar regarda le jeune homme avec le sourire d’un ancien ami, et le vieil Albérique, qui comprit ce regard, s’écria : — Je vous disais bien qu’il était impossible de ne pas aimer Yézid ; parlez maintenant, nous vous écoutons.
D’Aguilar leur raconta ce qui s’était passé depuis le moment où Tyrone, chef des révoltés, l’était venu joindre avec quatre mille hommes seulement. Avec cette faible troupe et les six mille Espagnols qu’il commandait, il n’avait pas craint d’attaquer près de Baltimore trente mille Anglais commandés par le vice-roi d’Irlande.
Les Espagnols, se battant avec leur valeur accoutumée, avaient longtemps soutenu le combat et rendu la victoire incertaine, mais abandonné lâchement par Tyrone et les Irlandais, d’Aguilar avait été obligé de faire sonner la retraite. Ralliant ses troupes et ne les laissant point entamer, il s’était jeté sur Kinsale et Baltimore, deux villes dont il s’était d’abord emparé.
Au lieu de lui venir en aide, les habitants de l’Irlande, frappés de terreur, s’étaient empressés, pour se soustraire à la vengeance d’Élisabeth, de faire leur soumission, sans s’inquiéter des alliés qui étaient venus les secourir ; dès lors l’expédition était devenue sans but, mais d’Aguilar avait voulu du moins conserver à son roi une armée dont tout le monde regardait le salut comme désespéré.
Attaqué, du côté de la terre, par le vice-roi et toute son armée, bloqué, du côté de la mer, par une flotte anglaise, le général espagnol avait fait dire au lord Montjoy qu’il s’ensevelirait sous les ruines de Kinsale et de Baltimore, qu’occupait alors son armée, et que si cette armée était perdue pour l’Espagne, ces deux villes le seraient également pour l’Angleterre.
Lord Montjoy, dont le cœur était noble et généreux, avait répondu à cette courageuse déclaration, en offrant à d’Aguilar la capitulation qu’il dicterait lui-même, et d’Aguilar avait exigé : qu’on accordât à ses troupes les honneurs de la guerre, qu’on les transportât en Espagne sur des vaisseaux anglais, avec leur artillerie et leurs munitions ; de plus, ne voulant même pas exposer à la colère du vainqueur les alliés qui l’avaient abandonné et trahi, d’Aguilar avait stipulé une amnistie pour les habitants de Kinsale et de Baltimore.
Tout lui avait été accordé !
— Et voilà, s’écria le vieillard avec indignation, voilà l’acte que l’on veut faire passer pour une lâcheté et pour une trahison. Ils ont dénaturé les circonstances et les faits. Ils m’accusent d’avoir traité avec des hérétiques, des excommuniés, et ne veulent m’écouter que lorsque je me serai constitué prisonnier de l’inquisition ; et comment du fond de ses cachots ma voix se ferait-elle entendre ? Ils auraient soin de l’étouffer, de publier des aveux mensongers que je ne serais pas là pour démentir.
J’ai fait un mémoire, le voici ; il faut qu’il soit lu, non par le duc de Lerma, mais par le roi, le roi lui-même.
C’est le service que j’attendais de mon neveu, don Fernand d’Albayda, à qui son âge accorde entrée au conseil. Nul autre que lui ne l’oserait maintenant, pas même le marquis de Miranda, notre parent, président de l’audience de Castille ; car ce serait se faire un ennemi du duc de Lerma, ce serait encourir sa disgrâce, et à présent en Espagne, dit le vieillard en baissant la tête, personne n’a ce courage.
— Si vraiment, répondit Yézid, qui venait d’écouter attentivement ce récit ; il est encore en Espagne des cœurs qui braveraient tout pour un ami : mais ceux-là ne sont pas à la cour.
— C’est-ce que je voulais dire, répondit d’Aguilar avec amertume.
— Ceux-là ne peuvent pas approcher le roi, continua Yézid… Mais il est d’autres moyens, je l’espère, d’arriver jusqu’à lui. Confiez-moi ce mémoire, et, avant une quinzaine de jours peut-être, il lui sera remis à lui… à lui-même, par une personne que nul ne soupçonnera et qui redoutera peu le duc de Lerma ; d’ici là, restez caché dans cet asile, où l’on ne pourra vous découvrir, et comptez sur moi.
Sans s’expliquer sur son projet, dont il désirait prendre sur lui seul tout le danger, Yézid voulait partir à l’instant même, au milieu de la nuit. On eut grand peine à le faire attendre jusqu’au jour.
Il employa ce temps à demander à d’Aguilar de nouveaux détails sur l’expédition d’Irlande, surtout sur lord Montjoy, que lui, Yézid, avait connu autrefois, à Cadix, au sujet d’une importante affaire, d’un traité secret de commerce entre les Maures de Valence et les sujets de la reine Élisabeth. Il conjura de nouveau d’Aguilar de prendre courage, lui promit un prompt retour, et s’arracha aux embrassements de son père et aux témoignages d’affection de ses fidèles serviteurs, tout attristés du nouveau départ de leur jeune maître.
À la cour cependant, et dans les principales villes du royaume, tout n’était que bals, fêtes, réjouissances pour l’arrivée et le mariage de la jeune reine.
Marguerite d’Autriche, la plus jeune des trois filles de l’archiduc Charles, n’était point d’une grande beauté ; mais elle était pleine de grâce, de franchise et d’abandon, et elle venait régner dans un pays où tout était gravité, dissimulation et étiquette. Jamais reine n’avait été moins faite pour l’Espagne.
Élevée, comme le sont presque toutes les princesses allemandes, dans l’intimité de la famille, dans une grande liberté d’action, dans une facile mais noble familiarité avec tous ceux qui l’entouraient, Marguerite avait conservé, de son pays, les idées exaltées qui devaient produire plus tard Werther, et la Marguerite de Faust.
Son imagination vive et ardente avait un côté tendre et mélancolique qui n’excluait point une douce gaieté, et ce caractère devait être assez difficilement compris dans le nouveau pays qu’elle allait habiter ; pays avec lequel elle formait une assez piquante opposition ; car l’azur de ses yeux contrastait avec l’œil noir des Andalouses, autant que la rêverie germanique avec le son des castagnettes et les poses animées du fandango.
La flotte qui l’avait prise à Gênes l’avait conduite à Valence, où le roi devait se rendre pour la cérémonie du mariage, et la cour l’avait précédée.
Marguerite avait été peu enchantée de Valence la belle, qui, avec ses rues étroites, tortueuses et impraticables, lui paraissait avoir usurpé son surnom. Elle avait fait son entrée par l’Alameda, ou la promenade publique, avait été reçue au palais du vice-roi, où toutes les dames de la maison lui avaient été présentées, et où don Juan Ribeira, patriarche d’Antioche et archevêque de Valence, l’avait haranguée et bénie. Marguerite s’était peu amusée ce soir-là, et ce qui surtout l’avait attristée, c’est que parmi toutes les grandes dames de la cour qui avaient paru au baise-main, et avec lesquelles elle allait passer sa vie, aucune ne lui avait inspiré de sympathie, ni de confiance. Il n’y en avait aucune qu’elle eût osé interroger ; et cependant elle avait tant de choses à demander !
C’était le lendemain que le roi devait arriver pour l’épouser, et elle ne connaissait rien de ce roi… que son portrait !… On lui avait dit seulement que, depuis longtemps, Philippe l’aimait et l’avait choisie ; que, du vivant du dernier roi, c’était un mariage convenu et arrêté, et en Allemagne il y a un grand respect et un grand charme attachés aux idées de fiancés, à ces engagements écrits dans le ciel, avant d’être réalisés sur la terre.
— Je lui appartiens déjà, se disait elle, je suis sa fiancée ! Je suis la femme de son choix, et cette seule pensée lui avait inspiré, sinon de la tendresse, au moins de la reconnaissance pour son royal époux. Elle aurait donné tout au monde pour connaître son caractère, ses goûts, ses idées, ses manières.
Mais à qui s’adresser dans cette cour où elle ne connaissait personne, où elle était étrangère, bien plus encore, où elle était reine, ce qui supposait que chacun refuserait ou craindrait de lui dire la vérité.
Ses femmes s’étaient retirées depuis longtemps, et Marguerite ne dormait pas, et elle ne pouvait dormir. Elle ouvrit une porte vitrée qui donnait sur les vastes jardins du palais. La nuit était superbe, l’air chaud et embaumé, partout un profond silence, des arbres élevés et d’épais ombrages. Marguerite se hasarda à faire quelques pas dans une allée, puis elle s’enhardit, s’avança plus loin, et se perdit sous des massifs de verdure.
— Au bout de quelques instants, elle crut entendre des voix de femmes dans un bosquet, et elle allait se retirer lorsque son nom et celui du roi frappèrent son oreille. La curiosité l’emporta, elle se cacha derrière des touffes de citronniers et de grenadiers, et écouta : c’étaient deux dames de la cour.
— Nous aurons des bals et des fêtes… Voici Sa Majesté Catholique enfin mariée ! ce n’est pas sans peine.
— Vous vous trompez, marquise, il n’y a jamais eu de difficultés pour marier le roi… au contraire…
— Au contraire, dites-vous… expliquez-moi cela, ma chère comtesse.
— Ne savez-vous donc pas comment ce mariage s’est décidé ?… c’est une histoire curieuse… Le duc de Lerma, qui depuis… l’ingrat !… mais alors j’avais toute sa confiance… le duc m’a raconté l’anecdote le soir même, sous le sceau du secret, car il avait une peur horrible du roi.
— Comme tout le monde, du reste.
— À commencer par son fils, dont la soumission et la faiblesse passaient toutes les bornes. Philippe II avait toujours craint que l’infant n’eût trop d’esprit ; il en croyait voir dans toutes ses actions.
— Pas possible !
— Il était si défiant ! aussi, dans sa profonde politique, avait-il formé le dessein de le rendre imbécile ; il avait fait en sa vie des choses plus difficiles ; mais bientôt il trouva lui-même qu’il avait trop bien réussi.
— Allons donc !
— C’est comme je vous le dis, et c’est justement à cela que se rapporte l’anecdote que je vous ai promise. Le feu roi voulait marier son jeune fils de son vivant… C’était une idée comme une autre, une idée paternelle et monarchique, et devant quelques personnes de la cour dont était le duc de Lerma, alors marquis de Denia, il lui déclara qu’il voulait lui donner pour femme une des trois filles de l’archiduc Charles d’Autriche.
— C’est vrai ! l’archiduc, je crois, en avait trois !
— Oui ! les princes allemands peuplent beaucoup ! et Philippe II, montrant à son fils trois tableaux magnifiquement encadrés, l’engagea à examiner attentivement ces trois portraits, ceux des trois princesses autrichiennes, et à désigner celle qu’il préférait pour sa femme. Devinez ce que fit le jeune prince ?
— Il les préféra toutes trois !
— Son père, tout dévot qu’il était, eût peut-être choisi ainsi ; mais le fils, s’inclinant respectueusement, répondit avec sa soumission accoutumée, qu’il s’en rapportait, pour une décision si importante, au jugement de Sa Majesté, — Mais, poursuivit le roi, il s’agit de votre goût. — Je m’en rapporte à celui de Votre Majesté. — De votre inclination. — Ce sera celle de Votre Majesté. — Mais enfin, il y a une de ces trois figures qui vous plaît le plus ? — Ce sera celle qui plaira à Votre Majesté. — Le roi proposa alors de faire porter ces trois portraits dans la chambre de l’infant, afin qu’il réfléchit et se décidât à loisir.
— C’est juste ! la nuit porte conseil.
— Le prince répondit que ce serait inutile, que son choix était fait d’avance, et qu’il était fermement décidé.
— À quoi ?
— À préférer celle que le roi désignerait. — Sa Majesté doit s’y connaitre mieux que moi, ajouta-t-il.
— C’était peut-être vrai !
— Et l’on eut beau faire, on ne put obtenir de lui aucune réponse. Les choses en restèrent là[11].
— Et qui donc enfin, dans cette grave affaire, a eu le pouvoir de décider ? Est-ce le duc de Lerma ?
— Non, mais un arbitre plus puissant que le ministre et que le feu roi lui-même, la mort, qui a enlevé successivement les deux filles de l’archiduc, de sorte que la princesse étant restée seule, a enfin obtenu la préférence.
— C’est heureux pour elle.
— Plus que pour Sa Majesté, qui n’avait pas tort d’hésiter si longtemps. À ce propos, demanda la marquise, comment trouvez-vous notre nouvelle souveraine ?
— Bien Allemande ! marquise.
— Et moi bien gauche ! comtesse.
— C’est ce que je voulais dire !
La reine avait à peine entendu ces derniers mots, qu’elle venait de s’enfuir, et sans que personne se fût douté de sa promenade, elle était rentrée dans son appartement, en se répétant : Choisie par lui !… Voilà comment il m’a choisie !… Ô mon Dieu !… mon Dieu !
Les illusions de la pauvre Marguerite, ce mariage écrit dans le ciel, ses rêves d’amour et de tendresse, tout venait de s’évanouir, et lorsque le roi arriva, lorsque, plein d’une émotion qu’il ne connaissait pas encore, il se présenta devant sa jeune épouse, un mot gracieux, un sourire encourageant pouvaient changer sa destinée et en faire un autre homme. Cet ascendant, ce pouvoir absolu qu’il avait laissé prendre à son ministre pouvait facilement se transmettre à la première femme qu’il eût aimée.

Mais Marguerite l’accueillit avec un air glacial, et quand Philippe, surpris et déconcerté, essaya de balbutier quelques compliments ou quelques galanteries, un sourire de mépris erra sur les lèvres de la jeune reine ; elle se rappela, dans ce moment, la phrase de soumission filiale adressée à Philippe II, et le roi, que la conversation embarrassait beaucoup, ayant demandé au bout de quelque temps quelle heure il était, distraite et préoccupée, elle répondit : « Celle qu’il plaira à Votre Majesté ; » mot que le roi prit pour une sottise, et qui n’était qu’une revanche.
Quant à ses dames d’honneur, elle eût été fort embarrassée de dire celle qui lui déplaisait le plus.
Elle tressaillit le lendemain aux premiers mots de basse adulation qui lui furent adressés. Elle avait reconnu, non les traits, mais la voix des deux dames qu’elle avait entendues la veille dans le bosquet.
L’une, d’un âge mûr, était sa cameriera mayor, la marquise de Gandia ; l’autre, jeune encore, et qui avait dû être charmante, était la comtesse d’Altamira, autrefois alliée, aujourd’hui ennemie du duc de Lerma, et qu’un pouvoir occulte, dont nous parlerons plus tard, avait maintenue à la cour ; mais comme elle n’exerçait en ce moment aucune fonction immédiate et ostensible, la reine demanda au premier ministre en quelle qualité la comtesse était auprès d’elle.
Le duc de Lerma répondit avec gravité :
— Comme gouvernante des enfants de Votre Majesté.
— Déjà ! reprit sèchement la reine, s’étonnant, en elle-même, qu’on eût pourvu d’avance à une charge qui lui semblait au moins douteuse.

Nous ne ferons point le détail des fêtes, bals, tournois, carrousels, illuminations et spectacles pompeux qui eurent lieu à l’occasion de ce mariage ; l’histoire en a gardé le souvenir. Le million de ducats annoncé par le duc de Lerma, fut, dit-on, dépassé, et si l’on en excepte les premiers ouvrages donnés par Calderon de La Barca, qui débuta à cette occasion dans la carrière dramatique, il était impossible d’acheter plus cher de l’ennui, denrée qu’il est si facile d’avoir pour rien, surtout à la cour.
Rassasiée de plaisirs et d’hommages, fatiguée de fêtes, de réceptions et d’étiquette, la reine déclara qu’elle voulait aller à Madrid, sans escorte, et traverser sans suite, incognito, et à petites journées, le beau royaume de Valence, qu’elle ne connaissait pas, et qu’elle désirait parcourir, avant d’entrer dans la Nouvelle-Castille.
Le roi aurait voulu l’accompagner, mais il avait solennellement promis à fray Cordova, son confesseur, cordelier placé près de lui par le duc de Lerma, de faire, après la première semaine de son mariage, une neuvaine à Saint-Jacques de Compostelle. Il était trop dévot pour oublier cette promesse, et le duc de Lerma, trop habile pour ne pas la lui rappeler.
C’était interrompre l’intimité que font naître, même entre époux couronnés, les premiers jours d’un mariage ; c’était, dans le cas où la reine aurait déjà pris quelque ascendant sur son mari, la meilleure manière de le détruire ou de l’atténuer.
Le roi, qui avait toute l’Espagne à traverser, partit promptement pour la Galice, escorté de son ministre et d’une grande partie de sa cour, tandis que la reine, avec une suite peu nombreuse, se mit en route, voyageant lentement, d’abord à cause de la chaleur, qui était excessive, et puis parce qu’à chaque pas elle s’arrêtait jour admirer.
La Huerta de Valence présentait l’aspect d’un magnifique jardin. Sa fertilité tenait du prodige. On l’attribuait aux flots de sang dont ses plaines avaient été inondées pendant les combats entre les Maures et les chrétiens. Mais sans doute le travail des Maures avait contribué plus que leur sang, à les féconder.
Partout, des réservoirs et des canaux d’arrosage distribuaient les eaux dans les terrains les plus éloignés et les plus arides ; partout, des eaux jaillissantes et des tapis de verdure, partout des fruits au milieu de corbeilles de fleurs.
La reine et son escorte suivaient depuis longtemps les bords du Guadalaviar, et ses yeux fatigués de la pompe des palais ne pouvaient se rassasier de cette nature enchanteresse.
Tout à coup. c’était la fin de la journée, le soleil était sur son déclin, elle s’arrêta et poussa un cri d’admiration à la vue d’un vallon ou plutôt d’un Éden, où se réunissaient les merveilles de la végétation, toutes les plantes des tropiques à côté de celles de l’Europe. Là, croissaient en plein air le bananier, le pistachier, le myrte et le sésame ; là s’élevaient des bois d’orangers et de citronniers dont les branches ployaient sous leurs fruits dorés.
Un ruisseau, dont la blanche écume étincelait sur les gazons, parcourait toute la vallée, arrosant de ses flots bienfaisants la canne à sucre, le cotonnier, l’ananas et le cafeyer. C’était une féerie, un enchantement, c’était le val parayso, la vallée du paradis !
À mi-côte s’élevait une habitation comme la reine n’en avait jamais vu.
C’était l’architecture arabe dans ce qu’elle avait de plus léger et de plus élégant, ses fines colonnettes, ses gracieuses parures découpées avec tant de coquetterie qu’on eût dit des dentelles en marbre. Autour de l’habitation régnaient des jardins délicieux, dont on apercevait de loin les massifs de fleurs et les jets d’eau retombant dans des bassins de marbre blanc.
Et ce palais, cette demeure royale, n’était cependant qu’une ferme opulente ; car des deux côtés du logement principal, à travers les portiques élégants que soutenaient ces sveltes colonnes, on voyait de nombreux troupeaux se presser et rentrer au bercail. La clochette des vaches et des brebis retentissait en cadence dans la vallée, et accompagnait le chant des pasteurs, chant suave et mélodieux, nouveau aux oreilles de la reine, mais non aux échos de la vallée, qui le répétaient avec complaisance, et semblaient le saluer comme le chant de la patrie.
La reine demanda à qui appartenait cette champêtre et magnifique habitation.
— Au plus riche propriétaire de Valence, Alamir Delascar d’Albérique.
— Voici la fin du jour, et au lieu de marcher jusqu’à Tuejar, où notre halte est préparée, j’aurais bien envie de m’arrêter ici, et de contempler demain cette belle vallée éclairée par les premiers rayons de l’aurore, comme elle l’est en ce moment par le soleil couchant.
— Je ferai observer à Votre Majesté que cela est impossible, dit la comtesse de Gaudia, la cameriera mayor.
— Et pourquoi ?
— On attend Votre Majesté à Tuejar… ce soir.
— Si j’étais indisposée, je ne pourrais m’y rendre !
— Mais, grâce au ciel, Votre Majesté ne l’est pas.
— Supposez que ce soir le ciel m’accorde ce bonheur… et je crois qu’en effet il vient de m’exaucer… car je souffre… j’ai mal aux nerfs.
— J’espère que cela n’est pas.
— Cela est ! cela m’arrive toujours quand on me contrarie.
— Sa Majesté a raison, s’écria la comtesse d’Altamira ; c’est un effet immanquable que j’ai souvent éprouvé.
— Envoyez un homme à cheval à Tuejar, et prévenez que nous n’irons que demain dans la journée.
— Mais, madame…
— Qu’est-ce encore ?
— Que prétend faire Votre Majesté ?
— Demander pour cette nuit l’hospitalité à Delascar Albérique. Pensez-vous qu’il la refuse à la reine ?
— Non, sans doute… mais lui accorder un tel honneur est impossible !
— Et pourquoi ?
— Ce d’Albérique est un Maure !
— Les Maures ne sont-ils point nos sujets comme les autres habitants de l’Espagne ?
— Si, madame !
— Pourquoi donc alors ne pourrais-je pas reposer sous son toit, aussi bien que sous celui du corrégidor de Tuejar ? !
— Je doute, madame, que Sa Majesté le roi catholique approuve ce projet !
— Faut-il donc lui envoyer un courrier sur la route de Galice, et la consulta royale doit-elle s’assembler pour savoir où nous passerons cette nuit ?
— Non, madame, reprit la cameriera mayor, mais je suis certaine que Son Excellence le duc de Lerma s’y opposerait formellement.
La reine jeta sur elle un regard qui l’empêcha d’achever sa phrase, tant il y avait dans ce regard d’indignation et de mépris ; puis se tournant vers un de ses gentilshommes : « Comte, lui dit-elle, veuillez demander au Maure Albérique s’il veut bien accorder, pour cette nuit, l’hospitalité à la reine d’Espagne. »
Le comte partit, et la reine, prenant un ton plus doux, dit à la cameriera mayor :
— Je ne vous oblige pas, madame la marquise, à braver la colère du roi, et bien plus encore celle de M. le duc de Lerma, en nous suivant dans cette demeure. Vous êtes la maitresse de ne pas nous y accompagner ; quoiqu’à vrai dire, mesdames, continua-t-elle gaiement, je sois fort curieuse de l’examiner en détail, et je serai bien trompée si la réception qu’on nous y prépare ne vaut pas celle qui nous attendait chez M. le corrégidor de Tuejar.
Elle avait à peine fini de parler, qu’un vieillard à la barbe blanche et à la figure vénérable s’approcha d’elle, et mettant un genou en terre,
— Je ne croyais pas, madame, qu’un si grand honneur fût jamais réservé à moi et à ma famille ; mais Votre Majesté a voulu commencer son rêgne par faire des heureux, et dans cette maison où elle daigne entrer, chaque jour on redira son nom avec respect et reconnaissance.
Puis, se relevant, et avec un regard où brillaient les dernières lueurs de la majesté des rois maures, il ajouta :
— D’autres viendront vous offrir les clés de leurs cités ou de leurs forteresses ; nous, madame, dans nos personnes et dans nos biens, qui sont à vous, rien n’est digne de vous être offert ; mais on dit que la bénédiction d’un vieillard porte bonheur : permettez-moi d’appeler sur vous celle du ciel ! Soyez bénie, ô reine ! que le sceptre vous soit léger ! que tous vos jours soient heureux !
C’était la première fois, depuis que Marguerite était en Espagne, qu’on lui parlait un langage qui allait au cœur, un langage qu’elle pouvait comprendre et qui ne répondait que trop bien à ses secrets sentiments.
Pendant qu’autour d’elle les gens de sa suite se consultaient des yeux, incertains s’il fallait approuver ou blâmer la hardiesse du Maure, la reine lui tendit la main en lui disant :
— Fils des Abencerages, nous nous confions à l’hospitalité du Maure : Entrons !
X.
la visite de la reine.
La première cour était entourée de légères arcades formées par des sculptures à claire-voie, d’un travail presque aérien, et soutenues par de minces colonnes de marbre blanc. L’air était embaumé par des massifs de fleurs, et, à travers les portiques de la cour, on apercevait les jardins où brillaient le cactus, l’aloès, le câprier, l’astragale ligneux, la giroflée sauvage, et des palmiers indigènes dont les cimes dépassaient les bosquets d’oliviers et de grenadiers.
À gauche de la cour, un portail richement orné servait d’entrée à une grande pièce pavée de marbre blanc.
Une coupole ouverte y laissait pénétrer l’air extérieur et la chaude lumière du soleil couchant. Là, des jeunes filles, vêtues de l’habit mauresque, vinrent présenter à la reine des fleurs étrangères et nouvelles, qui jamais en Allemagne n’avaient frappé ses yeux : c’était la rose du Japon, le camélia rouge et blanc.
Marguerite regardait tout ce qui l’entourait avec étonnement, avec plaisir, avec une curiosité enfantine qu’elle ne prenait pas la peine de déguiser. Dans cette habitation d’un autre âge, elle se croyait d’un autre siècle ; elle n’était plus reine d’Espagne, mais simple voyageuse au pays et au temps des rois maures.
Dans la salle où fut servi le repas, la partie inférieure des murailles était incrustée de belles briques mauresques vernies, sur lesquelles on voyait les écussons des Abencerages ; la partie supérieure était revêtue de ce beau stuc inventé à Damas, qui se composait de grandes plaques moulées, jointes ensemble avec tant d’art, qu’elles paraissaient avoir été sculptées sur place en bas-reliefs élégants, ou en arabesques fantastiques, mêlées de chiffres, de vers, et d’inscriptions en caractères arabes. Les ornements des murs et de la coupole étaient dorés, et les interstices remplis par du lapis-lazuli ; autour de la salle étaient des divans et des ottomanes soyeuses, placées d’espace en espace.
Une eau limpide, coulant dans des coupes de marbre, entretenait une douce fraîcheur, tandis que des jeunes filles offraient aux convives des parfums, des sorbets et des fruits glacés.
Tout dans cette habitation offrait l’aspect du bon goût et du bien-être. Le luxe ne s’y montrait pas, il s’y cachait, et partout l’élégance semblait vouloir faire pardonner la richesse.
Pendant la soirée, Marguerite, qui aimait beaucoup plus à s’instruire que l’étiquette ne le permettait aux reines d’Espagne, Marguerite causa avec Albérique, et celui-ci lui parla, non pas des souvenirs glorieux et des conquêtes de ses ancêtres, mais de ce qu’ils avaient fait pour enrichir l’Espagne et la rendre heureuse, des lois sages et équitables qu’ils lui avaient données, des sciences et des arts protégés par eux, de l’encouragement accordé à l’agriculture, au commerce et aux manufactures.
Il lui parlait aussi, comme du sujet qui devait le moins ennuyer une jeune reine, de la galanterie des Maures, de leur esprit chevaleresque, de leur amour pour la gaie science, la poésie, la musique, et surtout pour les dames… Les heures s’écoulaient, et plusieurs fois la cameriera mayor avait, par ses gestes d’impatience, indiqué à sa souveraine qu’il était l’heure de se retirer.
Marguerite la comprit enfin ; elle se leva.
Au-dessus du porche intérieur régnait une galerie qui communiquait à l’appartement des femmes. On y voyait encore les jalousies à travers lesquelles les beautés aux yeux noirs du harem pouvaient voir, sans être vues, et assister aux fêtes qui se célébraient dans les salons d’en has.
La distribution et l’ornement intérieur des appartements avaient été bien changés depuis par Albérique, et la chambre la plus belle, la plus élégante, surtout la plus commode, celle qui d’ordinaire était la sienne, avait été cédée par lui à la reine.
Dès qu’elle fut seule, dès qu’elle fut délivrée des empressements et des soins de ses femmes, elle se mit à rêver à tout ce qu’elle avait vu.
On ne peut contempler en Espagne la mosquée de Cordoue, l’alcazar de Séville, l’Alhambra de Grenade ou d’autres monuments du même style, sans que les anciens souvenirs de romans ne se réveillent dans l’imagination et ne s’y associent. L’on s’attend presque à voir la blanche main d’une princesse faire un signe du balcon, ou bien un œil noir briller, derrière la jalousie.
Ces impressions qu’ont ressenties presque tous les voyageurs, Marguerite les éprouvait en ce moment, et plus qu’une autre peut-être. Elle se représentait quelque jeune Abencerage, le turban en tête, le large cimeterre au côté, portant sur son bouclier sa galante devise et les couleurs de sa dame ; elle croyait entendre les pas de son coursier ; il en descendait, il s’arrêtait sous son balcon… Un instant après avait retenti le son de la guitare… et Marguerite s’endormit en rêvant à la cour de Grenade, au roi Boabdil, à la reine Zoraïde, mise en accusation par un époux jaloux, pour un crime que Marguerite eût pardonné… celui d’avoir été trop aimée.
La reine se réveilla au point du jour, et se leva pour examiner de sa fenêtre, comme elle se l’était promis, les campagnes de Valence au lever de l’aurore ; c’était d’abord un grand bonheur ; et un autre, non moins grand, c’était d’être seule pendant trois ou quatre heures ; car elle ne devait se lever officiellement qu’à neuf ou dix heures, et les femmes composant son service ordinaire ne pouvaient entrer dans sa chambre avant ce moment.
Tout dormait donc encore dans l’habitation du Maure, tout, excepté elle. Elle venait de jeter une légère mantille sur ses épaules que couvraient déjà ses blonds cheveux, lorsqu’elle entendit dans la muraille un bruit, une espèce de craquement qui la fit tressaillir, et vis-à-vis d’elle, un panneau doré, qu’éclairaient les premiers rayons du soleil levant, s’ébranla, tourna sur lui-même et lui laissa voir un jeune homme qui entra vivement et sans crainte dans son appartement.
Frappée de surprise et d’effroi, Marguerite n’eut pas même la force de crier ; sentant ses genoux fléchir, elle s’appuya contre sa haute et riche toilette, dont les rideaux de soie la cachèrent un instant.
— Mon père, mon père, s’écria vivement le jeune homme, réveillez-vous ! c’est moi ; j’arrive à l’instant, et il faut que je vous parle avant qu’on ne sache mon retour.
Et il marchait vers l’alcôve, et il tira les rideaux du lit, qui heureusement était désert ; la reine n’y était plus.
— Déjà levé ! s’écria-t-il ; et en se retournant, il aperçut près de la toilette une jeune femme, en costume du matin, qui baissait les yeux et rougissait.
Les deux mots du jeune homme venaient de tout lui apprendre, et incertaine maintenant, elle hésitait et ne savait si elle devait punir ou pardonner un hasard, dont personne n’était coupable, mais qui la mettait dans une situation si extraordinaire et si embarrassante !… Cependant, comme elle ne manquait ni de tête, ni d’esprit, ni de jugement, elle comprit, en un instant, que le seul danger véritable et réel était de donner lieu au moindre éclat ; que ceux qui pouvaient la perdre étaient, non le jeune homme qui était là dans son appartement, mais ceux qui veillaient sur elle, au dehors.
Et sur-le-champ son parti fut pris.
Pendant ce temps, Yézid, debout, immobile devant elle, la contemplait avec une émotion où il y avait mieux que de l’étonnement… car l’apparition subite de cette jeune et belle fille lui semblait magique et surnaturelle.
— Êtes-vous une fille du Prophète… une houri… une fée ? dit-il en tremblant.
— Non, répondit Marguerite avec dignité, mais je suis ta reine… ta reine à qui ton père a donné pour cette nuit l’hospitalité[12].
Yézid tomba un genou en terre.
— Pardon, madame, pardon ! s’écria-t-il.
La reine lui fit signe de la main de parler moins haut, et se rapprochant de lui :
— Comment te trouves-tu à cette heure dans cet appartement ?
— J’ai voyagé toute la nuit. J’arrivais de Cadix, et comme tout le monde était endormi, je me suis glissé dans la chambre de mon père par ce passage secret, que lui seul et moi connaissons.
— Quel est ce passage ?
Le jeune homme hésita un instant, puis voyant dans les yeux de la reine cette bonté et cette franchise de la jeunesse qui bannissent toute défiance, il lui dit :
— Ce secret est celui de ma famille, mon père m’avait dit : Ne le révèle qu’à Dieu ou à ses anges…
Il jeta sur la reine un regard de respect et d’admiration, et ajouta :
— Je puis le dire, je crois, à Votre Majesté.
— Eh bien ? dit Marguerite avec curiosité.
— Eh bien, ce passage conduit à un endroit où est renfermé le trésor de nos pères, trésor qui nous fut légué par eux, trésor que nous augmentons par notre travail, pour venir au secours de nos frères, si jamais le malheur ou la persécution devait les atteindre ; c’est leur avenir, leur existence peut-être que je viens de livrer à Votre Majesté. Mais je ne m’en repens point. Dieu ne saurait me punir d’avoir eu confiance en ma souveraine.
— Et tu as raison, dit Marguerite, ton père et toi possédiez seuls ce secret, nous serons trois maintenant, et pas d’autres.
Puis, élevant la main, elle dit :
— Je jure que le roi mon époux et aucun de ses ministres n’en auront jamais connaissance !
Alors, avec un sentiment assez difficile à définir et à expliquer dans une reine, si une veine n’était pas une femme… elle ajouta en souriant
— Et maintenant que je l’ai rassuré, maintenant que me voilà comme toi propriétaire de ce secret, dis-moi…
Elle hésita encore, et enfin, reprenant courage, elle acheva avec embarras :
— Dis-moi… si je ne pourrais pas le connaître… et le voir ?
— Vous, madame ! s’écria Yézid étonné.
— Oui, dit la reine avec naïveté, j’en meurs d’envie !
— Venez, venez… et si Votre Majesté daigne se fier à Yézid d’Albérique.
— Ah ! Yézid d’Albérique… c’est ton nom ?
— Oui, madame.
— N’était-ce pas celui d’un Abencerage ?..
— Oui, madame, celui qui le premier fut trainé, par l’ordre de Boabdil, dans la cour des Lions, et dont la tête roula la première sur la fontaine de l’Alhambra. Mais que Votre Majesté se rassure, continua-t-il en voyant l’émotion de la reine, nous sommes ici chez mon père, au milieu de ses serviteurs, et dans le souterrain où je vais vous conduire, il n’y a aucune apparence de danger.
— Eh mais ! dit la reine en souriant, il y en aurait un peu… pas beaucoup ! que je n’en serais pas fâchée.
— Malgré ma soumission à ses désirs, je ne puis en promettre à Votre Majesté.
— Eh bien donc ! et puisqu’il n’y a pas moyen, je me résigne ; Yézid d’Albérique, je suis prête à te suivre !
Yézid s’élança dans le passage secret ; Marguerite l’y suivit ; et à peine eut-elle fait quelques pas qu’elle réfléchit, pour la première fois, à sa démarche, à sa témérité !…
Mais elle pensa en même temps que, heureusement, il était trop tard pour réfléchir ; que, d’ici à quelques heures, on ne pouvait entrer dans son appartement. D’ailleurs, hésiter maintenant, c’était faire injure à la loyauté d’un Abencerage ; Yézid avait eu confiance en elle, elle pouvait bien avoir confiance en lui…
Et elle continua sa route.
Yézid lui avait dit la vérité. Le chemin qu’ils suivaient n’avait rien d’effrayant, ils marchaient sur un sable fin et léger qui ne blessait en rien les pieds délicats de la reine.
Pendant quelque temps ils furent éclairés, dans leur marche, par le jour qui venait de l’ouverture d’en haut ; puis ils arrivèrent à un rocher qui fermait la route et sur lequel croissaient des fleurs de grenadier.
La reine admirait leur éclat et leur beauté. Yézid en cueillit une touffe qu’il lui offrit avec respect, pendant que son autre main appuyait avec force sur un angle du rocher, qui s’ouvrit et leur livra passage. Mais cette fois ce passage était tellement obscur que Marguerite fut obligée, pour se guider, de s’appuyer sur le bras de Yézid !… elle, la reine !… et ceux qui se rappelleront l’étiquette de la cour d’Espagne, trouveront que c’était là une faveur insigne ! certaines familles, certains seigneurs de première classe en jouissaient seuls, et aux jours d’apparat, dans les palais de Madrid ou de l’Escurial, aux yeux de la foule, qui les enviait !
Yézid était bien plus heureux encore, et la reine n’avait pas seulement pensé à l’immense honneur qu’elle lui accordait.
Ils marchaient toujours dans l’obscurité, et un caillou heurté par le pied de Marguerite la fit chanceler ; Yézid la soutint, et la reine sentit ce cœur, contre lequel elle s’appuyait, battre avec violence, de respect et de crainte sans doute !
Par bonheur ce long passage souterrain venait de finir ; ils entraient dans une vaste salle éclairée par plusieurs lampes d’argent.
De nos jours encore, les histoires de trésors enfouis par les Maures sont généralement répandues en Espagne parmi les gens du peuple, et c’est tout naturel.
Les Maures de Grenade, au temps de Ferdinand et d’Isabelle, étaient persuadés que, tôt ou tard, ils rentreraient dans cette belle patrie qu’ils avaient conquise et qu’on leur enlevait injustement. Aussi beaucoup d’entre eux, avant leur départ, avaient enfoui ce qu’ils avaient de plus précieux.
Plusieurs de ces trésors avaient été trouvés par les paysans espagnols ; d’autres avaient échappé à leurs avides recherches, et les richesses de la famille d’Albérique étaient de ce nombre ; il est vrai que les pierres précieuses, que les lingots d’or at d’argent étaient, aux yeux de Delascar, des valeurs moins réelles et moins sûres que les richesses produites chaque jour par l’industrie et le travail ; aussi, comme l’avait dit Yézid, c’était la ressource non du présent, mais de l’avenir.
À l’aspect de ce souterrain, soutenu par huit colonnes en marbre noir, où l’or et les pierreries étincelaient de toutes parts, la reine se crut au milieu d’un conte des Mille et une Nuits, et se rappela l’histoire d’Aboul-Casem ; et, en effet, le riche négociant, l’habile manufacturier, l’intelligent agriculteur Delascar d’Albérique réalisait chaque jour, par ses travaux, les fictions des Arabes, ses ancêtres.
Dans des bassins de marbre, placés entre les colonnes, on voyait des pièces d’or monnayées à l’effigie des premiers califes de Cordoue ou des rois de Grenade ; dans des coffres en bois de cèdre brillaient des ornements, des parures, des armes incrustés de pierres précieuses. Un autre bassin renfermait des lingots, des masses d’argent brut et non travaillé. Enfin, dans des coupes de cristal de roche étincelaient des diamants, des topazes, des émeraudes et des rubis.
La reine regardait tout cela dans un profond silence ; elle n’osait marcher, elle n’osait même parler, craignant que le bruit de ses pas ou de sa voix ne fit évanouir ce rêve, cette féerie qui la charmait et qu’elle voulait prolonger.
Elle s’assit sur un siége de marbre, et, pensive, continuait à se taire. Yézid s’arrêta devant elle, et fléchit respectueusement le genou.
— Votre Majesté accordera-t-elle à son fidèle serviteur une dernière grâce, la plus grande de toutes ?
— Parle, Yézid.
— Moi, je n’oublierai jamais ce jour, le plus doux et le plus glorieux de ma vie, et rien ne manquerait à mon bonheur, si j’osais espérer que Votre Majesté en daignât conserver le souvenir.
— Je te le promets, Yézid.
— Que Votre Majesté me le prouve donc et ne s’offense pas de ma hardiesse.
En disant ces mots, il prit une des coupes de cristal qu’il renversa sur les genoux de la reine. Les diamants et les pierreries ruisselèrent à l’instant sur sa royale mantille.
Marguerite voulut prendre un air sévère, mais elle vit dans les yeux d’Yézid tant de respect et de dévouement ; la crainte de l’avoir offensée le frappa d’une douleur si profonde et si vraie, qu’elle ne se sentit point la majesté royale ou plutôt le courage de le désespérer.
De toutes les pierreries qui brillaient à ses yeux, elle choisit celle qui lui parut la moins précieuse ; c’était une turquoise sur laquelle étaient gravés des caractères, et elle lui dit en la prenant :
— Tu vois que je pardonne.
Yézid tressaillit de joie, et, secouant la mantille de la reine, il jeta à terre les autres pierreries.
— Mais il ne sera pas dit que la reine d’Espagne aura reçu du Maure Yézid sans lui rien donner… que puis-je pour toi ?
Yézid garda le silence.
— Es-tu donc tellement heureux que tu n’aies rien à demander à tes souverains ?
— Rien pour moi, mais trop peut-être pour un autre.
— Pour qui ?
— Pour un ami !
— Ah ! je comprends… tu aimes quelqu’un.
— Un ami de mon père, un noble et brave gentilhomme à qui l’on veut ôter le plus précieux des biens, son honneur !
— Et c’est pour lui que tu me demandes…
— Oui, madame… je demande justice.
— Et tu l’auras, je te le jure, s’écria la reine avec une vivacité et une joie dont elle ne se rendit pas compte… Parle, Yézid, parle !
Et Yézid lui raconta toute l’histoire de don Juan d’Aguilar qui ne pouvait, pour se défendre, ni arriver jusqu’à son souverain, ni lui remettre les preuves de son innocence.
— Je les lui remettrai, moi, dit la reine. Où sont-elles ?
— Sur moi… Tout est consigné dans ce mémoire, que ses ennemis empêcheront le roi de recevoir et surtout de lire.
— Eh bien ! je le lui lirai… moi, moi-même.
Yézid poussa un cri de joie et de reconnaissance.
— Tenez, madame, tenez ; et il lui remit le papier.
— Ne sachant, ajouta-t-il, aucun moyen de parvenir jusqu’à Philippe III, notre souverain, et ayant appris que lord Montjoy, vice-roi d’Irlande, allait être envoyé par la reine Élisabeth près la cour d’Espagne, j’ai couru en Angleterre et j’en arrive !
Je me suis adressé avec confiance à lord Montjoy lui-même, car il avait combattu don Juan d’Aguilar et connaissait mieux que personne sa noble conduite et sa bravoure ; j’espérais que ce mémoire serait remis par lui au roi, mais on m’avait trompé, la paix est loin encore. Le duc de Lerma n’en veut pas ! et lord Montjoy, qui s’apprêtait à partir comme ambassadeur, ne viendra point en Espagne.
Aussi, j’arrivais accablé du peu de succès de mon voyage. J’apportais à d’Aguilar et à mon père le découragement et le désespoir, et un mot de Votre Majesté va nous rendre à tous la joie et le bonheur.
— J’ignore quel peut être mon crédit ; je n’en ai pas encore fait l’essai, et peut être ne pourrai-je lutter contre le pouvoir du favori.
— S’il était vrai ! s’écria Yézid avec indignation.
— J’essaierai… Toi, cependant, garde le silence, même avec ton père.
— Je le jure à Votre Majesté.
— Même avec d’Aguilar.
— Avec tous ! Il y a des bonheurs qu’on ne partage avec personne, et je suis si heureux d’un secret où je suis de moitié avec Votre Majesté.
— Eh mais ! en voici déjà deux, dit la reine en souriant. Cependant, je ne me crois pas quitte envers toi : tu n’as demandé de sauver d’Aguilar, et nous y ferons notre possible. Mais pour toi, Yézid, que puis-je faire ?
— Ah si j’osais, dit Yézid en tressaillant de joie, je supplierais Votre Majesté…
— Eh bien ?
— De me rendre mon compagnon d’enfance, mon frère, don Fernand d’Albayda, retenu dans les prisons de Valladolid ! Oui, madame, poursuivit-il avec chaleur, pour avoir osé faire ce que j’ai tenté, pour avoir voulu défendre son oncle don Juan d’Aguilar, ils l’ont privé de la liberté et de l’honneur de servir le roi ! Qu’on lui rende son épée, et je vous jure, madame, qu’il ne l’emploiera jamais que pour défendre Votre Majesté.
— Bien, bien, dit la reine en souriant, toujours les autres ! et jamais toi ! La reine d’Espagne, je le vois, n’a pas assez de pouvoir pour te rien accorder.
— L’honneur que j’ai reçu aujourd’hui suffirait à combler tous les vœux. Je n’en ai plus à former ! qu’un seul peut-être…
Il s’arrêta un instant, et dit avec un sourire mélancolique :
— C’est que ce jour si heureux soit maintenant pour moi le dernier !
— Et pourquoi ?
— Que ferais-je désormais des autres ?
— Les autres, dit la reine avec émotion, seront aussi, je l’espère, des bonheurs ou des succès !
— Non, madame, répondit Yézid, mais des souvenirs !
Marguerite se leva sans répondre.
Yézid marcha à côté d’elle pour lui montrer le chemin ; mais Marguerite ne prit point son bras.
Ils remontèrent par le corridor sombre qui conduisait à l’appartement de la reine. Il était de bonne heure. Tout le monde dormait encore, Marguerite se retourna vers Yézid.
— Toi qui m’as si bien servi de guide et de chevalier, je te remercie… et je tiendrai ma promesse ! je penserai à don Juan d’Aguilar… et à Fernand d’Albayda.
Elle ne parla d’aucun autre, mais au moment où Yézid s’inclinait et allait se retirer :
— Un mot encore, lui dit-elle en souriant et en roulant entre ses doigts la fleur de grenade qu’elle : n’avait pas quittée ; nous avons accepté de toi cette turquoise où est gravé un chiffre inconnu ; si c’était quelque talisman… quelque maléfice…
— Non, madame, je le jure à Votre Majesté.
— Eh bien donc, explique-moi quel est le mot gravé sur cette pierre.
Yézid regarda et dit en balbutiant :
— C’est un mot arabe qui veut dire : toujours !
— Ah ! c’est arabe ! dit la reine en rougissant et en regrettant la demande qu’elle venait de faire. Adieu, Yézid, dit-elle d’une voix plus ferme, peut-être maintenant ne te reverrai-je plus… mais compte toujours, et elle appuya sur ce dernier mot, sur ma royale protection… Quant à nous, continua-t-elle avec émotion, nous comptons sur ton dévouement et sur ta discrétion !…
— Toujours ! dit Yézid.
Le panneau se referma : le jeune Maure disparut.
Une heure après, les dames de la reine étaient réveillées. La cameriera mayor entra dans la chambre de Sa Majesté, qui venait de se lever. L’escorte était prête, tout se disposait pour le départ. Le vieux Delascar d’Albérique et tous les gens de sa maison attendaient, dans les jardins, le moment où la reine descendrait.
C’était, ce jour-là, jour de repos. Tous les travaux étaient suspendus. Tous les Maures, hommes et femmes, en habits de fête, en costumes nationaux, formaient le coup d’œil le plus pittoresque et le plus piquant.
Lorsque la reine parut, Delascar lui présenta tous ceux qui, sous ses ordres, dirigeaient ses fabriques et ses manufactures. Les chefs d’ateliers offrirent à Marguerite et aux dames de sa suite des ceintures, des écharpes de soie, tissus les plus précieux où le fini du travail l’emportait encore sur la richesse de l’étoffe. Puis Delascar, prenant par la main un beau jeune homme, à la taille svelte et gracieuse, au front élevé, à la physionomie noble et expressive, dit à la reine :
— C’est mon fils Yézid, qui arrive, à l’instant même, d’un voyage lointain, et qui vient remercier Votre Majesté de l’honneur qu’elle a daigné nous faire.
À la vue d’Yézid, un murmure flatteur circula parmi les nobles dames qui formaient la suite de la reine.
— Ces Maures n’étaient pas si mal, dit à demi-voix la comtesse d’Altamira à une de ses compagnes, et le roi Philippe II a eu surtout raison de leur défendre ce costume élégant et gracieux, bien autrement séduisant que le lourd pourpoint, la collerette empesée et le manteau massif de nos jeunes seigneurs, qui les fait ressembler pour la légèreté aux statues de pierre de nos cathédrales.
C’est vrai, dit la jeune marquise de Médina ; celui-ci a un air chevaleresque, un air de roman.
— D’un roman amusant, reprit la comtesse, car ceux de chevalerie sont bien ennuyeux.
Et ces dames continuèrent à demi-voix leur conversation, que probablement la reine n’entendait pas ; elle écoutait alors une dissertation sur les progrès des manufactures dans le royaume de Valence. Cependant on la vit tout à coup rougir ! peut-être se rappelait-elle ses idées ou ses rêves de la veille sur les Abencerages.
C’était l’heure du départ ; on vit avancer le carrosse de la reine, et à la place des mules aragonaises qui le traînaient la veille étaient attelés six chevaux arabes magnifiques, dont les longues crinières étaient tressées de fleurs et dont les housses éclatantes étaient brodées de pierreries ; c’était un présent de roi.
— Est-ce donc là l’hospitalité des Maures ! s’écria la reine surprise. On nous l’avait vantée, et nous aurions eu raison de ne pas nous y exposer, ajouta-t-elle en souriant, car nous allons ruiner notre hôte.
Puis se tournant gracieusement vers le vieillard :
— J’espère que don Albérique Delascar…
Or, dans sa bouche, ce mot de don permettait à Albérique de prendre désormais ce titre, et conférait ainsi la noblesse à lui et à ses descendants.
— J’espère que don Albérique Delascar nous viendra visiter dans notre palais de l’Escurial ou d’Aranjuez, et que nous pourrons lui rendre l’hospitalité que nous avons reçue de lui. Mais je ne franchirai point le sol de sa maison avant de lui avoir octroyé une grâce, et je prie mon hôte de me la demander.
Delascar ému et attendri jeta un regard sur son fils, comme pour le consulter. Le jeune homme lui répondit à demi-voix en arabe, par un seul mot.
La reine portait une fleur de grenade d’un rouge éclatant : c’était celle qui, le matin, avait été cueillie sur le rocher ; elle l’avait, depuis une heure, placée à sa ceinture.
— Eh bien, dit d’Albérique avec respect, je demanderai à Votre Majesté de vouloir bien me donner la fleur de grenade qu’elle porte en ce moment.
La reine, et tout le monde en fut étonné, hésita un instant.
Puis elle détacha la belle fleur, d’une main tremblante, et la présenta en rougissant au vieillard.
— Était-ce bien à lui qu’elle la donnait ?
Un instant après les six chevaux arabes emportaient la reine d’Espagne au milieu des riches plaines du royaume de Valence.
XI.
la chambre du roi et de la reine.
Sa Majesté arriva à Madrid bien avant son royal époux, qui ayant enfin terminé sa neuvaine à Saint-Jacques de Compostelle, revint avec le duc de Lerma et le grand inquisiteur reprendre les rênes du gouvernement et retrouver sa femme.
Depuis qu’il était séparé d’elle, on avait eu soin de ne pas lui en parler ; on avait même éloigné tout ce qui pouvait rappeler son souvenir, et du caractère dont était le roi, il aurait facilement oublié qu’il était marié.
Il s’en ressouvint en voyant Marguerite.
Elle lui sembla plus animée, plus vive, plus piquante qu’à Valence. Ses traits et ses yeux avaient plus d’expression. Il fit une foule d’observations qui lui avaient échappé au premier coup d’œil. On ne peut pas tout remarquer d’abord, surtout quand on est roi et un roi aussi occupé que l’était Philippe III.
Il s’aperçut que la reine avait des cheveux blonds magnifiques, une peau d’une blancheur éblouissante, une bouche petite et gracieuse qui laissait voir un rang de perles, dès que Marguerite souriait ; mais jusque-là elle avait été si grave et si sérieuse qu’il eût été difficile de les deviner.
Maintenant la reine avait un air gracieux et affable ! qui charmait le roi, dont la timidité était le principal défaut, défaut qui laissait le champ libre à tous les autres, et paralysait les bonnes qualités qu’il pouvait avoir. C’est cette timidité qui le rendait incapable de discussion ou de résistance. Toute résistance d’ailleurs : était un travail, une fatigue, et l’indolence était le fond de son caractère.
On l’avait éloigné dès son enfance de toute occupation sérieuse ; on lui avait défendu même de penser, il s’y était habitué ; il fallait donc que l’on pensât pour lui, c’était un service à lui rendre, et celui qui lui rendait le plus fréquemment ce service devait lui devenir indispensable !
Telle était l’unique cause de la faveur du duc de Lerma, contre qui Marguerite avait, en ce moment, résolu de lutter.
— Ce que je médite, se disait-elle, n’est peut-être pas bien. C’est de la coquetterie ; mais avec un mari ce n’est pas défendu, et puis, c’est une bonne action.
Au retour du roi, le conseil s’était assemblé pour nommer à plusieurs emplois vacants, entre autres à celui de vice-roi de la Navarre, le duc de Lémos ayant demandé lui-même à revenir à Madrid ; mais Philippe, fatigué de son voyage, avait remis le conseil au lendemain.
Les personnes qui, ce soir-là, étaient de service près du roi et de la reine s’étaient retirées ; ils étaient seuls !
Après avoir quelque temps regardé Marguerite en silence, Philippe s’approcha d’elle, et lui dit avec quelque embarras :
— Si vous saviez, ma chère Marguerite, combien cette absence de quelques jours… vous a rendue encore plus jolie !
— En vérité, dit Marguerite en souriant, alors et dans mon intérêt, Votre Majesté aurait peut-être dû ne pas se hâter de revenir et rester plus longtemps en Galice.
— Et pouvais-je rester plus longtemps éloigné de vous ! je vous aime tant !
— C’est donc depuis votre pèlerinage, car autrefois il me semble qu’il n’en était pas ainsi.
— Toujours ! Marguerite.
— Non, sire, je l’ai bien vu, et ce Jacques de Compostelle, à qui je dois l’attention que Votre Majesté m’accorde aujourd’hui, est un grand saint en qui je vais avoir aussi foi et dévotion ; mais au lieu d’une neuvaine, vous auriez dû en faire deux, ce serait bien plus sûr encore !
— Pouvez-vous, Marguerite, plaisanter sur un tel sujet ?
— Je ne plaisante point, et la preuve, c’est que je prie Votre Majesté de vouloir bien me raconter son voyage en Galice.
— Dans tout autre moment, je ne dis pas, mais dans celui-ci… je n’ai aucun goût pour les voyages… au contraire ! celui-là, d’ailleurs, a été si ennuyeux !
— Ah ! c’est vous, sire, qui blasphémez contre saint Jacques de Compostelle !
— Non, vraiment… mais j’avais d’autres choses à vous dire.
— Quand vous m’aurez raconté votre pèlerinage et comment s’est passée votre neuvaine, jour par jour… commençons par le premier.
— Non, madame… s’écria le roi avec impatience, ce serait pour mourir d’ennui.
— Eh bien ! ce sera une pénitence… n’est-ce pas pour cela que vous avez entrepris ce voyage ? Et moi, par contre-coup, sans avoir eu la peine de le faire, j’en aurai, grâce à vous, tous les bénéfices.
— Mais, madame, il y a temps pour tout. La pénitence qui m’était imposée, c’était de m’éloigner de vous. Mais maintenant qu’elle est terminée, maintenant que le ciel m’a rapproché de tout ce que j’aime…
— Rapproché, dit la reine en s’éloignant un peu… Votre Majesté m’aime donc réellement… c’est donc vrai !
— Je vous le jure, s’écria Philippe avec chaleur, par Notre-Dame del Pilar, par Notre-Dame d’Atocha… par Notre-Dame…
— Certainement, dit la reine en l’interrompant… j’en crois toutes ces dames… mais c’est vous surtout, sire, vous que je veux croire… et il vous serait si facile de me persuader… il est tel mot qui aurait sur moi plus de puissance qu’un serment.
— Que voulez-vous dire ?
— Qu’on ne refuse rien à ceux qu’on aime !
— Et vous me dites cela, madame, s’écria le roi avec dépit, vous dont le sang-froid me glace, vous dont les refus sont invincibles.
— Eh mais ! reprit Marguerite gaiement, tout dépend peut-être du moyen de les vaincre.
— Et que puis-je donc faire ! parlez… voudrez-vous que je meure à vos pieds ? et quand je vous demande grâce, serez-vous inexorable ?
— Non, vraiment ! d’autant plus que, comme vous, sire, j’ai le droit de faire grâce, mais il n’est pas dit que j’userai seule de cette prérogative ; il n’est pas dit surtout que c’est moi qui commencerai.
— Qu’est-ce que cela signifie ? dit le roi étonné.
— Que j’ai peut-être aussi quelque chose à demander à Votre Majesté.
— Que ne le disiez-vous ?… Je l’accorde.
— En êtes-vous bien sûr ?
— Je l’accorde d’avance… Et ce sera ainsi, car, moi, le roi, je le veux.
— Qu’en savez-vous ?
— Comment ?
— Si le duc de Lerma ne le veut pas…
— Le duc de Lerma n’a que faire ici !
— C’est bien ainsi que je l’entends ; et il faut que Votre Majesté me jure de faire ce que je vais lui demander, que cela convienne ou non à son ministre.
— Qu’est-ce donc ? fit le roi un peu effrayé.
— Qu’il le veuille ou qu’il ne le veuille pas.
— Nous verrons, dit le roi en hésitant ; je lui en parlerai demain, et il faudra bien…
— Non, vous ne lui en parlerez pas. Inutile de le consulter, quand tout ceci doit être entre vous et moi, sire !
— Cela n’est pas possible… cela ne peut se passer ainsi.
— Que votre volonté royale soit faite ! sire, dit la reine en se levant.
— Madame… de grâce… reprit Philippe en la retenant par la main.
— Puisque vous ne pouvez rien sans consulter le duc de Lerma.
— Au nom du ciel ! daignez m’écouter.
— Je n’écoute rien ! J’aurai aussi un conseil particulier… la consulta de la reine, à qui je soumettrai vos demandes, sire, quand vous jugerez à propos de m’en adresser, et nous déciderons, après en avoir délibéré, si nous devons ou non y faire droit.
Et elle fit quelques pas pour rentrer dans son appartement.
Mais Philippe, à qui, pour la première fois de sa vie, une pareille résistance venait de donner de la vivacité et de l’énergie, se jeta à ses genoux, et avec toute la chaleur d’un cœur dévot qui cherche le ciel sur la terre, avec des expressions pieusement tendres et passionnées, il la supplia de rester.

— Vous me promettez donc, sire, dit la reine en s’arrêtant, de ne consulter que votre cœur et non le duc de Lerma ?
— Je vous le jure !
— Vous ne lui direz rien de tout ce qui va arriver ?
— Je le jure ! je le jure ! s’écria le roi avec béatitude.
— Vous jurez, de plus, de m’obéir et de faire tout ce que je vais vous demander ?
— Je le jure ! dit le roi tremblant d’impatience.
— Par Notre-Dame del Pilar et Notre-Dame d’Atocha ? dit la reine en souriant.
— Non, non, mais par vous, par mon amour !
— À la bonne heure ! Relevez-vous donc, sire.
— Eh bien ! que m’ordonnez-vous ?
— D’écouter le mémoire que je vais vous lire.
— Un mémoire ! s’écria le roi avec effroi, ce n’est pas possible.
— Eh ! si vraiment, un mémoire. Voyez plutôt.
— Et il y a quatre pages, encore ! d’une écriture très-fine.
— Que vous importe, puisque c’est moi qui lis.
— Cela n’en finira jamais, madame… Nous le lirons… plus tard !
— Non, sire, d’abord.
— Mais ce sera éternel !
— Je lirai le plus vite possible.
— Je suis trop ému… trop troublé… Je ne pourrai pas y prêter l’attention nécessaire.
— Rassurez-vous, je recommencerai.
— Ah ! s’écria le roi avec rage, vous avez juré de me désespérer !
— Non, sire, mais de vous rendre heureux.
— Est-il possible !
— En vous forçant de faire une bonne action, dont vous me remercierez, dont vos sujets vous béniront, et dont le ciel vous récompensera.
Le roi ne pensait pas au ciel dans ce moment ; mais, faute de mieux et forcé d’obéir, il se résigna à la bonne action dont on le menaçait.
La reine alors lui lut lentement, gravement, et cependant avec chaleur, le mémoire de don Juan d’Aguilar ; lui prouva que lord Montjoy, que ses ennemis même lui rendaient la justice que son pays lui refusait ; lui expliqua comment ce fidèle serviteur, qu’on accusait de trahison, lui avait conservé une armée que l’on croyait perdue et qui l’eût été sans sa prudence et sa fermeté ; qu’il fallait donc, non pas le punir et le livrer à l’inquisition, pour avoir traité avec des hérétiques, mais le récompenser, pour avoir bien servi Sa Majesté Catholique.
Que par la même raison il fallait mettre en liberté don Fernand d’Albayda, son neveu, dont le crime était d’avoir défendu le malheur, crime si rare, qu’il n’y avait rien à craindre pour la contagion et le mauvais exemple.
Philippe, dont le cœur était juste et bon, Philippe qui, après tout, finissait par comprendre, quand on lui expliquait bien, surtout quand ces explications lui étaient données par une femme jeune et jolie qu’il adorait, Philippe serra la main de sa femme, et lui dit :
— Vous avez raison, madame, vous avez raison, don Juan d’Aguilar est un loyal et fidèle serviteur qui doit être récompensé… Que dois-je faire pour lui ?
— Que Votre Majesté daigne écrire.
Le roi s’assit, jeta sur sa femme un regard chastement tendre, et écrivit sous sa dictée :
« Pour reconnaître les fidèles services de don Juan d’Aguilar, qui a soutenu en Irlande, contre des forces supérieures, l’honneur des armes espagnoles, et qui a sauvé l’armée que nous lui avions confiée, nous le nommons vice-roi de la Navarre… »
Le roi s’arrêta.
— Y pensez-vous, madame, un emploi aussi considérable !
— Eh ! oui, sans doute, il était vacant, depuis trop longtemps, par la présence du comte de Lémos, et en nommant don Juan d’Aguilar vice-roi de Navarre, c’est rendre justice à lui et service au pays.
Le roi écrivit et dit :
— Êtes-vous contente, madame ?
— Pas encore.
Elle continua de dicter :
« De plus, nous nommons don Fernand d’Albayda, son neveu, capitaine dans le régiment de la Reine.
« Donné dans notre palais de Madrid, le 24 septembre 1599.
La reine prit l’ordonnance royale, la plia bien précieusement, et dès le lendemain la fit expédier.
Mais, dès le lendemain, le roi, revenu de l’ivresse qui lui avait donné un si grand courage, fut le plus malheureux et le plus effrayé des hommes. Il contremanda le conseil, et tout ce qu’il eut la hardiesse de faire, ce fut d’éviter le duc de Lerma. Il fut même deux jours sans le recevoir et sans lui parler, ce qui ne lui était pas encore arrivé depuis son avènement au trône.
Il comprit cependant que plus il attendrait, plus l’affaire deviendrait difficile, et, comme l’enfant devant son précepteur, comme le coupable devant son juge, le souverain comparut enfin devant son ministre dans un embarras inexprimable, et balbutiant quelque excuse que le duc de Lerma comprit à peine.
Inquiet déjà depuis deux jours, le favori trembla bien plus encore quand il apprit ce qui s’était passé.
Il courut chez son frère Sandoval, le grand inquisiteur, et tous deux délibérèrent sur les mesures à prendre.
Le danger était grave et pouvait se renouveler.
Ils avaient dans la reine une ennemie redoutable et de plus une ennemie intime ; c’était un adversaire que l’on ne pouvait ni renvoyer, ni destituer de la place qu’elle occupait, et qu’il fallait donc ménager, tout en la mettant cependant hors d’état de nuire désormais.
Après avoir longtemps hésité et cherché bien des moyens, ils en adoptèrent enfin un, qui paraîtrait : aussi absurde qu’impossible, s’il n’était attesté par les mémoires du temps[13] et par des historiens dignes de foi[14] ; il prouvera jusqu’à quel point le duc de Lerma connaissait le caractère de son maître et l’espèce d’empire qu’on pouvait exercer sur lui.
Le grand inquisiteur se présenta chez le roi avec fray Cordova, son confesseur, Tous deux l’abordèrent : avec un visage pâle et les yeux baissés.
— Qu’avez-vous, mes pères, et d’où vous vient cette tristesse ?
— Ce n’est pas pour nous, sire, que nous sommes dans l’affliction, dit Sandoval, mais pour Votre Majesté, mais pour l’Espagne entière, car le meilleur des rois, le prince le plus juste et le plus religieux, va causer la perte du royaume.
— Et celle de son âme, ajouta Cordova.
— Comment cela ? dit le roi effrayé. Quelle faute, mes pères, quel péché ai-je donc commis ?
— Le plus grand de tous pour un roi, celui de trahir la volonté de Dieu.
— Car vous êtes l’oint du Seigneur.
— Car c’est sur votre front qu’il a placé la couronne d’Espagne…
— Et non sur celui de Marguerite d’Autriche.
— Non pas que nous blâmions la tendresse de Votre Majesté pour la personne de la reine.
— Nous sommes les fidèles serviteurs et sujets de votre auguste et bien-aimée épouse.
— Qui mérite tout votre royal amour.
— Vous êtes unis par le ciel, et jamais la terre ne peut séparer ce que Dieu a uni.
— Mais vous, sire, vous ne devez pas non plus réunir ce que Dieu a séparé.
— Comment cela, mes pères ? fit le roi, de plus en plus interdit de leur ton solennel,
— Le roi d’Espagne a ses devoirs, l’époux de Marguerite a les siens.
— Les confondre, c’est manquer à tous les deux.
— C’est encourir doublement la colère du ciel.
— Et remettre dans les mains de la reine le sceptre qui vous fut confié…
— C’est vous rendre responsable aux yeux de Dieu, non-seulement de vos péchés à vous, sire…
— Mais de tous ceux que la reine peut commettre en votre nom.
— Tel est du moins l’avis de votre confesseur.
— Tel est celui de la sainte inquisition, qui m’a chargé de le transmettre à vous, le roi catholique, avant d’en référer à la cour de Rome !
Ce raisonnement, qu’on aurait pu, avec plus d’apparence de justice, tourner contre le duc de Lerma en particulier et contre tous les favoris en général, produisit un tel effet sur le roi, que, troublé et tremblant, redoutant déjà les foudres du Vatican, il demanda comment il devait se conduire à l’avenir, et on lui fit jurer sur l’Évangile de ne jamais parler à la reine des affaires de l’État… même dans le lit royal !
Ce serment fut tenu par lui, et lorsque, quelques jours après, don Juan d’Aguilar et don Fernand d’Albayda, son neveu, vinrent remercier le roi, dont ils croyaient avoir reconquis la faveur, leur surprise fut grande et pénible en voyant le trouble et l’embarras avec lesquels on les accueillit.
Ils comprirent, sans en deviner la raison, que leur présence gênait le faible monarque. L’un se retira dans son gouvernement, et l’autre rejoignit son régiment, sans pouvoir remercier la reine, leur généreuse protectrice, dont ils ignoraient les bienfaits.
Un seul cœur se chargea de leur reconnaissance : ce fut celui de Yézid.
Le duc de Lerma, pour qui cet événement ne fut jamais clairement expliqué, essaya vainement d’en connaître les causes véritables. Il se doutait qu’elles se rattachaient au séjour de Marguerite chez Delascar d’Albérique. Il eut beau mettre tous ses espions en campagne, il ne découvrit rien qui pût compromettre le secret de la reine ; mais il resta persuadé qu’il trouverait en elle un obstacle, ou du moins une puissante opposition à des projets que lui, Sandoval et Ribeira, n’avaient point abandonnés et pour l’exécution desquels ils n’attendaient qu’une occasion favorable.
Aussi, dès ce jour, ils s’occupèrent activement des moyens de la faire naître et de frapper un coup d’État. duquel dépendaient, selon eux, les destinées de l’Espagne.
Tels étaient les événements qui avaient précédé l’entrée de Piquillo dans la maison d’Aguilar, et dont nous devions le récit à nos lecteurs, avant de reprendre la suite de cette histoire.
XII.
les deux jeunes filles.
Depuis que don Juan d’Aguilar avait été nommé de par et malgré le roi au commandement de la Navarre, il habitait Pampelune, et dans la belle saison, une délicieuse résidence à Tudela. Obligé de se rendre à Madrid, près de la comtesse d’Altamira, sa sœur, pour une affaire qui concernait la fortune de Carmen, sa fille, il avait obtenu, non sans peine, du ministre, un congé de quinze jours.
Il n’avait pas voulu, même pour ce voyage, se séparer de son enfant ; celle-ci n’avait pas voulu se séparer de sa compagne Aïxa ; voilà comment les deux jeunes filles étaient parties avec le vieillard, et c’est en revenant dans la Navarre, sur les confins de la Vieille-Castille, entre la sierra d’Oca et celle de Moncayo, que leur carrosse avait été arrêté par le bandit Caralo, et que Piquillo était tombé, du haut d’un chêne, à leur secours.
Arrivé à Pampelune, le premier soin du gouverneur fut de faire habiller son nouveau page, et Piquillo, qui, plus que jamais, rougissait du délabrement ou plutôt de l’absence presque totale de sa toilette, vit arriver un homme à la physionomie grave qu’il prit pour un conseiller.
C’était un tailleur, maître Truxillo, avec qui nous avons déjà fait connaissance lors des premiers troubles de Pampelune.
On aurait pu croire, au premier coup d’œil et en se rappelant le passé, que des chagrins domestiques : avaient imprégné ses traits de cette teinte de gravité que l’on y remarquait. On se fût trompé. Sa physionomie était antérieure à son mariage. Truxillo avait toujours été ainsi, même étant garçon ; c’était un homme qui avait pris son état au sérieux, et qui raisonnait un pourpoint ou un haut-de-chausses comme un général d’armée raisonne un plan de campagne.
N’ayant pas jusqu’alors habillé de page chez monseigneur le vice-roi, il voulait se signaler par un morceau d’apparat, un morceau d’étude, et prenait ses mesures avec un soin et une lenteur qui désespéraient Piquillo ; car ni lui ni son habit ne pouvaient guère attendre. Pour charmer le temps, et en garçon prudent qui, avant tout, veut connaître ceux dont va dépendre son sort, Piquillo interrogeait avec art maître Truxillo sur les habitants de la maison, sur ce qu’il pensait de monseigneur le vice-roi.
— Je voudrais n’avoir que du bien à en dire, répondit gravement le tailleur : c’est un brave militaire, un bon maître, ne faisant tort à personne, et surtout payant bien ; mais, franchement, il y a peu d’agrément avec lui ; sa goutte habituelle s’oppose au développement de mon art, mes ciseaux sont souvent paralysés comme lui, et je n’ai jamais pu lui confectionner un habit qui me fit quelque réputation.
— Et ses filles ? demanda Piquillo, qui ne comprenait pas beaucoup.
— La senora Carmen, c’est différent ! Joanna, sa couturière, est heureuse avec celle-là ! Monseigneur n’est pas riche, car il n’a que les revenus de sa place, et s’en fait honneur ; mais si on n’écoutait que son goût, sa fille aurait tous les jours une mantille ou une parure nouvelle, ainsi que la senora Aïxa.
— Son autre fille ?
— Non, ma foi, mais on le croirait ; il va au-devant de tous ses désirs… il fait toutes ses volontés ! il l’adore, seigneur page, et il a raison ! Impossible, avec elle, de manquer une robe ! quelle taille élégante et fine ! quelle souplesse, quelle cambrure, sainte Vierge ! Ainsi porté, comme un ouvrage se remarque ! quelle réputation cela vous fait ! Et pourtant elle a à peine douze ans ! elle ne les a pas ! mais dans trois ou quatre années, ce sera la perle de la Navarre ; tous les amoureux se la disputeront, et toutes les couturières voudront l’habiller pour rien !
— Quel est donc le nom de sa famille ?
— On n’en sait rien, répondit le tailleur en continuant à prendre mesure, on croit que son père était un officier sans fortune, compagnon d’armes de don Juan d’Aguilar, et tué sous ses yeux en Irlande. Tant il y a que, l’année dernière, en revenant des Pyrénées, où il avait été prendre les eaux pour sa goutte et ses blessures, le vice-roi est revenu à Pampelune avec cette jeune fille, qui depuis ne l’a plus quitté, et que la senora Carmen chérit comme une sœur… Il y a bien quelques personnes, ajouta le tailleur, en baissant la voix, qui disent qu’elle l’est réellement.
— En vérité ! reprit Piquillo avec curiosité.
— Elles se fondent sur ce que le vice-roi, qui adore sa fille, n’est pas jaloux de celle-là, quoiqu’elle soit bien plus jolie ; elles prétendent aussi que don Juan d’Aguilar n’a pas toujours eu la goutte, que c’était autrefois un gaillard, et que lui seul donnait des sérénades aux dames de la cour de Philippe II, où l’on ne donnait que de l’eau bénite !
Mais ceux qui connaissent la bonté de don Juan d’Aguilar disent qu’il aime cette jeune fille d’autant plus qu’elle n’a rien, qu’elle est orpheline, et qu’il a juré de lui tenir lieu de père… C’est là, Monsieur, ce qui me ferait croire, moi, poursuivit gravement le tailleur, à l’histoire de l’officier tué en Irlande… c’est d’ailleurs celle que le vice-roi lui-même a racontée.
— Ce doit être la véritable.
— C’est ce que je dis, reprit le tailleur d’un air de contrition… J’ai fini, seigneur page, je ne vous ferai pas attendre. En revanche, j’ose compter sur vous ; j’espère que, par égard pour moi, vous userez un peu plus que le seigneur d’Aguilar, votre patron, dont les habits sont éternels !
Piquillo le lui promit et n’était pas homme à manquer à sa promesse, vu que son éducation première ne lui avait donné aucune idée d’ordre, de soins, ni d’économie.
Enchanté de la jolie figure, de la gaieté et du babil deux jeunes filles, qui, pendant le voyage, n’avaient cessé de causer avec lui, Piquillo s’était aisément persuadé qu’il en serait toujours ainsi, et qu’il n’aurait pas d’autre occupation dans l’hôtel d’Aguilar, perspective qui l’enchantait, mais le vieux général, actif et laborieux de sa nature, n’entendait pas que chez lui on restât à rien faire ; dans l’intérêt même du jeune bohémien qu’il venait de recueillir, il le mit entre les mains de maître Pablo de Cienfugos, son majordome mayor, lui recommandant de l’instruire, de le former et de lui apprendre le service de la chambre, lui donnant sur l’enfant une autorité suprême et absolue, à la condition d’en user avec douceur et modération, condition qui est toujours la première oubliée par les pouvoirs absolus, généralement quelconques.
Pablo de Cienfugos y avait d’autant plus de disposition, que l’arrivée de Piquillo contrariait un projet arrêté par lui depuis longtemps, celui de faire entrer comme page, dans la maison du vice-roi, un protégé à lui qu’il appelait son filleul, mais qui lui était, dit-on, parent de plus près, et qui lui était vivement recommandé par la gouvernante d’un chanoine de Burgos.
Cette circonstance ne diminua point sa sévérité habituelle ; au contraire, il se sentit blessé, ainsi que tous les gens de la maison, dans sa dignité de domestique, en voyant ce titre conféré sans examen à un vagabond trouvé dans une forêt, perché sur un arbre, bien plus, à un petit mendiant déguenillé !… Oubliant donc que la livrée couvrait tout, ils ne virent dans le nouveau venu qu’un esclave qui leur était accordé pour leur service particulier. Chacun en usa dans ce sens, et il se trouva, au bout de quelques jours, que Piquillo était dans l’hôtel le domestique de tout le monde. Lui, qui avait aussi de la fierté, et qui surtout n’avait pas l’habitude du travail, se lassa bien vite de cette répartition inégale, et dès qu’il trouvait une occasion de s’y soustraire, il s’empressait d’en profiter.
La porte de l’hôtel était-elle entr’ouverte, il s’élançait pour respirer l’air de la liberté, c’est-à-dire de la rue. Il avait déjà couru à l’hôtellerie du Soleil-d’Or pour y retrouver son premier ami Pedralvi ; mais il n’y était plus, on ne savait pas ce qu’il était devenu. Plus heureux d’un autre côté, il avait reconnu, ou cru reconnaitre quelques-uns des jeunes soldats qui, il y a trois ans, avaient servi sous ses ordres, lors de sa première campagne dans les rues de Pampelune, et leur société lui paraissait beaucoup plus honorable et plus amusante que celle des domestiques de l’hôtel.
Plusieurs fois à son retour maitre Pablo l’avait sévèrement réprimandé de son absence ; mais les réprimandes, et même d’autres arguments plus sévères, n’avaient produit aucun effet. Au contraire, Piquillo s’indignait de cette tyrannie subalterne, et aurait préféré celle du vice-roi, qu’il eût presque reconnue comme légitime. On ne refait pas en un instant son naturel, et le sien était un naturel bohémien qui avait besoin du grand air. Il y a des qualités qui, comme certains arbres, ne croissent qu’en plein vent, et maître Pablo avait rédigé une espèce de mémoire où il déclarait que l’indocilité et le vagabondage de Piquillo ne permettaient d’en rien faire, qu’il n’y avait aucun moyen de le retenir à l’hôtel, et il concluait à son renvoi.
Le vice-roi était à déjeuner, en famille, lorsque lui parvint ce rapport foudroyant, auquel les jeunes filles ne pouvaient croire.
— Eh bien ! mes enfants, qu’en dites-vous ?
— Qu’il faut entendre le coupable.
On sonna Piquillo ; mais il faisait un temps superbe, le soleil brillait dans tout son éclat : le jeune page n’avait pu résister au désir de s’aller promener sur les bords de l’Arga et sur les hauteurs de la montagne Saint-Christophe.
Maitre Pablo regarda les juges d’un air triomphant. Le principal accusé, choisissant ce moment pour faire défaut, donnait à l’accusation une force accablante. Quand il rentra, on lui dit que le vice-roi et ses deux jeunes maîtresses l’avaient demandé. Piquillo devint pâle et courut à la porte de leur appartement attendre qu’elles sortissent.
Plus d’une heure s’écoula.
Enfin Aïxa sonna ; il entra. Elle écrivait, l’aperçut, continua sa lettre, mais sans lui parler, sans lui adresser un reproche.
Il restait ainsi, immobile devant elle, attendant son arrêt, lorsqu’il fut tiré de sa stupeur par la voix foudroyante de don Juan d’Aguilar, qui arrivait appuyé sur le bras de sa fille. Loin d’imiter le silence méprisant d’Aïxa, il entra ex abrupto en matière par un exorde des plus vifs, dont la péroraison menaçait d’être plus vive encore ; car il venait, dans l’animation de ses gestes, de lever une canne qu’il avait à la main. Carmen, qui avait la douceur et la bonté des anges, retint le bras de son père.
Aïxa ne remua pas et garda le silence.
Et Piquillo, se jetant aux genoux du vieillard irrité, lui criait :
— Vous avez raison, monseigneur, je suis coupable, et cependant ce n’est pas tout à fait ma faute !
Il raconta en peu de mots les injustices qui l’avaient poussé à la révolte.
— Mon père, s’écria Carmen, pardonnez-lui… je vous en conjure ! Aïxa ne proféra pas une parole.
— Pardonnez-lui, répéta Carmen, et il sera désormais plus sage.
— Je le jure ! je le jure ! s’écria Piquillo avec un accent de vérité et de franchise.
— Et, continua Carmen, il sera soumis et obéissant à maître Pablo.
Piquillo ne jura pas, et baissa la tête en gardant le silence.
D’Aguilar ne fit point attention À cette espèce de restriction mentale, regarda encore quelque temps le coupable avec un murmure sourd et inintelligible qui allait en decrescendo, semblable au dogue à demi apaisé, qui ne menace plus et qui gronde encore ; puis, abaissant sa voix et sa canne, il laissa échapper ces mots :
— À la bonne heure ! Mais que cela ne lui arrive plus, ou sinon…
Paroles qui, dans la bouche du brave gentilhomme, équivalaient à une amnistie pleine et entière.
Et il sortit avec sa fille.
Piquillo, resté seul avec Aïxa, aurait bien voulu, et n’osait lui adresser la parole ; enfin il leva les yeux vers elle, et lui dit timidement :
— Vous n’avez pas daigné parler pour moi, senorita… vous n’avez pas même daigné me gronder.
— À quoi bon ? répondit-elle froidement. J’espérais en toi, et je vois que je me suis trompée.
— Comment cela, senorita ?
— Je croyais que tu serais dévoué à Carmen et à moi.
— Toujours ! toujours !
— Que nous pouvions compter sur toi.
— À la vie, à la mort ! je vous le jure !
— Et tu passes tes journées comme un vagabond dans les rues de Pampelune, tu n’es jamais à l’hôtel ; et s’il arrivait quelque malheur, quelque danger, il faudrait donc, pour me secourir, que je m’adressasse à maître Pablo ?
— Jamais ! jamais ! s’écria Piquillo en se jetant aux genoux de sa jeune maîtresse.
Depuis ce jour, il ne quitta plus l’hôtel d’Aguilar.
Renonçant à ses habitudes du dehors, il devint sage et rangé, prévenant pour tout le monde, obéissant même, de temps en temps, à maître Pablo de Cienfugos. Mais rien n’égalait son zèle pour ses jeunes maîtresses. Debout à table devant elles, il semblait lire dans leurs yeux pour deviner et devancer leurs ordres. Le premier il était auprès de la voiture pour ouvrir la portière, abaisser le marchepied ; il se multipliait pour exécuter leurs commissions ; il était fier quand il les suivait à la promenade, portant leur ombrelle ou leur mantille, et chaque soir, Aïxa et Carmen trouvaient dans leur chambre les parfums qu’elles aimaient ou les fleurs qu’elles préféraient.
Un jour, cependant, et malgré sa bonne volonté, il arriva un grand malheur. Il y avait réception à l’hôtel d’Aguilar pour la fête du roi ; mais quelque vaste que fût le palais, on ne pouvait recevoir tous les nobles de la ville et des environs, car en Espagne il y en a beaucoup. Il fallait donc faire un choix, opération délicate et difficile dont le vieux gentilhomme se tira de son mieux avec le secours de ses conseillers intimes, Aïxa et Carmen, assez grandes déjà pour être consultées en fait de tact et de convenances. Piquillo, à qui on avait cru pouvoir se fier, fut chargé de remettre les messages à leur destination ; mais les erreurs les plus graves, les quiproquos les plus fâcheux avaient été commis.
Tel grand seigneur invité n’avait pas reçu son billet ; des invitations étaient arrivées à de nobles dames à qui elles n’étaient pas destinées, et qui avaient ainsi appris la préférence qu’on donnait à d’autres.
Ce fut un grand événement dans la ville de Pampelune, et la faute administrative qui fit peut-être le plus de tort à don Juan d’Aguilar, dont chacun se plaisait, du reste, à reconnaitre la sagesse, l’intégrité et la justice. Mais tous les gouvernements peuvent se tromper, surtout quand ils sont aidés par leur ministre, et, dans cette occasion, Piquillo avait tout fait.
Le jeune page, ci-devant bohémien, ne savait pas lire, et il eût été difficile, en effet, d’après ce que nous connaissons jusqu’ici de sa carrière, qu’il eût pu en consacrer la moindre partie à ses études. C’était là un malheur des temps ; mais ce qui fut peut-être une imprudence de sa part, ce fut d’avoir consulté, pour les adresses de ces lettres, maître Pablo de Cienfugos, qui, par la faveur toujours croissante de Piquillo, voyait lui échapper chaque jour l’espoir de placer son filleul à l’hôtel d’Aguilar.
Enfin, et quelles que fussent les causes du sinistre, on ne pouvait y remédier, mais il fallait du moins l’empêcher de se renouveler, et le vice-roi furieux ordonna à son page d’apprendre à lire dans un mois au plus tard, ou d’avoir à résigner ses fonctions.
Le lendemain Piquillo vit arriver un homme à l’air sémillant et léger, le senor Gérundio, qu’il prit pour un maître de danse ; c’était un maître de grammaire espagnole, un des littérateurs les plus distingués de Pampelune, qui avait composé quinze poëmes, deux cents tragédies, et montrait à lire pour la somme de cinquante maravédis par leçon. Dès ce temps-là, déjà, le génie n’était pas payé.
Le pauvre Piquillo avait eu bien des mauvais moments en sa vie, mais aucun tourment ne pouvait approcher de celui qu’il éprouva entre les mains du senor Gérundio, qui, trop supérieur pour descendre jusqu’à son écolier, voulait, dès le premier jour, l’élever jusqu’à lui, et lui démontrait les finesses et les beautés de la langue espagnole, quand il fallait d’abord commencer par lui en montrer les lettres.
Piquillo avait beau ouvrir les oreilles, et, béant d’attention, tendre toutes les fibres de son cerveau, toutes les facultés de son intelligence, il ne comprenait rien, et plus il avançait à tâtons, espérant trouver la lumière, plus les ténèbres devenaient épaisses. C’était à devenir fou, et le délai fatal approchait, et non-seulement il ne savait rien, mais, effrayé et découragé, l’œuvre qu’il tentait lui paraissait inexécutable, impossible.
— Et monseigneur, furieux, va me renvoyer, se disait-il, et malgré mon zèle, mon dévouement, il me faudra quitter cet hôtel, pour n’avoir pu déchiffrer cet infernal grimoire, ni comprendre l’infâme sorcier qui s’est chargé de me l’expliquer.
Et, dans un transport de rage, il avait saisi au collet le senor Gérundio, qu’il avait étranglé à moitié, le menaçant d’achever, s’il revenait. Or, Piquillo commençait à être grand et fort, et son professeur, qui ne voulait point compromettre ainsi la littérature espagnole, ni enseigner désormais la lecture à coups de poing, se le tint pour dit, et resta chez lui.
Alors, nouvelle désolation de Piquillo. Comment excuser aux yeux de monseigneur ce nouveau méfait et cet acte de rébellion ? Comment, à la fin du mois, se justifier de son ignorance, qui devenait plus profonde que jamais ? Et ce palais, cette maison paternelle où il se trouvait si bien, ses deux jeunes maitresses qu’il allait être forcé d’abandonner !
Jamais, je crois, même en son temps d’épreuve chez le capitaine Juan-Baptista, Piquillo ne s’était senti aussi malheureux.
Un soir, avant de se coucher, Aïxa et Carmen se promenaient en se donnant le bras dans les jardins du palais, échangeant leurs rêveries de jeunes filles, pensant au vieux général, au présent, à l’avenir, et surtout à leur amitié de sœur que rien ne devait altérer, lorsque, dans un petit bâtiment retiré, dans une espèce de serre qui était à l’extrémité des jardins, elles aperçurent, quoiqu’il fût déjà bien tard, une petite lumière qui jetait à travers les arbres une lueur vacillante et incertaine. Qu’était-ce donc, à une pareille heure ? Un mystère, une aventure, peut-être. Carmen, effrayée, voulait s’éloigner ; Aïxa, au contraire, fit un pas en avant.
— Reste, ma sœur, dit-elle, je vais savoir ce que c’est.
— Non, si tu y vas, j’irai avec toi.
Et toutes deux, se donnant le bras, et se serrant l’une contre l’autre, s’avancèrent vers le danger.
Elles marchaient sur la pointe du pied, retenant leur haleine, et maudissant leur jupe, qui de temps en temps froissait le feuillage et troublait le silence de la nuit.
Enfin elles arrivèrent près de l’endroit redoutable. C’était Une maison rustique qui n’avait qu’une croisée.
Aïxa avança la tête, regarda par un des carreaux, se mit à sourire, puis fit signe à Carmen d’approcher ; et que virent-elles ?
Piquillo, qui, pour ne pas être dérangé, avait choisi cette chaumière pour son cabinet d’étude ; Piquillo désespéré, s’arrachant les cheveux, déchirant les feuillets de sa grammaire espagnole, puis foulant le livre maudit à ses pieds, et enfin se laissant tomber sur un banc, hors de lui, accablé, tandis que roulaient dans ses yeux des larmes de douleur et de rage.
Aïxa poussa la petite fenêtre, qui n’était pas fermée en dedans, et passa sa jolie petite tête dans la chaumière en disant d’une voix douce :
— Piquillo !
À cette voix, à cette apparition, à cet ange qui semblait l’avoir deviné dans son désespoir et lui venir en aide au moment où il l’implorait, Piquillo tressaillit, étendit les bras du côté de la fenêtre, et murmura ces mots :
— Mon bon ange, est-ce vous ?
— Qui, et nous sommes deux ! s’écria Carmen.
— Que fais-tu là ?
— J’étudie.
— Avec rage, à ce que je vois.
— Et il faut, dit Aïxa, que tu aies une furieuse envie d’apprendre ; je n’ai jamais vu pareil étudiant.
Alors le pauvre Piquillo se mit à raconter ingénument tous les tourments qu’il avait éprouvés, la manière dont il avait traité son professeur et son livre, et dont il comptait se traiter lui-même, car il ne survivrait pas à l’affront et à la douleur de quitter l’hôtel, et bien certainement il se tuerait, si à la fin du mois il ne savait pas lire.
— Mais cependant, dit Aïxa, cela ne te viendra pas tout seul.
— Je n’espère qu’en Dieu ; il n’y a que lui qui puisse faire un pareil miracle.
— D’accord, dit Carmen, il en a le pouvoir.
— Mais il faudrait un peu l’aider, poursuivit Aïxa.
— Je ne le peux pas ; il m’est plus aisé de me tuer que d’apprendre à lire ; c’est trop difficile.
— Nous l’avons appris, cependant.
— Et toi, Piquillo, qui as de l’esprit, de l’intelligence, pourquoi ne ferais-tu pas comme nous ?
— Oh ! vous, vous faites tout ce que vous voulez.
— Et si nous voulions t’apprendre ?
— Que dites-vous !
— Si nous étions tes précepteurs ?
— Vous, mon bon Dieu !
— À la place du seigneur Gérundio ?
— Tu ne nous étranglerais pas comme lui ?
— Je ne puis croire à ce que j’entends ! ça n’est pas possible !
— Tout est possible, dit gravement Aïxa, avec de la patience et du courage, et tu le verras.
— Silence seulement, ajouta Carmen, et n’en parle à personne.
On juge si Piquillo promit le secret ! et dès le lendemain, cette idée, qui souriait aux deux sœurs, fut mise à exécution.
Sous prétexte de prendre les ordres de ses jeunes maîtresses et leurs commissions pour la journée, Piquillo venait chez elles, chaque matin, et quelquefois le soir. Ces leçons si difficiles, si âpres, si embrouillées avec le senor Gérundio, devenaient d’une simplicité et d’une clarté extrêmes avec ses nouveaux précepteurs, qui ne cherchaient point à briller ni à éblouir leur élève, mais qui, au contraire, se mettaient à sa portée.
— Elles lui expliquaient lentement, puis recommençaient avec une complaisance admirable, jusqu’à ce qu’il eût compris ; et Piquillo s’étonnait de trouver si facile ce qui lui semblait autrefois hérissé d’obstacles insurmontables.
Il faut dire que Carmen était toujours fatiguée la première de son rôle d’institutrice, et abrégeait la leçon pour rire ou pour plaisanter avec sa sœur, tandis qu’Aïxa, toujours la même, froide, patiente et sévère, ne se ralentissait pas d’un instant. Armée d’une baguette d’ivoire, elle indiquait sur le livre les lettres, les syllabes et les mots, que Piquillo suivait du doigt et épelait de son mieux, certain à chaque erreur de voir la baguette d’ivoire tomber impitoyablement sur la main de l’écolier inhabile.
Loin de se plaindre, Piquillo était presque heureux de la punition, et bien plus encore des éloges du seul professeur qui restât… Car, à la fin, voyant que sa sœur s’y entendait mieux qu’elle, Carmen la laissait faire, se contentant d’assister à la leçon, et d’intercéder, de temps en temps, pour leur élève, quand Aïxa se montrait trop sévère et le châtiait trop rudement.
Mais déjà Piquillo n’avait plus besoin d’indulgence ; Aïxa l’avait bien jugé. Loin d’être sans intelligence, il en avait une, au contraire, vive, pénétrante, rapide et qui n’avait besoin que d’être cultivée pour éclore, se développer et devenir bientôt supérieure. En peu de jours il lisait couramment, et déjà, effrayé de son succès, il tremblait presque qu’on ne le trouvât trop savant, tant il avait peur de voir terminer ses études ; mais pour y renoncer, les deux jeunes maîtresses tenaient trop à donner à leur œuvre toute la perfection dont elle était susceptible…
— Tiens, lui dit Aïxa un matin, étudie ta leçon dans ce livre, et après tu nous la liras tout haut.
Et pendant que Carmen, à genoux devant la cheminée, soignait une casserole d’argent qu’elle venait de placer sur le feu, Piquillo jeta les yeux sur le livre qu’on lui présentait, et vit en grosses lettres ce titre : Conquête de l’Espagne par les Maures.
— Ah ! les Maures… je sais ce que c’est.
— Toi, Piquillo !… et comment les connais-tu ? dit Aïxa en le regardant avec attention.
— J’en ai vu un qui était si noble et si beau !… Il m’a dit des paroles que je n’oublierai jamais… Et puis, les premiers amis que j’ai rencontrés étaient aussi des Maures, ils m’ont assuré que j’étais de leur race et de leur sang.
— C’est vrai, continua froidement Aïxa, je croyais que tu l’ignorais.
— Et toi-même, comment le sais-tu ? s’écria Carmen sans interrompre la préparation qui l’occupait, et à laquelle elle semblait attacher beaucoup d’importance.
— Je l’ai su bien aisément, répondit Aïxa. Le jour où il s’est offert à nos yeux, les branches d’arbres avaient tellement endommagé la manche de son pourpoint, qu’il était facile de voir le signe qu’il porte là au bras droit… Tu l’as toi-même remarqué.
— C’est juste… sans savoir ce que c’était, reprit Carmen.
— Eh bien ! dit Aïxa, c’est un signe arabe.
— Tu sais donc l’arabe, Aïxa ?
— Oui, sœur… quelques mots seulement… qu’on m’a appris dans mon enfance.
Puis, se retournant vers Piquillo :
— Étudie tout bas et ne nous dérange pas… car nous sommes là très-occupées… Eh bien, Carmen, as-tu fini ? notre déjeuner est-il prêt ?
— Oui, sœur… et d’après tes instructions ; le voici.
Et elle versa ce qui était dans la casserole d’argent sur un plat de porcelaine.
Bien, dit Aïxa, je me connais en morilles[15], et jamais tu n’en auras mangé de plus fraiches et de plus délicates.
Et toutes deux, ravies du repas qui leur avait été plusieurs fois défendu, se mirent à goûter, avec une joie enfantine, le plat qu’elles venaient d’apprêter en cachette, avec l’aide de Pablo, qui leur avait fourni tous les ingrédients nécessaires.
— C’est un mets délicieux, dit Carmen.
— Je le crois bien, répondit Aïxa, un ragoût excellent ! et moi qui sais distinguer les bonnes morilles des mauvaises, j’irai demain dans le parc, à l’endroit où j’ai trouvé celles-ci, en cueillir de nouvelles pour ton père, à qui nous en ferons le régal.
Et toutes deux, assises devant une petite table en laque de Chine, déjeunaient vis-à-vis l’une de l’autre, tandis que Piquillo dans un coin étudiait tout bas la Conquête de l’Espagne par les Maures, et, bien sûr de sa leçon, s’apprêtait à la répéter à ses jeunes maîtresses, dès qu’elles auraient déjeuné ; mais tout à coup la porte de la chambre s’ouvrit brusquement.
— Qui vient ainsi, sans que nous ayons sonné ! s’écria Aïxa.
Et elle se leva avec fierté, ainsi que Carmen, pendant que Piquillo venait de jeter brusquement sur une console le livre qu’il tenait à la main.
Celui qui entrait ainsi était maître Pablo de Cienfugos lui-même, qui, pâle et tremblant, s’écria :
— N’y touchez pas ! n’y touchez pas !… je viens des cuisines ; le chef dit qu’elles sont de la plus mauvaise espèce… que c’est une mort certaine.
Carmen poussa un cri… chancela et serait tombée sans connaissance, si Aïxa, dont le bras ne tremblait pas, ne l’eût soutenue avec force, et la pressant contre son sein ;
— Allons, sœur, allons, du courage !
En ce moment Piquillo s’élança vers la table, et saisissant ce qui restait du plat à moitié entamé, le porta avidement à sa bouche.

qui baissait les yeux et rougissait.
— Piquillo, s’écria Aïxa… y pensez-vous !
— Oui, senora, j’y pense, dit froidement Piquillo.
Et maître Pablo, qui venait de l’apercevoir, s’écria avec un accès ce rage :
— Voyez-vous, dans un pareil moment ! le gourmand !… le larron ! le mauvais sujet ! mais il sera puni par sa faute elle-même ! c’est Dieu qui s’apprête à le châtier.
— Au nom du ciel ! dit Aïxa en l’interrompant, ne pensez qu’à votre maîtresse… courez lui chercher du secours.
— Il n’y en a pas, à ce que dit le chef… tout est inutile… c’est mortel… et surtout si rapide ! dans une heure tout sera fini !…
— C’est juste, murmura à demi-voix Aïxa, j’ai entendu dire que c’était ainsi.
— C’est égal, reprit maître Pablo, comprenant la sottise qu’il venait de faire, et se ravisant un peu tard… c’est égal… il est peut-être temps encore… dites-moi, senora, ce qu’il faut faire…
— Rien… rien ! répondit Aïxa en entendant la voiture de don Juan d’Aguilar qui rentrait en ce moment… laissez-nous, et ne dites rien à monseigneur… entendez-vous ?
Maitre Pablo s’inclina et sortit. Aïxa, pressant les mains de Carmen, qui commençait à revenir à elle :
— Ma sœur, ma sœur, lui dit-elle, en voulant lui donner une confiance qu’elle-même n’avait pas… ils se trompent, j’en suis sûre, j’en ai l’espoir…
— Le crois-tu ? s’écria vivement Carmen.
— Oui… oui… je te le jure. Mais, quand même ils diraient vrai, que ton père ne se doute de rien ! Si nous avons encore une heure à vivre, elle lui appartient ; qu’il ne la passe pas dans les angoisses et les tourments… quand le ciel nous permet de lui donner encore quelques instants de joie et de bonheur.
— Tu as raison, dit Carmen en cherchant à ranimer son courage, j’étais faible… je ne le serai plus… mais mourir si jeune ! ma sœur !…

Tu te plains, répondit Aïxa avec une fermeté stoïque, et tu peux embrasser ton père !… et moi, dit-elle en élevant les yeux vers le ciel…
— C’est vrai !… c’est vrai !… s’écria Carmen, mais, moi du moins, je suis là…
Elle lui tendit les bras, Aïxa s’y précipita.
Et après ce dernier adieu, les deux jeunes filles, essuyant leurs larmes, l’air serein et le sourire sur les lèvres, s’avancèrent au-devant du vieillard, qui entrait en ce moment.
— Ah ! vous voilà toutes deux, s’écria-t-il d’un air joyeux… j’en suis charmé ; je vous apporte des nouvelles qui m’ont mis en belle humeur et qui produiront le même effet sur vous. Une folie… une extravagance à laquelle j’étais loin de m’attendre ! Qui croyez-vous que je viens de rencontrer ? le fils de Matéo Vasquès, un ancien secrétaire de Philippe II… immensément riche, ma foi… qui m’a parlé de Carmen… ma fille… de manière… oui, vraiment…
Et le vieillard se prit à rire avec une gaieté si franche que Carmen en tressaillit.
— Eh quoi ! dit son père, qui vit ce geste, te doutes-tu de quelque chose ? Eh bien, oui ! moi qui te regardais comme un enfant… il paraît qu’on a d’autres yeux que moi !… Matéo Vasquès aurait des idées d’alliance… Rassure-toi, ma fille, et ne tremble pas ainsi. Je l’ai remercié de l’honneur qu’il nous faisait… mais j’ai d’autres vues… et puis, Dieu merci… je ne veux pas encore me séparer de mon enfant ! elle restera avec moi… elle y restera longtemps… ainsi que toi, ma bien-aimée Aïxa !… Aussi, je ne veux pas entendre parler de maris qui viendraient vous enlever l’une ou l’autre à ma tendresse : qu’est-ce que je deviendrais donc sans vous, mes enfants ? si je vous perdais… je mourrais !
Carmen poussa un cri de douleur, et Aïxa sourit en tendant la main au vieillard.
— Eh bien ! eh bien ! qu’a-t-elle donc ?… Quelle folie de s’affliger d’une pareille chimère ! Vois donc quelle pâleur sur ses traits ! et des larmes dans ses yeux… Allons donc ! par saint Jacques, fais comme Aïxa… fais comme moi… rions de cette folie, rions-en tous les trois !
Et le pauvre père laissa éclater avec bonhomie toute la joie qu’il éprouvait. Carmen voulut l’imiter, mais elle n’en eut pas la force et tomba en sanglotant dans ses bras.
— Eh mais ! eh mais ! dit-il étonné, qu’as-tu donc ?
— Rien, mon père ; pardonnez-moi… j’avais besoin de vous embrasser.
— Il n’y a pas de pardon à demander pour cela.
Et Carmen le serra contre son cœur avec tant de vivacité, le couvrit de ses baisers et de ses pleurs avec des mouvements si convulsifs, que don Juan commença à s’inquiéter.
— M’expliqueras-tu cela ? dit-il à Aïxa, qui, pâle, mais conservant son sang-froid, avait depuis longtemps les yeux fixés sur la pendule de l’appartement.
— Rien, monseigneur… je vous jure… Un mal de tête… une migraine qui à tout à coup saisi Carmen… Il ne faut pas que cela vous effraie. Elle aurait même… un peu de frisson… que ce ne serait rien encore.
— Rien ! dit le vieillard alarmé.
— Vous la verriez… pâlir… chanceler… et même, cela lui est arrivé parfois, à elle et à moi… elle aurait quelques crispations, quelques mouvements nerveux…
D’Aguilar poussa un cri, et voulut se lever de son fauteuil ; mais Aïxa le retint en lui disant :
— Mais, non, non… rassurez-vous… elle n’en a pas, vous le voyez bien ! Elle est pâle, c’est vrai, mais elle ne perd pas connaissance, elle ne souffre point… N’est-ce pas, Carmen ? Elle n’a pas de frisson ! et elle lui saisit la main, n’est-il pas vrai ?… Et cependant, continua-t-elle avec véhémence en regardant toujours la pendule, l’aiguille avance, et tu n’éprouves rien… ni moi non plus.
— Oui ! oui ! s’écria Carmen les yeux rayonnants de joie.
— Je te disais bien… que l’on se trompait… qu’il y avait de l’espoir… Ce serait fini maintenant… Et tiens, tiens… entends-tu ?… L’heure est écoulée, la pendule sonne !
Elles étaient sauvées !
Poussant un cri d’allégresse, les deux jeunes filles se jetèrent aux pieds du vieillard. Puis, se relevant et se moquant mutuellement de leur frayeur, elles se mirent à battre des mains en riant et en dansant.
C’était au tour de d’Aguilar à s’effrayer. Il les crut folles.
— Avez-vous perdu la raison ?
— Non, dit Aïxa, car nous vous aimons plus que jamais, et nous venons de vous épargner… ce que nous avons souffert.
— Qu’est-ce donc ?
— Ne nous le demandez pas, nous le préférons. Aussi bien, dit-elle, j’étais sûre de moi et je savais bien que je m’y connaissais. Mais, c’est égal, vous me gronderiez, et elle aussi… Il vaut donc mieux que vous ne nous interrogiez pas.
— Et je veux cependant tout savoir ! dit le vieillard avec impatience.
— Alors, dit Carmen, venez, mon père, prenez mon bras, je vais tout vous raconter dans votre appartement… à condition que vous ne vous effraierez pas… puisque me voilà.
— Je m’effraierai… je m’effraierai si je veux ! répondit le père avec plus d’inquiétude encore que de colère ; venez, senora, venez.
Ils sortirent tous deux.
Aïxa fit alors quelques pas dans l’appartement, tira un rideau derrière lequel Piquillo était caché, et lui dit :
— Pourquoi as-tu pris ce qu’il y avait dans ce plat ?
— Pour rester, dit froidement Piquillo, si vous restiez toutes deux ; et pour partir, si vous partiez.
Aïxa lui tendit la main, et lui dit avec émotion :
— Désormais je croirai en toi !
XIII.
la sainte-marie del carmen.
Aïxa, la seule qui eût conservé son sang-froid, avait eu bien raison de ne pas associer le vieillard aux émotions qu’elle venait d’éprouver. Il n’aurait pu y résister ; et, lorsque sa fille lui fit le récit de leur imprudence, l’idée seule du danger qu’elle avait pu courir lui causa un tremblement dont il eut grand’peine à se remettre.
Enfin, et quand il fut bien rassuré, il fit venir maître Pablo pour se fâcher à son aise et sans crainte, et se fit répéter par lui tous les détails.
Il était évident que le chef s’était trompé, que c’était lui qui ne s’y connaissait pas, qu’il avait donné une fausse alarme, et qu’il n’y avait, dans tout cela, rien de réel ! Mais Pablo, qui avait été appelé pour faire un rapport, ne voulait pas être venu pour rien, et s’en aller sans avoir eu satisfaction.
Aussi, et comme moyen d’exploiter le reste de colère de monseigneur, il lui raconta, d’un ton pénétré d’indignation, le peu de respect de Piquillo pour les belles-lettres, sa conduite avec son professeur, qu’il avait maltraité et chassé de l’hôtel, laissant entrevoir qu’en pareil cas la peine du talion serait encore de la clémence, et qu’il était impossible de garder dans la maison de monseigneur un indiscipliné et un ingrat qui ne voulait rien faire, ni rien apprendre.
Ainsi que Pablo l’avait prévu, son maître fut comme soulagé de trouver enfin à faire tomber sur quelqu’un son impatience et son humeur contenues depuis longtemps, C’était le lendemain que le terme fatal expirait, le mois était écoulé, et ce jour-là le majordome accourut dire à Piquillo avec une mine effrayée, où perçait une nuance de satisfaction :
— Allez vite, monseigneur vous demande. Il est à table avec ces demoiselles.
Piquillo comparut au déjeuner de famille, le front modeste et les yeux baissés, tandis que maître Pablo, qui commandait le service, le regardait avec ironie, et faisait de lemps en temps passer sous l’épaule gauche, avec un air de triomphe, la serviette qu’il tenait de la main droite.
— Il paraît, monsieur, dit gravement le vice-roi au jeune page, que vous avez congédié votre précepteur ; le nierez-vous ?
— Non, monseigneur… c’est vrai.
— Et pourquoi, s’il vous plait ?
Piquillo hésita, et Aïxa répondit, pour lui, en riant :
— Parce qu’il n’en avait plus besoin !
— Ah ! monsieur était trop savant ?
— Non pas trop, répondit modestement Piquillo.
— Mais assez ! ajouta Carmen.
— Ce n’est pas vous que j’interroge, ma fille, dit le vice-roi, et puisque monsieur peut se passer de précepteur, puisqu’il est devenu, en un mois, un puits de science et d’érudition, c’est un fait dont on peut aisément s’assurer… Donnez-moi un livre.
— En voici un, dit Aïxa en tirant de sa poche un volume de Quévedo, qu’elle présenta, tout ouvert, à Piquillo.
— Oui, dit d’Aguilar en s’enfonçant dans un fauteuil, lisez, lisez tout haut.
Chacun, à commencer par maître Pablo, écouta avec attention, et Piquillo lut, non pas seulement couramment, mais d’une voix ferme, nette et accentuée, les vers que Quévedo a mis au devant de son livre, comme épitre dédicatoire, et dont voici la traduction :
« J’aurais voulu et ne sais comment prouver ma reconnaissance
« À celui à qui je dois tant !
« Mais je me suis dit : À quoi bon ?
« Le soleil darde ses rayons bienfaisants ;
« La moisson, qui en profite, ne dit pas : Merci !
« Mais elle mûrit !!!…
« C’est tout ce que veut le soleil ! »
Le vieillard étonné s’écria : Qu’est-ce que veut dire ceci ?
— Que Piquillo est la moisson, répondit Aïxa.
— Et qu’il a mûri, grâce à vous, ajouta Carmen ; c’est tout ce que vous vouliez, mon père.
— Permettez, permettez, dit d’Aguilar en regardant tour à tour et Piquillo et le livre qu’il venait de lui reprendre… peut-être y a-t-il quelque tromperie… peut-être ces demoiselles… et elles en sont bien capables, lui ont fait apprendre par cœur les lignes ou plutôt les flatteries qu’il vient de me débiter.
Les deux jeunes filles haussèrent les épaules en riant.
— Je vais bien le voir, continua d’Aguilar en tirant de sa poche un portefeuille où il prit un crayon et une feuille de papier… je vais bien le voir… à moins que notre savant ne le soit que dans les livres imprimés.
Et il lui remit le feuillet sur lequel il venait d’écrire. Piquillo lut ce qui suit avec émotion :
« Je donne à Piquillo cinquante ducats de gages par an, et je l’attache désormais au service exclusif de Carmen et d’Aïxa. »
Depuis ce jour, Piquillo n’eut plus rien à désirer, et les deux années qui suivirent furent peut-être les plus heureuses de sa vie.
Dès que ses devoirs étaient remplis auprès de ses jeunes maîtresses, et ces devoirs n’étaient ni difficiles ni fatigants, il courait prendre un livre, car c’était là son premier et son plus vif plaisir. Dans les commencements, il consultait Aïxa sur ses lectures ; c’est elle qui le guidait ; mais bientôt la petite bibliothèque des deux jeunes filles fut épuisée par lui. Il s’adressa à celle du vice-roi, qui était vaste et composée des meilleurs auteurs.
Les ouvrages graves et sérieux étaient ceux qu’il préférait ; les sciences, surtout, attiraient son attention. Là, tout était rigoureux, positif, clairement démontré. Le savoir des autres devenait le sien, et toutes les découvertes, toutes les connaissances des siècles précédents appartenaient en un instant à l’écolier qui venait de s’en emparer et de les saisir.
Que les heures s’écoulaient rapidement ! que le temps paraissait doux à Piquillo ! Il donnait au travail une partie de ses nuits, et ses jours, il les passait presque tous auprès d’Aïxa et de Carmen.
L’étude, qui avait développé son intelligence et élevé son esprit, avait en même temps formé son tact et son goût. Il avait deviné, avec une convenance admirable, les limites dans lesquelles il devait se renfermer. C’étaient toujours les deux jeunes filles qui l’appelaient et qui même le consultaient parfois. La conversation se prolongeait souvent des heures entières. Qui se fût étonné de cette intimité si naturelle et si simple ? Piquillo était leur page, leur élève, et puis il leur était si dévoué !… il n’existait que pour elles… Sa vie était de les aimer et de les servir.
Sans compter que, chaque jour, il devenait plus éclairé et en même temps plus aimable et meilleur, car un des bienfaits de l’éducation est non-seulement de changer ou de corriger un mauvais naturel, mais d’exalter et d’ennoblir encore les nobles sentiments ! Admis comme il l’était dans leur vie réelle, dans leurs qualités et même dans leurs défauts de tous les instants, Piquillo avait déjà acquis une intelligence trop supérieure et un coup d’œil trop fin, pour ne pas connaitre ses deux jeunes amies aussi bien que lui-même.
Carmen n’avait pas dans le cœur une seule pensée que l’amitié n’y pût lire.
Pour Aïxa, c’était différent, il y avait en elle une idée ou un souvenir, qui, de temps en temps, la préoccupait. C’était un sourire mélancolique qui errait sur ses lèvres, c’était une vague rêverie qui se dissipait bientôt, mais qui existait… Carmen ne s’en était jamais aperçue, et Piquillo, plus attentif ou plus pénétrant, n’avait cependant rien pu deviner, sinon que, malgré sa jeunesse, Aïxa avait au fond du cœur un secret qu’elle gardait trop fidèlement pour que ce ne fût pas un devoir ; jamais, en effet, Aïxa n’avait trahi un devoir. Carmen ôtait bonne pour tout le monde ; Aïxa choisissait ; elle était fière et dédaigneuse pour ceux qu’elle n’aimait pas, prévenante, gracieuse et adorable pour ceux qui avaient conquis son amitié ou son estime, et Piquillo jouissait maintenant de ce bonheur.
La Sainte-Marie del Carmen approchait, et le vice-roi désirait, cette année, célébrer la fête de sa fille bien-aimée avec plus de pompe qu’à l’ordinaire, d’abord parce que la jeune enfant des années précédentes était devenue une grande et belle senora, et parce que depuis longtemps d’Aguilar avait à cœur de prendre sa revanche aux yeux de la ville de Pampelune, et de faire oublier la soirée qui, deux ans auparavant, avait produit un si mauvais effet, grâce à Piquillo.
Il avait d’abord acheté pour sa fille un cadeau superbe : c’était un vase en porcelaine de Chine, le plus merveilleux et le plus rare qu’on eût jamais vu à Pampelune : le travail en était exquis et les couleurs admirables.
Le marchand qui lui avait proposé ce vase en avait deux, et d’Aguilar aurait bien voulu la paire ; mais il s’agissait de mille ducats (huit mille francs de notre monnaie), et le vieux seigneur avait été, à son grand regret, obligé d’imposer cette privation à son amour paternel. Le vase qu’il avait payé cinq cents ducats, afin d’y mettre des fleurs pour sa fille, fut confié par lui à Piquillo, qui le cacha dans la bibliothèque.
Mais cela ne suffisait pas, il fallait s’occuper des détails de cette fête. Aïxa promit de se charger de tout, et sans en parler à Carmen, dont il fallait bien se cacher, elle appela en conseil secret Piquillo, heureux de sa confiance et surtout de ce mystère !
Qu’Aïxa était belle et joyeuse ! avec quelle vivacité, avec quelle chaleur elle discutait tous les projets proposés par son jeune conseiller ! Enfin, après une longue et mûre délibération, elle s’arrêta à une idée qui devait lui plaire pour beaucoup de raisons ; une entre autres, s’il faut le dire, c’est que son costume de bal serait charmant.
Cette idée consistait à donner à Pampelune ce qu’on a appelé depuis des quadrilles historiques, des bals costumés, divertissement que la France et l’Espagne adoptèrent avec fureur sous les règnes suivants, ceux de Philippe IV et de Louis XIV.
Piquillo, chargé de seconder sa jeune maîtresse dans tous les préparatifs, déploya un zèle et une activité extraordinaires. Il courait chez tous les marchands et fournisseurs, et dans une occasion si importante, maître Truxillo, le tailleur, ne fut pas oublié.
Le grand jour approchait ; le bal devait avoir lieu le lendemain, et Aïxa, qui avait choisi et dessiné, pour elle et pour Carmen, des costumes mauresques, craignant encore qu’ils ne fussent pas rigoureusement exacts, dit le soir à Piquillo :
— Ne m’as-tu pas dit qu’il y avait dans la bibliothèque du vice-roi un livre de gravures sur les antiquités de Grenade ?
— Oui, senora… je l’ai vu ! un gros volume, dans les rayons d’en haut ; demain matin vous l’aurez, soyez tranquille.
Le lendemain, tout entière à ses préparatifs de bal, Aïxa vit arriver dans sa chambre Piquillo… pâle… hors de lui, et dans un état de désespoir impossible à décrire. Il s’était déjà présenté deux fois à sa porte, et il paraissait plus mort que vif.
— Eh mon Dieu ! Piquillo, qu’y a-t-il donc ?
— Le plus grand de tous les malheurs… je n’ai plus qu’à me tuer, et j’ai voulu vous voir auparavant.
— Se tuer un jour de bal… allons donc ! dis-moi ce dont il s’agit, et je te promets d’y porter remède.
— Impossible… personne ne peut réparer un pareil désastre… ce vase… ce beau vase de Chine que le vice-roi veut donner aujourd’hui à sa fille…
— Eh bien ? s’écria Aïxa avec impatience…
— Et qu’il a payé cinq cents ducats…
— Eh bien ?
— Il n’existe plus… brisé… anéanti !
— Par qui ?
— Par moi.
— Et comment cela ?
— J’étais, ce matin, monté sur une haute échelle, dans la bibliothèque, pour prendre, dans les derniers rayons, le volume que vous m’aviez demandé ; le livre garni en cuivre m’est échappé des mains…
Aïxa poussa un cri d’effroi.
— Il est tombé sur le vase qui était au-dessous, et j’eusse mieux aimé, continua Piquillo avec désespoir, être brisé moi-même en morceaux, car je ne me sens pas la force d’annoncer cette catastrophe à monseigneur. Il est dit que c’est moi qui changerai en désolation toutes les fêtes qu’il veut donner. C’est la seconde fois que cela m’arrive, et cette fois-ci ma maladresse est bien plus grande, bien plus terrible encore | que la première.
— Allons, calme-toi, lui dit Aïxa aussi désolée que lui.
— Non, senora, je m’enfuis de cette maison dont je ne causerais que la ruine et la perte !
— Mais attends donc, lui dit-elle en le retenant… si l’on pouvait cacher ta maladresse au vice-roi, s’il l’ignorait toujours ? Voyons, cherchons ensemble ; n’y aurait-il pas quelque moyen ?
— Aucun… aucun, senora, c’est ce matin, dans quelques heures, que monseigneur va venir chercher ce vase pour le remplir de ses plus belles fleurs, et pour porter lui-même son bouquet dans la chambre de sa fille. Il veut lui faire une surprise, et c’est lui, mon Dieu, qui va être surpris ! Quelle sera sa fureur ! comment la calmer ? que pourriez-vous dire pour m’excuser ?
— Attends donc, dit Aïxa, qui, sans se décourager, cherchait toujours… J’y suis ! j’y suis ! Ne m’as-tu pas raconté que le marchand chez lequel a été acheté ce vase voulait vendre la paire ?
— Oui, senora.
Ainsi le pareil existe… il est chez lui ?
— Qu’importe !.. Quand je me vendrais comme esclave, cela ne paierait pas un trésor semblable. Quand je travaillerais toute ma vie, je ne pourrais pas acquitter une telle dette… Vous voyez donc bien que je n’ai qu’à mourir ; qu’il n’y a ni ressource ni espoir, et que vous-même, vous, ma providence, vous, mon bon ange, vous qui pouvez tout, vous ne pouvez pas me tirer de là !
— Peut-être, dit froidement Aïxa.
Elle ouvrit un petit meuble en bois de rose, qui était à côté de son lit, en tira cinq rouleaux qu’elle mit dans une bourse, et dit à Piquillo en souriant :
— Avant que monseigneur n’ait découvert la catastrophe, cours chez ce marchand, et remplace le vase.
Il y a là cinq cents ducats.
Piquillo, la bouche et les yeux ouverts, la contemplait sans rien dire ; il ne pouvait croire à ce qu’il entendait ni même à ce qu’il voyait, à cette bourse qu’il tenait entre les mains et dont le poids cependant n’était point chimérique.
— Vous, senora ! une jeune fille, posséder une somme aussi considérable !
— Ne t’inquiète pas, dit Aïxa en souriant de son air effrayé, elle est bien à moi.
— Mais alors, c’est toute votre fortune ! Je ne peux… je ne veux pas accepter.
— Il ne tiendrait qu’à moi de me faire plus généreuse que je ne le suis ; mais, pour dissiper tes scrupules, tiens, regarde !
Elle rouvrit le tiroir où elle venait de puiser, et lui montra qu’il contenait encore un grand nombre de rouleaux pareils.
— Tu vois, lui dit-elle, que j’en ai beaucoup, et que je ne m’en sers pas. Si ce n’étaient quelques pauvres qui sont, en secret, mes pensionnaires, je n’aurais rien à dépenser ici, et je suis enchantée que ma meilleure amie reçoive de moi, sans s’en douter, un cadeau qu’elle croira tenir de son père. C’est un bonheur que je te devrai, Piquillo, ajouta-t-elle avec un sourire enchanteur ; et puis, comptes-tu pour rien le plaisir d’obliger un ami ? de l’empêcher de se tuer ? Car j’espère que tu ne veux plus mourir, Piquillo, ni quitter cette maison où il y a deux fêtes aujourd’hui ? C’était celle de Carmen, et maintenant c’est la mienne !
À ces paroles si bonnes, si généreuses, dites avec un air de gaieté et d’insouciance enfantines qui voulait en diminuer l’importance et qui en doublait le charme, Piquillo ne put rien répondre. Il ne pouvait se rendre compte des sentiments qu’il éprouvait. C’étaient la reconnaissance sans doute et le respect, car il tomba à genoux, et pressa contre ses lèvres la main d’Aïxa, qui lui dit d’un ton plus grave :
— Ce que je confie à Piquillo, personne ne doit le savoir, personne ! pas même Carmen !
Et comme il faisait un geste d’étonnement, elle mit un doigt sur sa bouche et dit :
— Et Piquillo ne doit rien me demander.
— J’obéirai ! Mais moi, continua-t-il avec un soupir, moi qui vous croyais orpheline et sans fortune, vous êtes donc riche ?
— Quand ce serait !… dit Aïxa étonnée de sa tristesse… ce n’était pas pour cela que tu m’étais dévoué…
— Non ! sans doute.
— Eh bien alors, dit-elle en lui tendant la main, cela ne doit pas t’empêcher de m’aimer ; puis elle referma le tiroir en lui disant : Va vite, qu’on ne se doute de rien.
Et elle se mit gaiement à sa toilette.
Piquillo sortit, tout étonné, tout troublé encore de ce qui venait de lui arriver, et ne sachant pourquoi à tant de joie et de bonheur se mêlait un vague sentiment de crainte ou de regret.
Il marchait rapidement et suivait la rue Sainte-Isabelle, où demeurait le marchand qu’il allait trouver, lorsqu’une voix lui demanda l’aumône. Dans sa préoccupation, il ne l’entendit pas, et continua sa marche. La voix le poursuivit et proféra ces mots : Ils sont donc tous sans pitié ! Il se retourna, et vit une vieille femme… au front basané, qui tendait la main.
Tout autre eût remarqué ses cheveux gris en désordre, son œil hagard et sombre, sa main agitée par un mouvement convulsif et l’animation fébrile qui contractait tous ses traits. Piquillo ne vit rien de tout cela : une autre idée le préoccupait ; il se rappela le jour où il tendait ainsi la main dans les rues de Pampelune, ce jour où il allait mourir de faim, quand Juanita vint à son aide.
— Elle aussi a faim, dit-il.
Et sans faire attention à l’air plutôt menaçant que suppliant de cette femme, il lui donna tout ce qu’il avait sur lui. C’était un demi-ducat !
— Un demi-ducat ! s’écria la mendiante en tressaillant de joie ; merci, mon jeune seigneur, merci, lui dit-elle d’un air ému.
Puis, tout à coup, elle laissa tomber ses bras avec découragement, et se dit à demi-voix :
— C’est égal ! ça n’est pas assez ! ça ne la sauvera pas !
— De qui parlez-vous ?
— De qui ?… dit la mendiante avec égarement ; d’elle… de ma fille… que la fièvre dévore, et ils veulent nous renvoyer de notre galetas… et elle va mourir sans abri !… dans la rue… et malgré cela, elle ne voulait pas demander… c’est moi qui suis sortie… pour tendre la main… Il le fallait bien… puisqu’il paraît que c’est ma faute… à moi !….. que c’est moi qui suis cause de tout, et cependant Dieu m’est témoin que j’aimais bien mon enfant !
Piquillo voulut l’interroger ; mais elle continua avec un éclat de rire qui tenait de la folie :
— Un demi-ducat ! à moi qui en ai jeté par poignées ! un demi-ducat ! à nous qui en devons dix !… Je vous demande si c’est juste !… et s’il y avait une justice au ciel !… Si seulement, en attendant, il y en avait une sur la terre…
— Taisez-vous ! taisez-vous ! lui dit Piquillo en l’interrompant ; je n’ai rien en ce moment, mais demain, je vous le promets, je ferai ce que je pourrai. Où est votre logis ?
— Oui, c’est vrai… notre logis, il faut se hâter de le dire, car demain nous n’en aurons plus !
— Où est-il ?
— Rue du Figuier, dans la maison du juif Salomon, le teinturier.
— Et votre nom ?
— Ah ! notre nom… est-ce le vrai que vous me demandez… le nôtre à nous ?
— Oui, sans doute.
— Alliaga, dit-elle.
Et elle s’enfuit.
Piquillo poursuivit sa marche, que cet incident avait retardée, arriva chez le marchand, paya, emporta le précieux vase, et il était rentré à l’hôtel, et tout était en place, avant que le vice-roi vint chercher le cadeau qu’il destinait à sa fille, et qui fut reçu par elle avec des transports de joie et de reconnaissance.
— Vois donc, dit-elle à sa sœur, les folies que mon père a faites pour moi.
— Et voici, dit Aïxa en l’embrassant, notre surprise à nous deux Piquillo : lui, pour le conseil, moi, pour l’exécution.
Et elle lui montra le costume mauresque pareil au sien, qu’elle avait fait faire, à son insu, et qui lui allait à ravir.
— Mais l’heure s’avance, s’écria gaiement Aïxa, nous n’avons pas de temps à perdre ; et s’adressant à Piquillo :
— Songe bien à ce que je t’ai dit, c’est toi que j’ai chargé des musiciens, du buffet et des rafraichissements.
Son fidèle esclave promit que l’on serait content de lui.
Déjà le pavé de l’hôtel avait retenti sous les roues bruyantes des nombreux équipages ; toutes les nobles familles de Pampelune et de la Navarre étaient accourues, disputant de richesse et d’éclat plutôt que d’élégance ; la soie, les diamants, les broderies, les larges galons d’or brillaient sur chaque costume, et les vastes salons, resplendissant de cristaux et de lumières, présentaient l’aspect le plus bizarre et le plus varié.
Toutes les nations du monde s’y étaient donné rendez-vous et y figuraient par quadrilles. Le vice-roi, heureux et triomphant cette fois, ne pouvait suffire à répondre aux compliments qui l’assaillaient de tous côtés. Il n’y avait qu’une voix sur le bon goût, l’originalité et l’admirable ordonnance de cette fête.
Le même concert de louanges éclatait dans tous les salons, et les échos en retentissaient jusque dans le vestibule, où se tenait modestement Piquillo, auquel personne ne songeait, et qui, ordonnateur de toutes ces merveilles, en surveillait attentivement l’exécution. Tout à coup cependant il se fit dans le premier salon un mouvement et un brouhaha si extraordinaire, que Piquillo, cédant à sa curiosité, s’approcha des grandes portes vitrées qui donnaient sur la salle du bal.
C’étaient Carmen et Aïxa qui, conduites par leurs danseurs, traversaient le salon.
Au milieu de cette foule d’habits dorés, lourds et pesants, le costume léger, exact et élégant des deux jeunes filles, fit jeter un cri d’étonnement et d’admiration.
Elles portaient une tunique d’étoffe persane rayée, brochée d’or et d’argent, serrée par une ceinture qui accusait l’élégance et la souplesse de leur taille, un dolman à manches étroites semé de pierreries, et enfin des pantalons de soie flottants, fermés au-dessus de la cheville. Des mules de maroquin rouge encadraient leurs jolis pieds. Leurs cheveux tresses, qui tombaient sur leurs épaules, s’échappaient d’un petit bonnet fort riche, placé avec coquetterie sur le sommet de la tête.
Aïxa surtout portait ce costume avec un charme et une aisance admirables. Ses longs cheveux descendaient jusqu’aux talons, et leur noir d’ébène faisait ressortir la blancheur et l’éclat de sa peau. Animée par le mouvement du bal, par le bruit de la musique, par le plaisir d’être vue, par le bonheur d’être belle, Aïxa souriait d’un air gracieux, et semblait d’avance remercier le flot d’admirateurs qui s’ouvrait devant elle et se reformait plus loin.
Un seul des spectateurs, un seul… pâle, immobile, et couvert d’une sueur froide, était resté à la même place, les yeux fixés contre les portes vitrées du vestibule. Aïxa était passée, elle ne l’avait pas vu, et lui… regardait encore… C’était Piquillo. À la vue d’Aïxa dans tout l’éclat de sa beauté et de sa parure, il aurait dû être glorieux de son triomphe et enchanté de l’admiration qu’elle inspirait ; loin de là, il éprouvait une impression pénible, un sentiment douloureux dont il ne pouvait se rendre compte ; il en eut bientôt l’explication.
On avait commencé à danser… un beau cavalier donnait la main à Carmen ; Piquillo demanda son nom à maître Pablo, qui était à côté de lui dans l’antichambre. C’était don Carlos, neveu de don Balthazar de Zuniga, ambassadeur à Vienne.
— C’est un grand seigneur ? dit-il.
— Oui, sans doute.
— Et ce jeune homme qui porte une chaine d’or et une plaque en diamants, celui qui danse avec la senora Aïxa ?
— C’est le fils du duc d’Ossuna, vice-roi de Naples… un charmant cavalier.
— Et il est très-riche ?
— Oui, vraiment.
— Et très-noble ?
— À coup sûr.
— Tous, nobles, riches… fils de grands seigneurs ! se dit-il en lui-même avec amertume ; et moi, pas de parents !… pas même de nom !… car Piquillo… qui sait même si ce nom est le mien !… Aussi, ils donnent la main à de belles et nobles demoiselles ! Ils sont au salon… et moi à l’antichambre ! Ils brillent, et je me cache !…
— Voyez, lui dit maître Pablo, comme le comte d’Ossuna est aimable et galant. La senora Aïxa a laissé tomber son bouquet… il vient de le ramasser et le lui rend après l’avoir porté à ses lèvres… Eh bien, Piquillo, que faites-vous donc ? dit-il en retenant le jeune homme, qui venait de s’élancer dans le salon.
— Rien, répondit Piquillo en s’arrêtant, j’allais voir si l’on avait besoin de moi.
À l’instant, par bonheur, cette danse finissait, et en retournant à sa place, Aïxa l’aperçut… Elle jeta sur lui un de ses plus aimables et gracieux sourires.
Piquillo sentit son cœur oppressé se dilater de joie et de bonheur.
Elle se leva et alla droit à lui.
Tout fut oublié, Piquillo n’en voulut plus à personne. Il se croyait maintenant l’égal de don Balthazar de Zuniga et du vice-roi de Naples.
— Bien, Piquillo, lui dit-elle de sa voix douce et caressante, très-bien ! mais voici le moment, fais servir les rafraîchissements.
Piquillo demeura accablé… il fit quelques pas en chancelant, et dit dans l’antichambre à maître Pablo :
— Veillez à tout, je vous prie… je ne me sens pas bien.
Il s’élança dans le jardin, fuyant le bruit du bal et de l’orchestre qui le poursuivait, et les flambeaux étincelants qui projetaient encore leurs lueurs jusque dans les massifs…
Il marcha toujours devant lui… jusqu’au bout du parc, jusqu’à la chaumière où Carmen et Aïxa étaient venues autrefois l’arracher à son chagrin… Et là, saisi d’une douleur bien plus profonde et plus poignante encore, il s’arrêta et se mit à fondre en larmes.
Ah ! il aimait… l’insensé ! il aimait de toutes les forces de son âme !… ou plutôt cet amour était son être et sa vie… il n’avait jamais fait autre chose qu’aimer cette jeune fille ! seulement alors, et par malheur, il s’en apercevait.
Sans connaître Je monde autrement que par ses livres, Piquillo en savait assez pour apprécier toute l’étendue de sa folie et mesurer l’abime au bord duquel il se trouvait. Le supplice qui l’accablait était le plus pesant et le plus horrible de tous, c’était celui que le Dante avait choisi pour caractériser les tourments de l’enfer, et de quelque côté qu’il se retournât et envisageât sa position, il ne pouvait que se répéter ces mots : Sans espoir ! sans espoir !
Et en effet c’était bien là la vérité ; mais en amour, la vérité n’est pas une raison ! si elle nous accable de son évidence, on détourne les yeux et on lui préfère une erreur, ou une extravagance qui nous console.
Pendant toute la nuit, Piquillo se répéta qu’Aïxa était probablement d’une haute naissance ; mais enfin cette naissance et cette famille, pourquoi les cacher aux yeux de tous ? il y avait là quelque chose d’encourageant, un mystère qui lui permettait d’espérer quelque mésalliance, quelque tache à son blason ; elle était riche, sans contredit, mais on avait vu tant de gens qui n’avaient rien faire de belles fortunes ! Les livres qu’il avait lus étaient remplis d’aventuriers heureux qui parvenaient aux emplois les plus élevés. Cela ne pouvait-il pas se voir encore ? Aïxa l’avait dit elle-même : avec de la patience et du courage on arrive à tout.
Alors il se levait… il marchait à grands pas, riche des plus belles illusions, qu’un instant de calme et de réflexion suffisait pour dissiper et détruire.
C’est ainsi qu’il passa toute la nuit.
XIV.
le lendemain de la fête.
Le lendemain de cette grande fête, personne ne se leva de bonne heure, et le supplice de Piquillo fut prolongé. Il vit Aïxa bien plus tard qu’à l’ordinaire, lui qui depuis le point du jour errait sous ses fenêtres ou devant sa porte !
Quand elle l’aperçut, elle fut effrayée du changement de ses traits. Elle avait bien su par Pablo qu’il avait été indisposé, et dans la soirée même, elle et Carmen avaient plusieurs fois demandé de ses nouvelles. Dans ce moment encore les deux jeunes filles l’accablaient de soins, d’attentions et de prévenances qu’on aurait dit, non d’un serviteur, mais d’un ami et d’un frère.
Piquillo comprenait bien qu’on faisait pour lui mille fois plus qu’on ne devait. Attendri jusqu’aux larmes, il se reprochait son ingratitude, et cela ne l’empêchait pas de sentir la main de fer qui étreignait son cœur. Il fût mort plutôt que d’avouer à personne un secret qu’il eût voulu se cacher à lui-même ; et, résolu de dompter, ou du moins de dérober à tous les yeux une passion insensée, il s’efforça de sourire et de plaisanter sur les plaisirs et les succès de la veille.
Carmen ne se douta de rien ; mais Aïxa était trop clairvoyante pour s’y laisser tromper : un instinct merveilleux et sympathique lui disait si promptement les peines de ses amis, qu’il semblait qu’elle les eût devinées ou éprouvées avant eux.
Elle posa sa main sur celle de Piquillo, qui tressaillit, et, le regardant attentivement, elle lui dit d’un air de reproche :
— Piquillo cache un mystère à ses amies.
À cet accent de bonté, à cette voix si douce et si tendre qui faisait vibrer toutes les fibres de son cœur, le pauvre jeune homme sentit faiblir sa résolution et son courage ; il se mit à fondre en larmes.
— Qu’as-tu donc ? qu’as-tu donc ? dirent-elles toutes les deux.
— Vous me le demandez ! s’écria-t-il en cherchant à retenir ses pleurs ; vous me le demandez ! vous qui, par bonté, avez fait de moi le plus malheureux des hommes ! vous dont l’amitié et les nobles sentiments m’ont presque élevé votre égal, quand, par ma condition, je devais rester au-dessous de tous ! vous qui m’avez instruit et éclairé pour me faire voir ma honte et ma misère, que j’aurais peut-être toujours ignorées !
À ces reproches inattendus et qui n’étaient que trop justes, Carmen restait muette de surprise et de douleur. Aïxa réfléchit un instant et lui dit :
— C’est vrai !… sœur, c’est vrai, Piquillo à raison ! la faute est à nous, c’est à nous de la réparer. Mais je lui dirai comme autrefois, c’est à lui de nous aider !
Oui, ajouta-t-elle d’une voix animée, ne te laisse pas abattre ; ne regarde plus le point de départ, mais le but, et tu arriveras, Piquillo, tu arriveras, je te le promets. L’Espagne n’est pas aujourd’hui, par malheur, si féconde en hommes de talent qu’il n’y ait place pour toi… et peut-être aux premiers rangs ! Je te dirais : « Prends une épée, » si tu étais gentilhomme ; mais tu ne l’es pas, je ne le crois pas du moins, ni toi non plus. Il faut donc choisir une autre carrière, et il en est où tu dois réussir, car tu es plus instruit, plus capable qu’eux tous ! Et ces nobles hidalgos et ces grands seigneurs, avec qui je causais hier, m’ont prouvé mieux que toi-même ce dont je me doutais déjà, c’est que tu as du mérite et beaucoup !
Ah ! si Aïxa avait pu se douter du bien qu’elle faisait à Piquillo, si elle avait pu lire dans son cœur, elle aurait vu que dans ce moment, et grâce à elle, il pouvait aspirer et arriver à tout ; nul obstacle ne pouvait plus l’arrêter.
Il est telle parole de la femme qu’on aime qui vous a créé un avenir.
— Bien ! bien ! reprit-elle en voyant l’air de joie et d’exaltation briller dans les yeux de Piquillo à la place des larmes qui y roulaient tout à l’heure ; bien ! le reste me regarde maintenant ! Je vais parler à ton père, Carmen, il saura nous comprendre et nous aider. Attendez-moi, mes amis !
Et elle s’élança vers l’appartement du vice-roi sans réfléchir que peut-être n’était-il pas encore éveillé.
Don Juan l’était depuis longtemps.
Enchanté de sa fête et surtout du succès qu’avait obtenu sa fille, car pendant toute la soirée son père n’avait vu qu’elle, il était resté le dernier à ce bal et s’était couché tard. Il dormait depuis quelques heures, entendant encore le bruit de l’orchestre, voyant encore danser sa fille… et l’admirant toujours en rêve, lorsqu’on frappa rudement à sa porte.
— Est-ce que Carmen serait malade, indisposée par les fatigues de la veille ? ce fut la première pensée du vieillard ; mais il fut promptement rassuré par les accents d’une voix qui lui était bien connue, et qui depuis longtemps n’avait retenti à ses oreilles.
— Rassurez-vous, maître Pablo, son excellence le vice-roi de la Navarre ne vous grondera pas de l’avoir réveillé en sursaut ; quand on vient en poste embrasser son oncle, et qu’on n’a que quelques heures à lui donner…
— Mon neveu !… mon neveu !… s’écria don Juan en s’élançant dans ses bras.
Et aux premiers rayons du soleil dont s’éclairait l’appartement qu’on venait d’ouvrir, il contempla la figure mâle et guerrière du jeune homme.
— Ah ! s’écria-t-il avec joie, ce n’est plus le beau page d’il y a cinq ans… mais c’est mieux encore ! D’où viens-tu ainsi ?
— Des Pays-Bas, où nous nous battons !
— Je le vois… je le vois bien, dit le vieillard en contemplant avec orgueil une légère cicatrice qui sillonnait le front bruni de son neveu.
— Et le capitaine du régiment de la Reine est aujourd’hui colonel, poursuivit gaiement le jeune homme. Oui, mon oncle, malgré la haine que m’a gardée le duc d’Uzède, le fils du ministre ; malgré la malveillance que me portait son père, une protection inconnue a toujours fait valoir mes services et m’a fait avancer ! Vous doutez-vous qui ce peut être ?
— Non, par saint Jacques ! C’est justice, et pas autre chose ! et puisque je te revois, tout va bien ! Je n’ai qu’un regret, c’est que tu ne sois pas arrivé hier soir… à notre fête, à notre bal !… Tu aurais vu ma fille !… Carmen, ta cousine, qui était charmante… Tu aurais dansé avec elle ! Tu ne la reconnaitras pas, j’en suis sûr, tant elle est jolie !… Hier surtout, imagine-toi…
Il allait commencer la description du costume de sa fille, et il s’arrêta, non pas qu’il l’en tint quitte ; mais passant rapidement à un autre sujet, car la joie est volontiers causeuse, il s’écria :
— Colonel ! ah çà ! nos affaires vont donc mieux dans les Pays-Bas ?
— Non, mon oncle, répondit tristement le jeune homme ; vous avez vu un temps où les armées espagnoles étaient triomphantes, un temps où elles se battaient du moins pour une bonne cause… mais maintenant tout est contre nous !
Pour placer la sœur de notre roi sur un trône, tuer de braves gens qui défendent leur pays et leur liberté, cela porte malheur !… La défaite est honteuse et le succès sans gloire. Ce peuple de marchands et de pêcheurs, ces Hollandais, tiennent tête depuis quinze ans à toutes les forces de l’Espagne ; leur Maurice de Nassau est un héros !… Il a fait des prodiges à Newport.
Oui, mon oncle, oui, dit-il à voix basse, nos meilleurs soldats, notre artillerie, nos bagages, et plus de cent drapeaux… notre désastre a été complet… Et sans le marquis de Spinola ! Au moins celui-là, c’est un général !…
— Aussi, le duc de Lerma ne l’aime pas.
— C’est lui qui nous a sauvés, qui a ramené la victoire et la discipline dans nos rangs ; c’est lui qui a payé, de ses propres deniers, des soldats qui n’avaient ni solde, ni habillement, ni pain, et qui pillaient au lieu de se battre.
— Et le duc de Lerma emploie nos finances à donner des fêtes ! s’écria d’Aguilar avec indignation.
— Enfin, la prise d’Ostende a terminé la campagne en notre faveur. Mon général, qui m’honore de quelque estime, m’avait chargé d’en porter la nouvelle à Madrid ; mais, malgré notre victoire, la mer n’est pas libre et ne nous appartient pas… il m’a fallu traverser la France, les Pyrénées… et voilà comment je viens à Pampelune, mon cher oncle, vous demander à déjeuner !
— Sois le bienvenu… mais tu nous donneras bien la journée…
— Quelques heures seulement… et je repars pour remplir ma mission…
— Quel dommage ! s’écria d’Aguilar ; à peine auras-tu le temps de voir ma fille…
— Par saint Yago, j’aurai toujours le temps de l’admirer, de l’embrasser, de lui dire que, malgré l’absence, j’ai toujours pensé à elle !
— Bien, bien ! dit le vieillard en se frottant les mains… Et puis, ajouta-t-il en riant : Voici le temps qui arrive… Tu ne croirais pas qu’on me l’a déjà demandée en mariage ! Rodrigo Vasquez, le fils de l’ancien secrétaire d’État… Et hier à ce bal… le neveu de Balthazar de Zuniga, notre ambassadeur à Vienne, ne l’a pas quittée des yeux de toute la soirée… Je te dis cela, parce que cela me fait plaisir… Cela doit t’en faire aussi… Mais mon seul vœu, à moi, le dernier espoir ; de mes jours, tu le sais, tu le connais ?
Vois-tu, Fernand, continua-t-il en lui prenant les mains, il y a des pressentiments dont on ne peut se rendre compte. Je suis heureux de te voir là, parce que je ne sais pas si je dois longtemps jouir de ce bonheur. Il me semble que le terme de mes jours approche. Mais que la volonté de Dieu soit faite, dit-il en levant les yeux au ciel, je partirai sans crainte, puisque je te laisse l’époux de ma fille…
Et si je te la donne, ce n’est pas parce que tu es riche, parce que tu es beau, parce que tu es brave : c’est qu’il y a là, et il lui frappa sur le cœur, un trésor de franchise et de loyauté que je connais. Tu n’as jamais manqué à ta parole, Fernand, et je croirai au bonheur de ma fille, si tu me jures de la rendre heureuse.
— Je le jure ! mon oncle ! je le jure ! s’écria le jeune homme, et si je manquais à ce serment…
La porte s’ouvrit, et Fernand s’arrêta immobile en voyant paraitre Aïxa.
Jamais elle n’avait été si jolie qu’en ce négligé du matin, qui la couvrait à peine. Elle accourait vive et joyeuse, animée par l’espoir d’une bonne action ; elle croyait à cette heure trouver d’Aguilar seul chez lui ; et en apercevant un étranger, un jeune homme, un militaire… elle s’arrêta toute troublée, baissant vers la terre les longs cils de ses yeux noirs, et ses joues se couvrirent d’une rougeur qui l’embellissait encore.

Fernand, qui à son arrivée avait interrompu sa phrase, était moins que jamais en état de l’achever… Troublé et interdit, il restait immobile de surprise et d’admiration, et son embarras rendit quelque confiance à la jeune fille, qui se hasarda à lever les yeux. Le beau cavalier qui était devant elle n’avait ni l’afféterie ni la fatuité des jeunes seigneurs dont elle se moquait la veille. Sa taille haute, élevée, ce front hâlé par le soleil des champs de bataille, cette noble cicatrice, cette moustache élégante, cette épée surtout sur laquelle il s’appuyait en ce moment, tout cela contrastait avec l’apparence chétive et grêle du pauvre Piquillo, avec sa tenue modeste, timide et embarrassée…
— C’est mon neveu, dit joyeusement d’Aguilar en le présentant à la jeune fille… don Fernand d’Albayda.
Aïxa tressaillit à ce nom, comme s’il lui eût rappelé quelque souvenir, et elle regarda le jeune homme avec un sentiment de curiosité qu’elle n’avait pas tout à l’heure.
— C’est mon enfant d’adoption, dit le vice-roi à Fernand en lui montrant Aïxa ; quelque jour nous te raconterons son histoire, dès que cela nous sera permis ; en attendant, c’est ma seconde fille, la sœur de Carmen… et tu ne la trouves pas mal, à ce que je vois…
— Charmante ! murmura Fernand à voix basse, en s’inclinant avec respect.
— Eh bien ! tant mieux ! s’écria le vieillard étourdiment ; tant mieux !… parce que, vois-tu bien, murmura-t-il à son oreille, Carmen est bien plus belle encore, tu la verras ! deux fois plus belle !
Le père disait vrai… il en était persuadé !
— Eh bien ! mon enfant, continua-t-il gaiement en s’adressant à Aïxa, que venais-tu me dire ? Que la présence de mon neveu ne te gène pas, nous sommes ici en famille ; et puis comme il ne nous donne que quelques heures, je n’en veux pas perdre un seul instant, et je ne le quitte pas.
— C’est trop juste, dit Aïxa, avec un sourire charmant ; et elle lui expliqua en peu de mots le désespoir de Piquillo, qui avait maintenant le malheur de se trouver un homme de mérite, et qu’il fallait alors traiter comme tel.
— Tu as raison ; que puis-je faire pour lui ?
— L’élever, d’abord, aux yeux des gens de votre maison, le sortir de la condition qu’il occupe… le nommer votre secrétaire…
— Tu le veux ! c’est fait !
— Voilà pour sa position… Quant à sa fortune, dit-elle avec un peu plus d’embarras et en baissant la voix, je voudrais… si vous le permettez… et sans qu’il s’en doutât jamais, y contribuer aussi ; car vous savez, monseigneur, qu’il y a des folies bien inutiles… qui ne me servent à rien…
— Très-bien ! très-bien ! dit d’Aguilar, qui parut la comprendre… je ne veux pas, dans ce moment, te priver de ce plaisir… nous verrons plus tard ce qu’il y aura à faire pour ton protégé.
— Disposez de moi, dit vivement Fernand en s’avançant ; tout ce que je peux avoir à Madrid d’amis et de crédit sera employé en faveur de quelqu’un auquel vous vous intéressez, vous, mon oncle… et la senora, dit-il en regardant Aïxa.
— Merci, seigneur Fernand, répondit-elle avec joie, vous êtes un digne rejeton de la famille ; le cousin de Carmen devait être bon et généreux comme elle, et voilà notre pauvre Piquillo assuré déjà d’un puissant protecteur.
Le vice-roi avait déjà envoyé prévenir son ancien page, qui arriva en ce moment et à qui l’on se hâta d’annoncer ces bonnes nouvelles.
— Tu es mon secrétaire, lui dit-il, tu auras deux cents ducats de traitement, et de plus, comme gratification, une année d’avance ; en prononçant ces derniers mots, il regarda en souriant Aïxa, qui l’approuva de la tête.
— Et moi, dit Fernand, j’espère, monsieur, par le crédit de notre parent, le président du conseil de Castille, vous faire bientôt obtenir une place qui, d’après ce qu’on m’a dit de vos talents, sera honorablement remplie.
Aïxa et Piquillo échangèrent un regard, l’une de joie, et l’autre de reconnaissance.
— À merveille, dit d’Aguilar avec impatience ; mais ma fille doit être levée et habillée… Il nous tarde de la voir et de l’embrasser, n’est-il pas vrai, Fernand ?… Et puis nous déjeunerons après tous les quatre en famille…
Le vieillard prit le bras du jeune homme, sur lequel il s’appuyait avec complaisance, et sortit suivi d’Aïxa.
Piquillo, resté seul, fut comme étourdi d’abord de tout le bonheur qui l’accablait. Puis sa première pensée fut celle-ci : Je ne serai pas seul à en profiter. Il venait de se rappeler la mendiante de la veille… et courut à la rue du Figuier.
La maison du juif Salomon était sale, noire et de hideuse apparence… Il demanda Alliaga.
— C’est ici.
— À quel étage ?
— Au dernier,
Et il monta.
XV.
sous les toits.
Piquillo était essoufflé quand il arriva au haut de l’escalier. Il est vrai qu’il venait de hâter sa marche et de monter vivement, car, dès le troisième ou quatrième étage, il avait entendu des cris confus qui devaient provenir des régions supérieures, le bruit augmentant à mesure que Piquillo gravissait les degrés. Arrivé au dernier étage, c’est-à-dire à un grenier situé sous les toits, il lui fut facile de trouver la chambre de la vieille femme, c’était la seule ; et plus facile encore d’y entrer, attendu que la porte était ouverte. Il aperçut d’abord trois hommes en manteaux noirs ; leurs longues épées, la plume râpée de leur chapeau, et mieux encore leurs traits durs, sévères et sans pitié, tout révélait des alguazils dans l’exercice de leurs fonctions.
— Vous n’enlèverez pas ma fille ! s’écriait la vieille femme qui la veille avait abordé Piquillo ; les cheveux gris en désordre, les yeux flamboyants, un bras tendu vers le ciel, elle brandissait de l’autre une pelle de fer qu’elle venait d’arracher du foyer et dont elle menaçait les assaillants.
Derrière elle, une femme, belle encore, mais pâle et maigre, venait de s’élancer d’un misérable grabat. Ses épaules brunes, à moitié nues, n’étaient couvertes que par ses longs cheveux noirs. Enveloppée dans une couverture de laine en lambeaux, elle se traînait à genoux, demandant grâce aux alguazils, dont un avait fait un pas vers elle et venait de la saisir par la main. À cette vue, poussant un rugissement de lionne à qui on enlève ses petits, la vieille femme avait levé sa redoutable pelle et allait en écraser la tête de l’alguazil, lorsque Piquillo parut devant la porte, semblable à ces corps d’armée qui, tombant à l’improviste sur le champ de bataille, arrivent pour décider du sort de la journée et changer la face des événements.
La pauvre femme suppliante étendit les bras vers lui ; les alguazils demeurèrent immobiles, la pelle de fer resta suspendue… tous les combattants s’arrêterent. Ce fut comme une trêve impromptue et tacite.
— Qu’est-ce, messieurs ? dit froidement Piquillo, pourquoi traiter aussi brutalement ces pauvres femmes ?
— Parce qu’elles doivent dix ducats au propriétaire de cette maison, au seigneur Pedro Diaz, corregidor de la ville de Pampelune.
On se rappelle que Josué Calzado, notre ancienne connaissance, n’exerçait plus depuis longtemps ces fonctions ; vu le rôle influent qu’il avait joué dans l’émeute des fueros, le duc de Lerma l’avait, le soir même, nommé corrégidor mayor à Tolède, et le seigneur Pedro Diaz l’avait remplacé à Pampelune sur la recommandation du duc d’Uzède, fils du premier ministre.
— Oui, seigneur cavalier, s’écria la vieille femme, c’est Pedro Diaz, le corrégidor, qui est cause de tout ! Ne pouvant le payer, nous voulions vendre jusqu’aux derniers meubles qui nous restaient de notre opulence… ceux dont ma fille ne voulait pas se séparer !
— Jamais !… jamais ! s’écria celle-ci avec désespoir, je l’ai juré…
C’étaient sa guitare et son miroir ! elle les avait gardés jusqu’à présent ; c’est moi, sa mère, poursuivit la femme avec une volubilité difficile à retenir, c’est moi qui, sans lui en parler, avais résolu de m’en défaire pour avoir du pain et payer nos loyers, et comme j’ai voulu moi-même aller les vendre… ne voilà-t-il pas que ce Pedro Diaz qui avait ses desseins, car il en a malgré ses soixante ans, ce misérable corrégidor !…
— Respect, s’écria gravement l’alguazil, respect, senora Urraca, au seigneur corrégidor !
— Je me moque de lui et de tous les corrégidors de l’Espagne, s’écria la vieille femme dans une exaltation qu’il n’y avait plus moyen d’arrêter. Nous avons vu et reçu des princes, des ducs, des grands seigneurs qui avaient d’autres tournures que ton corrégidor… qui est censé rendre la justice et qui devrait d’abord se la rendre à lui-même. Oui, seigneur cavalier, continua-t-elle en s’adressant à Piquillo… il a osé prétendre, voyant que nous allions lui échapper, que ces bijoux étaient trop beaux, trop riches pour nous appartenir, et que s’ils étaient dans nos mains, c’est que…
Sa fille poussa un cri d’indignation, et voulut s’élancer du grabat sur lequel elle s’était rejetée.
Tais-toi… tais-toi… Alliaga, lui dit sa mère en l’enveloppant de la couverture en lambeaux dont elle la drapa ; ce seigneur cavalier n’en croit rien, pas plus que ce corrégidor qui veut nous faire arrêter pour nous tenir, pendant tout le temps qu’il voudra, en prison et en son pouvoir.
— Serait-il vrai ! s’écria Piquillo.
— C’est notre ordre, dit le chef des alguazils.
— Et pendant ce temps, continua la vieille, ces Messieurs, pour payer les frais, s’empareraient de notre trésor, de la guitare de ma fille et de son miroir. Mais ils ne les auront pas, je les ai trop bien cachés pour cela.
— C’est ce que nous verrons, s’écria l’alguazil ; en attendant, seigneur cavalier, permettez-nous d’exécuter nos ordres.
— Vous me permettrez au contraire de m’y opposer, répondit Piquillo d’une voix ferme, jusqu’à ce que j’aie rendu compte de cette affaire à son excellence don Juan d’Aguilar, vice-roi de la Navarre, dont j’ai l’honneur d’être un des secrétaires.
À ce nom révéré, les trois alguazils s’inclinèrent en même temps par un mouvement de terreur rapide et sympathique.
— Comme il faut avant tout, cependant, poursuivit Piquillo, que le seigneur Pedro Diaz ait satisfaction pour ses loyers, voici les dix ducats qui lui sont dus, et un de plus pour les frais. Pour le reste, je me rends caution de ces femmes. Je vais d’abord les entendre, puis je ferai après mon rapport au vice-roi, en présence du corrégidor lui-même, s’il veut y assister… vous pouvez l’en prévenir.
Les alguazils prirent d’abord leur argent, puis saluèrent avec respect, et on entendit quelque temps encore, pendant qu’ils descendaient l’escalier, des exclamations de surprise et de joie dont le bourdonnement s’élevait et montait jusqu’à la mansarde.
C’était la première fois que Piquillo se posait comme protecteur de quelqu’un, lui qui jusqu’alors avait toujours été protégé ; c’était la première fois de sa vie qu’il connaissait le pouvoir et en usait ; nommé secrétaire d’un grand seigneur depuis une demi-heure à peine, il avait déjà fait du bien, il avait défendu un opprimé, bonheur que bien des fonctionnaires n’ont pas la chance de rencontrer pendant toute la durée de leur gestion.
Cependant la senora Urraca avait fermé soigneusement la porte, et présentait à Piquillo la seule chaise intacte qui existât dans la mansarde : elle s’assit sur le pied du lit de sa fille en lui disant :
— Puisque ce jeune seigneur veut bien nous protéger et nous défendre, dis-lui tout, mon enfant, dis-lui notre fortune, notre gloire, le rang que nous avons occupé…
Piquillo ne pouvait s’expliquer encore chez qui il était ; ces mots de gloire et de fortune contrastaient singulièrement avec l’abjection et la misère qui régnaient autour de lui. De ces deux femmes, l’une, noble et distinguée, lui inspirait, dans son malheur, une secrète compassion ; l’autre, basse et commune, lui causait une invincible répugnance.
La première avait été belle, et ne l’était plus !
À ne considérer que la régularité de ses traits, ses dents si blanches, ses yeux d’un noir velouté, et le sourire caressant qui errait encore sur ses lèvres, on ne lui eût donné que vingt-cinq ans. Mais quand on contemplait ce teint pâle, ces joues fanées et amaigries, et surtout une ou deux rides qui sillonnaient son front, il fallait supposer huit ou dix ans de plus, ou qu’alors les chagrins et non le temps avaient laissé ainsi la trace de leur passage.
Elle se souleva avec peine sur le seul matelas qui composait sa couche, et s’appuyant sur son bras, elle commença d’une voix lente et affaiblie un récit, interrompu à chaque instant par les exclamations, réflexions et lamentations de sa mère, pour qui parler était un besoin de première nécessité, et dont la loquacité était le moindre défaut.
— Mon père, Aben-Alliaga, était un des Maures qui prirent les armes dans les Alpujarras contre la tyrannie de Philippe II. C’est pendant cette guerre et au milieu des montagnes que je vins au monde, à ce que m’a dit ma mère.
— Oui… oui… s’écria Urraca, je portais mon enfant dans mes bras, et nous suivions l’armée qui, longtemps victorieuse contre le marquis de Mondejar, fut enfin vaincue par don Juan d’Autriche ; je me rappelle encore ses soldats qui ne faisaient pas de quartier, et qui nous obligeaient à nous cacher dans des rochers inaccessibles. Alliaga, mon mari, fut tué bravement à la montagne, en voulant nous défendre, et nous donner le temps de fuir… Je me sauvai à Grenade, et de là à Séville, où j’élevai mon enfant de mon mieux.
— C’est-à-dire pas du tout ! reprit sa fille. À cinq ou six ans, j’allais avec ma mère mendier dans les rues… rentrant à la maison avec ce qu’on nous avait donné, et quand on ne nous donnait rien, ne mangeant pas !
— Ah ! je connais ça ! se dit à part Piquillo.
— Je n’avais donc aucune espèce d’instruction… quant à la religion, pas davantage… ma mère n’ayant jamais su au juste si elle était maure, juive ou chrétienne !
— Ce n’est pas ma faute.
— Je ne vous en fais pas un reproche, ma mère. Mais alors, et à défaut de mieux, je me suis fait un culte à ma manière. Je pensais à mon père, le soldat, qui avait été tué pour nous, en nous défendant… Je le priais et lui demandais conseil ; rarement, quand j’étais heureuse ; beaucoup, quand j’avais du chagrin ; et depuis longtemps j’y pense toujours…
Piquillo se sentit ému, et rapprocha sa chaise du lit de la pauvre femme.
— À dix ans, continua-t-elle, il paraît que j’étais jolie.
— Charmante ! s’écria la mère avec fierté. Quelque misérables que nous fussions, seigneur cavalier, les passants s’arrêtaient dans la rue pour la regarder ; sa beauté perçait à travers ses haillons !
— Bien aisément, continua Alliaga en souriant, rien ne s’y opposait ! Un jour que j’avais bien froid et bien faim… je me mis à chanter pour passer le temps, et je m’aperçus que j’avais de la voix.
— Une voix admirable, s’écria la mère, admirable… une source de fortune ! aussi dès ce moment les maravédis commençaient à pleuvoir sur nous.
— J’allais tous les soirs au pied de la Giralda, continua sa fille, la grande tour de Séville… Vous la connaissez bien, monsieur ?
— Non, dit Piquillo.
— Ah ! c’est superbe !…
Et puis elle ajouta avec un sentiment de fierté qui contrastait singulièrement avec sa situation, c’est bâti par les Maures, nos ancêtres. Là, tous les soirs, se formait autour de moi un cercle nombreux, et quand, après avoir chanté, je faisais la quête avec mon tambour de basque, c’était à qui me jetterait une pièce de monnaie pour avoir de moi une révérence. Un jour, parmi mes auditeurs en plein air, se trouva le seigneur Esteban Andrenio, chef de la musique au grand théâtre. Il pensa sans doute que la Giralda (c’est ainsi qu’on me nommait dans Séville) était appelée à d’autres succès, et m’emmena avec lui, ainsi que ma mère.
— Certainement je ne voulais pas quitter mon enfant.
— En deux ou trois ans, il m’apprit la danse et la musique, et me forma pour le théâtre, avec des soins, une patience et une bonté que je crus longtemps désintéressés… Enfin je débutai.
— Je crois y être encore ! interrompit la mère avec exaltation. Quand ma fille parut, je manquai de me trouver mal ! je n’aurais pu donner une parole… ni une note.
— Heureusement, dit Piquillo, ce n’était pas vous qui débutiez !
— C’était elle ! c’était ma fille… mon enfant ! l’enfant que j’avais élevée et qui me payait, en un seul instant, de toute ma tendresse et de mes peines !… Quel succès ! quel triomphe ! Je croyais que la salle allait s’écrouler sous le bruit des applaudissements.
— Oui… oui… s’écria Alliaga… je fus égarée, enivrée ! Comment une pauvre jeune fille aurait-elle résisté à une pareille ovation, à de tels éloges ? C’était à en perdre la raison !
— Et le soir même, s’écria la mère avec orgueil, tous les comtes, les ducs, les grands seigneurs et le directeur du théâtre étaient dans ma loge à m’accabler de compliments ! Ils étaient tous à mes pieds, et dès ce moment la Giralda eut un traitement magnifique… trois mille ducats. Je ne la quittai pas d’un instant. Imaginez-vous, seigneur cavalier, un logement superbe ! une maison montée ! une femme de chambre ! un petit nègre pour nous accompagner au théâtre, et une table dont je faisais les honneurs.
— Alors, continua la Giralda, le seigneur Esteban Andrenio, le chef de musique, qui était la cause de ma fortune, voulut en réclamer le prix. La reconnaissance que je lui devais n’allait pas jusque-là, et je repoussai ses offres avec indignation.
— Un grand tort ! s’écria la mère avec l’air le plus grave. D’un homme dévoué qui pouvait lui être utile et lui donner des rôles, elle se faisait un ennemi mortel ! c’est une faute au théâtre ; mais les jeunes filles ne suivent que leur tête et leur caprice… elles ne veulent pas écouter leurs mères, qui ont de l’expérience et de la sagesse !
Et la senora Urraca poussa un profond soupir en ajoutant d’un air indulgent : Après cela, seigneur cavalier, il ne faut pas lui en vouloir, elle était si jeune alors… elle venait d’avoir quatorze ans !
Piquillo étonné ne comprenait plus ; habitué aux purs et chastes sentiments d’Aïxa et de Carmen, les usages et les mœurs dont on déroulait à ses yeux le tableau lui semblaient si extraordinaires, qu’il regardait si la senora Urraca parlait sérieusement.
L’excellente mère était de bonne foi, car les mères des comédiennes forment une classe à part et une maternité exceptionnelle. C’est un dévouement et un amour qu’elles entendent à leur manière, et Piquillo en écoutait le développement, non pas avec plaisir, mais avec curiosité ; semblable au voyageur qui, en quittant un beau et riant pays qu’il connait, n’est pas fâché de passer dans une région âpre, en désordre et effrayante, qui est pour lui toute nouvelle.
— Tout cela pouvait se réparer encore, continua la vertueuse mère en s’essuyant les yeux, si elle n’avait commencé par une folie… par une extravagance, une inclination de cœur… une passion ! M’a-t-elle donné assez de peine et de tourment, celle-là ! J’en pleurais jour et nuit, je voyais ma fille qui courait à sa perte !…
— Vous vouliez donc l’en empêcher ! s’écria Piquillo en rendant à la pauvre mère une partie de son estime.
— Oui, seigneur cavalier, oui ! le ciel m’en est témoin ! s’écria la senora Urraca d’un ton sévère. Je lui ai répété vingt fois :
« Tout dépend au théâtre du premier amant que l’on prend… tout notre avenir est là ; c’est par là qu’on nous juge ! »
Et si vous saviez celui qu’elle a choisi !…
— Je l’aimais, s’écria la Giralda, les yeux brillants de souvenirs, pendant que ses joues pâles se colorèrent un instant ; oui, je l’aimais, et ce fut mon premier, ce fut mon seul amour ! Il était du sang de mes ancêtres, de celui de mon père, du sang qui coule dans mes veines…
— Eh ! mon Dieu ! oui, dit la mère en soupirant, un Maure qui était riche !… mais, à quoi bon… elle ne voulut rien accepter de lui… rien !…
— Que la guitare sur laquelle je répétais ses chants arabes, et le miroir où il me trouvait si belle !
— Et, ce que vous ne croirez jamais, seigneur cavalier, s’écria la mère avec indignation, il voulait absolument la retirer du théâtre !…
— Oui… oui, dit tristement la Giralda ; j’aurais peut-être dû l’écouter ! Mais une fois, voyez-vous, qu’on a goûté de ces douceurs qui ne ressemblent à aucune autre, de cet enivrement de la scène, de ce frémissement qu’on fait naître, de ce bonheur de tenir une foule attentive et comme suspendue à ses lèvres ; quand on l’a entendue, ardente et passionnée, éclater tout à coup en cris de joie et d’admiration ; quand on est venu soi-même, à l’éclat des flambeaux, aux trépignements de la multitude, recueillir leurs bravos et leur moisson de fleurs… il n’y a plus moyen d’oublier de pareilles émotions, elles deviennent un besoin, un délire ; il faut vivre dans cette vie ou mourir !
Et la Giralda était presque redevenue belle ; sa voix sonore et accentuée s’élevait à mesure qu’elle parlait ; la couverture de laine qui la drapait à moitié laissait à ses gestes leur énergie et leur noblesse : ses yeux avaient retrouvé leur expression et lançaient des éclairs !…
Tout à coup elle s’arrêta… regarda les murs dépouillés de cette mansarde, le grabat sur lequel elle gisait étendue… Puis, ne pouvant supporter le contraste du souvenir et de la réalité, elle cacha sa tête dans ses deux mains et se prit à pleurer.
XVI.
sous les toits (Suite).
En voyant les larmes de sa fille, la vieille Urraca ne put y tenir, et se mit à sangloter ; il n’y a pas de nature plus apte à la sensibilité que celle des mères de théâtre.
— Oui, mon enfant, c’était une belle passe que la nôtre, et si tu avais toujours suivi mes avis… nous serions maintenant dans une autre position…
— Eh ! ce n’est point la richesse que je regrette, mais mon talent, ma beauté et ma jeunesse. Ah ! si le ciel pouvait me les rendre, combien j’en ferais un meilleur usage !
— Tu suivrais mes conseils, tu songerais à l’avenir ! Mais sa fille, sans l’écouter, poursuivit avec chaleur :
— Je ne perdrais pas un temps si précieux dans d’inutiles amours, dans de vaines intrigues, dans des rivalités de coulisses.
— Quand on vous attaque cependant, s’écria la mère, il faut bien se défendre, et si je n’avais pas été là… Imaginez-vous que pendant que Giralda faisait de beaux sentiments, arrivait à Séville une débutante, la petite Lazarilla. Vous en avez entendu parler ?
— Non, madame, reprit gravement Piquillo.
— C’était moins que rien, seigneur cavalier ! s’écria la vieille avec une volubilité toujours croissante ; de l’audace et de l’aplomb, mais c’est tout ! pas le moindre talent ! et voilà celle à qui on voulait faire une réputation ! Tout ça, vous comprenez bien, était un coup monté contre nous ; on nous en voulait, parce que nous étions plus jeune, plus jolie, et que nous étions adorée du public… du vrai public !
C’était le chef de musique, Esteban Andrenio, qui avait organisé cette cabale pour se venger de nos refus. Mais il s’agissait d’un rôle nouveau, d’un rôle superbe où il y avait du chant et de la danse, trois ou quatre costumes différents, sans compter les paroles ! enfin, seigneur cavalier, un rôle à effet, de ces rôles qui vous placent, et qu’on paierait de tout ce qu’on a, si on entendait ses intérêts !…
Eh bien ! ce rôle que toutes ces dames se disputaient, Lazarilla allait l’emporter…
On allait le lui donner, si nous n’avions pas mis de notre parti un des gentilshommes de la chambre, alors surintendant du théâtre… un grand seigneur !
— Oh ! s’écria la Giralda en fermant les poings avec colère, je me le reprocherai toujours !
— Eh bien ! ma chère, tu as tort… c’était de légitime défense… On fait des cabales contre nous, nous tâchons de les déjouer…… Sans compter que, par là, nous avons eu le pouvoir ! et dans les coulisses, c’est tout de régner !…
J’en ai tant vu qui avaient des amants jeunes, aimables et riches, et qui prenaient leur directeur… par-dessus le marché, rien que pour être reine et commander aux garçons de théâtre.
— Assez ! assez ! ne rappelons point ce temps-là ! s’écria avec impatience la Giralda, qui souffrait visiblement de tous les détails que sa mère retraçait avec tant de complaisance ; et, se retournant vers Piquillo :
Qu’est-il besoin de vous dire dans quel enivrement, dans quelle folie s’écoulèrent les quatre années qui suivirent ! courant de triomphe en triomphe, entourée d’adorateurs, comblée de trésors et d’hommages, tout me souriait, tout m’avait réussi, jusqu’au jour, où moi, qui n’avais eu que du talent, je m’avisai d’avoir de l’ambition !… Je ne vous accuse pas, ma mère ! dit-elle à la vieille, qui faisait un geste de douleur, mais…
Et elle s’arrêta en levant les yeux au ciel.
— Qu’avez-vous ? lui dit Piquillo en voyant ses lèvres pâles et tremblantes.
— Ne va-t-elle pas encore se désoler ! dit Urraca ; puisque nous avons fait de notre mieux, Dieu te pardonnera, car tu as toujours été bonne pour ta mère ! Dans le malheur ou dans l’opulence, tu ne l’as jamais abandonnée…
— Et mon enfant ! s’écria la Giralda avec un cri déchirant, si Dieu me demande ce que j’en ai fait, que lui répondrai-je ?… que lui répondrez-vous, ma mère, car c’est à vous que je l’avais confié ?
— Tais-toi, tais-toi !… dit la vieille femme voulant lui mettre la main sur la bouche.
— Non, je ne me tairai pas… j’ai promis de tout dire… ce sera ma punition à moi ; et, se tournant vers Piquillo :
Oui, celle qui fut bonne fille a été mauvaise mère !…
Pour que quelqu’un me consolât et me pardonnât à son tour, dit-elle en regardant sa mère, le ciel m’avait donné un enfant !
Je ne l’avais pas avoué pour mon fils, mais du moins à Séville, à Tolède, il restait près de moi… je le voyais matin et soir, et jusqu’à cinq ans, il ne m’avait pas quittée !… mais un jour…
La Giralda éclata en sanglots, et sa mère, se hâtant de prendre la parole, s’écria :
— C’est moi, c’est moi qui vous dirai tout, et vous jugerez vous-même !
À Madrid, où nous avions été appelée à débuter, vu nos succès dans les provinces, un jeune homme de haute et noble origine qui tenait à la famille des princes d’Eboli, le jeune don Alvar, irrité de nos refus, s’était épris tout à coup pour nous d’une passion insensée et légitime !…
« Oui, seigneur cavalier, il voulait nous épouser ; c’était tout naturel ! Depuis notre arrivée à Madrid, malgré nos succès, malgré notre réputation de talent et de beauté, il n’y avait rien à dire sur notre compte !… rien ! au contraire ; nous avions repoussé les offres les plus brillantes, ce qui nous avait donné, dans le monde, une renommée de vertu, et fait, au théâtre, de nouveaux ennemis !
Mais, grâce à ce mariage, je les bravai tous, continua la mère, dont il était impossible d’arrêter en ce moment les paroles, et jugez de ma joie, monsieur, d’établir enfin mon enfant d’une manière convenable… de nous allier à une famille princière, de voir la Giralda duchesse… et moi qui vous parle, moi, j’aurais été la belle-mère d’un prince d’Eboli !…
C’était inouï, étourdissant, presque impossible ; aussi je jurai que ce serait !
Don Alvar, qui avait repoussé les conseils de ses amis et les prières de sa famille, était décidé à tout braver ; rien ne pouvait l’en empêcher, qu’une découverte qui me faisait trembler !
C’était celle de notre enfant, sur lequel la famille d’Eboli avait quelques soupçons, bien qu’il passât pour notre neveu !… Mais cela ne prouvait rien, parce qu’au théâtre, comme dans les presbytères, on n’a jamais que des neveux !
De plus, la famille avait déjà reçu des lettres anonymes qui venaient de la Lazarilla, j’en suis sûre. On pouvait nier le reste ; mais cette naissance, si elle était démontrée, faisait rompre le mariage et l’illustre alliance que j’avais rêvée pour notre maison.
Je pris un parti, je quittai Madrid emmenant l’enfant avec moi, ce fut convenu avec ma fille ; mais ce que je ne lui dis pas, c’est que quand je fus bien loin, bien loin, je le déposai à la porte d’un couvent.
— Ah ! voilà notre crime ! s’écria la Giralda.
— Le mien ! répondit la mère… le mien, à moi seule ! c’était pour assurer à jamais ton bonheur, ta fortune et la paix dans ton ménage !
Et après tout, me disais-je, où est le mal que cet enfant soit recueilli dans une pieuse maison, où l’on aura soin de lui, où il recevra une éducation meilleure encore que celle que j’aurais pu lui donner !
Pouvais-je prévoir, qu’après une année entière de combats et de lutte avec sa noble famille, au moment où celle-ci allait enfin, de guerre lasse, donner son consentement, don Alvar irait se prendre de dispute avec un autre soupirant, un rival, un jeune officier des gardes wallonnes, qui, tous les soirs, venait admirer la Giralda au théâtre, pas ailleurs, seigneur cavalier, je vous le jure, au théâtre seulement.
— Eh bien ? s’écria Piquillo.
— Eh bien… ce don Alvar, comme un amoureux, comme un étourdi qu’il était… s’est laissé tuer ! Un coup d’épée bien fatal pour nous ! Laissant ma fille, la future princesse d’Eboli, veuve avant son mariage, et toute notre maison, la maison Alliaga, déshéritée de la splendeur qui l’attendait !
Je me hâtai alors d’avouer à ma fille ce que j’avais fait de son enfant, que je courus redemander au couvent et aux révérends pères à qui je l’avais confié.
— Parti, monsieur, parti ! s’écria la Giralda… Où le chercher, où le retrouver ?
— Et voilà, chaque jour, ce dont elle s’accuse, quand moi seule suis coupable.
— Non, ma mère, non, je n’aurais jamais dû me séparer de mon enfant ; mon plus grand crime n’est pas sa naissance, mais son abandon, et sa mort peut-être ! Aussi, depuis ce moment, rien ne m’a plus réussi, tout s’est tourné contre moi ; mon père lui-même ne me console plus, car depuis que j’ai abandonné mon fils, je n’ose plus le prier.
— Vous l’entendez, s’écria Urraca, vous ne lui ôteriez pas de l’idée que son père l’a maudite !
— Oui, oui, répondit la Giralda, c’est sa malédiction qui a flétri mes traits, qui m’a ôté ma beauté et jusqu’à mon talent ! alors mes richesses follement dissipées ne sont plus revenues ; alors il ne m’est plus resté que le remords, la honte et la misère ; voilà où j’en suis…
Arrivée dans cette ville, j’espérais obtenir un engagement au théâtre, c’était notre dernière ressource, par malheur, moi qui voudrais me dérober à tous les regards, j’ai attiré ceux de ce Pedro Diaz, le corrégidor | de qui nous dépendons !… il m’a empêchée de débuter… et quand la misère qui nous poursuit, quand la fièvre qui me dévore ont épuisé toutes nos ressources, il nous accuse d’avoir dérobé les seuls souvenirs qui me restent du passé, les derniers débris de notre opulence ; vous en savez l’origine, seigneur cavalier, et en les voyant, vous comprendrez que j’ai dit la vérité.
— Donnez-moi-les, ma mère, dit-elle en s’adressant à la vieille femme. Où les avez-vous serrés ?
— Pas ici, répondit Urraca, nous n’avons que cette seule chambre, où ils auraient été bien vite découverts… Je les ai confiés à notre voisine de l’étage au-dessous… je vais les chercher et je reviens.
Elle sortit, et à son départ Piquillo se sentit soulagé.
L’aspect de cette femme lui était pénible, et refoulait dans son cœur la pitié prête à s’en échapper. Resté avec Alliaga, il se leva, lui prit la main et lui dit :
— Courage ! vous n’avez rien à craindre du corrégidor, je vous le jure ! Mais j’aurais fait peu pour vous, si mes services se bornaient là. Si j’ai compris ce qui se passe dans votre cœur… Votre plus grand tourment est dans le passé !
— Oui, ce sont mes remords !… c’est l’absence de mon fils !
— Eh bien ! si, par le crédit du vice-roi, je pouvais obtenir quelques renseignements sur son compte…
Un éclair de joie brilla dans les yeux de la pauvre femme, et elle étendit vers Piquillo une main qu’elle laissa retomber soudain.
— C’est impossible ! dit-elle d’un air découragé ; comment en venir à bout ?
— Je l’ignore ; mais c’est pour cela que je vous consulte.
— Il y a déjà si longtemps… dit-elle, plus de douze ans…
— Oui, cela devient plus difficile : mais le couvent où votre mère l’avait exposé ? dans quelle partie de l’Espagne, dans quelle ville était-il ?… cela m’est nécessaire…
— Dans quelle ville… s’écria la Giralda… vous me le demandez ! Dans une ville maudite et qui devait toujours me porter malheur… Non, non, j’ai tort, reprit-elle vivement, puisque j’y trouve un protecteur aussi généreux que vous.
— Dans cette ville ? dit Piquillo.
— Oui, à Pampelune… car ma mère voulait aller jusqu’en France pour confier mon enfant à quelque berger des Pyrénées ; elle me l’avait dit du moins… mais pour mon malheur elle avait changé d’idée et s’était arrêtée ici.
— Et dans quel couvent a-t-elle déposé cet enfant ?
— Dans celui des franciscains.
— Ah ! dit Piquillo, ne sont-ce pas des moines qui ont de grandes robes blanches ?
— J’en ai souvent rencontré… ils sont ainsi.
Piquillo tressaillit et continua :
— En entrant dans le couvent, n’y avait-il pas à droite… un jardin… où était un grand cerisier ?
— Je l’ignore… pourquoi me faire ces questions ?
Piquillo ne lui répondit pas, mais il dit tout haut :
— Je suis sûr qu’autrefois il y avait un grand cerisier.
— C’est possible… mais comme vous êtes pâle, seigneur cavalier ! Et le voyant chanceler, elle voulut le retenir, et s’écria avec terreur :
— Ah ! comme vos mains sont froides !
XVII.
la famille.
En ce moment la senora Urraca rentra et referma la porte. Elle portait à la main une guitare et un miroir qu’elle posa sur le lit de sa fille.
— Tiens, les voilà… ces meubles-là sont bien à nous et nous appartiennent, dit-elle.
— Oui, dit la Giralda en les regardant avec tristesse… Voilà tout ce qui reste à la pauvre comédienne, sa guitare en souvenir de son talent ! son miroir en souvenir de sa beauté !
Elle laissa tomber ses yeux sur la glace… et jeta un cri d’effroi.
— Ah ! je ne devrais jamais la regarder… Je ne peux plus m’y voir telle que j’étais… et je n’ose m’y contempler telle que je suis…
Elle détourna la tête et repoussa la glace sur son lit, rappelant en ce moment le désespoir de Laïs, qui, consacrant son miroir à Vénus, s’écriait avec douleur :
Je le donne à Vénus, puisqu’elle est toujours belle !
Pendant ce temps, Piquillo, debout au pied du lit, était resté immobile et plongé dans ses réflexions ; il ne voyait rien, n’entendait rien de ce qui se passait autour de lui, lorsque le geste de la Giralda lui fit lever les yeux, et il aperçut le miroir…
Il éprouva un singulier effet.
Il lui semblait que ce n’était pas la première fois que ce meuble frappait ses yeux. Mille idées confuses, dont il ne pouvait se rendre compte, jaillissaient à la fois et se croisaient dans son esprit.
Soudain… poussant un cri, dont il n’est pas le maître, il saisit le miroir, appuie le doigt sur un des ornements en or du piédestal. Un ressort part, un tiroir secret apparait, et Piquillo, hors de lui, tombe pâle et tremblant sur le bord du lit.
Surprises au delà de toute expression… les deux femmes restèrent immobiles, le regardant d’abord en silence ; puis la senora Urraca lui dit :
— Vous venez de faire partir ce ressort secret, seigneur cavalier ; comment le connaissez-vous ?
— Ou comment l’avez-vous deviné ? ajouta la Giralda.
Piquillo n’avait rien deviné : il s’était rappelé !…
Quand il était petit, son grand amusement était de faire jouer ce ressort, sans compter que ce tiroir renfermait toujours des dragées ou des friandises qu’il visitait deux ou trois fois par jour.
— Seriez-vous souffrant… dit la vieille, en remarquant alors sa pâleur.
Piquillo ne répondit point ; il l’aurait essayé vainement, accablé qu’il était par le passé et par le présent !… lui, qui, plein d’ardeur et d’espérance, rêvait aux moyens de se rendre digne d’Aïxa, il en était plus loin que jamais depuis qu’il connaissait sa mère et surtout son aïeule !
Dans son désespoir, il eut un instant la pensée de s’aller tuer, sans en rien dire à ces femmes qui s’inquiéteraient aussi peu de sa mort qu’elles s’étaient souciées de sa vie… Il se leva brusquement dans ce dessein ; mais il jeta un dernier regard sur celle qui était sa mère… Il la vit pauvre, flétrie, méprisée de tous ! Il se rappela surtout qu’elle venait de donner une larme à son enfant… et il resta.
S’avançant vers elle, il lui dit :
— Ce fils que vous avez abandonné, vous y pensez donc encore ?
— Toujours ! toujours ! s’écria-t-elle… c’est le tourment de mes jours et de mes nuits !
— Je vous ai promis de vous le rendre.

qu’il écouta d’un air importun et affairé.
— Que je le voie encore avant de mourir ! qu’il vienne, qu’il vienne ! s’écria-t-elle en joignant les mains, dût-il venir, comme mon juge, m’annoncer ma condamnation et mon châtiment.
— Il viendra ! je vous le promets !
— Il existe donc ?
— Il existe et viendra vous apporter, non le châtiment, mais la consolation et l’oubli.
— Vous le connaissez donc, seigneur cavalier ?
— Je le connais.
— Et vous êtes sûr qu’il ne me maudira pas ?
Alors Piquillo, levant les yeux au ciel, s’écria :
— Il vous a déjà pardonné… et vous bénit, ma mère !…
La Giralda poussa un cri de terreur, et Piquillo étendit la main sur la coupable, qui courbait la tête devant lui.
— Fille d’Alliaga, lui dit-il, fille du brave soldat maure, vous pouvez maintenant prier votre père.
— Oui… oui, je ne l’osais plus ! je l’oserai maintenant.
— Quant à votre fils, il ne saura rien du passé… rien de ce que vous avez raconté à l’étranger… Il ne se rappellera qu’une chose, c’est que vous êtes sa mère !
Alors la Giralda éperdue, attendrie, se jeta à ses pieds qu’elle baigna de ses larmes, et quand il l’eut relevée et serrée dans ses bras, ses sanglots étouffèrent sa voix ! Elle ne pouvait que répéter : Mon fils… mon fils… Elle ne se lassait pas de le regarder… de l’admirer, de le couvrir de ses baisers en s’écriant : Que je meure maintenant, j’ai revu mon fils… mon fils m’a pardonné !
— Et moi, dit timidement la vieille femme, qui jusque-là s’était tenue dans un coin, à l’écart, et que tout le monde semblait oublier.
— Vous ! ma grand’mère !… lui dit Piquillo avec bonté…
À ce nom, la pauvre femme tressaillit de joie.
— Il faut bien aussi ne plus vous en vouloir, puisque tout ce que vous avez fait, dites-vous, était pour mon bien, pour me donner une meilleure éducation… et je commence à croire que vous aviez raison. Ah ! si vous aviez été heureuse… et opulente, c’eût été différent : j’aurais renoncé à la succession… mais vous êtes dans la misère, vous avez besoin de moi… vous êtes de la famille… asseyez-vous donc, ma grand’mère, et causons de nos affaires.

Urraca, enchantée, avait déjà repris son insouciance et sa gaieté.
Quant à la Giralda, elle ne parlait pas… mais elle regardait son fils, et ne quittait point sa main, qu’elle tenait serrée dans les siennes.
— Ma mère, dit Piquillo, je ne suis pas bien avancé, car, d’aujourd’hui seulement, je commençais ma fortune ! j’étais décidé à travailler pour moi !… je travaillerai pour deux !
En entendant un soupir que venait de pousser la senora Urraca, il ajouta en la regardant :
— Pour trois !…
La vieille femme reprit son air serein et écouta son petit-fils, qui continua en ces termes :
— Je n’ai rien ! pas un maravédis de rente… mais j’ai une bonne place, des amis dévoués…
Et il donna en lui-même un regret et un soupir à Aïxa.
— J’ai de plus un protecteur puissant, le vice-roi de Pampelune, don Juan d’Aguilar, qui, j’en suis sûr, me poussera dans le monde, et comme j’ai du courage, de l’ardeur, de l’éducation et des talents, je compte bien faire mon chemin ; je ne parlerai pas de vous à mes protecteurs… cela ne servirait ni à vous ni à moi… mais il est une chose que je vous demanderai, parce qu’elle peut grandement influer sur ma fortune, sur mon avenir, et par conséquent sur le vôtre, ma mère, dit-il en regardant la Giralda : Quel est mon père ?
À cette question si naturelle et si simple, les deux femmes restèrent interdites, se regardant toutes les deux avec inquiétude.
— Ma mère, reprit Piquillo, étonné de ce qu’il allait apprendre… je ne vous demande que son nom… pas autre chose… mais j’attends de vous la vérité… j’ai le droit de l’exiger, et je la demande.
Voyant qu’elle baissait les yeux et continuait à garder le silence, il reprit d’un ton plus ferme :
— Quel qu’il soit, je veux le connaître ! parlez, quel est mon père ?
Alors, courbée par la honte, se tordant les mains de désespoir, et n’osant lever les yeux vers lui… elle lui dit à voix basse :
— Je n’en sais rien !
Et elle tomba à genoux, la tête cachée dans ses mains.
— Et moi, je vais vous dire la vérité ! s’écria Urraca. Lorsqu’elle aimait ce Maure, son premier amour, pour enlever un rôle à Lazarilla, elle écouta les vœux d’un gentilhomme de la chambre, du surintendant du théâtre… c’est lui !… c’est ce grand seigneur…
— Taisez-vous, ma mère… taisez-vous ! s’écria la Giralda en se relevant ; que la faute que vous m’avez fait commettre retombe sur moi… puisque j’ai écouté vos conseils et puisque je les ai suivis !…
Pour être tardive, la punition n’a pas manqué, elle est arrivée… el je ne crois pas qu’on puisse inventer de supplice pareil à celui que je viens de subir… l’infamie infligée à une mère devant son enfant !…
Mais rassure-toi, dit-elle à Piquillo… en portant la main à son cœur… je sens que j’en mourrai… c’est le dernier coup !… c’est tout ce que je peux faire pour toi ; ma mort sera le dernier, ou plutôt le seul bienfait que tu auras reçu de moi… mon fils ! Mais, s’écria-t-elle tout à coup, comme inspirée par une idée soudaine, si auparavant Dieu avait pitié de moi… s’il m’éclairait… s’il me guidait…
Alors elle regarda quelque temps avec attention son fils… cherchant à lire la vérité dans ses yeux… à la deviner dans ses traits, interrogeant ses moindres gestes, étudiant cette physionomie qu’elle connaissait à peine ; puis indécise, éperdue, et ne pouvant sortir de ce doute horrible, elle s’écria de nouveau avec désespoir :
— Je ne veux pas le tromper, je ne sais rien… je ne sais rien ! Maudis-moi, mon fils, maudis-moi… car je ne puis te dire quel sang coule dans tes veines. Mais écoute-moi : celui qui méprisera le moins ta mère… celui qui ne te repoussera pas… celui qui aura pour toi le cœur et l’amitié d’un père… c’est celui-là et non pas moi qu’il faut croire ! c’est celui-là qu’il faut aimer ! — Ma mère… ma mère, s’écria-t-elle, donnez-moi du papier et de l’encre.
— Que veux-tu faire ?
— Que vous importe ?… donnez… donnez, pendant que cette fièvre soutient et redouble encore mes forces.
Et, courbée sur son lit, elle écrivit, oppressée et haletante.
— Tiens, mon fils, lui dit-elle, que Dieu te conduise et veille sur toi… voilà tout ce que je peux faire pour ta fortune et ton avenir… voilà la seule main qui puisse, à présent, te protéger !
Et elle lui remit une lettre.
— Je t’envoie bien loin, continua-t-elle, à Madrid ! et il faut partir à l’instant… car je veux avoir la réponse, et si tu tardais… elle ne me trouverait plus, je le sens !… Porte cette lettre toi-même, il le faut… c’est mon seul espoir… me le promets-tu ?
— Oui, ma mère ! Mais avant mon départ… je vous verrai… je veillerai à ce que rien ne vous manque.
— Ah ! peu importe ! Mais tu m’embrasseras, n’est-ce pas ?
— Oui… oui… je vous le jure !
Et s’arrachant avec peine aux caresses de sa mère, Piquillo descendit l’escalier, tout étourdi de ce qu’il venait de voir et d’entendre, et ne sachant pas s’il était encore sous l’empire d’un bon ou d’un mauvais rêve.
Arrivé dans la rue, il regarda la lettre que sa mère venait de lui remettre ; elle portait sur l’adresse ces mots :
« À monseigneur le duc d’Uzède, En son hôtel, à Madrid. »
XVIII.
la recherche d’un père.
En arrivant à l’hôtel du vice-roi, en entrant dans le salon, où il aperçut Aïxa et Carmen, Piquillo sentit, à la vue de ces deux jeunes filles, comme un air pur et léger qui rafraichissait sa poitrine oppressée ; il respirait plus librement, il lui semblait renaître !
Le souvenir et les impressions pénibles de la mansarde s’effaçaient devant le riant tableau qui s’offrait à lui. Carmen, assise entre son père et son cousin, regardait celui-ci avec une expression de plaisir qu’elle ne prenait pas la peine de cacher, et don Juan, plus heureux encore, répétait avec joie à son neveu :
— Eh bien, que dis-tu de ta fiancée ? Avais-je tort de te la vanter ? C’est la plus jolie fille de la Navarre… je m’en vante ! Je te l’ai gardée jusqu’ici ; mais maintenant conseille au duc de Lerma de fuir la guerre de Flandre pour que tu n’aies plus à y retourner, et viens vite m’aider à défendre ta femme, sinon nos gentilshommes de Pampelune te l’enlèveront.
Fernand répondait avec une vive et franche affection aux bruyants transports de son oncle et aux regards plus timides, mais non moins tendres, de sa cousine ; et cependant un observateur adroit et intéressé aurait remarqué que, de temps en temps, même quand il parlait le plus vivement à Carmen, ses regards étaient distraits ou préoccupés, et se portaient, malgré lui, vers un coin du salon qui était toujours le même : c’était celui où Aïxa travaillait à une broderie.
C’est dans ce moment, et lorsqu’à peine la famille venait de sortir de table, que Piquillo se présenta dans le salon.
— Ah ! monsieur le secrétaire ! s’écria Aïxa en riant : combien sa place lui a déjà donné d’aplomb et de gravité ! il n’est plus reconnaissable !
Puis avec l’instinct de l’amitié elle s’aperçut à l’instant que la gravité de Piquillo était de la tristesse, et son regard lui demanda : Qu’avez-vous ?
— Monseigneur, dit Piquillo en s’inclinant devant le vice-roi, Votre Excellence va me trouver bien ingrat de lui demander un congé le jour même de mon entrée en fonctions, mais il faut qu’à l’instant même je parte pour Madrid.
— Vous, Piquillo ! dirent les jeunes filles.
— Tout le monde part donc pour Madrid ! s’écria Carmen en jetant un regard sur son cousin.
— Et pourquoi donc ? lui demanda gravement d’Aguilar.
— Pourquoi ? répétèrent les jeunes filles.
— Pour des affaires importantes qui ne me regardent pas seul, et dont je vous demande la permission de ne pas vous parler encore ; mais je vous supplie de vouloir bien m’accorder un congé… huit jours seulement.
— Prends-en quinze.
— Ah ! je n’en demande pas tant ! s’écria vivement Piquillo en jetant, malgré lui, un regard sur Aïxa ; mais il faut que je parte à l’instant.
— N’est-ce que cela ? dit en s’avançant don Fernand d’Albayda : si le secrétaire de mon oncle veut accepter une place dans ma voiture, je le conduirai à Madrid.
— En vérité ! s’écria Piquillo étonné, en balbutiant un remercîment.
— Vous ne me devez aucune reconnaissance, répondit Fernand avec une franchise toute militaire ; vous êtes un ami, un enfant de la maison, je parlerai avec vous, en route, de mon oncle, de ma cousine, de tout ce que j’aime. Je ne croirai pas les avoir quittés, et nous voyagerons en famille.
Don Juan lui serra la main, et Carmen le remercia d’un sourire.
— Par exemple, continua Fernand, je ne vous donne qu’une heure pour vos préparatifs ; ainsi donc, ici, à midi précis.
— J’aurai cet honneur, dit Piquillo en s’inclinant. Et don Juan entraîna hors du salon Fernand et sa fille.
Aïxa, demeurée seule avec Piquillo, n’avait pas encore ouvert la bouche ; mais déjà son regard avait demandé : Qu’est-ce que cela veut dire ? et Piquillo se hâtait de répondre :
— Ne me demandez rien ! c’est le seul secret que j’aurai pour vous. Si je réussis, je vous dirai tout : si je dois échouer, permettez-moi le silence, dans l’intérêt même de mon amour-propre. Croyez seulement que je n’oublierai jamais vos conseils, et que, quoi qu’il arrive, je resterai digne de votre amitié.
Elle réfléchit un instant et dit :
— C’est juste ! vous avez vos secrets, comme j’ai les miens. Je n’ai pas le droit d’insister ; mais ce voyage ne peut-il vous offrir des dangers ?
— Aucun avec don Fernand.
— Il ne restera pas sans cesse avec vous, et si je connaissais ceux avec qui vous aurez affaire, si je pouvais vous éclairer sur eux…
— Tenez, dit Piquillo en lui montrant la lettre que lui avait remise la Giralda, connaissez-vous ce nom ?
— Comment, dit-elle en souriant, vous êtes déjà en relation, vous, Piquillo, avec le duc d’Uzède… le fils du premier ministre ?
— Est-il possible ! s’écria Piquillo étonné. Est-ce que le fils du premier ministre a été autrefois surintendant des théâtres ?
— Il l’est encore. C’est une place où il n’y a rien à faire, et qui, dit-on, l’occupe beaucoup.
— Et le duc d’Uzède !… s’écria Piquillo avec un sentiment de joie et d’espérance, qu’il ne pouvait cacher et qui lui faisait battre le cœur… le duc d’Uzède est le fils du premier ministre ?
— C’est ce que tout le monde sait… excepté vous.
— Quel âge a donc ce duc d’Uzède ?
— Pas encore quarante ans, à ce que je crois.
— Et le duc de Lerma ?
— Soixante-cinq.
— C’est bien cela !… se dit Piquillo à part ; ainsi donc, si le duc d’Uzède est mon père… je suis le petit-fils du premier ministre ! Et son émotion fut si vive qu’il en changea de couleur ; mais il faut rendre justice au pauvre Piquillo, pas un grain d’ambition ne lui avait monté à la tête… il n’avait pensé qu’à la seule Aïxa !
— Vous irez donc à la cour ? lui dit celle-ci avec curiosité.
— Peut-être ! si je réussis… ce que je ne puis dire.
— Je ne vous demande pas votre secret ; mais quand on va à la cour, il faut y faire figure, et je suis justement chargée par don Juan d’Aguilar d’une commission qui vient bien à propos… ces deux cents ducats qu’il m’a dit de vous remettre d’avance et à titre de gratification.
— Il n’avait dit ce matin que cent ducats, reprit Piquillo étonné.
— Oui, mais depuis et à l’occasion du mariage de sa fille…
— Ah ! Carmen se marie ?
— Elle épouse Fernand, son cousin, c’est décidé, si, comme on l’espère, on fait la paix avec les Pays-Bas, et dès que Fernand aura porté à Madrid les dépêches de Spinola, dont il était porteur pour le duc de Lerma ; car vous n’êtes pas le seul, Piquillo, continua-t-elle en souriant, qui ayez de graves intérêts à traiter avec la famille du duc de Lerma… Prenez donc, lui dit-elle.
Et elle lui offrit une bourse verte brodée par elle, qui contenait deux cents ducats en or.
— C’est trop ! c’est trop !… s’écria le jeune homme ; don Juan est trop généreux ! me payer ainsi !… lui qui n’a pas de fortune !
— Il a sa vanité de vice-roi de Navarre, et il veut que son secrétaire représente dignement ; faites donc vite vos dispositions, les emplettes nécessaires, et que rien ne vous manque ! Il faut que vous soyez bien ; vous allez voyager avec don Fernand d’Albayda, un des premiers barons du royaume de Valence.
— Qui me parait charmant.
— Je l’ai à peine vu… et ne le connais pas ; mais, dans l’intérêt même de Carmen, vous qui allez le voir de près et voyager avec lui, étudiez-le et écrivez-nous ce que vous en penserez.
— Vous me permettez donc de vous écrire ?
— Je croyais vous l’avoir demandé !
— Vos amis, quand ils sont loin de vous, dit Piquillo avec émotion, sont donc toujours vos amis ?
— Bien plus encore ! Dans ce cas là, monsieur, la distance rapproche ! pour moi du moins !
Et elle lui tendit sa main, qu’il porta à ses lèvres.
Ivre de joie, d’espérance et d’amour, il se précipita hors du palais.
Mais son bonheur ne lui avait pas fait tout oublier ; quand on est heureux, on pense volontiers à sa mère ; quand on est malheureux, toujours !
Il courut chez le corrégidor mayor qui, craignant que l’affaire ne vint aux oreilles du vice-roi, promit de ne plus inquiéter la Giralda.
Pour plus de sûreté, et ne se fiant qu’à moitié à sa parole, Piquillo vit le premier secrétaire de don Juan d’Aguilar et lui recommanda de surveiller cette affaire en son absence…
Dans ses courses, il avait remarqué, plusieurs fois, derrière la rue de la Taconnera, une petite maison simple et très-propre, habitée par une dame, veuve d’un capitaine tué en Flandre, à la bataille de Newport ; elle tenait à loyer des appartements tout meublés ; Piquillo choisit, au second, trois pièces chaudes, commodes, élégamment arrangées ; de bons tapis, de bons lits, un aspect riant, des fenêtres donnant au midi, pour que les rayons du soleil vinssent ranimer un corps languissant et égayer une âme malade.
Il paya d’avance cet appartement au nom de la senora Alliaga, qui, dans une demi-heure, allait venir l’habiter.
Tout cela avait été fait rapidement, à la hâte, il n’avait qu’une heure devant lui ; et puis, d’un pied leste et le cœur joyeux, il franchit les cinq étages qui conduisaient à l’ignoble mansarde, et embrassant la Giralda :
— Ma mère, lui dit-il, je vais partir et suivre vos ordres. D’ici à mon retour vous n’avez rien à craindre ; mes amis veillent sur vous… mais il vous faut abandonner ces lieux ; je ne veux pas vous y laisser. Venez, suivez-moi, ainsi que la senora Urraca.
— Où me conduis-tu, mon enfant ? disait la pauvre mère, heureuse et fière de s’appuyer sur le bras de son fils.
Ils arrivèrent à la petite maison, où un bon lit et un bon feu avaient déjà été préparés.
— Vous êtes chez vous, ma mère, lui dit-il.
La Giralda regarda autour d’elle, et à l’aspect de ce bien-être qui l’entourait et auquel elle n’était pas habituée depuis longtemps, un éclair de joie brilla sur sa figure, qui bientôt se rembrunit.
— Il nous donne un asile, murmura-t-elle à voix basse, nous qui l’avons exposé dans la rue, à la porte d’un couvent ! Il vient d’allumer pour nous ce bon feu qui nous réchauffe et qui pétille, nous qui l’avons laissé au froid, à la pluie, et tendant ses mains transies vers sa mère qui ne l’entendait pas !
Et elle tomba à genoux en sanglotant : Pardon ! pardon ! mon fils !
— Allons, ma mère, à quoi pensez-vous là ? Le passé n’existe plus, ne songeons qu’au présent. Bonnes ou mauvaises, nous partagerons désormais toutes nos chances. Voici aujourd’hui ma fortune, dit-il en tirant de sa poche la bourse qu’Aïxa venait de lui donner. Je n’ai jamais été si riche : deux cents ducats en or ! la moitié pour vous !
Et malgré les supplications de la Giralda, qui ne voulait pas accepter, il jeta l’or sur la table, embrassa sa mère et s’arracha de ses bras en criant : Adieu ! adieu !… l’on m’attend !
En effet, quand il arriva, les chevaux étaient attelés dans la cour du palais. Le vice-roi et les jeunes filles étaient sur le perron.
Fernand, ému et troublé, venait d’adresser à Aïxa un salut plein de grâce et de noblesse. Don Juan d’Aguilar venait de presser son neveu contre son cœur ; puis, lui jetant sa fille entre les bras :
— Embrasse-la, dit-il, embrasse ta femme !
La pauvre Carmen, fraîche et vermeille comme une rose, cherchait en vain à se dégager. Elle y réussit bien mal, car, dans cette espèce de lutte qui rapprochait les deux jeunes gens, leurs lèvres se rencontrèrent, et le père s’écria :
— Maintenant, fiancés pour toujours !
— Pour toujours ! dit Carmen.
Serment que ne murmurèrent point ses lèvres, mais que son cœur répéta.
Fernand fit monter en voiture son jeune compagnon de voyage, qui, de loin, adressa un dernier adieu aux jeunes filles, et bientôt la chaise de poste roula rapidement dans les rues de Pampelune, et de là dans la campagne.
Ils avaient quatre-vingt-deux lieues à faire pour arriver à Madrid, et Fernand avait de plus à regagner les quatre ou cinq heures qu’il venait de donner à sa famille.
Mais on va vite quand on paie bien, et Fernand jetait l’or sur la route ; aussi, dès le soir même, les voyageurs avaient franchi Estella, la Guardia, traversé l’Èbre, et ils continuèrent à courir toute la nuit.
Il était difficile de ne pas aimer Fernand d’Albayda.
Au bout de quelques minutes on avait fait connaissance avec lui, et dès qu’on le connaissait, on ne pouvait se lasser d’admirer sa franchise et sa loyauté, son aimable et joyeux caractère ; une si grande fortune, exempte de fierté ; une noblesse si haute et en même temps si simple et si affable, ne descendant pas, mais élevant par la bienveillance tout le monde jusqu’à lui.
Ajoutez à cela l’insouciance que donnent la jeunesse et l’état militaire, et l’on comprendra comment, à l’armée, Fernand était adoré de ses soldats et de ses camarades, et comment, dans ses immenses domaines, il était béni de ses vassaux.
Quant à sa position à la cour, nous avons vu, la première fois qu’il avait eu entrée au conseil du roi, avec quel courage il avait fait entendre la vérité et pris la défense du malheur.
Cela lui avait valu, il est vrai, quelques semaines de prison ; mais il en était sorti capitaine au régiment de la Reine, et depuis, malgré des ennemis puissants, son avancement, comme il le disait lui-même, avait été glorieux et rapide. Il avait même, à sa grande surprise, été appuyé en secret près du marquis de Spinola, son général, par une main inconnue et protectrice qu’il n’avait pu deviner.
Yézid avait gardé le secret de la reine, et d’ailleurs Fernand, pendant les cinq ou six ans qu’il avait passés à se battre dans les Pays-Bas, n’avait pu voir son ami.
Rien ne rend expansif et communicatif comme le grand air, la grande route et le mouvement rapide d’une bonne chaise de poste.
Déjà, vingt fois, Fernand avait interrogé son compagnon de voyage, qui, timide et réservé d’abord, avait compris que le respect et la modestie ne doivent pas empêcher de se montrer aimable et instruit quand on l’est, et il l’était beaucoup. Aussi, au bout d’une demi-heure, Fernand, charmé de sa conversation, s’écria :
— Par saint Yago ! nous autres militaires, nous ne savons pas grand’chose, mais, en revanche, nous autres nobles, nous ne savons rien ! Et c’est dommage ; il y aurait du plaisir à s’instruire, si on avait le temps ; et dites-moi, mon jeune ami, s’il est vrai que vous ne soyez jamais sorti de la maison de mon oncle d’Aguilar, brave militaire, qui n’est pas non plus un grand savant, où diable avez-vous appris tout cela ? car je crois, Dieu me pardonne, que vous en remontreriez à un bénédictin !
Alors Piquillo, souriant, se mit à lui dire, avec toute la candeur et la franchise de son âme, comment il était entré dans la maison d’Aguilar, en qualité de page, sous les ordres de maître Pablo, le majordome, et comment il en sortait avec du mérite, grâce à deux Jeunes filles, Aïxa et Carmen.
Il raconta sans rougir et avec toute la fierté de la reconnaissance tout ce qu’il devait à leurs bontés et à leurs bienfaits.
Fernand, touché et attendri, ne se lassait point d’entendre ces détails ; c’était une occasion toute naturelle de parler de Carmen et même d’Aïxa par occasion.
Une fois sur ce chapitre, Piquillo ne se lassait point de raconter, et Fernand d’écouter.
Dans le peu d’instants qu’il avait contemplé Aïxa, il s’était dit qu’il n’avait jamais rencontré de figure plus belle, plus séduisante, et à mesure qu’il entendait Piquillo, il se répétait : Je m’étais trompé ; sa beauté n’est rien auprès de son âme !
On juge alors que la conversation ne languissait pas, et à la nuit seulement nos voyageurs, qui gravissaient alors une haute montagne, cessèrent de parler et s’endormirent, bercés par le chant monotone des postillons, par le balancement de la voiture et par la marche lente et mesurée des mules, qui, dans cette partie de la route, étaient forcées d’aller au pas.
Le jour commençait à peine à paraître. Piquillo, réveillé par un cahot, regarda autour de lui ; il se frotta les yeux, et crut dormir encore… Il était sous le pouvoir d’un songe terrible qui le faisait reculer de six ou sept ans dans sa vie. Un frisson involontaire parcourut ses veines ; il regarda de nouveau.
Ce site, ce paysage, ce carrefour de la forêt, lui étaient trop bien connus pour qu’il lui fût possible de jamais l’oublier. Tout à coup, à sa droite, presque au bord de la route, se dressa près de lui comme un immense géant aux formes colossales, aux bras noirs et décharnés.
C’était un chêne qu’il était difficile de ne pas remarquer ; seul au milieu de tous les autres arbres qui l’entouraient, il était sans verdure et sans feuillage ; une partie de son tronc et de ses branches avait été calcinée ; le feu avait commencé l’œuvre de sa destruction, et le temps l’avait achevée.
À l’aspect de ce lieu qui, pour un instant, lui rendit présentes toutes les angoisses qu’il y avait éprouvées, Piquillo poussa un cri, et Fernand s’éveilla.
— Qu’est-ce ? qu’y a-t-il ?
— Ce chêne ! vous ne voyez pas ?
— Un arbre frappé de la foudre ; il était assez élevé pour cela ?
— Oui, vous avez raison, et je ne sais pourquoi…
— Eh bien ?
— Cette rencontre sinistre me semble de mauvais augure.
— Allons donc !… à vous… un savant !
— Où sommes-nous donc ici ?
— Dans la sierra d’Oca ou dans celle de Moncayo. C’est une longue chaine de montagnes situées au delà de l’Èbre et qu’il faut franchir pour aller à Madrid, quand on vient des provinces basques, ou, comme nous, de la Navarre.
— C’est juste ! vous voyez que, de nous deux, en ce moment, le plus instruit c’est vous.
— Oui, savant… comme un postillon ! J’ai fait tant de fois cette route, mais pas toujours aussi tranquillement qu’aujourd’hui. Tenez, tenez, dit-il vivement à Piquillo en lui pressant le bras, ne voyez-vous pas là-bas à gauche, au milieu des halliers, le toit ruiné d’une hôtellerie ?
Postillon, pas si vite ; mets tes mules au pas. Vous ne connaissez pas cette masure ? continua-t-il en s’adressant à Piquillo.
Piquillo ne la connaissait que trop bien ; c’était la posada du capitaine Juan-Baptista Balseiro, le berceau de son enfance, le séjour où il avait été en partie élevé, et cette fois il ne lui vint pas à l’idée de raconter à don Fernand l’éducation qu’il y avait reçue.
Il venait de retrouver la petite allée qui s’enfonçait dans le bois et par laquelle il avait voulu tenter sa première promenade. Ces murs ruinés lui rappelaient les scènes dont il avait été le témoin, presque le complice, et il se sentait couvert d’une sueur froide, pendant que don Fernand poursuivait son récit :
— Vous voyez cette masure… elle a soutenu un siége contre moi, il y a sept ans à peu près, lorsque j’avais l’honneur d’être capitaine au régiment de la Reine. La place était défendue par d’intrépides bandits, qui se battaient en désespérés. Ils nous avaient même blessé quelques soldats, et moi, qui commandais les opérations du siége, voyant qu’il traînait en longueur, je fis mettre le feu à cette bicoque, et nous tirâmes alors à notre aise sur les bandits qui tentaient de s’échapper.
C’est de la besogne que nous avons épargnée à la justice, qui peut-être du reste ne l’aurait pas faite ! Voilà l’histoire de mon expédition dans la sierra d’Oca.
Postillon… va maintenant plus vite et rattrape-nous le temps perdu.
La voiture continua à rouler, et Piquillo, plongé dans ses réflexions, se mit à comparer le passé au présent, ce qu’il aurait pu être et ce qu’il était ; il n’y voyait que des raisons de bénir la Providence.
Il venait de faire, il est vrai, une pénible découverte, et le fils de la Giralda, le petit-fils surtout de la senora Urraca, n’avait pas à remercier le ciel de sa naissance ; mais, d’un autre côté, il était probablement le fils du duc d’Uzède, le petit-fils du duc de Lerma !
L’illustration et l’éclat de la branche paternelle pouvaient balancer les inconvénients de la ligne maternelle, et, tout compensé on pouvait s’arrêter, dans ces deux extrémités de l’échelle sociale, à un juste milieu qui composait une naissance fort honorable.
D’ailleurs, l’histoire, qu’il avait lue tant de fois et qu’il connaissait si bien, ne lui offrait-elle pas à chaque instant l’exemple de bâtards adoptés par leur noble famille et qui en devenaient l’honneur ? Des deux fils de Charles-Quint, don Juan d’Autriche n’était-il pas plus illustre que son frère Philippe II, qui n’était que roi !
Ainsi donc, lui, Piquillo, pouvait se rendre digne d’Aïxa. La naissance n’était plus un obstacle, et le jeune voyageur, ravi, plein d’illusions, acheva sa route sous l’empire de ses rêves et de ses châteaux en Espagne.
C’était l’occasion ou jamais d’en faire… il était dans le pays.
Ils arrivèrent le lendemain au soir à Madrid. Fernand lui offrit un logis chez lui, dans son hôtel, en lui disant, avec cet air de bonté et de franchise qui force les gens à accepter :
— En quoi puis-je vous être utile ? que puis-je faire pour vous ?
— J’aurais besoin d’un protecteur et d’un appui auprès du duc d’Uzède.
— Ah ! répondit Fernand en soupirant, je ne puis de ce côté-là vous aider en rien. Je suis brouillé avec le duc, et la moindre protection de ma part vous serait plus nuisible qu’utile. Du reste, disposez de ma maison et de ma bourse comme vôtres.
Piquillo s’inclina en le remerciant.
— Un mot encore, lui dit Fernand en riant ; ma jolie cousine, la senora Aïxa et mon oncle lui-même, ne vous appellent jamais que Piquillo, c’est un nom d’amitié… dont peut-être déjà, ajouta-t-il d’un air gracieux, j’aurais, comme eux, le droit de me servir ; mais pour ceux qui nous entendraient, un autre nom serait plus convenable ; veuillez me dire quel est le vôtre.
Piquillo n’avait jamais pensé à une demande aussi simple. Il fallait pourtant y répondre, et sur-le-champ.
Il ne pouvait se dire de la famille d’Uzède ; sa généalogie de ce côté-là était encore trop incertaine.
Mais il était sûr du moins d’être le fils de sa mère ; il n’y avait malheureusement pour lui aucun doute de ce côté, et, pensant à son aïeul maternel, au brave soldat tué dans les Alpujarras en défendant sa religion et sa liberté, il dit à don Fernand :
— Mon nom est Alliaga !
— Eh bien ! senor Piquillo Alliaga, répondit Fernand en lui tendant la main, en tout temps et en tous lieux comptez sur mon amitié.
Fernand s’habilla à la hâte, courut chez le duc de Lerma lui porter ses dépêches, et répondre à toutes les questions qu’on allait sans doute lui adresser.
Quant à Piquillo Alliaga, il se fit enseigner l’hôtel du duc d’Uzède, et s’y rendit.
XIX.
l’hôtel d’uzède à madrid.
Le duc d’Uzède habitait à Madrid, dans la rue Fuen Carral, un palais vaste plutôt qu’élégant.
Il ne demeurait point avec le duc de Lerma, son père ; il avait son habitation, sa cour, ses flatteurs, et peut-être même déjà ses projets particuliers.
Immensément riche, il passait pour avare. Il est vrai que tout le monde eût paru tel, auprès du duc de Lerma. Il n’en menait pas moins un grand état de maison, et Piquillo, déjà troublé le fut bien plus, quand il vit sous le vestibule du palais cette masse d’officiers, de pages, de laquais et de gens de toutes, les conditions, l’air humble, respectueux et le chapeau bas, quoiqu’il n’y eût encore personne à saluer.
Piquillo demanda d’une voix timide à un homme, galonné sur toutes les coutures et tenant à la main une hallebarde, s’il n’y aurait pas moyen d’arriver jusqu’à Son Excellence.
Le heiduque, la tête haute et l’air insolent, frappa de sa hallebarde le marbre du pavé, toussa d’un air de protection, et répondit :
— Monseigneur le duc d’Uzède n’y est pas.
— Je reviendrai, répondit Piquillo.
Il retourna à l’hôtel de don Fernand d’Albayda.
Ce dernier, après une conférence d’une demi-heure ; avec le premier ministre, était parti brusquement pour Valladolid, où la cour se trouvait en ce moment ; mais il avait ordonné à son hôtel, avant son départ, que le senor Alliaga fût traité en son absence comme lui-même.
Le senor Alliaga, seul dans ce bel hôtel et en proie à une tristesse qu’il ne pouvait vaincre, eut recours à son appui, à sa consolation : il écrivit à Aïxa. Il lui raconta tous les détails de son voyage, et lui dépeignit don Fernand d’Albayda comme il le voyait lui-même.
C’était son héros, son Dieu ; le plus aimable, le plus charmant cavalier qu’il eût jamais vu ou imaginé, car l’imagination était chez lui la moitié de sa vie.
Il finissait en vantant le bonheur de Carmen et la tendresse de son père, qui lui avait choisi l’époux le plus adorable et le plus accompli.
Il lui parlait aussi de l’admiration que don Fernand professait pour elle, admiration qui était, selon lui, la preuve la plus évidente de son esprit, de son tact et de son bon goût.
Le lendemain, et de bien meilleure heure, Piquillo se rendit chez le duc d’Uzède.
On lui répondit qu’il était sorti.
Il revint à l’hôtel, et, désolé de l’absence de Fernand d’Albayda, dont les conseils auraient pu lui être si utiles, il écrivit encore à Aïxa, lui parlant d’elle toujours, de son ami Fernand beaucoup, de lui Piquillo très-peu ; car, avant d’avoir réussi, il ne voulait avouer à personne ses folles espérances.
Il retourna, le lendemain, au milieu de la journée, à l’hôtel d’Uzède. On venait d’ouvrir les deux battants de la grille dorée, et le carrosse du duc roulait sous la voûte du vestibule, ramenant son maître.
Piquillo tressaillit de joie, et se dit : Aïxa avait raison, on ne réussit que par le courage et la patience, surtout à la cour. Enfin, je vais donc voir le duc.
Il se présenta au suisse galonné.
— Son Excellence monseigneur le duc d’Uzède ?
— Il est sorti.
— Vous voulez dire rentré.
— Sorti.
— Je viens de le voir rentrer…
— Pas pour vous, mon jeune seigneur.
— Et pourquoi ?
— Parce qu’il n’est pas visible.
— Comment donc peut-on le voir ?
— En lui demandant une audience.
— Il fallait donc le dire.
Piquillo rentra à l’hôtel, écrivit une demande d’audience ; puis il écrivit à Aïxa, il écrivit à sa mère, il écrivit à tout le monde. Il porta lui-même la lettre au palais du duc, pour être bien certain qu’elle lui serait remise, et demanda quand il aurait réponse.
— Dans huit jours.
— Ah ! mon Dieu !
— Peut-être plus tard ; cela dépendra des occupations de monseigneur.
Il s’éloigna désespéré, mais qu’y faire ? attendre !
Il ne pouvait pas, quoiqu’il en eût bien envie, écrire toute la journée à Aïxa. Ce pouvait être ennuyeux pour elle et dangereux pour lui.
L’amitié vous entraine si loin… surtout l’amitié écrite ! Quand on est seul avec son cœur et son imagination, quand on n’a pas devant soi une belle personne qui vous intimide et vous fait balbutier, deux grands yeux noirs qui vous troublent et vous arrêtent, on n’a plus peur, et c’est effrayant… pour ce qu’on va dire.
Piquillo, pour tuer le temps, prit donc le parti de parcourir Madrid, qu’il ne connaissait pas, et qui valait bien la peine d’être visité. Que le lecteur ne s’effraie pas, je n’aime pas les descriptions, et pour en faire, Piquillo n’avait pas le temps ; à peine avait-il celui de regarder ; car, même au milieu de Madrid, son cœur et ses pensées étaient à Pampelune.
Il passait, d’un air indifférent, dans les belles rues : d’Alcala et de San-Bernardo, sur la plaza Major ou à la puerta del Sol, devant le palais du roi, devant les jardins de Buen-Retiro et de las Delicias, et traversait le beau pont sur le Manzanarès sans faire attention qu’il ne manquait rien qu’une rivière !
Enfin, après quelques jours de promenade, il se trouva un matin dans la rue d’Atocha, une des plus belles, des plus spacieuses et des plus riches de la ville de Madrid. Il s’arrêta devant un magasin brillant qui flattait moins encore ses yeux que son odorat, et il lut, sur la devanture de la boutique, ces mots :
De chaque côté de la boutique, à vingt pas et plus, s’étendait une odeur de benjoin, de tubéreuse et de jasmin capable de donner la migraine aux passants ; malgré le danger, nous avons dit que Piquillo s’était arrêté.
Il relisait ce nom : Andrea Cazoleta, qui n’était pas nouveau pour lui ; mais il ne pouvait se rappeler où il l’avait déjà entendu prononcer, et, las de chercher en vain, il continua sa route.
À quelques pas de là, en détournant à gauche dans une rue étroite et obscure, il passa près d’une petite boutique peinte en bleu qui n’était pas ouverte, mais au-dessus de la porte le bruit de trois palettes en plomb que le vent agitait l’une contre l’autre, lui fit lever les yeux, et avec une surprise et un battement de cœur inexprimables, il vit cette inscription écrite en gros caractères :
Il retrouvait un ancien ami ! c’était là sans doute que demeurait le barbier avec Juanita, sa nièce, et l’on revoit toujours avec tant de plaisir ceux à qui l’on a rendu service !
Par malheur, et quoique ce fût jour de la semaine, la boutique était fermée, et probablement depuis longtemps, à en juger par les araignées qui avaient étendu leurs toiles sur les volets, et par les placards et avis divers qu’on y avait apposés.
Piquillo frappa à la porte ; on ne lui répondit pas. Il s’adressa à un naranjero, un fruitier voisin, et demanda le seigneur Gongarello.
— Je ne le connais pas.
— C’était votre voisin.
— Il est parti.
— Depuis quand ?
— Depuis trois ans.
— Où est-il allé ?
Le fruitier le regarda avec terreur, et répondit :
— Je n’en sais rien.
— Et comment sa boutique n’est-elle pas louée ?
— Il y a des gens qui portent malheur aux maisons qu’ils habitent.
— Comment cela ?
— Cela ne me regarde pas… Si vous voulez des oranges ou des citrons, vous n’avez qu’à parler ; j’en ai de Murcie et du Portugal, choisissez.
Piquillo n’en put tirer autre chose ; mais dans ce moment le souvenir qu’il avait jusque-là vainement cherché lui revint tout à coup à l’esprit, le parfumeur de la cour !… Cazoleta !
C’est bien cela, Gongarello avait quitté Pampelune pour Madrid, et le soir où il avait couché dans l’hôtellerie du capitaine Juan-Baptista, il avait raconté, à souper, aux bandits, qu’il comptait sur la protection et le crédit de son parent Andrea Cazoleta, parfumeur de la cour.
Deux minutes après, Piquillo était au milieu de l’élégant magasin.
— Le seigneur cavalier veut-il des essences à la rose, à l’œillet ou à la vanille ? lui dit un petit homme aux yeux ronds et au nez pointu. Désirez-vous des sachets ou des gants parfumés ? Demandez.
— Je vous demanderai ce qu’est devenu le barbier Gongarello, votre parent ?
— Mon parent ! s’écria le marchand en laissant tomber le paquet de gants qu’il tenait à la main, ce n’est pas vrai ! c’est celui de ma femme Cazilda.
— Peu importe ! moi, je suis son ami.
— Dites-vous vrai ?
— Son ami intime, je vous le jure ! Piquillo ! qui lui a sauvé la vie dans la sierra d’Oca et de Moncayo.
— Histoire qu’il nous a racontée tant de fois, dit le parfumeur en se rassurant un peu. Quoi ! c’est vous, seigneur cavalier, vous en êtes bien sûr ? Je vous avais pris pour un alguazil déguisé.
— Je ne pardonnerai pas à ma figure d’avoir pu vous donner une idée pareille, mais dites-moi seulement…
— Parlons bas, seigneur cavalier ! quoique j’aime beaucoup cet excellent Gongarello, qui était mon compère et mon cousin, — ou plutôt celui de ma femme, j’aimerais mieux ne vous en rien dire…
— Eh bien ! moi, je vous en parlerai, dit à voix basse la senora Cazoleta en s’avançant et en prenant part à la conversation.
— Silence, ma femme !
— Eh ! ne craignez rien, personne ne peut nous entendre. Oui, seigneur cavalier, Gongarello est mon parent, je suis Maure comme lui…
— Maure baptisée ! s’écria le mari, c’est comme qui dirait chrétienne de naissance.
— Eh ! qu’importe ?
— C’est important quand on est parfumeur de la cour ! sans cela, et si je n’avais pas peur de perdre ma place, je ne craindrais rien… j’aurais même parlé, réclamé en faveur de Gongarello.
— Que lui est-il donc arrivé ?
— On n’en sait rien ! il était volontiers assez jovial, assez causeur ; il était au fait de tout, et on l’aimait dans le quartier, parce qu’un barbier bavard c’est utile et économique : en se faisant faire la barbe, on apprend les nouvelles. Il commençait déjà une bonne maison, et sa nièce Juanita aurait pu devenir un assez, bon parti, lorsqu’un soir, il y a de cela trois ans, les voisins virent entrer dans sa boutique, pour être rasé, un homme qui en avait bien besoin, une barbe noire et épaisse !… un air effrayant dont Gongarello n’eut pas assez peur.
On ne sait pas ce qu’il lui raconta ou ce qui se dit entre eux ; mais le lendemain de bon matin la boutique du barbier était fermée et n’a pas été ouverte depuis !
Lui et sa nièce avaient disparu, et jamais on n’en a entendu parler.
— Jamais ! répéta le parfumeur à voix basse et en appuyant sur le mot.
— On a dit dans le quartier, continua sa femme, que la personne qui était venue ainsi le faire causer, était un membre du saint-office, ou un alguazil déguisé,
— Voilà pourquoi j’ai si peur, dit Cazoleta.
— Quelques-uns même ont assuré que c’était Bernard y Royas de Sandoval lui-même, le grand inquisiteur !
— Tant il y a que, depuis ce temps, on n’a pas eu de ses nouvelles.
— Et personne n’ose en demander.
— Et voilà, seigneur cavalier, toutes celles que nous pouvons vous donner.
Piquillo soupira en pensant à Gongarello et surtout à Juanita, sa première protectrice ; il acheta quelques parfumeries au seigneur Cazoleta, et revint plusieurs fois causer avec Cazilda, sa femme, qui était bonne et obligeante ; et puis, il y avait du sang mauresque dans ses veines, et par un instinct naturel aux opprimés, tous les Maures se comprenaient et se portaient entre eux consolation, secours et amitié !
Les huit jours s’écoulèrent ; Piquillo n’avait pas reçu de réponse du duc d’Uzède. Il raconta ses chagrins à Cazilda, devenue sa confidente ; celle-ci lui donna le conseil le plus raisonnable et le plus ennuyeux… celui d’attendre !
Huit jours se passèrent encore ; aucune nouvelle de sa demande d’audience ; la patience de Piquillo était à bout, il se rendit à l’hôtel, décidé à entrer de vive force s’il le fallait.
Il demanda Son Excellence.
— Son Excellence ! dit le suisse d’un air étonné.
— Oui, répondit avec colère Piquillo, monseigneur le duc d’Uzède ; il faut absolument que je lui parle, pour une affaire de famille qui l’intéresse, lui personnellement.
— Seigneur cavalier, répondit gravement le suisse, vous seul ignorez que Son Excellence est partie depuis quatre jours pour Valladolid, où se tient la cour en ce moment.
Pour le coup, Piquillo fut atterré. Quel parti prendre ? Fernand d’Albayda n’était pas de retour ; il ne pouvait demander conseil à personne, il courut chez Cazilda.
Lorsqu’il entra dans la boutique du parfumeur, le senor Cazoleta était occupé avec ses principaux garçons, d’une commande très-pressée, d’une caisse qu’il fallait expédier au plus vite, de sorte que Piquillo put causer à son aise dans l’arrière-boutique avec la senora Cazilda.
— Le duc est parti, lui dit-il, parti pour Valladolid ; je crains qu’on ne m’abuse encore et que ce ne soit vrai.
— Eh mon Dieu ! nous venons de l’apprendre à l’instant, il n’y a pas à en douter.
— Il faut absolument que je voie le duc ; il y va de mon bonheur, de mon avenir, de toute mon existence.
— Partez alors pour Valladolid.
— Quarante lieues encore !
— Qu’importe ?
— Je n’hésiterais pas, si je devais être plus heureux ; mais je trouverai à Valladolid les mêmes obstacles, les mêmes empêchements.
Comment arriver jusqu’à ce grand seigneur ? ce sera plus difficile encore à la cour qu’à Madrid, où il n’avait rien à faire ; qui me donnera les moyens de pénétrer dans son appartement, de lui parler à lui en particulier, en tête-à-tête ?
C’est cependant ce que je désire, ce qu’il me faut, et quel ami assez puissant, quelle protection assez haute pourrait faire cela pour moi ? Y en a-t-il ?
— Peut-être ! lui dit Cazilda.
— Et qui donc ?
— Moi !

— Vous ! il serait possible ! vous auriez ce crédit ?
— Dès aujourd’hui si vous voulez, si cela vous convient.
— Parlez, parlez, je suis prêt, tout me conviendra.
— Eh bien, nous sommes parfumeur de la cour ; c’est chez nous que beaucoup de grands seigneurs, entre autres le duc d’Uzède, font leurs emplettes ordinaires. À l’instant même nous recevons de lui une commande.
La voici, lui dit-elle en lui montrant un papier. Il nous prescrit de lui envoyer le plus promptement possible à Valladolid, où il vient de se rendre, une caisse de parfums et de cosmétiques que l’on ne remet d’ordinaire qu’à lui-même, et nul doute qu’on ne fasse entrer sur-le-champ, dans ses petits appartements, la personne chargée par nous de cet envoi. Comprenez- vous ?
— Ah ! s’écria Piquillo, qui répugnait à se présenter ainsi pour la première fois devant son père, n’avez-vous pas d’autre moyen ?
— Aucun autre ! Celui-ci vous assure l’entretien particulier que vous désirez, car il y aura, dans cette caisse, certaine fiole que Son Excellence ne fait voir à personne !
— Comment cela ?
— Le duc, lui dit-elle à voix basse, a de fort beaux cheveux… des cheveux très-noirs qui ne le sont pas toujours ! nous seuls en connaissons le secret, et il reçoit d’ordinaire sans témoin ceux qui viennent de notre part. Voyez, décidez-vous.
Piquillo hésita longtemps ; mais, comme l’avait dit Cazilda, il n’y avait pas d’autre moyen. D’ailleurs le tout était d’arriver près du haut et puissant seigneur, et dès que celui-ci saurait la vérité, pourrait-il ne pas pardonner une pareille ruse ?
— Merci, dit-il à Cazilda, merci du service que vous me rendez. Non-seulement vous ne vous en repentirez pas, mais si je réussis comme je l’espère, je ne vous oublierai jamais, et je me flatte même que le duc d’Uzède vous en saura gré.
Le lendemain, le descendant des Royas de Sandoval et du duc de Lerma, obligé, pour entrer dans sa noble maison, d’avoir recours à la maison Cazoleta, partit de grand matin pour Valladolid, muni des instructions de Cazilda et de la précieuse cassette.
XX.
la cour à valladolid.
Dans une pièce solitaire et retirée, dans un cabinet autour duquel régnait une riche bibliothèque dorée, assis dans un large fauteuil et devant un bureau de travail chargé de livres, de dossiers et de parchemins, un homme se faisait les ongles, c’était le duc d’Uzède.
La porte principale s’ouvrit, un valet de chambre parut.
— Le duc de Medina-Cœli demande à parler à Votre Excellence.
— Dites au duc que si j’avais été prévenu de sa visite, je me serais arrangé pour lui donner quelques instants… mais je ne le puis ce matin… je suis occupé.
— Le premier salon est encombré de solliciteurs, de personnes à qui Votre Excellence a donné audience.
— Répondez qu’il m’est impossible de recevoir… je suis occupé !
Le valet de chambre sortit, et le duc se remit à faire ses ongles.
Quelques instants après, il se leva, se promena en long dans son cabinet d’un air pensif, s’approcha d’une belle glace de Venise, et dit d’un air sombre : Mon teint ne se bonifie pas ! l’air de Valladolid ne me vaut rien !
Il se promena de nouveau, cette fois en large… puis se rapprocha de la glace ; il regarda ses dents, qui étaient fort belles, ses cheveux, qui étaient moins noirs qu’à l’ordinaire et dont les racines commençaient à se montrer d’un rouge brun.
— Pourvu, s’écria-t-il avec inquiétude, que le message que j’attends ne tarde pas !
Il sonna si vivement qu’il manqua de briser la sonnette, et les pauvres solliciteurs restés dans le premier salon se regardaient et se disaient à demi-voix : — Il parait qu’il y a de grands événements, et qu’une importante affaire s’agite en ce moment.
Le valet de chambre rentra effrayé.
— Je n’y suis pas, dit le duc d’un ton grave, mais si l’on venait de Madrid… écoutez…
Et quoiqu’ils fussent seuls, il lui parla bas à l’oreille et ajouta tout haut :
— Vous entendez ?
Le valet s’inclina et sortit.
Après s’être encore complu quelques instants dans sa taille, qui était haute et bien prise, après avoir admiré sa jambe, qui était fine et élégante, et sa robe de chambre brochée en or, le duc, faisant un effort sur lui-même, et comme se reprochant le temps qu’il venait de perdre, se rapprocha vivement de son fauteuil, s’assit devant son bureau de travail, écarta les lettres et les papiers qui l’encombraient, prit trois ou quatre plumes, et s’amusa à les tailler.
Il était depuis quelques minutes dans cette occupation, plus ordinaire qu’on ne croit aux hommes d’État, lorsqu’on frappa légèrement à une petite porte à gauche de la cheminée, porte cachée dans la boiserie et de plus recouverte par une tapisserie. Le duc se leva avec l’impatience d’un homme qu’on arrache à un important travail, alla ouvrir, et s’écria d’un air galant :
— La comtesse d’Altamira !…
C’était une superbe personne, qui n’était plus jeune… ce n’était pas sa faute, mais qui était encore belle et qui avait juré de l’être tant qu’elle le pourrait ! elle avait tenu parole. Le temps avait beau faire, il était impossible d’opposer à ses attaques une résistance plus opiniâtre et plus habile.
La comtesse d’Altamira, que nos lecteurs se rappelleront peut-être avoir entrevue à Valence dans les jardins du palais et plus tard avec la reine Marguerite, lors de sa visite au Maure Albérique, la comtesse d’Altamira était une des premières dames du palais et des plus haut placées, quoiqu’elle y fût à peu près mal avec tout le monde, position qui se rencontre parfois à la cour et dont voici, à cette circonstance, l’explication.
Don Juan d’Aguilar, actuellement vice-roi de Navarre, avait eu deux sœurs, beaucoup plus jeunes que lui.
Quoiqu’il n’eût pas de fortune à leur donner, toutes deux s’étaient fort bien établies.
La première, Isabelle d’Aguilar, bonne, douce et aimante, avait épousé Alonzo d’Albayda, un des premiers barons du royaume de Valence ; de ce mariage était né Fernand d’Albayda, qui depuis longtemps avait perdu ses parents.
La seconde sœur, la cadette, Florinde d’Aguilar, d’une beauté éclatante, mais fière, hautaine, égoïste et n’aimant qu’elle, s’était fait adorer aisément du comte Altamira, un des premiers écuyers de Philippe II, car elle avait autant d’esprit que son mari en avait peu ; de plus, de l’ambition, de l’adresse, de l’audace et l’amour de l’intrigue poussée jusqu’à la passion ! c’était sa vie !
Elle avait besoin de mouvement, de danger, d’émotion, et se disait, comme plus tard la duchesse de Longueville : cela tourmente… mais cela occupe !
Sous Philippe II, qui n’aimait point ce genre d’occupation, la comtesse, qui était fort jeune alors, lança deux ou trois fois son mari dans des projets dont il ne se doutait même pas, et qui faillirent le perdre.
Heureusement pour lui, une fluxion de poitrine l’enleva aux complots qui l’auraient compromis.
Restée seule, la comtesse intrigua en chef et pour son compte, mais avec l’adresse et la modération qui était alors de rigueur.
Nous avons vu que Philippe II, qui redoutait pour son héritier l’esprit et le talent, avait pris tous les moyens possibles pour l’en préserver.
Le succès avait, en grande partie, secondé ses efforts paternels.
Mais il n’avait pu, quoi qu’il fit, isoler complétement le jeune prince. Il avait laissé auprès de lui son ancienne gouvernante, la marquise de Vaglio, un gentilhomme de la chambre nommé Muriel, et Royas y Sandoval, marquis de Denia, depuis duc de Lerma.
La comtesse d’Altamira voyant qu’il n’y avait rien à faire pour le présent, voulut au moins s’assurer l’avenir. Elle s’attacha à la marquise de Vaglio, et ce quatuor forma à peu près toute la camarilla du prince royal. Cette petite cour était peu occupée et n’avait rien à faire qu’à amuser l’infant d’Espagne.
Il n’est pas prouvé que la comtesse n’eût pas dès lors l’idée de le soumettre à sa domination et d’exercer, comme favorite, l’empire que le duc de Lerma exerça plus tard comme favori ; mais le moyen de tenter un pareil projet, avec Philippe II, qui voyait tout ; avec le marquis de Denia, qui l’eût peut-être dénoncé, et surtout avec un jeune prince tellement soumis et craintif qu’il n’eût osé prendre de l’amour sans en demander la permission au roi son père !
La comtesse se contenta donc de servir les desseins du marquis de Denia, au lieu de les traverser : c’était plus loyal, et d’ailleurs elle ne pouvait faire autrement.
La marquise de Vaglio, la comtesse, Muriel et le marquis s’entendirent franchement pour partager les bonnes grâces du prince royal, et pour exploiter sa puissance quand il serait roi.
En attendant, ils avaient besoin d’appui et ne savaient où en trouver ; personne à la cour n’aurait osé venir à eux. Le confesseur du roi était dominicain, et par conséquent toute l’inquisition était dévouée à Philippe II.
Le père Jérôme, Florentin, de l’ordre des jésuites, qui avait un grand crédit par sa compagnie et surtout par son talent comme prédicateur, fut le seul qui offrit secrètement au marquis de Denia son appui et celui de son ordre : d’abord, en haine des dominicains, leurs rivaux et leurs ennemis naturels ; ensuite ils espéraient par là arriver, après la mort de Philippe II, à diriger la conscience de son successeur, objet de tous leurs vœux.
Le marquis de Denia promit donc que le confesseur du nouveau roi serait choisi dans l’ordre des jésuites, et l’ordre fournit au marquis, sur sa signature et sa responsabilité, toutes les sommes dont il avait besoin, pour subvenir aux dépenses du jeune prince, à qui le roi son père ne donnait pas d’argent.
Ce fut là, au dire de tous les historiens, le moyen le plus puissant employé par Denia et ses alliés pour capter la faveur de leur jeune maître.
Mais quand Philippe II fut mort, quand son fils eut, dès les premiers jours de son règne, remis toute l’autorité royale entre les mains du duc de Lerma, celui-ci, maître absolu, vit venir tout le monde à lui.
Le patriarche d’Antioche Ribeira lui amena le clergé, Royas de Sandoval lui amena l’inquisition, et le duc se trouva fort embarrassé de ses anciens alliés, les jésuites, qui réclamèrent ses promesses et leur argent.
Le père Jérôme voulait être confesseur du roi ; Sandoval et Ribeira, ennemis déclarés de l’ordre de Loyola, voulaient que ce confesseur fût un dominicain.
Le duc de Lerma n’était ni assez fort, ni assez habile, pour tenir la balance, d’une main ferme, entre deux puissances aussi redoutables. Pour les opposer l’une à l’autre, et les faire toutes les deux concourir à ses desseins, il eût fallu être Richelieu ; mais Richelieu n’était pas encore venu, et plus tard le ministre espagnol eut à lutter contre lui sans pouvoir le vaincre ni l’imiter.
Le duc prit, comme tous les gens faibles, un terme moyen. N’osant satisfaire entièrement aucun des deux partis, il s’arrêta à une résolution qui les mécontenta tous les deux.
Il ne choisit le confesseur du roi, ni parmi les jésuites, ni parmi les dominicains, mais parmi les cordeliers. Il nomma à cette place un pauvre moine, nommé fray Gaspard de Cordova, homme d’un extérieur négligé, qui portait un bonnet et des souliers déchirés, qui n’avait ni goût ni talent pour l’administration de l’État, et qui était incapable de s’en mêler.
De sorte que, grâce à cette nomination, la place resta toujours vacante, et que les deux partis continuèrent à se la disputer.
Quant à la marquise de Vaglio et à Muriel, le duc n’en avait plus besoin et n’y pensa plus.
La comtesse cependant n’était pas femme à se laisser oublier ; elle réclama avec aigreur, et pour la calmer on lui donna d’abord la place de première dame d’honneur de la reine ; puis on la nomma gouvernante des enfants d’Espagne.
Mais c’était trop peu pour elle.
Ce qu’il lui fallait, c’était du pouvoir, c’était sa part dans le gouvernement ; et ses prétentions devinrent si exagérées que le duc de Lerma se fit ce raisonnement tout naturel : Il est impossible de ne pas nous brouiller un jour ; brouillons-nous tout de suite ; j’y gagnerai ce que j’aurais été obligé de lui donner dans l’intervalle.
Cette pensée reçut promptement son exécution. Dès le jour même le cabinet du ministre fut fermé à la comtesse, et les anciens amis devinrent ennemis mortels.
La comtesse, la rage dans l’âme, jura de se venger, de renverser ce ministre ingrat qu’elle avait contribué à élever, et ce fut désormais la seule occupation de sa vie.
Elle aurait intrigué pour rien ; à plus forte raison pour une cause aussi juste.
Elle se tourna d’abord du côté de la reine, qu’elle supposait être fort mal disposée pour le favori. La reine reçut ses avances avec une dignité, une froideur et même un air de mépris qu’elle ne put s’expliquer et qui l’éloignèrent pour toujours.
Marguerite n’avait point oublié la conversation qu’elle avait entendue, la veille de son mariage, dans les jardins de Valence ; Marguerite croyait à la franchise et à l’amitié : elle ne pouvait croire à la comtesse d’Altamira.
Celle-ci revint alors à ses anciens amis, le père Jérôme et les siens, furieux, comme elle, contre le ministre qui les avait joués. Ils mirent en commun leur vengeance, leur fortune et leur esprit.
Le père Jérôme et la comtesse en avaient beaucoup et ils s’adjoignirent quelqu’un qui en avait au moins autant qu’eux.
C’était le confesseur de la comtesse, un pauvre moine, bien célèbre depuis par ses ouvrages, mais inconnu encore, et qu’on nommait Antoine Escobar y Mendoza.
Il n’avait pas alors trente ans, il était jésuite depuis l’âge de quinze ans. Son premier ouvrage avait été un poëme, en vers latins, consacré à la gloire de saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus. Grâce au père Jérôme, dont il était l’élève, il se distingua ensuite comme prédicateur.
Sa facilité d’élocution était si grande, que souvent il montait deux fois en chaire dans la même journée et discutait le pour et le contre avec une égale supériorité. Homme d’une habileté et d’une érudition profondes, passionné pour la gloire de son ordre, et de bonne foi dans son genre, comme Ribeira, l’archevêque de Tolède, l’était dans le sien.
Escobar eût brûlé la moitié de l’Espagne en l’honneur de Loyola ; Ribeira eût brûlé l’autre moitié en l’honneur de saint Dominique.
Mais comment renverser le duc de Lerma, ce favori tout-puissant, plus roi que le roi lui-même, protégé par l’inquisition et défendu par l’imbécillité de son maître ?
Tout lui était soumis et dévoué. Il ne voyait autour de lui que des flatteurs et des courtisans dont les trésors de la monarchie lui servaient à payer les appointements.
Non content d’avoir partagé les principaux emplois entre tous les siens, il s’était appliqué à rendre la faveur royale héréditaire dans sa famille ; il élevait son fils, le duc d’Uzède, à remplir après lui la place de favori.
Comment attaquer un pareil homme, dans une grandeur si élevée et si bien fortifiée ? où lui découvrir un endroit vulnérable ?
Eh bien, cet endroit faible, cette brèche à son bonheur, la comtesse l’avait trouvé.
Si l’histoire n’était pas là pour l’attester, si les événements ne l’avaient pas prouvé, le fait paraîtrait incroyable, impossible, absurde, et cependant c’était la vérité. Le duc de Lerma avait chez lui, dans son intérieur, quelqu’un qui aspirait à le renverser.
Cette personne, c’était son fils !
Entendons-nous : le duc d’Uzède n’avait pas eu d’abord tout à fait cette idée, mais peu à peu la comtesse avait fini par la lui donner.
Le duc d’Uzède n’était pas méchant, mais c’était un sot, le sot le plus beau, le plus radieux, le plus content de lui qui se soit jamais épanoui à la cour, et l’on ne sait pas jusqu’où peut aller un sot quand il est bien mené !
Celui-là était en bonnes mains. En lui parlant de l’ingratitude de son père envers elle, la comtesse s’était fait plaindre ; en lui parlant de lui, duc d’Uzède, et toujours de lui, elle s’était fait aimer. Elle n’eut pas besoin d’autre coquetterie. Plus elle l’admirait, plus il l’adorait.
Dès ce moment, c’est sur le duc d’Uzède que reposèrent toutes les espérances du parti.
Le père Jérôme se chargea de son esprit, la comtesse de son cœur, et Escobar de sa conscience.
Le duc de Lerma, ainsi que nous l’avons dit, voulait, en bon père, élever son fils à lui succéder. Il avait essayé de le pousser dans l’intimité du roi ; il avait tenté surtout de l’introduire dans les différents conseils. Il avait été obligé d’y renoncer ; Sandoval le lui avait demandé en grâce. Il y avait trop de danger à lui confier le secret de l’État ou le maniement des affaires.
Le duc de Lerma et Sandoval, après s’être consultés entre eux, avaient été forcés de s’avouer, en famille, l’un que son fils, l’autre que son neveu n’était qu’un sot.
Quoique cette délibération eût été secrète, les effets s’en manifestèrent bientôt. On lui retira peu à peu toute confiance, tout pouvoir, tout crédit ; mais, par tendresse ou par égard, on lui laissa l’apparence de ce qu’on lui ôtait, et depuis longtemps il n’était plus rien que l’on croyait encore dans le monde qu’il était quelque chose.
Escobar et la comtesse étaient trop habiles pour ne pas voir, et ils virent ; bien plus, ils eurent l’adresse et la cruauté de ne tromper le duc en rien ; de lui montrer la vérité tout entière, de la lui faire toucher, comme on dit, au doigt et à l’œil.
Ils lui prouvèrent facilement que son oncle et son père le regardaient comme incapable, et le traitaient comme tel.
Le duc d’Uzède fut indigné.
La comtesse feignit de l’être encore plus que lui.
Il devint furieux ; et la fureur de la comtesse parut telle que lui-même fut obligé de la calmer.
Mais le coup l’avait frappé au cœur, ou plutôt dans son amour-propre, la blessure était incurable.
Il devint jaloux des honneurs et de la puissance dont jouissait son père. On avait beau le flatter et l’honorer : c’était pour arriver à son père que l’on passait par lui ; car après tout, il le comprenait sans peine, il n’était rien, il ne faisait rien. De là, un sentiment tout naturel d’opposition qui le portait à dénigrer et à blâmer tout ce qu’on faisait ; de là, l’idée si facile à faire germer dans son orgueil, que s’il était à la tête des affaires, tout irait autrement ; de là, le désir immodéré d’arriver au premier rang.
Mais ce premier rang était occupé… ce premier rang où tout le monde l’appelait, il fallait, pour s’en emparer et pour y briller, qu’il fût vacant… Donc, comme disait Escobar, qui était l’homme aux conséquences, donc il fallait… dans l’intérêt de l’Espagne, souhaiter que le duc de Lerma se retirât des affaires.
C’est ainsi que, de conséquence en conséquence, le duc d’Uzède en était arrivé à désirer vivement la retraite de son père, et de la désirer à y aider, il n’y avait qu’un pas.
XXI.
la cour à valladolid (suite).
Tel était l’état des choses, lorsque le duc, qui était à travailler dans son cabinet, vit entrer la belle comtesse d’Altamira, que depuis bien longtemps nous avons laissée sur le seuil de la porte, et à laquelle nous nous hâtons de revenir.
— Vous, comtesse ! s’écria le duc enchanté, et de si bon matin !
— Je pars… un voyage… des affaires de famille ! j’y suis obligée… Je vous conterai cela.
— Vous partez ! et je vais rester seul à Valladolid, où je m’ennuie à périr !
— Pourquoi y êtes-vous venu ?
— Pour vous d’abord, comtesse ; et puis le moyen de rester à Madrid quand toute la cour est à Valladolid ! on a l’air de ne servir à rien.
— On ne vous a donc pas enjoint d’y venir ?
— Du tout.
— La gazette de la cour l’avait dit.
— Par mon ordre.
— C’est bien ! je reconnais là votre tact, votre esprit.
— Pourquoi aussi transporter la cour à Valladolid ! quelle idée, et à quoi bon ?
— Vous ne le savez pas ?
— Eh ! non, vraiment… Est-ce qu’on me dit rien à présent !
— Ils vous craignent trop pour cela.
— Je le vois bien… mais patience ! Et vous dites, comtesse, que vous savez… vous…
— Oui, par la reine elle-même, ou plutôt par son mécontentement ; car la reine ne dit rien non plus.
— C’est une cour muette !
— Et ennuyeuse !… quand vous n’êtes pas là ; il n’y a que vous qui égayez le roi par vos saillies.
— Ce pauvre roi est si nul !
— Il faut savoir se mettre à sa portée, ce que vous entendez à merveille ! lui plaire, l’amuser ; de là dépend pour nous le succès.
— Je le comprends bien… nous avons passé hier la soirée à découper de saintes images !… mais vous disiez donc que la reine…
— La reine est au plus mal avec le roi et avec le ministre, qui d’abord en avait peur et craignait qu’elle ne prit quelque empire sur son mari… mais elle ne s’occupe plus d’affaires, et ne se mêle de rien.
— Alors on doit être rassuré.
— On a peur de tout. Sa Majesté la reine, qui est Autrichienne, ne voyait dans son intimité, à Madrid, que la vieille impératrice, sœur de Philippe II.
— Elle existe donc encore ?
— Toujours, c’est la seule parente de la reine ; et, ce que vous ne croiriez jamais, c’est que le ministre, à qui leur amitié porte ombrage, et qui redoute quelque complot de leur part, leur a fait défendre par le roi de se parler seules ou en allemand.
— Ce n’est pas possible !
— C’est comme je vous le dis ! Et vu que la reine ne tenait aucun compte de cet avis, et continuait son jargon germanique avec sa vieille parente, c’est, dit-on, pour les séparer que le ministre a transporté la cour à Valladolid[16].
— Ce n’est pas croyable !
— Tout cela est si mesquin, tout ce monde-là est si craintif, si méticuleux ! Point de portée ! point de grandes vues ! Rien de ce que vous auriez, vous, monsieur le duc, si vous étiez là !
— Certainement ! dit le duc avec un air capable. Puis il ajouta avec un soupir : Mais il faut y être… il faut y arriver…
— Et nous en sommes peut-être plus près que vous ne croyez.
— Comment cela ?
— Grâce à la reine, qui va nous servir sans le vouloir. Mais du silence !
— Le duc alla sur la pointe du pied fermer les verrous de la porte principale, et revint s’asseoir mystérieusement près de la comtesse, qu’il écouta d’un air important et affairé.
— Il y a quelques années, dit la comtesse d’Altamira, six ou sept ans à peu près, lors du mariage de Sa Majesté, et quelques jours après le voyage de la reine dans le royaume de Valence, il s’est passé entre elle et le roi une aventure mystérieuse que je n’ai jamais pu savoir au juste.
— Et que je sais, moi !… dit le duc gravement ; car on me disait tout alors !
Et s’approchant de l’oreille de la comtesse, il lui dit à demi-voix :
— La reine avait usé de son pouvoir de jeune mariée pour obtenir de l’amour du roi la grâce d’une personne qui m’avait insulté, et que j’avais fait mettre dans la tour de Valladolid… car j’avais du crédit alors !…
— Quelle était donc cette personne ! demanda la comtesse avec curiosité.
— Le jeune don Fernand d’Albayda !
— Mon neveu ! s’écria la comtesse en riant. Voilà ce que je ne savais pas. Mais cela ne m’étonne point. D’Albayda est un charmant garçon, un joli cavalier à qui beaucoup de grandes dames veulent du bien ; j’ignorais que la reine fût de ce nombre… Et moi qui négligeais ce pauvre Fernand… et ne le voyais jamais !… C’est mon neveu, après tout… mon plus proche parent… et je veux désormais…
— Eh ! non, comtesse, dit le duc avec impatience, vous êtes dans l’erreur : la veine ne le connaît pas et ne l’a jamais vu, pas plus que don Juan d’Aguilar, qu’elle a fait nommer à la même époque vice-roi de Navarre.
— Mon frère ! s’écria Florinde en riant de nouveau, comment, c’est ainsi qu’il a obtenu ce titre qu’il croit bravement ne devoir qu’à ses anciens services… Ah çà ! il paraît que toute ma famille, excepté moi, est protégée par la reine… qui est censée ne se mêler de rien. Et d’où cela vient-il ? comment cela se fait-il ?
— Je l’ignore !
— Vous qui saviez tout… dans ce temps-là.
— Tout ce que le ministre savait !… Mais personne, pas même lui, n’a pu découvrir d’où venait l’intérêt que la reine portait à don Juan d’Aguilar et à son neveu ; et, le plus étonnant, c’est que don Juan, ni son neveu n’en ont eux-mêmes jamais rien su, pas plus que moi, je vous le jure.
Et, pour finir l’histoire, dont voici le plus curieux, continua le duc d’Uzède, mon oncle Sandoval, le grand inquisiteur, effrayé du crédit que pouvait prendre la reine dans certains moments, obtint du roi… au nom de l’inquisition et de la cour de Rome… mais vous n’allez pas me croire…
— Si, dit la comtesse en souriant, je crois tout de Sa Majesté.
— Il obtint du roi que de sa vie il ne parlerait plus d’affaires d’État à la reine… même dans le lit royal…
Florinde partit d’un éclat de rire qui se prolongea tellement que le duc eut toutes les peines du monde à l’arrêter.
— Comtesse !… comtesse !… lui disait-il, prenez garde ; si l’on vous entendait, cela me ferait du tort.
— Comment ! l’on ne peut pas rire ?
— Dans le cabinet d’un homme d’État. — Impossible ! cela ne se fait pas.
— Eh bien ! eh bien ! reprit la comtesse en cherchant à modérer sa gaieté, eh bien ! notre digne roi a signifié à sa femme ses nouvelles intentions… conjugales ?
— Oui, mais la reine a répondu fièrement : « Que la dernière bourgeoise de son royaume avait le droit de prendre intérêt à la fortune et aux affaires de son mari ; que sans cette confiance, il n’y avait point de mariage, qu’elle ne se regardait plus comme mariée ; qu’elle permettait au roi de s’enfermer seul dans son cabinet, mais qu’elle réclamait la même permission, pour elle, dans sa chambre à coucher… » Et cette permission, elle l’a prise !
— À merveille ! s’écria Florinde avec joie ; nous voici justement arrivés où je voulais en venir. Oui, la reine a tenu sa parole. J’étais certaine de ce fait, mais j’en ignorais la cause. Oui, sa chambre royale est fermée au roi, son mari.
— Je comprends alors !… Sa colère dure toujours !
— Nullement. Elle tient avec calme et sang-froid une résolution qui ne lui coûte rien ; au contraire, on dirait qu’elle a été charmée de l’occasion, et qu’elle s’est empressée de la saisir.
Quant à l’autorité qu’elle reprendrait encore… et qu’elle conserverait toujours, si elle le voulait, elle ne paraît pas s’en soucier le moins du monde ; elle voit autour d’elle chacun se disputer le pouvoir, sans qu’il lui vienne la fantaisie d’en réclamer la moindre part.
— C’est un cœur qui ne sent rien… tout lui est indifférent.
— Je n’en voudrais pas répondre… Plus j’observe… plus je l’examine (et une dame d’honneur n’a que cela à faire), elle n’est ni ambitieuse, ni méchante, ni jalouse, à peine dévote… et pas du tout coquette. Il faut que cette femme-là ait une passion…
— Allons donc !
— Tout le monde en a une !… même plus ! Pourquoi n’en aurait-elle pas ! Ce serait absurde, invraisemblable. Il faut absolument qu’elle en ait une.
— Et laquelle ?
— Si je la connaissais, ce ne serait plus elle qui serait la reine, ce serait moi ! Mais je la découvrirai peut-être ! En attendant, voici ce que j’ai cru voir : c’est que Sa Majesté le roi des Espagnes et des Indes supporte très-impatiemment son veuvage, et que votre oncle Sandoval, le grand inquisiteur, qui a cru faire un coup de maître, a fait un pas de clerc en le séparant de sa femme ; mais l’inquisition n’entend rien à ces choses-là ! Sa femme, d’après ce que je connais de son caractère, n’eût cherché à prendre sur lui aucun ascendant, tandis qu’une autre…
— Que dites-vous ?
— Oui, s’écria vivement la comtesse, dans la situation où est le roi, une femme jeune, jolie, séduisante, prendrait à l’instant sur lui un empire terrible, et contre lequel se briserait en une minute tout le pouvoir des favoris.
— C’est une idée… une idée admirable, dit le duc, d’un air aussi satisfait que si elle venait de lui.
— Oui, mais une idée dangereuse, qui peut tourner contre nous-mêmes si la favorite n’est pas dans nos intérêts, si elle ne nous doit pas sa faveur…
— C’est vrai ! dit le duc d’un air profond.
— Si elle n’est pas amenée, protégée, et dirigée par nous, je veux dire par vous, monsieur le duc.
— C’est juste ! il me faudrait alors quelqu’un qui me fût dévoué, qui m’aimât…
Et sans le vouloir, son œil se leva sur la comtesse, dont il était épris et qu’il adorait. Mais pour quelqu’un que dévore l’ambition, toutes les autres passions, quelque ardentes qu’elles soient, ne viennent qu’en seconde ligne et ne sont que des moyens.
La comtesse avait compris son regard.
Elle aurait pu répondre : J’y pensais ! ou plutôt : J’y ai déjà pensé, et j’ai vu que je ne pourrais pas réussir ; mais trop habile pour être si franche, elle jeta sur le duc un regard de tendresse désespérante.
— Ingrat ! lui dit-elle avec un accent mêlé de reproche et de douleur.
Il y avait dans ce mot une expression sublime.
— Ingrat !… et vous !… vous que j’aime !…
Il fut impossible au duc de ne pas tomber à ses pieds : c’était de rigueur.
— Écoutez-moi, reprit-elle, je rêverai à notre projet, je m’en occuperai. Quant à vous, mon cher duc, vous voyez le roi presque tous les soirs ; on vous laisse sans défiance causer avec lui des heures entières, parce qu’ils sont loin de se douter de la profondeur de vos desseins et de la finesse de votre esprit.
— Je n’en laisse rien paraître ! dit le duc d’un air mystérieux.
— Continuez toujours, et faites venir adroitement la conversation.
— Sur ce sujet ?
— Non, n’en dites rien ! mais amenez Sa Majesté à causer avec le père Jérôme, son prédicateur ordinaire. Le roi a des passions, mais il est dévot. Les dévots ont des passions comme tout le monde ; mais de plus ils ont des scrupules qui demandent à être levés. Après cela, ils vont plus loin que d’autres ; lestes et légers, rien ne les gène sur la route, pas même leur conscience ! ils ne s’occupent plus des bagages ; ce sont leurs confesseurs que cela regarde. Ah ! si Escobar était là !… si au lieu de ce fray Gaspard de Cardova, il dirigeait le roi…
— Nous et la favorite l’emporterions dès demain !
— Dès ce soir ! Mais enfin le père Jérôme a du crédit et du talent, c’est lui qui doit prêcher le prochain carême, c’est un prétexte pour causer d’avance avec Sa Majesté. Quand il aura parlé, quand il aura écarté les premiers scrupules, commencez alors !… entretenez chaque soir le roi dans ces idées ; persuadez-lui que ce n’est pas sa faute, mais celle de la reine… en un mot, que c’est comme s’il était veuf ?
— Et en cas de veuvage on peut se remarier.
— Prendre une autre femme ! les rois ont dans certaines occasions des priviléges,
— Ils en ont tous !
— Même les plus saints monarques !
— Témoin le roi Salomon, qui avait, dit-on, sept ou huit cents…
— Priviléges ! dit la comtesse en riant ; mais notre roi a des idées plus restreintes et plus modestes, et serait fort embarrassé, je crois, de priviléges aussi étendus. Qu’il voie le père Jérôme, vous ensuite ; et moi, je vous seconderai à mon retour.
— Où allez-vous donc ?
— À Madrid, et peut-être à Pampelune… si mon frère don Juan d’Aguilar va plus mal, car il est tombé subitement malade ; je viens d’en recevoir la nouvelle par sa fille Carmen, ma nièce, une charmante jeune fille, un ange de bonté et de douceur.
En ce moment, on frappa légèrement à la porte principale, dont le duc avait fermé les verrous.
Le duc alla ouvrir. C’était le valet de chambre. Il s’inclina respectueusement devant la comtesse, et dit à voix basse à son maître :
— La personne et la cassette qu’attend Votre Excellence.
Le duc répondit avec embarras :
— C’est bien ! dans un instant.
— Qu’est-ce ? dit Florinde, en voyant le trouble du duc.
— Rien, je vous jure… une affaire particulière, une audience qu’on me demande.
La comtesse, défiante comme toutes les personnes qui sentent qu’on aurait le droit de l’être avec elles, fronça le sourcil et dit gravement :
— Monsieur le duc, il faut avant tout de la franchise. Nous n’avons point de secret pour vous, et si vous en avez pour nous…
— Aucun, je vous l’atteste.
— Quelle est donc cette personne que vous recevez quand votre porte est défendue ? quelle est donc cette mystérieuse cassette ?
— J’aimerais mieux ne pas vous le dire…
— Et si je l’exigeais ?
— Eh bien… dit le duc… c’est une caisse qui m’est apportée…
— Par qui ?
— Par un garçon du senor Cazoleta !
— Le parfumeur ! s’écria la comtesse en riant de nouveau ; puis voyant l’air déconcerté du duc, elle s’arrêta d’elle-même, et ajouta : C’est bien, c’est bien, je me retire… ce sont des mystères que je respecte. Adieu, duc, je vous laisse ; bientôt je serai de retour.
Et elle disparut par la porte secrète pendant que le valet de chambre faisait entrer par la porte principale Piquillo Alliaga, portant une cassette sous le bras.
Le valet de chambre se retira, et le laissa seul avec le duc. quoi j’ai prié Cazoleta de m’envoyer quelqu’un.
XXII.
la voix du sang.
Quand on voit pour la première fois l’auteur d’un ouvrage que l’on connaît beaucoup, et auquel on s’est grandement intéressé, on ne peut se défendre d’un vif sentiment d’émotion et de curiosité ; à plus forte raison, quand on voit pour la première fois l’auteur de ses jours, quand on se trouve face à face avec celui qu’à tort ou non, on soupçonne d’être son père.
Piquillo fut si troublé qu’un nuage couvrit ses yeux, ses jambes chancelèrent.
— Prenez donc garde, lui dit vivement le duc en s’avançant pour le soutenir.
Piquillo fut sensible à cette première marque d’intérêt.
— Vous allez laisser tomber cette caisse et la briser !
Cette seconde réflexion l’empêcha de s’attendrir, il se contenta de poser la caisse sur le bureau.
— Bien, dit le duc, en se hâtant de l’ouvrir et d’en examiner le contenu avec la plus scrupuleuse attention.
Piquillo profita de ce temps pour examiner son père, et pour prendre connaissance avec sa figure.
Le duc était grand, Piquillo était petit ; le duc avait un air de fatuité grave et noble, Piquillo l’air moins distingué, mais spirituel. Du reste beaucoup de leurs traits étaient les mêmes, et Piquillo trouva la ressemblance frappante.
— La senora Urraca, ma grand’mère, avait raison, se dit-il. C’est lui.
Le duc procédait toujours à l’inventaire de la caisse.
— La crème circassienne pour la peau… bien… L’eau du sérail pour donner aux ongles une teinte rosée… très-bien. La pâte de miel à l’amande de noisette pour les mains… c’est du nouveau… Est-ce de l’invention du senor Cazoleta ?
— Probablement.
— Ah !… voici la fiole !… l’élixir capillaire… j’en avais mis la dernière fois quelques gouttes de trop, la nuance était trop dure et l’ébène trop accusé ; vous me direz au juste la dose… ou plutôt vous serez là… demain… je ferai la mixtion devant vous… voilà pourquoi j’ai prié Cazoleta de m’envoyer quelqu’un.
— Je dois vous dire la vérité, monsieur le duc…
— Je comprends. Le prix est augmenté, c’est trop juste.
— Non, monsieur le duc.
— C’est encore mieux ! Comment va la senora Cazoleta ?
— Votre Excellence est bien bonne.
— Elle n’est pas mal, cette femme-là… très-bien conservée… c’est tout simple, quand on est à la source de l’eau de Jouvence… M’en a-t-elle mis quelques flacons ?… Oui, voilà !…
— J’ai autre chose à vous dire, monsieur le duc, balbutia Piquillo avec émotion.
— Vraiment, mon garçon !… parle.

Et pour la première fois le duc jeta les yeux sur Piquillo, qu’il n’avait pas encore honoré d’un regard.
— Eh… eh… voici un garçon qui a une assez bonne tournure… pour un parfumeur !… la senora Cazoleta ne choisit pas mal. Tu as donc à me parler de sa part ?
— Non, monseigneur, de la mienne… une demande à vous faire.
— Ah ! ah !… se dit le duc à part lui, un solliciteur qui profite de l’occasion ! et sa figure riante devint tout à coup dure et sévère.
Piquillo fut glacé de ce changement subit ; mais il chercha à reprendre son courage, et tirant de sa poche la lettre de la Giralda, il la présenta au duc d’une main tremblante.
— Votre Excellence connaît-elle cette écriture ?
— Non, ma foi.
— C’est celle d’une personne qui me recommande à vous.
— Une lettre de recommandation… Bien… je la lirai.
Il la jeta sur la table à côté de beaucoup d’autres, et dit à Piquillo d’un air indifférent et ennuyé :
— Raconte-moi ton affaire… ce sera plus tôt fait ! Qu’est-ce que tu veux ? qu’est-ce que tu demandes ? à quoi es-tu bon ? va toujours, je t’écoute !
Et s’approchant de la glace, il étala sur ses lèvres une légère couche d’opiat au corail, le tout en tournant le dos à Piquillo.
Il était impossible de choisir une position plus désavantageuse pour une reconnaissance. Piquillo essuya la sueur qui coulait de son front, et dit en hésitant :
— Votre Excellence n’a sans doute pas oublié une femme… qu’autrefois… à Séville… vous avez aimée…
— Laquelle ? il y en a tant !
— La senora Alliaga.
— Alliaga ! je ne connais pas ce nom-là.
— C’est juste, dit Piquillo, blessé au cœur, c’était un nom honorable ; mais elle en avait un autre qui ne l’était pas, et que vous devez connaître… la Giralda !
— La Giralda ?… oui, palsambleu !…… Un beau talent ! une femme superbe ! Nous en avons tous raffolé à Séville… Mais finie, disparue… Est-ce qu’elle existe encore ?

— C’est elle qui vous écrit, monseigneur.
— J’y suis… quelques secours… ou plutôt un engagement dans la troupe de Valladolid, mais elle ne peut plus jouer que les mères, à présent !
Piquillo tressaillit.
— Elle doit être bien vieille !
— Elle est plus jeune que Votre Excellence.
— En vérité ! dit le duc d’un ton piqué ; eh bien alors, mon cher, vous lui direz que je verrai à loisir… que je lirai sa lettre.
— Non, monseigneur, répondit Piquillo d’une voix ferme, vous la lirez à l’instant.
— Qu’est-ce à dire ! s’écria le duc en se retournant avec fierté.
— Vous la lirez, monseigneur, non pour la Giralda, mais pour vous, dans votre intérêt, car c’est vous que ce papier concerne.
Le duc regarda Piquillo d’un air étonné et un peu inquiet. Il reprit la lettre, qu’il avait jetée sur le bureau.
— Je ne sortirai pas d’ici que vous n’en ayez pris connaissance.
Et il s’assit, contemplant le duc en silence.
Celui-ci froissa vivement le cachet et ouvrit la lettre.
À mesure qu’il lisait, on le voyait rougir et pâlir. Un dépit et une colère concentrés éclataient dans tous ses traits ; mais, faisant ses efforts pour rester maître de lui-même, il sourit avec dédain, jeta sur Piquillo un regard glacé, et lui dit avec ironie :
— C’est donc là, monsieur, le message dont vous avez eu l’honneur de vous charger ?
— Il n’y a là aucun honneur, ni pour vous, ni pour moi ! répondit froidement Alliaga, mais une dure nécessité ; car je vois que nous sommes tous les deux humiliés, et avec raison : vous, de m’avoir pour fils, et moi, monseigneur… de vous avoir pour père !
— Rassurez-vous, lui dit le duc en lui lançant un regard furieux ; grâce au ciel, nous n’en sommes pas là ! Quand on est dans ma position, on reçoit souvent des réclamations pareilles, c’est une spéculation comme une autre.
— Une spéculation ! s’écria Alliaga indigné.
— Convenez, monsieur, que si je n’étais un riche, un grand seigneur, vous ne seriez pas venu à moi, et que la Giralda, votre mère, aurait choisi quelque autre personne mieux placée pour l’honorer d’une paternité douteuse… que je repousse et que je désavoue ! trop de monde pourrait me la contester, et je n’aime pas les procès.
— Ah ! s’écria Alliaga hors de lui, réjouissez-vous de ce que, par malheur, ce doute existe encore pour moi ! sans cela, vous n’auriez pas achevé cette phrase et dans ce moment, monsieur le duc, vous ne sortiriez pas vivant de mes mains !
Le duc, effrayé de l’exaspération de Piquillo et de la fureur qui étincelait dans ses yeux, s’élança sur sa sonnette, qu’il agita vivement.
— Oui, qu’il me soit prouvé que vous n’êtes rien pour moi, c’est ce que je veux, c’est ce que je désire, et je prendrai alors la vengeance qui m’est due ! et tout grand seigneur que vous êtes, il faudra bien que vous me rendiez raison de vos outrages.
— À l’instant même, et je ne vous ferai pas attendre, dit le duc complétement rassuré, en voyant entrer quatre ou cinq domestiques de l’hôtel.
Il se tourna vers eux avec dignité, et leur montrant Piquillo du doigt, il laissa tomber ces paroles :
— Jetez-moi cet homme à la porte.
Piquillo fut saisi d’un transport de rage, et voulut s’élancer vers le duc, mais déjà les domestiques le tenaient en respect.
— Et si jamais, continua le duc, il osait se représenter à l’hôtel, je vous permets de le châtier comme il le mérite !… emmenez-le !
— Monsieur le duc, s’écria Piquillo, vous êtes placé bien haut, et moi, bien bas. J’ignore quel destin nous attend l’un et l’autre ; mais vous vous rappellerez cette journée, vous vous rappellerez que vous m’avez fait chasser de votre hôtel… vous !…
Les domestiques qui l’entrainaient l’empêchèrent d’en dire davantage.
Le duc, resté seul, sentit un instant de malaise intérieur et de mécontentement qui ne lui semblait pas naturel et qu’il avait peine à s’expliquer, mais il n’avait pas le temps de s’appesantir sur des idées pareilles ; de graves occupations le réclamaient.
Il se mit à sa toilette, et alla le soir chez le roi, comme il l’avait promis à la marquise.
XXIII.
le retour à madrid.
Piquillo avait été conduit jusqu’aux portes de l’hôtel, qui s’étaient refermées sur lui. Repoussé, outragé, la rage dans le cœur, rêvant des projets de vengeance que tout lui démontrait impossibles, il errait dans les rues de Valladolid et ne savait à quel parti s’arrêter.
Il voyait toutes ses espérances détruites, tous ses projets renversés, son avenir encore une fois anéanti.
Comment confier à Aïxa la honte de sa naissance et son humiliation, à lui, plus profonde encore ? Chassé par son père, comme un intrigant, comme un infâme, traîné dans la rue par des valets… Non, non… ni Aïxa, ni personne ne connaîtrait sa position, avant qu’il n’eût trouvé le moyen d’en sortir et de se relever aux yeux des autres comme aux siens.
Plongé dans ces réflexions, et marchant au hasard, il vit passer à côté de lui un homme qu’il crut reconnaître pour l’intendant de Fernand d’Albayda.
— Ah ! se dit-il… ingrat que j’étais, tout ne m’a pas abandonné… Fernand est ici, à Valladolid ; je lui dirai tout, et il me donnera conseil, ou plutôt, je le connais, il me tendra la main pour m’aider à sortir de l’abîme où je suis.
Heureux de cette idée, il courut après le domestique, et lui demanda où était son maître.
— Hélas ! senor Alliaga, lui répondit le vieux serviteur, notre jeune maître, que nous aimons tant, nous ne pouvons pas en jouir, il n’est jamais avec nous. À peine arrivé à Madrid, il à fallu accourir à Valladolid, et après quelques jours passés ici, à la cour, à attendre des ordres… il a reçu avant-hier celui de repartir sur-le-champ pour les Pays-Bas.
— Reparti ! s’écria Alliaga avec douleur, moi qui arrivais de Madrid !…
— Vous vous serez croisés en route…mais rassurez-vous : tout le monde assure ici que son absence ne sera pas longue, qu’il retourne dans ces maudites provinces hollandaises, non pas pour se battre, mais pour porter au marquis de Spinola l’ordre de conclure une trêve de douze ans. C’est du moins, ce que tout le monde disait hier au café de la Comédie, dont je suis un habitué. Parce que, vous comprenez, senor Alliaga, que l’Espagne n’a aucun intérêt à continuer une guerre qui nous épuise…
— Merci, merci ! se hâta de dire Piquillo, sans écouter la fin de la dissertation politique. Et il s’enfuit.
Décidément tout était conjuré contre lui, et cette dernière circonstance du départ de Fernand lui persuada qu’il y avait une fatalité qui le poursuivait, et que rien désormais ne pouvait lui réussir.
La tête en feu, la peau sèche et brûlante, il rentra à la mauvaise hôtellerie où il était descendu en arrivant à Valladolid. Il fit demander un muletier ; il voulait repartir dès le lendemain, dès le soir même pour Madrid, et de là pour Pampelune… afin de revoir sa mère, et de lui dire tous ses affronts. C’était la seule personne à qui il pouvait les avouer ! la seule devant qui il lui fût permis de rougir et de pleurer !
Mais il lui fut impossible de se mettre en route. Tant d’émotions et de fatigues, et surtout les tourments qu’il avait fallu renfermer en lui-même, avaient épuisé son courage et ses forces. Une fièvre ardente se déclara.
Sans parents, sans amis, livré à des mains étrangères, le pauvre jeune homme fut une douzaine de jours entre la vie et la mort.
L’hôtelier et sa femme étaient, par hasard, de braves gens, qui prirent un grand soin de lui. Par un second hasard, le docteur auquel ils s’adressèrent était un médecin de talent, qui ne fit rien, laissa agir la nature, et grâce à ce régime et à sa jeunesse, Piquillo fut bientôt hors de danger.
Après quelques jours de convalescence, il se revit en pleine et entière santé.
Il n’en pouvait pas dire autant de sa bourse, qui était en ce moment bien débile et bien faible ; mais pendant le peu de jours qu’avaient duré ses rêves de fortune, le senor Alliaga n’avait pas eu le temps de s’habituer à être seigneur ; il reprit le bâton de pèlerin, partit à pied de Valladolid, s’arrêtant chaque soir dans la plus humble posada et vivant à l’espagnole, c’est-à-dire avec une croûte de pain par jour, quelques légumes et l’eau de la fontaine.
Grâce à son économie et à sa sobriété, il avait encore quelques réaux dans sa poche, quand il arriva pédestrement dans cette belle ville de Madrid où, quelques semaines auparavant, il était entré avec Fernand dans une bonne chaise de poste, au bruit des mules qui agitaient leurs sonnettes et des postillons qui faisaient retentir leurs fouets.
Ce n’était pas là ce que regrettait Piquillo, mais les espérances qu’il avait alors et qui toutes s’étaient dissipées.
Il ne craignit pas de se présenter à pied à l’hôtel de don Fernand d’Albayda, son premier asile.
Il fut reçu par les gens de la maison comme s’il arrivait en équipage…… Les bons maîtres font les bons domestiques.
On lui apprit que deux ou trois fois déjà l’on était venu s’informer s’il était de retour, et que depuis dix jours, un billet l’attendait.
Ce billet, on le lui remit ; et quelle fut sa surprise ! il ne pouvait s’y méprendre, l’adresse en était écrite de la main d’Aïxa. Il l’ouvrit en tremblant et lut ce peu de mots :
« Nous sommes à Madrid ; dès que vous arriverez, accourez nous voir, car nous sommes bien malheureuses et nous avons besoin de nos amis… c’est pour cela que Carmen et moi avons d’abord pensé à vous. Nous vous attendons ? Aïxa. »
Et au bas : « Nous demeurons en ce moment dans la rue d’Alcala, à l’hôtel de madame la comtesse d’Altamira. »
Piquillo fut saisi d’un serrement de cœur inexprimable ; malgré la joie inespérée qu’il éprouvait de revoir Aïxa, un frisson soudain parcourut ses veines. Il comprenait que quelque grande douleur pesait sur eux tous. Aïxa et Carmen ne pouvaient pas être malheureuses, sans qu’il ne fût malheureux.
Il courut à l’instant même à l’hôtel d’Altamira.
On ne voulait pas le laisser entrer. Il se nomma ; toutes les portes lui furent ouvertes.
Il franchit un vaste escalier de marbre blanc, traversa plusieurs pièces richement décorées, arriva à un petit appartement dont il ouvrit brusquement la porte, et vit les deux sœurs, pâles et les joues sillonnées par les pleurs, assises sur un canapé ; elles se tenaient par la main.
À l’aspect de Piquillo, elles poussèrent Un cri et se levèrent.
Toutes les deux étaient vêtues de noir.
— Vous à Madrid ! s’écria Piquillo ; puis regardant d’un œil inquiet autour de lui :
— Je ne vois pas votre père ! où est-il ?
Carmen cacha sa tête dans ses mains et se mit à sangloter.
— Où est-il donc ?
— Mort ! répondit Aïxa.
Piquillo poussa un cri de surprise et de désespoir, et resta quelque temps anéanti.
— Mon bienfaiteur n’est plus ! s’écria-t-il, et je n’étais pas là pour le soigner et le servir, pour recueillir ses dernières volontés !
— Il vous a appelé et vous a béni ! dit Carmen.
— Il vous a recommandé de veiller sur sa fille, dit Aïxa.
— Je vous obéirai, mon maître ! s’écria Piquillo en levant les yeux au ciel. C’est vous qui avez recueilli l’orphelin et qui l’avez élevé ; il était sans asile, et vous lui en avez donné un ; il n’avait pas de quoi vivre, et vous l’avez fait asseoir à votre table. Bien plus encore, il n’avait que des vices, et vous lui avez donné vos vertus ! Il eût été un méchant, et en vous regardant, mon maître, il est devenu bon ! Aussi vous vivrez toujours pour lui, et il restera le serviteur de vos enfants comme il était le vôtre.
Les deux jeunes filles lui tendirent la main, et répondirent en peu de mots à toutes les questions dont il les accablait.
Quelques jours après son départ et celui de Fernand, le vieillard s’était tout à coup affaibli et ne pouvait presque plus marcher ; mais en pensant au prochain mariage de Fernand et de sa fille, il se sentait si heureux que le bonheur le soutenait. Il ne voulait pas mourir avant d’avoir été témoin de cette union, et pendant quelques jours on reprit espoir. Mais une attaque de goutte rendit le danger imminent.
On avait écrit à Fernand. Il n’était plus à Madrid et venait de repartir pour Ostende, où l’attendait le marquis de Spinola, son général.
On avait écrit à la comtesse d’Altamira, sœur de don Juan d’Aguilar. Elle accourut pour recevoir les derniers soupirs du général, qui ne pensait ni à lui ni à ses souffrances, mais seulement à sa fille et à la situation où il allait la laisser.
La comtesse lui promit qu’elle emmènerait Carmen, et que sa nièce resterait près d’elle, dans sa maison, jusqu’à son mariage avec don Fernand d’Albayda.
Le vieillard, qui pouvait à peine parler, approuva des yeux, tendit la main à Aïxa prosternée au pied de son lit… et murmura ces mots à l’oreille de la jeune fille : Tu leur diras… mon enfant… que jusqu’au dernier moment j’ai tenu ma promesse !…
Puis, il bénit sa fille bien-aimée, prononça le nom de Fernand, et l’âme du juste remonta vers les cieux.
La comtesse permit d’abord à sa nièce de se livrer à toute sa douleur. Au bout de quelques jours, et tout en l’accablant des plus vifs témoignages de sympathie et de tendresse, elle lui donna à entendre que des affaires importantes la réclamaient à Madrid, qu’elle était obligée d’y retourner ; et elle lui rappela les dernières volontés de son père.
Carmen ne voulait point se séparer d’Aïxa, et Aïxa, dans un pareil moment, ne pouvait abandonner sa sœur orpheline. La comtesse proposa alors d’emmener avec elle les deux jeunes filles, et toutes deux acceptèrent. Mais elle prit Carmen en particulier, et lui demanda quelle était Aïxa.
— C’est ma sœur, répondit naïvement Carmen.
— Mais quelle est-elle ?
— Je n’en sais rien.
— Sa naissance, sa position ?
— On ne m’en a jamais parlé, ni elle, ni mon père.
— Mais sa famille et ses parents ?
— Elle n’en a pas besoin, puisque c’est ma sœur.
La comtesse ne put obtenir d’autres renseignements. Elle se tourna alors vers Aïxa, et avec son regard le plus séduisant et sa voix la plus douce, avec les marques du plus tendre intérêt,
— Qui êtes-vous ? lui dit-elle.
— La sœur de Carmen, la fille adoptive de don Juan d’Aguilar.
— Et votre famille à vous ?
— Don Juan seul la connaissait.
— Et vous, ma chère, que savez-vous d’elle ?
— Je sais qu’elle m’aime !
— Et pourquoi ?
— Parce qu’elle m’a confiée à don Juan d’Aguilar !
— Vous confiera-t-elle à moi ?
— Je ne pense pas qu’elle veuille me séparer de Carmen ; ses ordres en décideront.
— Vous les lui avez donc demandés !
— Non… mais elle me les enverra !
— Comment ?
— Je l’ignore… mais je les recevrai.
— Qui vous le fait croire ?
— C’est qu’elle veille sur moi !
C’est tout ce que la comtesse découvrit sur Aïxa, et en attendant que son adresse ou le hasard lui en apprit davantage, elle emmena les deux jeunes filles à Madrid.
Aïxa et Carmen, qui vivaient très-retirées, n’avaient d’autre désir que de rester ensemble en tête-à-tête, et la comtesse, qui avait en ce moment beaucoup d’occupations, car la cour était revenue passer l’hiver à Madrid, la comtesse respectait leur solitude, et se permettait bien rarement de la troubler, attention dont les jeunes filles lui étaient très-reconnaissantes.
Aïxa avait appris par les lettres de Piquillo tous les détails de son voyage avec Fernand et de son arrivée à Madrid. Elle savait que Fernand lui avait offert un logement dans son hôtel. Elle y envoya sur-le-champ. Mais Piquillo était absent ; il était parti pour Valladolid, sans doute, pensèrent les jeunes filles, pour rejoindre Fernand ; aussi son retour fut un grand bonheur pour les deux orphelines.
C’était avec lui, avec lui seul, leur ami d’enfance, qu’elles pouvaient parler de don Juan d’Aguilar et des jours heureux qui s’étaient écoulés auprès de lui.
Tous ces détails de leurs plaisirs et de leurs jeux, tous ces retours vers le temps passé, tous leurs souvenirs enfin… seul bonheur d’un bonheur qui n’est plus, il n’y avait que lui qui pouvait les comprendre. Et puis Piquillo, si doux, si aimable, si instruit, savait toujours deviner le sujet de conversation qui pouvait charmer ou distraire leurs douleurs.
Il leur parlait chaque jour de Fernand avec une amitié, un dévouement, un enthousiasme dont les yeux de Carmen le remerciaient.
Aïxa se contentait d’écouter.
Il avait été convenu que les deux sœurs demeureraient chez la comtesse jusqu’au mariage de Carmen et de Fernand, qui maintenant ne pouvait avoir lieu que dans un an au plus tôt ; que Piquillo continuerait de loger à l’hôtel d’Albayda, ainsi que son généreux propriétaire le lui avait proposé ; mais que chaque jour il viendrait voir celles qu’il appelait les filles de son maître. C’était son devoir, et il aurait pu ajouter, son bonheur.
Aïxa lui avait dit un jour, en présence de Carmen : « Le général, qui pensait à tout le monde, ne vous a pas oublié dans son testament : il vous a légué deux cents pistoles ; les voici. » Et elle les lui remit.
Piquillo, attendri jusqu’aux larmes, serra la main de Carmen et sortit pour cacher son émotion. Il ne voulait pas pleurer devant elle !
Quand il fut sorti, Carmen dit à voix basse à sa sœur :
— Tu as bien fait, et il faut bien lui laisser son erreur. Le testament de mon père ne parlait que de cent pistoles.
— Tu crois ? dit Aïxa.
— J’en suis sûre.
— C’est donc ma faute, répondit-elle en souriant, et c’est à moi de payer mon étourderie.
— Non pas ! Ce que tu as dit au nom de mon père est sacré ! Cela me regarde.
— Les fautes sont personnelles, ma sœur, et les miennes… sont à moi !
— Je ne l’entends pas ainsi !
— Et moi, je le veux ! dit Aïxa avec un air d’autorité qu’elle prenait rarement, mais contre lequel il n’y avait jamais à revenir.
C’est ainsi que le général se trouva avoir légué deux cents pistoles à son ancien page, qui lui en garda une éternelle reconnaissance.
Piquillo avait écrit à Pampelune à sa mère. Il lui avait appris l’événement qui le retenait à Madrid et l’empêchait d’aller la rejoindre ; il lui racontait en même temps son voyage à Valladolid, et l’accueil qu’il avait reçu du duc d’Uzède.
Il finissait sa lettre en l’engageant à quitter la Navarre, à venir le retrouver à Madrid, où il espérait, lorsque don Fernand d’Albayda, actuellement son seul protecteur, serait de retour, obtenir un emploi qui le ferait vivre honorablement, lui et sa mère, et la senora Urraca, sa grand’mère !
Il les prévenait qu’il avait retenu pour elles, dans un quartier retiré de la ville, un appartement à l’hôtel de Vendas-Novas.
Après avoir rempli ses devoirs de bon fils, après avoir écrit cette lettre et l’avoir mise à la poste, il revenait chez la comtesse d’Altamira et traversait la rue de Santo-Domingo, où était alors le palais de l’inquisition.
Une grande foule assemblée l’empêcha de passer. Les rangs étaient serrés, et un murmure sourd et prolongé circulait parmi les assistants.
— C’est une indignité ! c’est une horreur ! disaient les uns.
— On ne traite pas ainsi de bons catholiques et de vrais chrétiens ! disaient les autres.
— On doit avoir plus d’égards ! criait un groupe de femmes.
Piquillo demanda à son voisin dans la foule, pourquoi cet attroupement.
Et l’homme de la rue lui répondit d’un ton animé :
— Imaginez-vous, seigneur cavalier, qu’il doit y avoir dans trois jours un auto-da-fé dans la bonne ville de Madrid. Tous ceux qui doivent y figurer sont extraits des prisons de l’inquisition pour entrer en chapelle ; c’est à midi que le cortége et la procession devaient sortir…
— Eh bien ?…
— Eh bien ! c’est une horreur… c’est une infamie…
— Oui, sans doute ! s’écria vivement Piquillo.
— Sans doute, répéta son interlocuteur avec un redoublement de colère ; voilà deux heures qu’on nous fait attendre ! Deux heures viennent de sonner à la paroisse Saint-Dominique, et je suis ici depuis midi !
Piquillo resta stupéfait.
— Et moi donc ! cria un muletier, j’étais ici bien avant midi.
— Et moi depuis ce matin ! dit une marchande de fruits et légumes, tant j’avais peur de ne pas trouver de place.
— On dit que la cérémonie sera belle, continua le muletier, et qu’ils seront douze.
— On m’a dit quinze, s’écria une cabaretière.
— Je suis sûre que c’est douze, reprit la marchande de fruits et légumes. Mon compère, qui est un familier du saint-office, un homme très-bien… Vous le connaissez, ma voisine…
— Si je le connais ! dit la cabaretière, il s’est grisé dernièrement chez nous !
— Mon compère m’a donné tous les détails, ils ne sont que douze : sept hérétiques purs et simples ; mais en revanche, trois juifs et deux Mauresques !
— Ah ! ça sera intéressant !… dit la cabaretière.
— Il y en a là qui sont depuis cinq ans dans les cachots de l’inquisition, au pain, à l’eau, et aux fers dans la semaine.
— En vérité ! dit le muletier.
— Et la question le dimanche.
— Voyez-vous ça !
— Et rien n’a pu les toucher, rien n’a pu les convertir.
— Les endurcis, les enragés !
— Rien n’a pu leur faire aimer la religion catholique, apostolique et romaine.
— Aussi on est trop bon !
— On n’en brûle pas assez.
— Voilà le premier auto-da-fé depuis le nouveau règne.
— Tandis que sous le dernier…
— Sous le saint roi Philippe II…
— Il n’y avait pas de semaine où il n’y eût pour nous quelque chose à voir… quelles processions ! quel cortéges !
— Des spectacles magnifiques !
— Et jamais on ne nous faisait attendre.
— Ça n’était pas comme aujourd’hui.
— À l’heure dite, ça commençait.
— Quelquefois avant !
— C’était juste… il y en avait tant… il fallait s’y prendre de bonne heure.
— Moi qui vous parle, dit d’un air de jubilation un vieillard en cheveux blancs, j’en ai vu brûler quatre-vingt-dix en un jour…
Et la foule regarda le vieillard avec admiration.
— Ah ! dame… c’était beau, quatre-vingt-dix ! tous des Mauresques, et autant la veille… Les pauvres gens en étaient harassés… ils n’en pouvaient plus…
— Qui donc ?
— Les familiers du saint-office et les employés au bûcher ! mais le roi Philippe II, arrivé au premier et resté jusqu’au dernier, n’avait pas plus l’air fatigué que vous et moi.
— C’était un roi, celui-là, un défenseur de la foi !
— Mon Dieu ! l’inquisiteur actuel et l’archevêque de Valence, Ribeira, ne demanderaient pas mieux…
— C’est le duc de Lerma qui n’ose pas ?
— On dit même que l’auto-da-fé de mardi prochain a été obtenu malgré lui.
— Comment, c’est mardi prochain ?
— Comptez plutôt… ils vont sortir de prison aujourd’hui vendredi… ils resteront, comme c’est l’usage, trois jours en chapelle… samedi, dimanche et lundi… Vous voyez bien que ça ne peut pas avoir lieu avant mardi.
— Et moi qui, ce jour-là, ai des voyageurs à conduire, dit le muletier, je ne pourrai pas y être.
— Ni moi non plus, dit le vieillard, j’ai de l’argent à toucher à Hénarès !
— Comme si on ne devait pas choisir pour des cérémonies pareilles un jour où personne n’a rien à faire !
— Le dimanche, par exemple, après la messe.
— Ah ! ah ! enfin ! s’écria-t-on de toutes parts ; et un murmure de satisfaction succéda aux cris d’impatience qui déjà se faisaient entendre.
Les portes de l’inquisition venaient de s’ouvrir.
Depuis longtemps Piquillo aurait voulu sortir de la foule, mais elle s’était renfermée et agglomérée derrière lui, et elle était devenue si compacte qu’il eût été aussi impossible de reculer que d’avancer.
Il avait donc été obligé d’entendre les conversations qui s’échangeaient autour de lui et d’assister au spectacle qu’on attendait avec tant d’impatience.
Quelques familiers du saint-office précédaient les condamnés, qui commencèrent à paraître, et à ces cris : Les voilà ! les voilà ! la foule qui s’ébranlait fut repoussée par un détachement d’alguazils et rejetée contre les murailles avec une telle force que Piquillo manqua d’être écrasé.
Par bonheur une borne assez élevée se trouvait derrière lui, et porté par le flot populaire, il y prit pied, y resta et domina ainsi sans danger cette mer tumultueuse et agitée.
Après les familiers du saint-office venaient les inquisiteurs, puis la bannière de saint Dominique ; les condamnés s’avançaient lentement deux par deux.
Piquillo avait beau faire, il ne pouvait s’empêcher de contempler tous les détails de cet horrible cortége. Posé sur un piédestal, juste en face de la porte du palais, lequel était élevé de quelques marches, il voyait tous ces malheureux descendre et défiler devant lui.
Aussi pâle, aussi tremblant qu’eux, il était prêt à se trouver mal. Il lui semblait être en proie à des vertiges, à une hallucination, surtout lorsqu’au milieu de ces visages inconnus, il crut voir des traits de femme ; des traits bien changés sans doute, mais qui lui rappelaient ceux d’une jeune fille qui avait été autrefois sa bienfaitrice et son bon ange !… cette pauvre petite Juanita, que depuis cinq ou six ans il n’avait plus revue !
— Non, disait-il, non, ce n’est pas possible ! un nuage couvre mes yeux, et cette apparition… ce fantôme qui lui ressemble… est un rêve !
Tout à coup il poussa un cri déchirant, qui heureusement ne fut pas entendu au milieu du tintement des cloches, du chant des prêtres et des acclamations de la multitude.
Ce n’était point un rêve, mais une horrible réalité ; car à côté de la jeune fille, il venait de voir la figure autrefois si joyeuse, à présent si pâle et si bouleversée, du pauvre barbier Aben-Abou, dit Gongarello, et si Piquillo avait pu conserver le moindre doute, ce doute eût été dissipé par les cris de la foule, qui les désignait du doigt en criant :
— Les Maures ! les Maures !… ce sont ces deux-là !
Et dans la foule, on vit des femmes, des mères exhausser leurs enfants dans leurs bras en leur disant :
— Tiens ! les vois-tu ?
Tout le cortége défila… s’éloigna peu à peu, se dirigeant vers la chapelle où on allait les renfermer. En un instant la rue se trouva déserte ; la foule fatiguée mais non assouvie, avait suivi la procession pour se rassasier plus longtemps encore du plaisir de voir des malheureux !
Les grilles de fer du palais de l’inquisition venaient de se refermer, Piquillo se trouva seul sur sa borne. Depuis quelques instants il ne voyait, ni n’entendait plus rien. La fureur, l’indignation, l’effroi, s’étaient succédé en lui avec tant de rapidité, que toutes ses facultés étaient anéanties : c’était à devenir fou !
— Non, s’écria-t-il, ce ne sont point des hommes, mais des bêtes fauves, mais des démons ! Sortons de cet enfer !
Et il s’enfuit, courant vers son paradis à lui, vers ses anges, vers les deux jeunes filles, qui, en le voyant, furent effrayées de sa pâleur et du désordre de ses traits.
— Qu’avez-vous donc ? que vous est-il arrivé ?
Piquillo était tombé dans un fauteuil et ne pouvait articuler un mot.
— Parlez, de grâce ! parlez !
Il reprit enfin ses sens, rassembla ses idées et raconta tout ce qu’il venait d’entendre… surtout ce qu’il venait de voir, et le sort qui menaçait le pauvre Gongarello le barbier, et Juanita sa nièce, la première amie de Piquillo.
— Les infâmes ! s’écria Aïxa, brûler de pauvres gens parce qu’ils ont été élevés dans une autre croyance que la leur !
— Que dis-tu ? s’écria Carmen effrayée.
— Rien, dit Aïxa en s’efforçant de sourire, le récit de Piquillo m’avait indignée ! J’en suis encore toute tremblante !
— C’est vrai !… tes mains sont crispées… je peux à peine les ouvrir… l’on dirait d’une attaque de nerfs…
— Non… non, c’est passé… Mais toi, Piquillo, que dis-tu de cela ?
— Moi ! senora, je les sauverai, ou je me ferai mettre avec eux au bûcher !
— C’est absurde ! s’écria Carmen.
— Oui… absurde, répéta froidement Aïxa… mais c’est bien !
Et il y avait quelque chose dans son accent qui disait :
— J’en ferais autant… si je le pouvais !
— Mais comment les sauver ? demanda Piquillo.
— Fernand d’Albayda pourrait seul nous aider. Par malheur, il n’est pas ici, dit Carmen en soupirant.
— D’ailleurs, Fernand lui-même n’y pourrait rien… il n’y a pas en Espagne de pouvoir qui puisse lutter contre celui de l’inquisition.
— Si cependant le roi voulait, dit Carmen, le roi d’Espagne !
— Lequel ?… demanda Aïxa… Philippe ou le duc de Lerma ? Philippe ne le pourrait pas.
— Et le duc de Lerma n’oserait le tenter, dit Piquillo, se rappelant ce qu’il avait entendu dans la foule.
— Oui, continua Aïxa, on prétend qu’il n’est ni méchant ni cruel.
Cette assurance fit plaisir à Piquillo, toujours dans la supposition que le duc pouvait être son grand-père.
— Mais il tient à garder le pouvoir, et il craindrait de le compromettre en se brouillant avec l’inquisition.
— Attendez, dit Carmen, je vais en parler à ma tante, la comtesse d’Altamira ; elle connaît mieux que nous la cour et tout ce qui s’y passe. Elle est bonne et charitable et nous aidera, ne fût-ce que de ses conseils. Attendez-moi, je reviens dans l’instant.
Et elle sortit.
Resté seul avec Aïxa, qui marchait dans la chambre d’un air agité et sans prononcer une parole, Piquillo lui dit :
— Avez-vous quelque espérance en cette démarche ?
— Aucune.
— Ces pauvres gens vont donc périr ?
— Ce ne sera pas du moins sans que j’aie tenté de les sauver ? s’écria Aïxa. Malheur à qui ne vient pas en aide à ses frères !
Et voyant que Piquillo la regardait avec étonnement en répétant ces mots : Ses frères !
— Oui, lui dit-elle à voix basse, ce sont les tiens, je le sais. Le sang maure coule dans tes veines.
— Qui vous l’a dit ?
— Personne. Je le sais depuis longtemps, depuis le jour où pour la première fois nous t’avons vu, au carrefour de la forêt, lorsque tu tombas du ciel ou de ton arbre pour venir à notre secours.
— Et comment alors l’avez-vous deviné ? s’écria Piquillo, dont la surprise redoublait.
— Bien aisément ! répondit Aïxa en riant, à travers les manches de ton pourpoint déchiré il était facile d’apercevoir ces caractères arabes que portent les enfants du peuple dans votre tribu.
— Et jamais vous ne m’en avez parlé.
— À quoi bon ? il vaut mieux, dans ton intérêt, que ce soit un secret pour tout le monde, maintenant plus que jamais. Tu vois, par ce pauvre barbier et par sa nièce, comme on traite les Maures.
— Que ferons-nous donc pour les sauver ?
— Si on le pouvait à prix d’argent… il y aurait quelque espoir… le crois-tu ?
— Impossible… il y aurait trop de monde à gagner, et nous n’avons devant nous que trois jours.
— Écoute, dit Aïxa à voix basse, je puis compter sur toi ?
— À la vie et à la mort !
— Écoute bien ! quand même nous réussirions, ce que je n’ose croire, tu ne diras jamais à personne, pas même à Carmen, pas même à ces pauvres gens, que j’ai été assez heureuse pour contribuer à leur délivrance.
— Piquillo la regarda avec étonnement, mais il répondit : Je le jure !
— Attends-moi donc, dit la jeune fille.
Aïxa se mit à une table, écrivit rapidement une lettre… qu’elle déchira, en écrivit une seconde, qui eut le même sort ; enfin elle en composa une troisième qui ne renfermait que quelques lignes.
Elle la relut, en eut l’air plus satisfaite, la mit sous une enveloppe, la cacheta et écrivit l’adresse tout en parlant à Piquillo et en lui disant :
— Voilà tout ce que je peux faire. C’est à toi maintenant, et je ne saurais t’en indiquer les moyens, c’est à toi de t’arranger pour que ce billet parvienne promptement, et secrètement surtout, à la personne elle-même !
Elle appuya sur ces derniers mots :
— Maintenant, prends cette lettre.
Elle la lui remettait quand on entendit la porte s’ouvrir.
— Cache-la-lui ! dit-elle vivement.
La lettre était déjà serrée dans la poche de Piquillo, lorsque Carmen rentra avec sa tante.
Celle-ci venait leur exprimer tous ses regrets et leur expliqua comment, malgré sa place de dame d’honneur au palais et de gouvernante des enfants d’Espagne, elle était fort mal avec le premier ministre ; comment son crédit se bornait maintenant à faire des vœux pour ses amis ; comment enfin le moment était des plus mal choisis pour solliciter en faveur des Mauresques.
Personne à la cour n’oserait s’y hasarder, attendu que l’on méditait contre eux quelques grands projets ; que la persécution recommençait ; qu’il y avait ordre exprès de baptiser, de gré ou de force, tous ceux qui auraient jusqu’à présent échappé au baptême ou qui tenteraient de s’y soustraire ; et que la sainte inquisition permettait même au besoin de se défaire des relaps ou des hérétiques obstinés.
Après ce long discours, qui développait seulement la volonté bien avérée que la comtesse avait de ne rien faire, Piquillo salua respectueusement les trois dames et sortis.
À peine fut-il rentré à l’hôtel d’Albayda, et seul dans sa chambre, qu’il tira de sa poche le mystérieux papier, et crut s’être trompé en lisant la suscription. Il se frotta les yeux, regarda une seconde fois, et ne put revenir de sa surprise en voyant que la lettre était adressée à Sa Majesté la reine d’Espagne.
Il cherchait vainement à s’expliquer comment Aïxa, jeune orpheline, élevée au fond de la Navarre, qui depuis huit jours seulement était arrivée à Madrid et ne connaissait personne à la cour, comment Aïxa osait et pouvait écrire à la reine !
C’était un événement qui renversait toutes ses conjectures, changeait toutes ses idées, et le faisait entrer dans un ordre de choses où sa raison ne pouvait ni le servir ni le guider.
Cependant, il n’y avait pas d’explication à demander à Aïxa ; il fallait lui obéir et la seconder ; et ce nouveau point était pour Piquillo plus embarrassant encore que le premier, attendu qu’il ne s’agissait plus de comprendre ou de deviner, mais d’agir soi-même et d’exécuter.
Or, comment pénétrer dans le palais ? comment y être admis ? comment parvenir jusqu’à la reine ? toutes choses impossibles pour lui, qui n’avait de connaissance et de parenté à la cour que celle du duc d’Uzède, parenté qu’il n’était plus tenté de réclamer.
Et quand même un bon hasard le jetterait sur le passage de la reine, comment, au milieu de ses courtisans et de ses gardes, oser remettre une lettre à Sa Majesté !
Il eut bien l’idée d’envelopper le billet dans un papier qui aurait la forme d’une pétition, et, dût-il être écrasé sous les pieds des chevaux ou sous les roues du carrosse royal, de la lancer par la portière ; mais d’après les règles de l’étiquette, cette pétition ne serait probablement pas lue d’abord par la reine… Elle ne pouvait pas les lire toutes. Remise par elle à une de ses dames d’honneur, à la camariera mayor, c’est celle-ci qui en prendrait connaissance, et Aïxa lui avait recommandé de remettre cette lettre secrètement et à la reine elle-même.
Piquillo cherchait, ne trouvait rien, et déjà la première journée était écoulée.
L’œil fixé sur la pendule, il voyait les minutes et les heures s’enfuir rapidement, et cette lettre était toujours entre ses mains ; le barbier et sa nièce n’avaient plus que deux jours à vivre.
Dans son désespoir, il sortit, il alla se promener autour de Buen-Retiro, où était alors la cour, revenue depuis quelques jours de Valladolid.
Il espérait que l’aspect des lieux lui inspirerait quelque moyen heureux, quelque idée subite. Il regardait toutes les voitures qui entraient dans les jardins ou qui en sortaient, car il y avait ce jour-là grande réception ; il voyait toutes les fenêtres du palais richement illuminées. Il se disait : La reine est là… et sans penser à ce qu’il faisait, il s’avançait de quelques pas pour franchir la grille dorée qui fermait les jardins.
Plusieurs fois déjà il avait excité l’attention des sentinelles qui veillaient aux portes ; enfin un soldat lui enjoignit de s’éloigner, et comme il résistait, plusieurs le couchèrent en joue de leur arquebuse.
— Ah ! se disait Piquillo, s’il ne s’agissait que de passer à travers les arquebusades pour parvenir jusqu’à la reine… je m’élancerais bien pour arriver ou être tué… mais si j’étais tué, qui remettrait cette lettre ?… qui sauverait la pauvre Juanita ?
Et il s’éloigna lentement. La nuit était venue ; il rentrait à son hôtel par la rue d’Atocha, qui était fort sombre, excepté dans un seul endroit, d’où jaillissait une éclatante lumière. Cette vive clarté venait d’une boutique splendidement illuminée, et cette boutique était celle du senor Andrea Cazoleta, parfumeur de la cour.
— Ah ! s’écria Piquillo, je crois que le ciel me vient en aide.
Et il s’élança dans la boutique.
Il trouva le senora Cazilda seule et rêveuse au milieu de ses pommades et de ses eaux de senteur. Elle poussa un cri de joie en apercevant Piquillo. L’ingrat, depuis son retour à Madrid, n’avait pas été la voir. Sans trop se l’expliquer à lui-même, il se rappelait, non le service qu’elle lui avait rendu, mais l’affront et l’humiliation qu’elle lui avait involontairement procurés, et sa vue ne pouvait que lui être pénible.
Dans cette circonstance, c’était tout différent : il s’agissait non de son agrément à lui, mais du salut de ses amis.
— Vous voilà donc ! s’écria-t-elle ; que vous est-il arrivé ? il faut que vous ayez bien mal rempli votre message. Le duc était furieux contre vous, et nous a fait dire qu’il nous retirerait sa pratique si l’on ne vous renvoyait de notre boutique, satisfaction qu’il nous a été facile de lui donner, et nous lui avons déclaré que, dès ce moment, et pour lui complaire, vous ne faisiez plus partie de notre maison.
— Et oui, vraiment, dit Piquillo en soupirant, j’ai été fort mal reçu, car j’allais lui parler en faveur d’une personne pour qui il n’est pas permis de demander grâce, et qui cependant en a grand besoin, pour Gongarello, votre parent.
— Vous savez donc ce qu’il est devenu ?
— Il est depuis cinq ans dans les prisons de l’inquisition.
— J’en étais sûre ! il ne pouvait pas s’empêcher de parler et de raconter des histoires, et nous autres pauvres Mauresques, il faut nous taire ! Je ne dis jamais rien à mes pratiques que le prix des marchandises ; mais lui… quelques plaisanteries qui lui seront échappées dans sa boutique devant un inquisiteur auront suffi pour compromettre sa liberté.
— Et ses jours… et ceux de sa nièce.
— Jésus Maria ! que me dites-vous là !
Piquillo lui raconta alors, à voix basse, le spectacle dont il avait été témoin le matin.
La pauvre Cazilda devint froide comme un marbre, et se mit à trembler de tous ses membres. Elle aimait Gongarello, son cousin, et surtout la petite Juanita, sa cousine ; et puis, ainsi que les Maures, alors sujets de l’Espagne, tous ces actes de persécution contre leurs coreligionnaires la remplissaient de compassion pour les pauvres victimes et de terreur pour elle-même.
— Et dans deux jours ils ne seront plus ! s’écria la pauvre femme en pleurant.
— Peut-être, dit Piquillo, dépend-il de vous de les sauver !
— Comment cela ? parlez ! je ferai tout au monde, pourvu que mon mari n’en sache rien.
— C’est justement ce que j’allais vous recommander.
— Bien ! bien ! dit-elle. Alors, allez m’attendre dans l’arrière-boutique, car le voilà, je crois.
En effet, c’était le senor Cazoleta qui rentrait pour mettre de l’ordre dans ses comptes, et écrire la recette de la journée. Elle avait été bonne ; une fête qui se préparait à la cour lui avait valu de toutes ses pratiques de nombreuses commandes.
Dès que sa femme le vit installé devant ses livres de doit et avoir, elle le laissa gardien du magasin, et ; sous prétexte de ne point le déranger dans ses calculs, elle se réfugia dans l’arrière-boutique, où Piquillo l’attendait.
— Parlez, maintenant… parlez ! s’écria-t-elle.
Et Piquillo, le cœur plein d’espoir, lui dit à voix basse :
— Vous et votre mari, vous êtes parfumeurs de la cour ?
— Certainement.
— Et de la reine ?
— Cela va sans dire. Vous n’avez donc pas vu au-dessus de notre boutique les armes royales ?…
— À merveille ! avez-vous entrée au palais ?
— Tous les matins… quand Sa Majesté me fait appeler, ou quand j’ai quelque chose de nouveau à lui offrir ou à lui proposer.
Piquillo lui sauta au cou et l’embrassa.
— Prenez donc garde ! s’écria Cazilda, mon mari qui est dans la boutique !
— Ne craignez rien, il écrit.
Et il continua à voix basse :
— Pouvez-vous demain vous présenter chez Sa Majesté. avec des gants, des sachets, des parfumeries nouvelles ?
— Oui, sans doute.
— Eh bien ! j’ai là une supplique, une demande en grâce, adressée par ce pauvre Gongarello à la reine…
— En vérité !
— Si cette pétition est lue par Sa Majesté… par elle-même ! je vous réponds que Gongarello est sauvé.
— Vous croyez ? dit Cazilda toute tremblante de joie.
— Mais prenez garde… Il faut que cette pétition soit remise par vous sans qu’on la voie.
— Il y a d’ordinaire une ou deux dames d’honneur dans le cabinet de toilette de la reine… pas toujours, mais souvent.
— C’est là le terrible !
— On pourrait cependant… Attendez… Cette supplique tient-elle beaucoup de place ?
— C’est une lettre ordinaire.
— Je la glisserai dans un sachet parfumé.
— Très-bien !
— Avec les jarretières de la reine… elle seule y touche.
— À merveille ! demain, de bon matin, avant d’aller au palais, passez à l’hôtel d’Albayda, je vous remettrai cette pétition.
Il se leva et traversa la boutique. Le parfumeur, en le voyant, fit la grimace et le salua d’un air de mauvaise humeur, tandis que Cazilda le reconduisait jusqu’à la porte en lui adressant le plus gracieux sourire.

XXIV.
la reine et le ministre.
Le lendemain, après la messe de midi, il se passa au palais un événement qui mit toute la cour en émoi, et ouvrit le plus vaste champ aux conjectures.
Les politiques de Madrid en causèrent pendant toute une semaine à la puerta del Sol ; les valeurs publiques et commerciales s’élevèrent considérablement, et les ambassadeurs écrivirent le jour même à leurs cours respectives.
La reine, qui depuis plusieurs années ne voyait pas le duc de Lerma, lui avait fait dire par la comtesse d’Altamira, sa première dame d’honneur, qu’elle désirait lui parler.
Le duc, étonné et presque effrayé d’une faveur dont il ne pouvait comprendre le motif, se hâta de se rendre auprès de sa souveraine, et quand ils furent seuls, quand les portes furent closes, la reine, avec sa voix douce et calme, lui dit :
— Monsieur le duc, depuis plusieurs années, vous jouissez en Espagne du règne le plus paisible.
Le ministre, surpris d’une attaque aussi franche et aussi hardie, se levait pour s’incliner et réclamer. La reine lui fit signe de rester assis, et continua avec la même tranquillité :
— Je ne vous en fais pas de reproche ; que la volonté de mon époux soit faite ! Il vous a fait roi par sa grâce, comme il l’est lui-même par celle de Dieu, et vous exercez par intérim. On pouvait gouverner mieux, on pouvait gouverner plus mal ; d’autres que moi vous demanderont compte de vos actes, ce soin-là ne me regarde pas.
Mais pendant que vous siégez au conseil, que vous décidez de la paix et de la guerre, moi, monsieur le duc, séparée de mon mari, reléguée dans mes appartements, éloignée de tout pouvoir, surveillée même par vous dans mes relations d’amitié ou de famille, j’ai l’air de céder comme tout le monde à votre ascendant, à votre empire, à votre habile politique. Détrompez-vous : ce que vous croyez devoir à votre adresse, vous ne le devez qu’à ma volonté ou à mon indifférence, parce que peu m’importe qu’il en soit ainsi.
Le duc voulut balbutier quelques mots ; la reine ne lui en laissa pas le temps, et continua d’une voix forte et assurée :
— Vous vous croyez fort parce que je vous permets d’exploiter la faiblesse de votre maître. Vous vous croyez clairvoyant parce que je ferme les yeux, et puissant parce que je vous laisse faire ; mais j’ai voulu vous dire ceci, monsieur le duc, et vous me croirez sans peine, car vous connaissez le roi aussi bien que moi : dès ce soir, si je le veux, si je dis un mot, la porte de cette chambre sera ouverte au roi, et demain la sienne vous sera fermée.
Le duc tressaillit.
— De toute cette semaine vous ne pourrez arriver jusqu’à lui, et la semaine prochaine vous serez renvoyé.
Le duc pâlit.
— Ce maître, qui vous adore et ne peut se passer de vous, ne vous donnera ni un regret ni un souvenir : votre présence seule vous rendait nécessaire, votre absence vous rendra inutile ; qui est loin de ses yeux, est bientôt loin de son cœur, et, dans quelques jours, il ne saura même pas si vous existez !
Une sueur froide couvrait le front du duc… et à chaque mot que disait la reine, il se répétait en lui-même : C’est vrai… elle ne le connaît que trop bien !
— Votre Majesté me permettra-t-elle de lui répondre ? dit le duc en cherchant à cacher son émotion.
Le duc ne manquait pas d’adresse. Il avait d’un coup d’œil compris, ou du moins cru comprendre sa position et deviner les intentions de la reine.
Avec une résolution dont on ne l’aurait peut-être pas cru capable, il prit sur-le-champ un parti, c’était d’offrir lui-même ce qu’on allait lui demander ou lui prendre.
— Tout ce que dit Votre Majesté est vrai : mais en m’accusant, elle a pris elle-même soin de me défendre et de me justifier. Si le caractère du roi est tel que vous venez de le dépeindre, n’était-ce point alors le devoir de ses fidèles serviteurs d’aplanir pour lui le chemin, et de le guider sur la route ?
Je conviens avec vous, madame, que le guide qu’il a choisi pouvait être lui-même plus éclairé, plus fort, plus habile, et que le roi avait, sans sortir de son palais, et près de sa royale personne, un soutien, un appui préférable. Mais pourquoi cette intelligence supérieure s’est-elle jusqu’ici tenue à l’écart ? pourquoi a-t-elle craint de se montrer, et ne s’est-elle révélée qu’aujourd’hui, à nous, ses fidèles sujets, qui aurions été heureux de concourir avec elle à la prospérité et à la gloire du royaume ?
Si, jusqu’à présent, et avec nos faibles lumières, nous avons pu marcher d’un pas assez ferme, que serait-ce si nous étions aidés et secondés par les siennes ?…
— Je devine, monsieur le duc, dit la reine en l’interrompant, je devine où tend ce discours. Vous m’offrez de partager le pouvoir. Vous aimez mieux en céder une partie que de perdre le tout ; ce qui serait encore un mauvais calcul ; car si j’acceptais, c’est que je serais ambitieuse, et si j’étais ambitieuse, il me faudrait bientôt la puissance tout entière ; mais rassurez-vous, reprit-elle en souriant, je ne veux rien.
Le duc respira plus librement.
La reine continua :
— Je ne désire point le pouvoir, je le craindrais au contraire. C’est un fardeau trop pesant et trop lourd, surtout pour une femme, et Dieu me préserve d’assumer jamais sur moi une pareille responsabilité ! Je vous la laisse tout entière, monsieur le duc, et peut-être sera-t-elle un jour terrible pour vous.
Mais en me retirant, en m’isolant du pouvoir, en vous laissant tous les droits de la couronne, il en est un cependant auquel je ne prétends pas renoncer entièrement, c’est celui de faire du bien… toujours ! et d’empêcher le mal… toutes les fois du moins que je le pourrai.
— Votre Majesté, dit le duc de l’air le plus aimable et le plus gracieux, aurait-elle quelque infortuné à me recommander… ou plutôt quelques ordres à me donner ?
— Oui, monsieur, dit la reine d’un ton sévère. Puisque, aujourd’hui, ce qui nous arrive rarement, nous causons politique, je vais, pour la première et pour la dernière fois de ma vie, vous dire mon opinion sur une affaire d’État, c’est la seule dont je me mêlerai jamais. Il s’agit des Maures.
— Ah ! s’écria le duc, toujours un peu déconcerté de la manière franche et brusque dont la reine abordait les questions… vous leur portez, madame, un bien grand intérêt.
— C’est votre faute. Quelques jours après mon mariage, j’ai traversé la province de Valence. J’ai reçu l’hospitalité la plus magnifique et la plus royale chez le Maure Delascar d’Albérique, et lorsque j’ai voulu, ainsi que je le lui avais promis, lui rendre à mon tour cette hospitalité en le recevant à l’Escurial ou à Aranjuez, vous vous y êtes opposé.
— Une pareille visite… une manifestation aussi éclatante, aussi publique, aurait contrarié des idées… des projets que le conseil du roi avait adoptés.
— Ces idées, et ces projets, nous en parlerons tout à l’heure ; mais il n’en est pas moins vrai que, vous et le conseil, avez empêché une reine d’Espagne de tenir sa promesse. Je suis donc restée débitrice envers le Maure Delascar d’Albérique et les siens. Voilà pourquoi, toutes les fois que l’occasion se présentera, je m’acquitterai envers eux, en les protégeant.
— Il me semble que Votre Majesté a déjà fait beaucoup. Lors de sa visite, elle a conféré la noblesse au Maure d’Albérique et à sa famille.
— C’était justice, après les services qu’ils ont rendus. Par eux, l’Espagne devient chaque jour plus riche et plus fertile.
— Mais ce qui se justifie difficilement, et ce qui annonce l’idée audacieuse de faire revivre les prétentions de leurs ancêtres, d’Albérique et son fils ont placé dans leurs nouvelles armes une fleur de grenade en champ d’azur.
— Ah ! une fleur de grenade !… dit la reine en rougissant ; je ne crois pas qu’en prenant cet emblème, fort innocent, du reste, ils aient pensé aux rois de Grenade, leurs aïeux.
Et, malgré elle, ses yeux se baissèrent sur une turquoise fort simple qu’elle avait fait monter en bague, et qu’elle portait toujours à son doigt ; puis, comme si la vue de cette bague lui eût donné un nouveau courage, elle reprit avec fermeté :
— Il paraît, du reste, monsieur le duc, que ma protection est loin de leur porter bonheur, et qu’il suffit que la reine d’Espagne s’intéresse à eux pour qu’on les proscrive !
— Comment… que veut dire Votre Majesté ?
— Que, depuis longtemps, dans l’ombre et le silence, on médite un édit qui serait la ruine de l’Espagne et la honte de notre règne… ou plutôt du vôtre… mais écoutez bien ce que je vais vous dire, monsieur le duc : les Maures resteront en Espagne, et vous ne les en chasserez point tant que je vivrai !
Le duc, hors de lui, voulut en vain cacher son trouble.
— Après cela, le mot que je viens de dire est bien hardi… je le sais !… et pourrait peut-être, continua-t-elle avec un sourire ironique, abréger mes jours.
— Ô ciel ! s’écria le ministre en pâlissant, Votre Majesté pourrait me croire capable d’une telle pensée, d’un tel crime !
— Non… non, ce n’est point un crime que cela s’appelle, mais un coup d’État.
Le duc de Lerma, quoi qu’on ait pu dire depuis, était, par ses mœurs et par son caractère, fort loin d’une pareille combinaison politique.
Aussi, la reine le regardant d’un air plus doux, lui dit :
— Je ne vous soupçonne pas, vous, monsieur, mais vous avez des amis qui sont si bien avec le ciel, que tout leur est permis sur terre ; n’importe !… je ne les crains point. Je vous autorise à dire à l’inquisition et à ses ministres ce que je viens de vous apprendre.
— Mais que Votre Majesté daigne réfléchir… et elle comprendra comme moi…
— Que cela les gênera un peu et les forcera d’attendre ! Il n’y a pas de mal.
— Madame, daignez m’écouter pour vous, pour vous-même…
— Pour moi ! s’écria la courageuse reine, ne craignez-vous pas déjà, comme je vous le disais, le fer, le poison ou la flamme des bûchers ?… Est-ce pour cela qu’on les rallume ? Et l’auto-da-fé de mardi prochain n’est-il qu’un prélude ? On s’est abusé. Je déclare, monsieur le duc, je déclare, moi, la reine, qu’il n’aura pas lieu !
— Ce n’est pas possible ! il a été solennellement annoncé et promis… le peuple murmurerait.
— C’est au grand inquisiteur Sandoval y Royas, votre frère, à lui faire entendre raison. Celui qui sait soulever la multitude doit connaître les moyens de l’apaiser.
La cour de Rome n’est pas si avare de jubilés et d’indulgences, qu’on n’en puisse distribuer de manière à contenter tout le monde !
Du reste, monsieur le duc, c’est pour cela que j’ai désiré vous parler. Vous n’avez pas oublié le commencement de notre conversation.
— Je jure à Votre Majesté que si cela ne dépendait que de moi…
— Quoi ! le pouvoir que vous donne le roi est insuffisant ! Ministre tout-puissant, vous vous laissez mener et gouverner aussi ! Vous faites le roi… jusque-là !… Ah ! c’est trop fort !
Il y avait dans la voix de Marguerite un accent d’ironie et de mépris dont le duc fut accablé, et toutes ses craintes le reprirent quand la reine ajouta :
— Si vous n’osez braver votre frère Sandoval, et faire droit aux prières de votre reine, il faudra bien alors qu’elle se charge d’exécuter elle-même ce qu’elle aura ordonné.
Dès ce soir je serai réconciliée avec Philippe ; dès demain je lui demande votre renvoi, et quant au grand inquisiteur Sandoval, votre frère, nous verrons plus tard !
La reine s’exprimait d’une voix si décidée et si ferme ; sa menace était si facile à réaliser, que tout autre à sa place n’eût pas parlé, mais à l’instant même eût agi.
Le ministre, peu habitué à rencontrer des volontés, redoutait ceux qui osaient en avoir. Accoutumé à voguer, sans danger en pleine mer, un écueil, aperçu même de loin, suffisait pour l’effrayer. Il craignait de s’y heurter et d’y briser le vaisseau de sa fortune.
Le ministre eut peur, s’inclina, promit de donner à la reine toute satisfaction, et celle-ci, à cette condition, promit désormais de ne plus se mêler des affaires d’État.
À cette parole, le duc de Lerma protesta de son dévouement, suppliant Sa Majesté de le mettre à l’épreuve.
— Soit, dit Marguerite en souriant, pour vous, monsieur le duc, et non pour moi, car je ne doute pas de votre sincérité. Et pour vous donner l’occasion que vous paraissez désirer de m’être agréable, je vous demanderai, puisque décidément l’auto-da-fé n’a plus lieu, de faire remettre à l’instant même en liberté un pauvre homme, un Maure nommé Gongarello, qui, je crois, est barbier de sa profession, et sa nièce Juanita, une jeune fille que l’on destinait au bûcher, et qui maintenant ne peuvent plus vous servir à rien !
— J’avoue, dit le ministre, que j’ignorais complètement ces détails.
— C’est un tort ! vous qui dirigez tout, vous devriez savoir. Moi qui ne me mêle de rien… je sais bien ! jugez si je m’en mêlais ! Je vous apprendrai donc que ce pauvre diable et sa nièce ont été baptisés. Ainsi ils sont à l’abri de vos nouvelles ordonnances.
Le seul crime du barbier, c’est d’avoir parlé un peu haut, de s’être permis quelques plaisanteries sur votre frère Sandoval, sur vous peut-être… je vous dis cela parce que je vous sais généreux, et que maintenant, monsieur le duc, vous voilà engagé d’honneur à le protéger.
— Votre Majesté a raison ! ses ordres seront dès aujourd’hui exécutés. Mais cet homme ne peut cependant, sans braver l’inquisition revenir ouvertement et aux yeux de tous à Madrid, dans sa boutique !
— C’est juste ! il faudra qu’il s’établisse à quelques lieues de Madrid.
— Et quant à sa nièce…
— Une jeune fille ! que l’on dit charmante ; ne vous en inquiétez pas, monsieur le duc, je me chargerai de la placer.
Le duc prit congé de la reine, et courut encore tout effrayé chez son frère Sandoval.
Celui-ci voulait soutenir la lutte ; il ne craignait rien ; le ministre craignait tout. Le grand inquisiteur, qui, ainsi que nous l’avons dit, était le plus entêté des sots, ne voulait rien céder de ses droits et prérogatives.
Mais un de leurs affiliés, grand seigneur, car l’inquisiteur avait des affiliés partout, le comte de Lémos, beau-frère du duc, vint leur apprendre en grand secret que, la veille et l’avant-veille, le père Jérôme, de la Société de Jésus, avait causé pendant une heure et plus avec Sa Majesté.
Le duc trembla : l’inquisiteur pâlit.
La reine, prête à exécuter ses menaces, aurait-elle préparé un traité d’alliance avec leurs ennemis ?
Si le père Jérôme, le Florentin, prédicateur renommé, venait à renverser fray Gaspard de Cordova, confesseur de Sa Majesté, homme nul et qui ne pouvait se défendre, c’en était fait de l’influence du duc et même de celle de Sandoval.
La Société de Jésus, protégée par la reine, et une fois maîtresse du roi et de sa conscience, ne lâcherait point sa proie ! Les suites d’une pareille révolution devenaient incalculables pour l’Espagne, et surtout pour l’ordre de Saint-Dominique !
À l’instant même, le fier inquisiteur sentit se fondre son opiniâtreté ordinaire. Elle devint souple, malléable et flexible ; Sandoval comprit sur-le-champ toute la justesse des raisonnements et la haute politique du duc de Lerma.
Le résultat de cette conférence fut, qu’on ne se brouillerait point avec la reine ; qu’on lui tiendrait parole cette fois, sans que cela tirât à conséquence, quitte, en attendant mieux, à redoubler, en secret, de persécutions contre les Maures.
L’auto-da-fé, retardé d’abord à cause du jubilé que venait de proclamer le pape, fut ajourné indéfiniment, et d’autres affaires plus importantes le firent, plus tard, tout à fait oublier.
XXV.
scènes d’intérieur.
Le soir même de ce jour mémorable, Piquillo était à l’hôtel d’Albayda, dans le cabinet de don Fernand, assis près d’une large cheminée et plongé dans ses réflexions, quand l’intendant de la maison vint lui dire mystérieusement qu’une dame demandait à lui parler.
Quoique occupant l’hôtel et la place d’un grand seigneur, Piquillo n’en était pas plus fier. Il fit entrer sans faire attendre… et la senora Cazilda, la parfumeuse, les yeux rayonnants de joie, s’avança sur la pointe du pied, lui disant à demi-voix :
— Pouvez-vous les recevoir ? ils sont en bas… dans la rue.
— Mais qui donc ? s’écria Piquillo.
— Qui donc ?
— Là, sous votre fenêtre !
— Nos amis… ceux qui vous doivent tout ! Gongarello et sa nièce !
Piquillo poussa un cri et resta immobile de surprise : puis, revenant à lui.
— Qu’ils viennent !… qu’ils viennent !
La Cazilda ouvrit la fenêtre, fit, dans la rue, un signe de la main, sortit en courant, et quelques minutes après, elle rentra avec le barbier et sa nièce.
Gongarello et Juanita étaient aux pieds de Piquillo, qui s’efforçait en vain de les relever, et qui ne pouvait se rassasier du plaisir de les voir et de les embrasser.
— Notre sauveur ! toujours notre sauveur ! s’écria Juanita.
— C’est magique ! c’est incompréhensible ! répétait le barbier, surtout cette pétition que, sans le savoir, je me trouve avoir écrite…
— Silence ! dit Piquillo.
— Et remise à ce jeune homme… sans l’avoir vu… Voilà qui est étonnant, voilà une histoire comme je n’en ai jamais vu ni raconté !…
— Et vous ne la conterez pas ! et vous n’en direz jamais rien à personne ! s’écria Piquillo, à moins que vous ne préfériez rentrer dans les prisons de l’inquisition.
— Je suis muet, muet, dit le barbier, je ne parlerai plus que par gestes !
— Et vous aussi, Cazilda, le plus grand secret sur cette aventure !
— Ne craignez rien.
— Pour les vôtres et pour vous-même… pas un mot sur cette pétition.
— Ah ! je l’ai bien vu ! car ce matin, lorsque la reine était à sa toilette, j’ai saisi un instant où la comtesse d’Altamira et une autre dame étaient au fond de l’appartement ; j’ai placé respectueusement, et sans dire un mot, des gants et de nouveaux éventails devant Sa Majesté, et je tremblais tellement en lui présentant ses jarretières renfermées dans un sachet parfumé, qu’elle a sur-le-champ entr’ouvert ce sachet et a vu la pétition…
— Que j’avais écrite, dit Gongarello.
— J’ai fait un geste de prière en joignant les mains, continua Cazilda, rien de plus ! La reine a refermé vivement le sachet, et m’a fait des yeux un geste si rapide et si expressif que j’ai deviné tout de suite, sans rien comprendre cependant, qu’il fallait se taire ou que quelque grand danger me menaçait. Aussi, sans en rien dire à mon mari, toute cette journée je tremblais chez moi toute seule, lorsqu’à la nuit tombante… j’ai vu arriver…
— Moi… moi ! dit le barbier ravi ; moi et ma nièce, qui nous croyions pour jamais rayés du nombre des vivants, et nous avions, ma foi, déjà commencé, parce que cinq ans dans les prisons de l’inquisition, c’est un à-compte. Oui, mes amis, s’écria-t-il, c’est une horreur ! c’est un enfer !… c’est un séjour…
Cazilda et sa nièce firent un geste d’épouvante, et le barbier, qui déjà s’oubliait, reprit, en regardant avec effroi autour de lui et à voix haute :
— C’est un séjour… fort agréable… pour un cachot ! il n’y en a pas certainement de mieux disposés !
Puis il reprit à demi-voix : Vous préserve le ciel d’y entrer ! Quant à moi, m’en voilà dehors. Il est vrai qu’on m’exile de Madrid. On m’envoie à cinq lieues d’ici, à une jolie ville, à Alcala d’Hénarès… Je trouverai toujours à exercer mon rasoir ; il y a des barbes partout.
Et à propos de cela, notre ami et notre bienfaiteur, dit-il en regardant Piquillo… moi, qui, il y a quelques années, n’aurais pu faire la vôtre, même pour prouver ma reconnaissance, il semble qu’à présent je pourrais m’acquitter, car vous êtes devenu un homme. Vous voilà bien changé, mon garçon, de figure, s’entend.
— Oui, dit Juanita, car le cœur est toujours resté le même.
— Et votre nièce, la gentille Juanita, me paraît bien plus gentille encore.
— Non, monsieur, rien ne mûrit à l’ombre, dit tristement le barbier. Mais, bast ! tout s’efface, tout s’oublie, reprit-il gaiement, et dans quelque temps, quand elle viendra me voir à Hénarès, je retrouverai ses joues fraîches et rebondies et ses belles couleurs d’autrefois.
— Comment ! dit Piquillo étonné, vous ne l’emmenez pas avec vous ?
— Est-ce que c’est possible… est-ce que vous ne savez pas…
— Eh ! non vraiment, je ne sais rien.
— J’ai cru que c’était encore à vous que nous devions ce bonheur-là !
— Et lequel ?
— Juanita a une place au palais.
— Ce n’est pas possible !
— C’est certain… femme de service auprès de la reine.
Piquillo poussa un cri de surprise.
— Oui, mon noble seigneur, la reine le veut. Dès demain ma nièce entre en fonctions, et quand on a une nièce placée au palais et près de la reine, on se moque des méchants et des envieux, on ne craint plus rien !… Et mais, qu’avez-vous donc, notre bienfaiteur ? dit-il à Piquillo, vous voilà immobile et silencieux.
— Et vous, cousin, vous parlez trop, dit Cazilda, et sous ce rapport-là, il est très-utile que vous quittiez Madrid au plus tôt.
— Oui… oui, continua Piquillo, tout cela ne vient pas de moi, mais d’un ange que j’ai promis de ne pas nommer… et que malheureusement vous ne connaîtrez pas, dit-il en souriant et en regardant le barbier ; je suis discret, mais si un jour cela m’est permis, je vous apprendrai qui vous devez remercier.
— Et en attendant, nous prierons pour cette personne-là, dit Juanita, quelle qu’elle soit.
— Oui… oui, reprit le barbier les larmes aux yeux… nous prierons pour elle ; mais, c’est égal, j’aimerais mieux la connaître.
— À quoi bon, mon oncle ? on ne connaît pas le bon Dieu, et on le prie tout de même.
Le lendemain Piquillo était chez Aïxa, que par bonheur il trouva seule, Carmen était dans le cabinet de sa tante à écrire des lettres sous sa dictée. Il lui rendit compte de tout ce qui était arrivé, du succès de sa lettre, de la liberté de Gongarello et de la place obtenue par Juanita.
Aïxa leva les yeux avec reconnaissance, et s’écria :
— Que Dieu protége la reine ! que la reine soit heureuse !
Piquillo n’osait l’interroger, ni sur ces événements, qui à chaque instant redoublaient sa surprise, ni sur la part qu’il avait prise lui-même à ces mystérieuses aventures ; il se hasarda seulement à lui dire d’une voix timide :
— Vous connaissez Sa Majesté ?
— Non, Piquillo.
— Vous l’avez vue quelquefois ?
— Jamais, répondit Aïxa.
— Mais du moins, dit le jeune homme, qui sentait redoubler sa curiosité, pour que vous ayez autant de crédit, et que la reine vous aime à ce point-là, il faut, senora, que Sa Majesté vous ait vue quelquefois.
— Jamais ! répéta Aïxa, je n’ai pas été à la cour et ne pourrais y paraître, car je ne suis pas une grande dame, Piquillo, je ne suis qu’une pauvre fille.
Piquillo tressaillit de joie.
Aïxa lui tendit la main ; avec un accent enchanteur, elle s’écria :
— Si je ne vous dis pas quel est mon sort, à vous, mon ami le plus fidèle et le plus dévoué, c’est que ce secret n’est pas le mien, qu’il ne m’appartient pas… S’il ne devait compromettre que moi, vous le sauriez déjà.
— Je ne veux rien, dit Piquillo au comble du bonheur, rien que vous servir !
— Je ne vous ai déjà que trop exposé en vous mêlant à une affaire pareille. Grâce au ciel et à la bonté de la reine, la chance a bien tourné, mais il pouvait en être autrement.
Aussi, engagez vos amis à se taire, pour eux d’abord, et pour vous, qui risquez autant qu’eux si l’on venait à savoir qui vous êtes.
On prétend, continua-t-elle en baissant la voix, que les persécutions recommencent contre les Maures ; persécutions d’autant plus rigoureuses et terribles, qu’elles sont secrètes, qu’on ne les avoue pas, que les victimes n’ont pas même l’avantage de souffrir au grand jour, et de réclamer pitié pour elles, et justice contre leurs bourreaux !
— Quel est le but de ces nouvelles cruautés ?
— De convertir les Maures à la foi catholique, et pour cela tous les moyens sont bons ! on emprisonne et on torture ceux qui ne peuvent pas prouver qu’ils ont été baptisés.
— Quelle horreur !
— Et vous, Piquillo… dit Aïxa après un instant d’hésitation et de crainte, avez-vous reçu le baptême ?
— Non pas que je sache !…
— Le recevriez-vous ?
— Si mon cœur et ma raison me le conseillaient, peut-être ; si on voulait m’y contraindre…… jamais !
— C’est bien !
— Plutôt braver alors les bourreaux et le bûcher ! je vous le jure !
Aïxa le regarda d’un œil où brillait le courage, et lui serra la main en répétant :
— C’est bien !
Piquillo ne pouvait trop se rendre compte de son bonheur, mais il se sentait heureux et joyeux.
Il courut chez Carmen, et sans lui faire connaître par quels moyens Juanita avait été sauvée, il lui apprit sa merveilleuse délivrance.
Depuis ce jour, Carmen désira vivement connaître la jeune fille, et elle lui fut amenée par la comtesse d’Altamira, qui la voyait quelquefois dans son service auprès de la reine.
Carmen et Aïxa accueillirent la nièce du barbier avec un intérêt si vif et si tendre, que celle-ci se prit bien vite pour elles de reconnaissance et d’affection.
Mais quand Juanita eut appris que Piquillo n’avait pas lui-même d’autres protectrices, ni de meilleures amies que les deux sœurs, Juanita redoubla pour elles de zèle et de dévouement, et si au fond du cœur elle se sentait un sentiment de préférence en faveur d’Aïxa, elle se l’expliquait en disant : C’est la faute de Piquillo, qui a l’air de l’aimer davantage !
Quant à Piquillo, plusieurs fois le soir, en reconduisant Juanita au palais, il lui parlait de leurs souvenirs d’enfance, de leur première rencontre devant l’hôtellerie du Soleil-d’Or, du souper qu’elle lui avait servi par le soupirail de la cave.
À tous ces souvenirs Juanita riait et soupirait encore plus souvent, et Piquillo se hasarda un jour à lui dire :
— Et Pedralvi ?
Dans ce moment le barbier n’aurait pas pu dire que les couleurs de sa nièce n’étaient pas revenues, car la pauvre fille devint toute vermeille.
— Tu y penses donc toujours ?
— Eh ! que faire en prison, s’écria-t-elle naïvement ; que faire pendant cinq ans dans les cachots de l’inquisition ?… C’est là ce qui soutenait mon courage ; mais lui, depuis ce temps, il m’aura crue morte, et pour se consoler, il se sera hâté d’en aimer, et peut-être d’en épouser une autre.
— Tu ne sais donc pas ce qu’il est devenu ?
— Impossible. Quand il est entré au service de l’hôtelier de Pampelune, Ginès Pérès, mon ancien maître, c’était pour m’aimer, pas pour autre chose ; et on le voyait bien à la manière dont il faisait son ouvrage. Il n’y pensait guère et ne s’occupait que du mien.
Aussi Ginès Péres se fâchait, le battait même. N’importe, il prétendait que ça ne lui faisait pas de mal, pourvu qu’il fût auprès de moi et me vit tous les jours. Mais quand, par suite de la méchanceté et des dénonciations de ses confrères les barbiers de Pampelune, mon oncle a été obligé de quitter la ville, il fallait voir la désolation de ce pauvre Pedralvi ! il se repentait bien alors de n’avoir rien amassé et rien appris… pas même un état. Aussi il me jura qu’il allait devenir actif et laborieux ; qu’il était bien jeune encore, qu’il avait du temps devant lui, et que dès qu’il aurait fait une petite fortune, nous serions alors tous deux en âge de nous marier, et qu’il viendrait me demander à mon oncle…
Il est venu peut-être ! s’écria la jeune fille en pleurant, et ne m’aura pas trouvée…
— Puisque tu étais en prison !
— Il n’en aura rien su !… et m’aura crue infidèle ! voilà ce qui me désespère, sans cela tout le reste ne me serait rien.
— Et tu ne sais pas où il est ?
— Qui me l’aurait dit ? Pedralvi ne savait ni lire ni écrire, et quand même il aurait appris ce talent-là, quand même il m’aurait adressé des lettres à Madrid, voyant qu’elles restaient sans réponse, il se sera découragé. Les hommes ! ça se décourage si vite !… ca n’est pas comme nous !
Et la pauvre Juanita se remettait à pleurer, et Piquillo faisait tous ses efforts pour la consoler.
Il lui promettait qu’au retour de Fernand d’Albayda il aurait par lui des renseignements, qu’on s’informerait de ce que Pedralvi était devenu, et qu’on finirait bien par le découvrir.
Alors Juanita, les yeux encore en pleurs, se mettait à sourire, à faire des projets, des rêves de bonheur, pour elle, pour tout le monde et surtout pour Piquillo, qui, grâce à Juanita, se trouvait en ce moment avoir pour amies et protectrices trois jeunes filles.
Mais l’amitié dont il était entouré, la douce vie qu’il menait alors, ne lui faisaient pas oublier sa mère, et il s’étonnait de n’en pas recevoir de nouvelles ; plusieurs fois il était passé à l’hôtellerie de Vendas-Novas qu’il avait fait préparer pour elle ; elle n’était pas encore arrivée, et aucune lettre ne venait lui expliquer la cause de ce retard.
Enfin, un matin, on lui apporta un petit billet sans orthographe, dans lequel on le priait de se rendre à l’instant à l’hôtel de Vendas-Novas.
Piquillo y courut, et au lieu de la Giralda, qu’il s’attendait à embrasser, il ne vit que la senora Urraca.
— Ma mère ! s’écria-t-il avec émotion, ma mère !… où est-elle ? Pourquoi n’est-elle pas venue avec vous ?…
La vieille femme ne répondit pas, elle était pâle et changée. Alors seulement Piquillo s’aperçut qu’elle était en deuil.
— Ma mère est malade… morte ! peut-être ! morte !
La grand’mère se cacha la tête dans ses mains, et se mit à sangloter.
Le seul sentiment réel qu’eût éprouvé la vieille femme, c’était son amour pour sa fille ; amour maternel, qu’elle entendait, comme nous l’avons dit, à sa manière ; c’est-à-dire qu’elle voulait donner à la Giralda le bien-être, l’aisance, la réputation, la fortune…… n’importe à quel prix.
Le bonheur de sa fille entrait en première ligne dans sa vie ; le sien après ; et s’il se fût trouvé de la place pour les principes et pour la vertu, elle ne les eût certainement point repoussés, mais elle ne leur avait jamais fait aucune avance.
Les ennemis, les rivalités et les succès de la Giralda avaient été les siens ; elle avait vécu de sa vie de théâtre, elle avait été reine de sa royauté, et se regardait comme déchue depuis que sa fille avait cessé de régner.
— Oui !… s’écria-t-elle ; oui, la Giralda a succombé sous les chagrins dont on l’a abreuvée, et le jour de la justice est déjà arrivé pour elle ! Les ingrats qui l’ont abandonnée comprennent maintenant ce qu’ils ont perdu… Quelle âme !… quel feu ! et quelle voix !
— Ma mère n’est plus ! s’écria Piquillo en se laissant tomber sur un fauteuil.
— Oui, vous avez raison de pleurer, mon enfant ! il n’y en aura jamais comme elle, il n’y en a plus pour jouer la Cléopâtre et la Didon abandonnée !… Si vous l’avez entendue comme moi !… Quel enthousiasme ! quel frémissement dans la salle à son grand air final : Tu pars, cruel ! Il y avait sur tout une note dans le haut…
La grand’mère essaya de la faire… la voix lui manqua, et elle se remit à pleurer en s’écriant :
— Et quel cœur !… quelle piété filiale ! Ce n’est pas celle-là qui aurait abandonné sa mère !… Elle mettait toujours pour première condition que nous ne nous quitterions pas ! Sans cela elle aurait refusé les propositions les plus belles, les plus riches et les plus honorables.
— Eh ! senora !… s’écria Piquillo avec impatience, et cherchant vainement à la faire taire.
— Toutes les robes qu’elle ne mettait plus… c’était à moi qu’elle les donnait, continua la grand’mère en sanglotant ; elle était trop bonne et elle avait trop de talent pour être heureuse… les cabales l’ont tuée. Mais elle sera vengée !… Vous ne savez pas, dit-elle en s’interrompant et en essuyant ses larmes, j’ai vu Lazarilla Burgos ; elle est vieille, elle est affreuse, elle chante faux et elle joue les duègnes, mon cher ! poursuivit-elle avec un éclat de rire… oui, les duègnes, et elle n’y est pas bonne… on l’a même sifflée… Mais à quoi bon, reprit-elle en pleurant, ma fille n’était pas là pour en être témoin et pour l’entendre !… Ah ! ma pauvre Giralda ! ma pauvre enfant !
Et ses sanglots recommencèrent. Tout ce que Piquillo put obtenir au milieu de ce déluge de larmes, de regrets, de retours sur le passé et de complaintes sur le présent, c’est que la Giralda, déjà bien malade, avait été frappée au cœur en recevant la lettre de son fils.
Elle espérait pour lui la protection et la puissance du duc d’Uzède, elle le voyait déjà sur le chemin de la fortune et des honneurs, et en apprenant l’affront et l’humiliation qu’il venait de subir, et dont elle était la cause première, elle n’avait pu y résister.
La pauvre Giralda avait du cœur. Sans sa mère, qui avait pris à tâche d’étouffer en elle tous les bons mouvements, elle eût été une honnête fille ; si l’on eût développé et encouragé ses nobles instincts, elle eût été une femme supérieure. Presque toujours on nous donne nos vertus ou nos vices, et ceux qui ne doivent rien qu’à eux-mêmes, sont, en bien comme en mal, d’une nature exceptionnelle.
La pauvre Giralda n’avait pas eu la force d’entreprendre le Voyage de Madrid, quelque envie qu’elle éût de revoir et d’embrasser encore une fois son fils.
— Oui, mon enfant, s’écria Urraca, elle est morte la veille de notre départ, en me chargeant pour vous de sa bénédiction.
Piquillo ne vit que sa mère, et songeant à la bénédiction qu’elle lui envoyait, il oublia celle qu’elle en avait chargée.
— Je vous la donne pour elle ! s’écria la vieille en étendant sa main décharnée sur le front de Piquillo… et de plus, voici deux lettres, l’une pour vous, et l’autre…
— Pour qui ? demanda Piquillo.
— Pour qui ? reprit la vieille en hésitant un peu, pour une personne qui doit vous tenir de très près.
Pardonnez-moi, continua-t-elle avec embarras, ce que je vous ai dit d’abord au sujet du duc d’Uzède… c’est le désir que j’en avais… Il me semblait que cette famille-là devait vous être plus avantageuse, et le bonheur de mes enfants avant tout… Moi, je suis comme cela ! Mais s’il faut vous avouer la vérité, en mon âme et conscience, je crois que je m’abusais !
— Eh ! qu’en savez-vous ? s’écria Piquillo en retenant avec peine sa colère.
— Je n’en sais rien… c’est vrai ! puisqu’il y a doute !… mais ce doute n’en est plus un pour moi. Oui, oui ! quand je rappelle mes souvenirs, comme il y a quelqu’un que la Giralda à toujours aimé, comme, malgré mes avis et mes remontrances, ce fut sa première et seule inclination…
— Eh ! qu’importe ?
— Il importe qu’elle vous l’a dit elle-même !…… Rappelez-vous ses dernières paroles : « Celui qui aura pour toi le cœur et l’amitié d’un père… c’est celui-là et non pas moi qu’il faut croire… » C’est ce qu’elle vous répète encore dans sa lettre. Lisez plutôt.
En effet, la Giralda à son lit de mort demandait encore grâce et pardon à son fils, et le suppliait, à mains jointes, de porter lui-même à son adresse la lettre qu’elle lui envoyait. L’idée que Piquillo serait reconnu et adopté pouvait seule adoucir ses derniers moments, et elle mourait persuadée que son fils exécuterait ses ordres, et que Dieu exaucerait ses vœux.
Malgré la répugnance qu’il éprouvait à tenter de nouveau une démarche pareille, il ne voulut point que la prière de sa mère fût repoussée par lui ; il jura d’obéir.
Il veilla d’abord à ce que la vieille Urraca ne manquât de rien. Grâce aux libéralités du vice-roi ou plutôt d’Aïxa, il lui fut facile de lui assurer pour ses derniers jours une existence modeste.
Sans inquiétude désormais de ce côté, il songea à remplir au plus vite le devoir qu’on lui imposait.
La lettre qui lui avait été remise portait pour suscription :
« À Delascar d’Albérique, commerçant et mamufacturier dans le royaume de Valence. »
XXVI.
le départ.
En proie à toutes les réflexions qui venaient l’assaillir, Piquillo se répétait avec désespoir qu’à coup sûr, un commerçant, un manufacturier n’accueillerait pas mieux que le grand seigneur un enfant inconnu qui, après vingt ans, lui tombait du ciel. À coup sûr, il serait dédaigné, repoussé, peut-être même chassé, comme il l’avait été déjà… mais sa mère le voulait.
D’ailleurs et grâce au ciel, le royaume de Valence était loin de Madrid ; Piquillo serait seul témoin de l’humiliation qu’il allait subir, il ne s’en vanterait pas, et n’en parlerait à personne, ni avant, ni après. Son plus grand chagrin était son départ. Il était si heureux de passer sa vie avec Carmen, Aïxa et même Juanita ! À l’idée seule de renoncer pour quelques semaines à cette gracieuse existence, à ce monde enchanté où s’arrêtaient et se bornaient tous ses vœux, il sentait faiblir son courage et se repentait de son serment.

Mais il avait promis à sa mère !… à sa mère, qui n’était plus et qui ne pouvait lui rendre sa parole… Il fallait donc la tenir, c’était un devoir, et Piquillo ne savait point transiger avec ses devoirs.
Il fit ses adieux à ses jeunes amies, les priant de ne pas l’interroger sur le but de son voyage, et de lui pardonner une discrétion dont, plus que jamais, cette fois, il comprenait la nécessité. Il promit de revenir bientôt… le plus tôt possible ; d’autant qu’on attendait Fernand d’Albayda, qui avait annoncé son retour à Madrid comme très-prochain, et Piquillo comptait, pour son avenir, bien plus sur l’amitié de Fernand que sur la réception plus que douteuse de sa nouvelle famille.
— Adieu, lui avait dit Aïxa, n’oubliez pas les amis que vous laissez à Madrid. N’oubliez pas qu’ils partageront toujours vos joies et vos chagrins.
— Et vous, avait répondu Piquillo, et vous, Aïxa ! en quelque lieu que je sois, quelque danger qui me menace, quelque fortune qui m’attende, si jamais j’étais assez heureux pour que vous eussiez besoin de moi, dites un mot… je quitterai tout, je reviendrai.
Aïxa ne lui répondit pas, mais elle lui tendit la main d’un air ému, et avec un sourire de reconnaissance qui voulait dire :
— J’y compte.
Jetant un regard, non devant lui, mais en arrière, le jeune pèlerin partait avec peu d’espérance dans le cœur et beaucoup de regret. Il ne songeait point à ce qui l’attendait, mais à ce qu’il venait de quitter, et cette fois, nulle idée ambitieuse, nul rêve de fortune ou de puissance, n’abrégea pour lui les ennuis de la route.
Il avait près de quatre-vingts lieues à faire, et se dirigea vers Valence, en prenant, à l’est, par la province de Cuença.

Le chemin qu’il parcourut d’abord n’était que trop en harmonie avec les sentiments qu’il éprouvait. Rien de plus triste, de plus aride que les environs de Madrid et une grande partie de la Nouvelle-Castille. Le pays qu’il traversait lui semblait inhabité, tant sa population, indolente et oisive, offrait peu de mouvement et d’activité.
Nulle part on n’apercevait la charrue du laboureur, ni les troupeaux des bergers, ni la circulation du commerce ou de l’industrie ; nulle part on n’entendait le bruit d’une manufacture ou d’une fabrique, ou les chants de l’ouvrier. Tout était mort et silencieux.
Mais le troisième jour, au moment où il mit le pied dans le royaume de Valence, on aurait dit qu’un magicien, étendant sa baguette, venait de réveiller toute cette population endormie, de lui rendre tout à coup l’âme, le mouvement et la vie.
À l’aspect de ce jardin continuel, où l’air est imprégné du parfum des orangers et des citronniers, de ces moissons de froment, de chanvre et de maïs qui s’élevaient en amphithéâtre, de ces forêts de mûriers, de caroubiers, d’oliviers et de figuiers qui couronnaient les hauteurs, Piquillo s’arrêta, stupéfait et ravi, sur un petit tertre qui dominait de vastes prairies, et se mit à l’ombre sous un berceau de grenadiers et d’aloès, le long desquels s’élevaient des guirlandes de vignes dont les grappes dorées retombaient en festons au-dessus de sa tête.
Jamais rien de pareil ne s’était offert à ses yeux ou à son imagination. Ni les campagnes froides et humides de la Navarre, ni les plaines de la Castille, les seuls pays qu’il eût vus, n’avaient pu lui donner idée fixe d’une nature aussi riche, aussi splendide, aussi féconde ; et partout le travail et l’industrie, portés au plus haut point, étaient venus seconder ce luxe de la végétation.
On ne pourrait de nos jours s’imaginer tout ce que les Maures du royaume de Valence avaient déployé d’art, et même de génie, dans l’agriculture, si les travaux créés par eux, et qui subsistent encore en partie, ne venaient comme jeter un défi à leurs vainqueurs, qui n’ont pu les surpasser, ni même les imiter. Ils avaient, entre autres, établi un système d’irrigation admirable, dont j’emprunterai la description à un voyageur moderne[17].
« Les eaux du Turia, qui se jettent dans la mer un peu au-dessous de Valence, ont été soutenues par une digue à deux lieues environ de son embouchure, et sept coupures principales, dont trois sur une rive et quatre sur l’autre, vont distribuer dans la plaine ces eaux qui s’étendent en éventail et fertilisent toute la Huerta, contenue et comme embrassée entre leurs deux branches intérieures. Sur chacune de ces sept artères principales, le même système est répété en petit, et une multitude innombrable de veines secondaires viennent prendre l’eau et la porter au plus humble carré de terre caché au centre de la plaine.
« Ce système, dont l’idée est fort simple, offrait néanmoins, dans l’exécution, une complication dont les difficultés n’ont pu être résolues que par la prévoyance la plus ingénieuse.
« Une de ces difficultés se trouvait dans la nécessité d’observer partout une telle graduation de niveau, que tous les terrains, sans exception, pussent jouir à leur tour des bienfaits de l’irrigation. Or, la plaine, bien qu’assez égale, ne présentait pas cependant ce nivellement parfait et géométrique ; on y a suppléé par de petits canaux et des ponts aqueducs.
« En se promenant dans la plaine, on voit à chaque instant de petits canaux qui passent sur les grands, et je ne sais combien d’aqueducs en miniature, construits les uns sur les autres, pour porter à quelques perches de terre un volume d’eau trois fois gros comme la cuisse. Ailleurs, vous voyez, au milieu d’un terrain tout plat, le chemin s’élever tout à coup de quatre pieds, et vous obliger de suspendre, pendant douze pas, le trot de votre cheval : c’est un aqueduc souterrain qui passe par là. Tout ce travail est peu apparent ; la plupart du temps, il se cache sous terre, mais il est plein de sagesse et de prévoyance.
« Une autre difficulté, c’était de répartir les eaux équitablement, afin que chacun pût en jouir à son tour : car, pour faire monter les eaux d’une acequia (c’est le nom des canaux), il faut presque mettre les autres à sec.
« Après le travail de l’ingénieur, venait donc le travail de l’administrateur et du légiste.
« Ce travail a également été fait par les Arabes, et subsiste encore aujourd’hui tel qu’ils l’ont laissé.
« À chacune des sept branches mères correspond un jour de la semaine ; ce jour-là, elle emprunte l’eau de ses voisines pour élever les siennes au niveau voulu ; le tout, bien entendu, à charge de revanche ; ce jour-là, tous les petits filets qui s’alimentent des eaux de la grosse artère sont également ouverts ; mais comme leur nombre est immense, et qu’en venant la sucer tous à la fois, les eaux ne pourraient se maintenir à la hauteur nécessaire, chacun d’eux a son heure dans la journée, comme la branche mère a son jour dans la semaine.
« Voilà près de huit siècles que ces détails minutieux sont fixés, que chaque filet d’eau a son heure et sa minute assignées. Quand cette heure arrive, un des colons intéressés défait en trois coups de pioche la digue de gazon qui ferme sa rigole, l’eau monte, et à mesure qu’elle vient à passer devant chaque pièce de terre, chaque colon, qui l’attend la pioche à la main, lui donne accès chez lui par le même procédé ; alors la terre est submergée et couverte de plusieurs pouces d’eau pendant un temps déterminé.
« Le lendemain, les choses se passent de la même manière dans une autre partie de la Huerta, et au bout de la semaine, toute la campagne a été imprégnée à son tour de ces eaux fécondantes. »
Si de pareils travaux excitent de nos jours l’admiration du voyageur, jugez ce qu’ils durent produire sur Piquillo, qui descendit cette riche plaine en marchant de prodige en prodige. Cette nature riante et animée avait banni ses idées sombres.
Le soleil, qui s’était levé radieux, commençait à devenir brûlant ; l’air du matin et une marche de quelques heures avaient excité l’appétit du jeune voyageur, il aperçut devant lui, avec un certain plaisir, une hôtellerie propre et élégante, chose des plus rares en Espagne, nouveau miracle réservé au pays où tout, excitait sa surprise.
L’hôte et les servantes avaient un air de bonne humeur, signe de contentement et de prospérité. Une énorme marmite bouillonnait devant une large cheminée, tandis que plusieurs broches de différentes dimensions, et placées en amphithéâtre, offraient aux ardeurs d’un brasier étincelant, une moitié de mouton, une demi-douzaine de belles poulardes et une vingtaine de perdreaux qui, par un mouvement de rotation lent et régulier, se coloraient successivement d’une teinte dorée et appétissante.
Des voyageurs de bonne mine, des commerçants, des ouvriers étaient assis à différentes tables, non pas selon leur appétit, mais selon leur rang et selon leur bourse.
Lorsque Piquillo parut dans l’hôtel du Faisan-d’Or, un homme habillé de noir et qui avait l’air d’un alguazil, tournait le des à la porte, et achevait de régler son compte avec l’hôte.
Il jeta généreusement une poignée de maravédis pour les garçons et les servantes de l’hôtellerie, et sortit presque au moment où Piquillo entrait.
Celui-ci eut à peine le temps de l’entrevoir, et sentit à sa vue comme un mouvement de crainte, comme un frisson involontaire dont il ne pouvait se rendre compte. Il lui semblait qu’il venait de passer à côté d’un ennemi ; il crut avoir reconnu dans la taille, dans les manières, dans les traits de ce voyageur, quelque chose de son ancien maître, le damné capitaine Juan-Baptista Balseiro.
Mais comment supposer que le capitaine fût devenu alguazil et qu’il eût passé dans les rangs de ses ennemis naturels ? ce n’était pas probable, et notre jeune voyageur s’était trompé sans doute. En tout cas, l’inconnu, quel qu’il fût, n’avait pu reconnaître Piquillo, dont la taille et les traits étaient bien autrement changés depuis sept années.
Tourmenté cependant par cette idée, il interrogea l’hôte du Faisan-d’Or, le seigneur Manuelo, persuadé qu’un hôtelier devait tout connaître. Celui-ci lui répondit que c’était la première et probablement la dernière fois qu’il voyait ce voyageur ; que, d’après ce qu’il lui avait entendu dire à lui-même, il était alguazil, et se rendait, par ordre supérieur et pour affaires de sa profession, à Valence, où il devait s’embarquer.
Piquillo respira, tout en regrettant néanmoins que, dans un pays comme le royaume de Valence, il y eût des alguazils. La vue de celui-là lui avait gâté le paysage !
Peu à peu cependant la gaieté revint à Piquillo ; quant à l’appétit, il ne l’avait pas quitté, et il se disposa à faire honneur à la volaille que son hôte venait de placer devant lui et qui répandait au loin un fumet exquis.
Il commença d’abord par déboucher une bouteille de petit vin blanc de Benicarlo, et il venait d’en boire un verre au souvenir de ses amis, quand, de la fenêtre près de laquelle il était placé et qui, vu la chaleur, était restée ouverte, il vit arriver, pâle, exténuée et se trainant à peine, toute une famille de pauvres gens.
La mère portait un enfant dans ses bras ; deux autres la suivaient en tenant son jupon, dont les lambeaux couraient risque de rester dans leurs mains ; le fils soutenait ses deux sœurs, et le père, dont les traits présentaient les traces de la souffrance et de la maladie, s’appuyait sur l’épaule d’un garçon de quinze à seize ans qui le regardait les yeux pleins de larmes.
Ils étaient tous debout devant les fenêtres de l’hôtellerie, ne se plaignant pas, ne demandant rien, mais regardant ! regardant, eux qui avaient faim, des gens qui mangeaient !
Piquillo allait porter à sa bouche une aile de cette volaille si tendre et cuite si à point. Il vit les yeux de la pauvre mère attachés sur les siens. Le morceau lui tomba des mains. Soudain, et comme par un effet magique, il crut se voir… il se vit quelques années auparavant souffrant et maladif, assis sur le pavé dans les rues de Pampelune, et dévorant avidement des côtes de melon jetées au coin d’une borne.
L’apparition qu’il venait d’avoir rendait encore plus vif et plus présent à sa mémoire ce premier souvenir de son enfance.
— Senor Manuelo, s’écria-t-il à l’hôtelier du Faisan-d’Or, n’y a-t-il pas, dans cette large marmite qui bout devant votre feu, de quoi faire une soupe copieuse et une bonne olla-podrida pour cette brave famille qui ne demande rien, mais qui acceptera bien, je l’espère, dit-il en se penchant vers la fenêtre, le repas que leur offre un ami ?
La mère lui jeta un regard de reconnaissance et fit un pas vers lui ; le père, qui était le plus près de la fenêtre, restait immobile et hésitait encore.
Piquillo devina ce qui se passait dans son cœur.
C’était un malheureux qui, à coup sûr, ne l’était pas depuis longtemps, et chez qui la souffrance n’avait pas encore éteint la fierté.
Il avança par la fenêtre sa main, qu’il lui tendit, et il ajouta :
— Vous pouvez accepter ce que vous offre un ami qui naguère était comme vous… et qui n’en rougit pas.
À ces mots, prononcés noblement et sans affectation, tous ceux qui étaient dans la salle levèrent les yeux sur Piquillo. Il y eut un murmure d’approbation. Le pauvre homme pressa contre son cœur la main qu’on lui tendait, et le seigneur Manuelo s’empressa de servir sur l’herbe et en dehors de l’hôtellerie le dîner de la famille, pour qui ce secours venait bien à point : ils tombaient de faiblesse, excepté les petits enfants, qui riaient et battaient des mains à l’aspect de l’immense plat d’olla-podrida qu’on venait de leur apporter.
On y avait joint du pain blanc, du vin et des fruits, et Piquillo, après avoir dîné lui-même, se mit à causer avec le chef de la famille.
Sidi-Zagal était Maure d’origine, et il était venu avec tous les siens s’établir dans la Nouvelle-Castille ; il avait loué auprès de Cuença, dans un assez mauvais terrain, une métairie, que le marquis de Pobar, qui en était propriétaire, lui avait affermée très-cher pour une quinzaine d’années.
Par son industrie, par son travail, par celui de sa femme et de ses enfants, il avait fini par rendre fertile cette terre dont il avait doublé la valeur. Il commençait à prospérer et à recueillir enfin le fruit de ses peines, lorsqu’en vertu des derniers édits, on était venu l’arrêter et le jeter dans les prisons de Cuença, lui et les siens, sous prétexte qu’aucun d’eux n’avait été baptisé, ce qui était vrai.
Mais le pauvre homme, exaspéré par la captivité et par la persécution qu’on lui faisait endurer, avait refusé de recevoir le baptême et de se convertir. On l’avait tenu prisonnier pendant près d’une année, et alors les supplications de sa femme, les pleurs et la misère de ses enfants, avaient fait sur lui ce que n’avaient pu faire la menace et les tourments. Il avait avoué que la foi venait tout à coup de l’éclairer, et avait consenti, pourvu qu’on lui rendit la liberté, à subir, ainsi que toute sa famille, la religion catholique, apostolique et romaine.
L’évêque de Cuença avait fait grand bruit de cette conversion, dont le grand inquisiteur Sandoval l’avait félicité, mais dont l’archevêque de Valence, Ribeira, avait été extrêmement jaloux, car il y avait rivalité entre tous les prélats du royaume : c’était à qui, de gré ou de force, obtiendrait le plus de conversions.
Quoi qu’il en soit, le nouveau chrétien Sidi-Zagal avait été, après un an de prison, renvoyé dans la métairie qu’il tenait du marquis de Pobar, un des premiers gentilshommes de la chambre du roi.
Mais pendant son année de captivité, les terres étaient restées en friche. Il n’avait pu faire de récolte et par conséquent payer son seigneur et maître, qui, aux termes du bail, pouvait, dans ce cas, rompre avec son fermier et le renvoyer ; ce qu’avait fait le noble gentilhomme, attendu que la terre ayant doublé de valeur par les soins de Sidi-Zagal, il pouvait maintenant louer sa métairie beaucoup plus cher à un autre.
Quant à l’année d’arrérages que lui devait son malheureux fermier, il la lui avait fait payer, en vendant à vil prix son troupeau, ses instruments aratoires et toute la monture de sa ferme.
C’est ainsi que le pauvre Maure et toute sa famille avaient quitté Cuença et se rendaient dans le royaume de Valence, convertis et chassés, chrétiens, mais ruinés.
Sidi-Zagal avait à peine achevé ce récit, que Piquillo, se levant, paya sa dépense et celle de ses pauvres convives ; tous les voyageurs qui avaient dîné dans l’hôtellerie s’étaient successivement remis en route, et Piquillo en allait faire autant.
— Que comptez-vous faire ? dit-il au Maure.
— Chercher de l’ouvrage pour moi et les miens. On dit que dans le royaume de Valence il y en a toujours pour nous autres enfants d’Ismaël.
Nos frères qui sont riches nous font travailler et nous pardonnent d’être chrétiens. Ils savent bien que ce n’est pas notre faute.
Comme il disait ces mots, on entendit le bruit d’une voiture, et plusieurs individus entrèrent dans l’hôtellerie faisant un bruit proportionné à leur importance. C’était à ne pas s’entendre.
— Un bon diner, de bon vin, et ce qu’il y aura de mieux ! cria l’un des voyageurs d’une voix haute.
— Voici, messeigneurs, dit humblement l’hôtelier.
— Quels sont ces nouveaux venus ? demanda tout bas Piquillo.
— Des gens du fisc.
— Et celui qui est à leur tête, ce gros homme ?
— Le receveur de la province de Valence, don Lopez d’Orihuela. Piquillo salua.
Le gros homme avait les bras trop courts pour atteindre jusqu’à son chapeau, car il ne salua pas, et n’eut pas l’air d’apercevoir Piquillo. Mais il jeta un regard de mépris et d’étonnement sur Sidi-Zagal et sa famille.
— Qu’est-ce que c’est que cela ? dit-il à l’hôtelier en les montrant du bout de sa canne à pomme d’or.
— Des Maures, ou plutôt de nouveaux chrétiens qui viennent de la Nouvelle-Castille, et se rendent dans le royaume de Valence.
— Eh bien ! ont-ils payé le droit de mutation ?
— Comment cela ? dit Piquillo.
Don Lopez d’Orihuela ne le regarda pas davantage, et continua sans répondre à personne :
— Ne savez-vous pas que des Maures, fussent-ils des chrétiens de fraîche date, ne peuvent point passer d’une province dans une autre et s’y établir… sans payer des droits au gouvernement ?
— Quelle tyrannie ! s’écria Piquillo, à qui l’hôtelier faisait vainement signe de se taire.
— Hein !… qu’est-ce ? qui a parlé ? continua le gros homme. C’est trois ducats par tête. Vous êtes neuf : vingt-sept ducats à payer au roi, représenté par moi.
El il tendit la main.
— Mais, monsieur, dit Piquillo, ces malheureux sont sans un maravédis.
— Ça ne me regarde pas. Ils paieront ou rebrousseront chemin, et n’entreront point dans le royaume de Valence.
— Et s’ils s’adressaient à votre générosité…
— Je ne répondrais qu’un mot : Je ne suis point payeur, mais receveur du roi. J’ai acheté ma charge assez cher, et Murvieo, monsecrétaire, ici présent, vous dira que je suis moi-même gêné, que le duc de Lerma nous demande toujours des versements en avance.
— Et Votre Excellence est en retard des deux derniers, ajouta le secrétaire.
— On ne vous demande pas cela ! répliqua sèchement don Lopez. Grâce au ciel, j’ai du crédit.
— Mais vous n’en faites point ! s’écria Piquillo ; et si l’on était pour vous aussi impitoyable que vous l’êtes pour les autres…
— Qu’est-ce à dire ? s’écria le receveur furieux. Je n’ai besoin de personne… moi !
— Peut-être ! s’écria une voix forte et vibrante qui partait de l’autre extrémité de la salle.
Tous les yeux se tournèrent de ce côté, et l’on vit, enveloppé dans un manteau, un beau jeune homme, de vingt-huit à vingt-neuf ans, adossé contre la muraille, immobile comme une statue, et qui, entré depuis quelques instants, n’avait pas perdu un mot de cette conversation.
XXVII.
les rencontres.
L’arrivée et la voix de l’inconnu avaient surpris tous les assistants, mais le receveur des finances, don Lopez d’Orihuela, fut celui sur lequel cette apparition produisit le plus d’effet.
Il oublia le dîner qu’on venait de lui servir, se leva sur-le-champ d’un air interdit, et ce qu’il y eut de plus étonnant, ses bras s’étaient tellement allongés par l’effet de la frayeur, qu’il ôta facilement son chapeau, et s’inclina même avec une souplesse que l’ampleur de son ventre n’aurait pas fait croire vraisemblable.
— Le seigneur Yézid ! s’écria-t-il.
— Lui-même, seigneur don Lopez d’Orihuela ! Remettez votre chapeau, et n’interrompez pas pour moi votre dîner, répondit le jeune homme, qui semblait grandir en ce moment de toute l’humilité du receveur. Vous demandiez, je crois, vingt-sept ducats pour ces pauvres gens… y compris ces enfants… c’est beaucoup.
— Certainement… dit don Lopez en balbutiant, je n’avais pas vu qu’il y avait des enfants.
— N’importe ! personne plus que nous ne respecte les droits du roi et du fisc… Il faut rendre à César ce qui appartient à César.
Et il jeta sur la table les vingt-sept pièces d’or.
— Quoi ! vous daignez, seigneur Yézid, vous occuper d’une misère pareille… Nous aurions réglé cela demain ensemble… car je me rendais de ce pas chez vous.
— Épargnez-vous cette peine ! ni mon père ni moi n’avons plus d’affaires à traiter avec vous.
— Quoi ! ce crédit que vous daigniez m’ouvrir…
— Ce jeune homme avait raison, dit Yézid en montrant Piquillo, pourquoi vous ferait-on crédit, vous qui n’en savez point faire ? Vous aurez, de plus, la bonté d’acquitter cette semaine les sommes que vous nous devez, nous avons attendu trop longtemps.
— Mais je perdrai ma place… elle sera donnée à un autre.
— Qui l’exercera peut-être avec moins de rigueur.
En ce moment l’hôtelier rentra dans la salle, et cria d’une voix haute :
— Le seigneur don Lopez d’Orihuela est servi.
— Que je ne retarde point votre diner… je pars, je continue ma route, mais j’ai auparavant deux mots à dire à ces braves gens.
Et Yézid, prenant à part Sidi-Zagal, se mit à causer avec lui à voix basse, tandis que le financier, tour à tour pâlissant, rougissant, voulait et n’osait implorer de nouveau l’inflexible Yézid. Il hésitait s’il se jetterait à ses pieds ou s’il battrait en retraite.
On le regardait ; il prit ce dernier parti et sortit fièrement, quitte à s’abaisser plus tard, en tête-à-tête, ou par écrit.
Pendant le peu de temps qu’avait duré cette scène, Piquillo, frappé de surprise, avait vainement cherché à rappeler ses idées. L’aspect d’Yézid, ses traits et surtout sa voix l’avaient jeté dans un trouble inexprimable.
Ce n’était pas la première fois que sa physionomie belle et imposante avait frappé ses yeux. Ce n’était pas la première fois que les accents de cette voix avaient retenti à son oreille et fait vibrer dans son cœur de nobles et généreux instincts. Lui aussi voulait courir et s’écrier : « Qui êtes-vous ? d’où viennent l’émotion et les souvenirs que votre vue réveille en moi ? » mais Yézid venait d’adresser quelques paroles de bienveillance à la pauvre mère et à ses enfants.
Il avait serré la main de Sidi-Zagal, dans laquelle, sans que personne le vit, il avait laissé tomber sa bourse, et comme celui-ci voulait le remercier, Yézid s’était élancé sur un cheval qu’un écuyer tenait en main à la porte de l’hôtellerie, et quelques secondes après, le maître et le domestique étaient déjà bien loin. Mais en voyant fuir ainsi devant lui le jeune Arabe emporté sur son rapide coursier, Piquillo venait de retrouver tous ses souvenirs.
Cette scène venait de lui rappeler celle de la forêt, et la nuit où, dans la sierra de Moncayo, et dans une circonstance à peu près pareille, Yézid lui était apparu pour la première fois.
— C’est lui ! s’écria-t-il, c’est mon bienfaiteur !
Et se tournant vers l’hôtelier, qui descendait en ce moment.
— Le connaissez-vous ? s’écria-t-il, savez-vous qui il est ?
— Sans doute, dit l’hôtelier en souriant, et le seigneur don Lopez, son débiteur, le sait encore mieux que moi.
— Son nom… son nom ! dites-le-moi, par grâce !
— Demandez-le à tous les pauvres, à tous les malheureux ! le premier venu vous le dira.
En effet, Sidi-Zagal, les larmes aux yeux, s’écria :
— C’est le noble, c’est le généreux Yézid. Il nous a dit : Venez tous, vous serez reçus chez mon père ; vous y trouverez du travail et du pain… et surtout des amis !
— Il a dit cela ! s’écria Piquillo en se rappelant qu’autrefois, dans la forêt, Yézid lui avait adressé à peu près les mêmes paroles : il a dit cela !
— Il a fait plus : il m’a donné de quoi achever le voyage, et au delà. Voyez plutôt cette bourse ! Oui, ma femme ; oui, mes enfants, vous n’avez plus rien à craindre du malheur et de la misère… Yézid d’Albérique vous protége !
— D’Albérique !… s’écria Piquillo ; quel nom avez-vous dit ?
— Le sien ! c’est le fils de Delascar d’Albérique.
— Delascar !… dit Piquillo en poussant un cri.
— Qu’avez-vous, seigneur étranger ? dirent Sidi-Zagal et ses enfants, en le voyant chanceler et pâlir.
— Ce n’est rien, mes amis… ce n’est rien ; j’espère bientôt vous revoir.
Et il se remit en route, assailli par une foule de nouvelles pensées.
Quoi ! ce noble jeune homme, le premier qui avait éveillé en lui des sentiments d’honneur et de vertu, celui qui l’avait réconcilié avec lui-même en lui disant : Courage, tu seras un honnête homme ! celui enfin qu’il avait admiré dès le premier moment qu’il l’avait vu… c’était son frère ! ou du moins ce pouvait être son frère !… oui… oui, son cœur le lui disait. Ce devait être… c’était là sa famille, car il éprouvait de ce côté autant d’entraînement et de sympathie qu’il avait ressenti de répulsion et d’éloignement pour le duc d’Uzède et les siens.
Après cela, quelle preuve donner ?… quel droit faire valoir ?… aucun ! N’importe ! il marchait d’un pas plus hardi, il s’avançait maintenant avec plus de confiance. D’après ce qu’il connaissait d’Yézid, son père Delascar d’Albérique devait être un cœur noble et bon ; il ignorait quel accueil était réservé à lui, Piquillo, enfant inconnu, mais, à coup sûr, on ne le mettrait pas à la porte, on ne le ferait pas chasser par des valets, comme avait fait le duc d’Uzède.
Cependant, à mesure qu’il s’avançait dans la Huerta, ou plaine de Valence, et lorsque, frappé d’admiration et de surprise à la vue de ces champs si bien cultivés, de ces riches moissons, de ces nombreux troupeaux, de ces riantes fabriques qui s’élèvent de toutes parts, il s’écriait, comme avait fait la reine, sept ans auparavant : À qui tous ces trésors ? et que chaque laboureur, chaque berger, chaque ouvrier lui répondait : Au Maure Delascar d’Albérique, — Piquillo, découragé et effrayé de tant de richesses, se disait à part lui : Il est impossible qu’un pareil homme puisse faire attention au pauvre Piquillo, et laisse tomber sur lui un regard de bienveillance.
Il y en a tant d’autres, et il pensait au receveur don Lopez d’Orihuela, qui sont durs, dédaigneux et orgueilleux à meilleur marché.
Il n’était plus qu’à quelques lieues du Valparaiso, ou Vallée du paradis, habitée par le Maure et par sa famille, et plus il approchait du but de son voyage, plus il sentait redoubler son hésitation et ses craintes.
S’il avait osé, il serait retourné en arrière ; et pour se reposer, ou plutôt pour différer encore de quelques heures son arrivée, il s’arrêta à une petite hôtellerie située sur le penchant d’un coteau et qui avait pour enseigne la Corbeille de Fleurs.
La vérité habite rarement les enseignes ; mais cette fois du moins le voyageur n’était pas trompé, car, de la fenêtre ouverte sur laquelle s’appuyait Piquillo, il voyait de tous les côtés s’élever autour de la posada les touffes de fleurs qui embaumaient l’air et réjouissaient la vue.
Il contemplait les campagnes ravissantes qui se déroulaient devant ses yeux, paradis terrestre où il semblait si facile d’être heureux, et pour cela, il ne manquait à ce riche paysage qu’une vue… une seule… et sa bouche murmurait tout bas le nom d’Aïxa.
Absorbé dans ses réflexions, il ne s’apercevait pas que lui-même était l’objet d’une attention toute particulière.
À quelques pas au-dessous de lui, en dehors de la posada, un homme vêtu de noir ne détournait point ses regards de la fenêtre sur laquelle était appuyé Piquillo. Celui-ci à la fin baissa les yeux, et reconnut l’alguazil qu’il avait rencontré l’avant-veille au Faisan-d’Or.
Était-ce ou non le capitaine Juan-Baptista Balseiro ?…
C’est ce dont il voulut s’assurer. Il le regarda à son tour attentivement, et d’un œil si décidé et si ferme que, malgré son aplomb et son audace, l’inconnu parut éprouver quelque embarras.
Piquillo, en le rencontrant quelques jours auparavant, n’avait pu se défendre d’un mouvement de surprise et même de terreur, tant les premières impressions de la jeunesse sont fortes et durables, et Piquillo avait eu autrefois si peur du capitaine, qu’il n’était pas étonnant qu’il lui en restât quelque chose. Mais il avait trop de cœur et trop de raison, pour céder plus longtemps à une crainte absurde dont il rougissait ; ce n’était pas à lui, c’était au capitaine à trembler, et décidé à éclaircir cette affaire, il ferma la fenêtre, descendit l’escalier, sortit de la posada et se dirigea vers l’endroit où il avait laissé le prétendu alguazil.
Il avait disparu : il eut beau regarder, il ne vit personne.
Il pensa que cette seule manifestation avait mis en fuite l’observateur.
Il rentra en riant, se fit servir à déjeuner, et, seul devant une table, dans la basse salle de l’hôtellerie, il achevait son repas, quand une voix claire, nette et stridente, prononça derrière lui ce seul mot :
— Piquillo !
Il se retourna vivement pour voir qui l’appelait.
— C’est bien lui, dit la même voix ; c’est tout ce que je voulais savoir.
Piquillo saisit un couteau qui était sur la table et se leva.
Il aperçut l’homme noir qui venait de franchir la croisée de la salle basse. Il s’enfuyait à travers la campagne, et disparut bientôt derrière un bois d’orangers et de citronniers.
Piquillo eut un instant l’idée de le poursuivre ; mais il ne connaissait pas le pays, et puis ce n’était pas pour le capitaine Juan-Baptista, si toutefois c’était bien lui, qu’il était venu à Valence.
Sa mission n’était pas de le faire arrêter, juger et condamner ; les rapports mêmes qu’il avait eus autrefois avec lui ne pouvaient, s’ils étaient divulgués, que lui faire du tort auprès de sa nouvelle famille, et la recommandation du capitaine n’était pas un bon moyen de se faire accueillir par elle.
Il ne parla donc de cette rencontre, ni au maître de la posada, ni à aucun de ses gens, et continua sa route. Mais sans être faible ni superstitieux, il ne pouvait se dissimuler à lui-même que cette aventure, que la vue de Juan-Baptista, son persécuteur et son mauvais génie, était de fâcheux augure pour l’entreprise qu’il allait tenter, et tout lui disait que ce voyage devait lui porter malheur.
Préoccupé de ces idées, il faisait à peine attention aux sites enchanteurs qui, de tous les côtés, s’offraient à ses regards, et lorsqu’il arriva en vue de la ferme ou plutôt du palais de Delascar d’Albérique, il se frotta les yeux comme un homme qui s’éveille.
Il semblait qu’il n’eût rien vu de la route, et qu’il se trouvât transporté là comme par enchantement.
Enchantement était bien le mot, car cette habitation, dont nous avons fait la description lors du voyage et du séjour de la reine, paraissait à Piquillo, qui n’avait aucune idée de l’architecture mauresque, un édifice magique bâti par les fées. Il arrivait aussi le soir, au soleil couchant, et s’arrêta pour jouir du délicieux spectacle que présentait la vallée.
Il attendit que les ombres eussent couvert les jardins, la ferme et le palais. Il aimait mieux n’entrer qu’à la nuit dans cette riche habitation.
S’il devait en être chassé, personne du moins ne verrait sa honte. Il se glissa donc furtivement et en tremblant le long des murs, et arrivé à la porte principale, il leva d’une main timide un marteau d’airain, qui, retombant avec fracas, le fit tressaillir.
XXVIII.
le toit paternel.
Au bruit que fit le marteau, on entendit les chiens aboyer, on vit briller des lumières, et un jeune homme grand et fort, leste et bien découplé, aux yeux vifs et noirs et au teint basané, parut à la grille et demanda :
— Qui va là ?
— Un étranger.
— Que voulez-vous ?
— Un asile.
La grille s’ouvrit, et le jeune Maure d’une voix douce et franche s’écria :
— Que l’étranger soit le bienvenu ! il est ici chez lui, il est chez Delascar d’Albérique !
— Puis-je lui parler ? dit timidement Piquillo.
— C’est l’heure de la prière. Il est enfermé avec son fils et tous les siens ; mais ce ne sera pas long. Entrez. et asseyez-vous au foyer ; vous voilà de la maison.
— Sans savoir qui je suis ?
— Notre maître vous le demandera demain, quand vous vous en irez.
— Mais aujourd’hui ?…
— Aujourd’hui, vous êtes son hôte et son ami, et j’ai ordre de vous traiter comme tel.
En parlant ainsi, le jeune Maure ouvrit un salon élégant, richement éclairé, entouré de divans pour reposer les membres fatigués du voyageur. Sur une table de marbre, on voyait briller, dans des flacons de cristal, des liqueurs rafraichissantes ou fortifiantes.
Le Maure prit un vase et le présenta à Piquillo.
— C’est la coupe de l’hospitalité, lui dit-il en souriant, et dès que tes lèvres y auront touché, tu seras sacré pour nous.
Mais Piquillo tenait la coupe, regardait le jeune Maure, et sa main tremblait.
— Qu’as-tu donc ? es-tu un ennemi, un traitre ?… alors, s’écria-t-il avec un accent qui partait d’un noble cœur, hâte-toi de boire ! hâte-toi, tu n’auras plus rien à craindre : c’est nous qui te défendrons.
Et le jeune Maure remplit la coupe jusqu’aux bords ; mais au lieu de boire, Piquillo s’appuya d’une main sur la table de marbre, tandis que de l’autre il tenait la coupe vacillante. Son cœur paraissait oppressé, des larmes roulaient dans ses yeux, et dans un trouble inexprimable, il s’écria :
— Frère, frère, si je me trompe, ne me réponds pas.
— Et pourquoi ?
— C’est qu’il me semble que c’est toi… et si je m’abuse, rien ne me consolera.
Il posa la coupe sur la table de marbre, saisit le jeune Maure par la main, écarta les cheveux noirs qui retombaient en boucles épaisses sur son front, le regarda encore une fois avec un œil incertain et avide, puis, d’une voix émue et haletante, il s’écria :
— Pedralvi !
— C’est moi, c’est mon nom ! qui te l’a dit ?
— Mon cœur, qui n’a jamais changé, comme mes traits. As-tu donc oublié ton jeune ami, celui qui ne t’a plus revu-depuis la nuit où, pour le délivrer, tu franchissais les murs du Soleil-d’Or ?
— Piquillo ! s’écria son ancien camarade en se jetant dans ses bras.
— Oui, c’est moi ! et Juanita, notre protectrice ?
— Morte ! s’écria Pedralvi… morte ou perdue à jamais.
— Non, vivante ! et sauvée par moi ! sauvée pour toujours !
— Que dis-tu ?
— Qu’elle t’aime toujours… qu’elle te pleure, qu’elle t’attend.
— Où est-elle donc depuis cinq ans ?
— Dans les cachots de l’inquisition !
— Comment la délivrer ?
— C’est déjà fait, elle n’y est plus !
Les deux amis, assis sur un divan, s’interrogeaient mutuellement et à la fois. Une demande n’attendait pas l’autre. Ils eurent bien de la peine à mettre quelque ordre dans le récit de leurs aventures.
Celles de Piquillo, le lecteur les connaît, et celles de Pedralvi n’étaient pas longues.
Depuis le jour ou plutôt la nuit où Piquillo avait été emmené par le capitaine Juan-Baptista, laissant son camarade à cheval sur le chaperon du mur de l’hôtellerie du Soleil-d’Or, Pedralvi s’était enrôlé dans les marmitons de l’hôtel pour ne pas quitter Juanita, la servante.
Deux ans plus tard, lorsque le barbier Gongarello était parti avec sa nièce pour Madrid, Pedralvi, commençant à comprendre qu’il ne savait rien et qu’il n’était bon à rien, avait résolu, en lui-même, de faire fortune ; mais ne sachant ni lire ni écrire, il n’avait qu’un parti à prendre… celui de se faire soldat ou matelot. Cette chance-là ne lui était pas même permise.
Comme Maure, il ne pouvait porter les armes ; ne pouvant servir dans les armées, ni dans les flottes du roi, à Valence, où il était venu pour s’embarquer, il serait mort de faim, s’il n’avait trouvé à se placer dans la marine marchande, à bord d’un vaisseau richement chargé qui appartenait au Maure Delascar d’Albérique.
Yézid, le fils du maître, l’avait distingué à cause de son zèle et de son travail. Il l’avait pris avec lui, l’avait élevé, lui avait témoigné affection et estime ; bien plus, il lui avait donné sa confiance, et Pedralvi, qui s’était dévoué corps et âme à la famille d’Albérique, ne demandait qu’une chose au ciel, c’était une occasion de se faire tuer pour eux, seul moyen qu’il eût de leur prouver sa reconnaissance.
— On dit qu’ils sont bien riches ? lui demanda Piquillo avec inquiétude.
— Riches comme le roi ! Mais ils emploient mieux que lui leur fortune ; car ils donnent de l’ouvrage à tout le monde, et surtout à leurs frères opprimés et malheureux.
Aussi Delascar et son fils sont regardés comme les chefs et les soutiens des Maures. Eux seuls, peut-être, n’ont pas été baptisés.
— Et le duc de Lerma ne les inquiète pas ?
— On n’oserait. Plutôt que d’y souscrire, ils quitteraient le pays, et si Delascar d’Albérique fermait ses ateliers, tous les ouvriers se révolteraient.
— Est-il marié ? demanda Piquillo avec crainte.
— Il est veuf depuis bien des années ; et quoique sa croyance lui permette non-seulement de se remarier, mais d’avoir plusieurs femmes, il s’est consacré à son fils et au bonheur des siens.
— Et tu dis qu’il est noble et généreux ?
— Tu le verras par toi-même, si tu as quelque chose à lui demander.
En ce moment la prière du soir venait de finir.
Delascar d’Albérique allait se mettre à table avec son fils et les chefs de ses ateliers, ainsi que les principaux employés de sa maison, table immense et patriarcale présidée par lui.
C’était un grand bonheur d’y être admis, un châtiment d’en être exclu. Mais chacun se soumettait, sans murmurer, aux décisions du vieillard.
Les Arabes conservèrent longtemps de leurs anciennes mœurs ce respect, Cette soumission, cette obéissance passive de la famille pour son chef. Autrefois chaque père, dans sa maison, avait presque les droits du calife[18] ; il jugeait sans appel les querelles entre ses femmes, entre ses fils ; il punissait sévèrement les moindres fautes, et pouvait même infliger la peine de mort pour certains crimes.
La vieillesse seule donnait cet empire. Un vieillard était un objet sacré.
Sa présence arrêtait le désordre ; le jeune homme le plus fougueux baissait les yeux à sa rencontre, écoutait patiemment ses leçons, et croyait voir un magistrat à l’aspect d’une barbe blanche.
Cette puissance des mœurs, qui vaut bien celle des lois, existait encore dans la maison d’Alami Delascar d’Albérique ; tous ceux de sa tribu se regardaient comme ses enfants, et le respectaient comme le chef de la famille.
— Maître, lui dit Pedralvi, voici un étranger qui réclame l’hospitalité, et qui, en outre, a une grâce à te demander.
— Et moi, je lui en demande une, répondit le vieillard, c’est qu’il veuille bien s’asseoir à ma table.
— Cet étranger n’en est pas un ! s’écria Yézid en le reconnaissant ; car avant-hier, à la posada du Faisan-d’Or, chez Manuelo, il a pris la défense de ce pauvre Sidi-Zagal, dont je vous ai parlé, mon père.
— Oui, dit le vieillard… Sidi-Zagal… à qui tu donneras la ferme de Xativa. C’est un de nos frères.
— C’est un des miens ! s’écria Piquillo avec fierté ; moi aussi je suis Maure !
— Et pourquoi alors, répondit Delascar, demandes-tu l’hospitalité, quand tu es chez toi ? Assieds-toi là, mon frère, entre mon fils et moi. Et vous, dit-il aux domestiques, servez-nous.
Delascar avait à peine soixante ans, et sa vieillesse était verte et vigoureuse ; ses yeux pleins de feu brillaient d’un éclat juvénile, sa voix était mâle et sonore, son esprit étendu et cultivé.
Pendant le repas, Yézid mit la conversation sur les Maures leurs ancêtres, sur leur domination et leurs lois quand ils étaient maîtres de Grenade et de Cordoue. Delascar répondait à la fois à son fils et à son nouvel hôte, qui l’interrogeait sur le glorieux Abdérame et sur Al-Man-Zour, et Piquillo, encouragé à son tour par l’air affable du vieillard, par son sourire gracieux et approbateur, sentit bientôt sa crainte se dissiper.
Il se crut en famille, et, sans cesser d’être modeste, se montra si aimable et si instruit, que plus d’une fois le vieillard et son fils se regardèrent entre eux avec contentement et presque avec orgueil, en voyant un des leurs posséder, si jeune encore, tant de goût, de sagacité et de jugement.
Le plus étonné était Pedralvi, qui, debout derrière son ancien camarade, dont il était fier, l’écoutait avec tant de ravissement qu’il oubliait souvent de le servir.
Quant à Piquillo, il osait à peine, durant le repas, lever les yeux sur Delascar ; mais il était attiré vers Yézid par un attrait irrésistible, et que ce fût ou non son frère, il sentait que son cœur était à lui pour toujours.
Lorsque le souper fut terminé, le vieillard, Yézid et Piquillo passèrent dans une salle particulière.
— Parlez maintenant, dit Delascar, je vous écoute. Yézid, par discrétion, se leva pour se retirer.
— Non, seigneur Yézid, s’écria Piquillo, je vous supplie au contraire de vouloir bien rester.
— Que pouvons-nous pour vous ? lui dit gracieusement Delascar.
Piquillo voulut parler et s’arrêta tremblant.
— Qui êtes-vous, du moins ? poursuivit le vieillard en voyant son embarras. Maintenant, notre hôte, nous pouvons vous le demander.
— Qui je suis… quel est mon nom ?
Il balbutia… à demi-voix celui d’Alliaga.
— Alliaga, dit vivement le vieillard, c’était le nom d’un brave soldat qui combattit avec nous dans les Alpujarras. Moins heureux que moi, il ne rencontra pas pour le sauver un ami comme don Juan d’Aguilar… et fut, dit-on, massacré.
— C’est la vérité, dit Piquillo… je suis de son sang.
— Ah ! c’était votre parent… dit Delascar en lui prenant la main, vous devez alors avoir connu sa fille ?
— Oui, seigneur, dit Piquillo en tressaillant.
— Pauvre jeune fille ! s’écria Delascar avec tristesse ; je t’en ai parlé plus d’une fois, Yézid, dit-il en se tournant vers son fils.
Oui, j’étais libre alors, et elle m’aimait ! je le croyais du moins ; mais la vanité, le désir de briller, et surtout sa mère, l’ont perdue… Il m’a fallu abandonner celle qui me trahissait ! Depuis, j’ignore ce qu’elle est devenue.
— Et vous, dit-il en s’adressant à Piquillo, le savez-vous ?
— Oui, seigneur.
— A-t-elle besoin de moi ? parlez ! dit vivement Delascar.
— Non, seigneur.
— En quels lieux, du moins, existe-t-elle ?… dites-le-moi.
— Elle n’existe plus !
— Ah ! pauvre Giralda ! s’écria le vieillard en croisant les mains.
Il garda quelques instants le silence et semblait comme absorbé dans quelques souvenirs du passé. Pendant ce temps deux grosses larmes roulaient dans ses yeux, et glissèrent le long des rides qui sillonnaient ses joues.
— Ainsi, dit-il à Piquillo, ce n’est pas pour elle que vous venez ?
— Pour elle, au contraire, reprit Piquillo avec émotion… pour elle !… pour lui obéir… car moi, seigneur… je ne demande rien… je ne veux rien… que vous remettre cette lettre… qui est écrite de sa main.
— De Giralda ? s’écria le vieillard ; donnez, donnez !
Et il prit la lettre d’une main tremblante. Il s’assit pour la lire dans un fauteuil, contre lequel Yézid était appuyé, et pendant ce temps, Piquillo, debout derrière lui, se cacha la tête dans ses mains.
Le vieillard lut la lettre lentement et avec une émotion qu’il s’efforçait vainement de cacher.
Quand il eut fini, il la donna à Yézid en lui disant :
— Mon fils bien-aimé, je n’ai pas de secret pour toi, lis.
Se levant alors, il s’approcha de Piquillo, qui, toujours debout, toujours la tête baissé, attendait en tremblant son arrêt.
Delascar posa sa main sur l’épaule du jeune homme, Piquillo tressaillit, et le vieillard lui dit d’une voix lente et solennelle…
— Tu ne serais que le fils d’Alliaga…
Mais le généreux Yezid ne le laissa pas achever. Il se précipita dans les bras de Piquillo en s’écriant :

— Mon frère, mon frère ! moi, je te regarde comme tel ! et vous, mon père, vous ne me désavouerez pas !
— Non, Yézid, non, mon fils, j’aurais gardé chez moi, j’aurais adopté l’enfant d’Alliaga, à plus forte raison, celui que tu nommes ton frère !
Piquillo tomba à leurs genoux, pressant contre ses lèvres leurs mains qu’il baignait de ses larmes.
— Sois le bienvenu parmi nous ! s’écria le vieillard. Si le ciel nous abuse, ton cœur du moins ne nous trompera pas ! Aime Yézid comme ton frère, car c’est le plus noble et le plus généreux des hommes.
— Je le sais, je le sais ! s’écria Piquillo.
— Jure-moi de le respecter comme l’aîné, comme le chef de la famille, de le défendre et de mourir pour lui, s’il le faut.
— Je le jure !
— C’est ton devoir, mon fils.
— Et ce devoir, je le remplirai. Je vous le jure devant Dieu et devant vous ! je le jure par l’honneur, par le nom sacré que vous me permettez de vous donner ! ce nom, ajouta-t-il en hésitant, que ma bouche n’ose encore prononcer.
— Et que j’attends, répondit le vieillard en souriant.
— Mon père ! s’écria Piquillo.
Delascar le reçut dans ses bras, et Yézid, le faisant asseoir entre eux deux, le traita dès ce moment comme le fils de la maison, comme l’enfant de retour, sous le toit paternel, après un long voyage.
— Voyons, frère, lui dit-il, raconte-nous ce qui t’est arrivé pendant ton absence.
Et Piquillo attendri, Piquillo, qui comprenait tout ce qu’il y avait de délicat et de généreux dans chaque mot d’Yézid, se mit à raconter tout ce qu’il se rappelait de sa vie, jusqu’à leur rencontre dans la sierra de Moncayo ; comment quelques paroles d’Yézid avaient contribué à le diriger dans la bonne voie, et à faire de lui un honnête homme ; comment, par malheur, il n’avait pu profiter de ses offres généreuses.
— Je le crois bien ! s’écria Yézid ; vous rappelez-vous, mon père, la bourse et les tablettes qui m’ont été rapportées par ce prétendu marin ; la fable qu’il nous a faite de cet enfant, enlevé par nos frères, les Maures d’Afrique ?
— Oui, dit le vieillard, et le millier de ducats que nous lui avons donnés pour le rachat, l’éducation et l’établissement de cet enfant.
— Et c’est moi qui suis cause que l’on vous à ainsi rançonnés et pillés ! s’écria Piquillo.
— Il vaut mieux que cela soit ainsi, répondit Yézid, puisque te voilà.
Piquillo, continuant alors son récit, leur raconta comment il avait sauvé don Juan d’Aguilar ; comment, recueilli par ce digne seigneur, il avait été élevé, par lui, près de ses deux filles, Carmen et Aïxa ; comment il avait découvert à Pampelune la Giralda, sa mère, et comment, protégé par Fernand d’Albayda, il avait attendu de lui son état et son avenir, jusqu’au jour le plus heureux de sa vie, où il venait de trouver une noble famille qu’il n’osait encore dire la sienne ; mais plus tard, du moins, grâce à sa tendresse et à son dévouement, il espérait bien ne pas mourir insolvable, et se montrer digne des cœurs généreux qui daignaient le reconnaître et l’adopter.
Pendant ce récit, que Yézid avait entendu avec la plus vive émotion, plusieurs fois il s’était levé, plusieurs fois il avait voulu interrompre Piquillo ; mais retenu par un regard de son père, il se rasseyait, il se calmait et continuait à écouter.
Quand Piquillo eut terminé, la nuit était avancée, et, fatigués des émotions de la journée, tous avaient besoin de repos. Delascar appela ; et toujours le premier à obéir au moindre signal de ses maîtres, Pedralvi parut.
— Voici, lui dit le vieillard en lui montrant Piquillo, voici, mais pour toi seul, car c’est encore un secret, le fils de la maison, le jeune senor Alliaga, ton nouveau maître.
Pedralvi, hors de lui, ouvrait les yeux et les oreilles. Il croyait avoir mal entendu.
— Oui, répéta Yézid en souriant, c’est mon frère. Pedralvi se mit alors à sauter de joie, ravi de ce changement inattendu.
— Le présent ne me fera pas oublier le passé, dit Piquillo, en tendant la main à son ancien camarade.
Delascar donna ordre au fidèle serviteur de conduire son jeune maître dans son appartement. Adieu, mes fils, dit-il aux deux jeunes gens. Il embrassa Piquillo, qui se retirait, et il fit signe à Yézid de rester avec lui.
— Imprudent ! lui dit-il en souriant.
— Qu’ai-je donc fait, mon père ?.
— Tu allais, comme à l’ordinaire, n’écouter que ton cœur. Tout semble prouver qu’Alliaga est un noble et généreux jeune homme qui mérite ce que nous faisons pour lui ; mais nous ne connaissons encore ni sa prudence, ni sa discrétion, et j’ai vu le moment où, dans l’excès de ta confiance, tu allais…
— Tout lui dire, c’est vrai ! tout lui confier, comme à un frère ! nos projets, nos secrets, ceux de notre famille, celui de nos richesses…
— Attends, mon fils, attends encore… que le temps nous ait permis de l’éprouver. Je crois à sa loyauté ; mais sait-on à son âge garder un secret ? Un jeune homme ne peut-il pas le trahir, même à son insu, par étourderie, par légèreté et surtout par amour ? Ces secrets, d’ailleurs, et tout ce qui s’y rapporte, nous appartiennent-ils à nous seuls ?
— Vous avez raison, mon père, dit vivement Yézid en pensant à la reine ; ils compromettraient bien d’autres que nous !
— Et tu livrerais à une jeune tête, que nous connaissons à peine, un secret que tu n’as même pas confié à Fernand d’Albayda, ton ami d’enfance et notre protecteur.
— Pardon, mon père, aujourd’hui, comme toujours, la prudence a parlé par votre bouche. Quelque tendre affection que je ressente pour Alliaga, je ne lui dirai rien que vous ne me l’ayez permis.
— Bien, Yézid. Maintenant, va te reposer.
Et le jeune homme se retira.
Alliaga, conduit par Pedralvi, venait d’entrer dans l’appartement qui lui était destiné. Pedralvi s’était dit : c’est le fils de la maison, c’est un secret que l’on a confié à moi, à moi seul ! Et certain de n’être pas désavoué, il avait conduit son ancien camarade et son nouveau maître dans la chambre la plus somptueuse, après celle d’Yézid et de son père.
Si la reine d’Espagne avait été étonnée de l’élégance de son appartement, qu’on juge de la surprise de Piquillo, qui n’était pas habitué, même chez le vice-roi de Navarre, à un luxe pareil.
Il osait à peine fouler aux pieds ces tapis soyeux, ces bouquets de fleurs, travail admirable, chef-d’œuvre d’industrie et de magnificence. Quand Pedralvi s’approcha de lui pour le déshabiller, il le repoussa de la main.
— À quoi penses-tu ? à quoi pensez-vous, mon maître ? dit le jeune Maure, en se reprenant, d’un air respectueux.
— Je pense, dit Alliaga, au jour où, assis tous les deux au coin d’une borne dans la rue de Pampelune, nous étions bien heureux d’un rayon de soleil et d’une côte de melon.
Puis, faisant un signe à Pedralvi de s’asseoir à côté de lui, les deux amis causèrent encore longtemps du passé, et de l’avenir qui maintenant s’offrait à eux si riant et si doux !
Alliaga enfin demeura seul ; enfoncé dans de riches et moelleuses courtines, sous des rideaux de damas aux franges d’or, il retrouva plus charmants et plus gracieux encore les songes que, dans la sierra de Moncayo, il avait dus autrefois à son frère Yézid.
Cette fois du moins, il ne trouva pas à son réveil l’horrible figure du capitaine Juan-Baptista, mais près de lui à son chevet, en ouvrant les yeux, il vit les traits vénérables de Delascar d’Albérique.
Pour la première fois de sa vie, il s’entendit saluer de ces douces paroles : — Bonjour, mon fils !
À ces mots, Piquillo sentit tout son cœur tressaillir, et ses yeux se tournèrent avec une expression de bonheur et de reconnaissance vers celui qui les lui adressait. Un instant après, Yézid entra et vint lui donner l’accolade fraternelle.
— Mon fils, dit le vieillard… Il y avait dans la manière dont il prononçait ce nom, une expression qui équivalait presque à une caresse ; il le répétait souvent, et à dessein, comme pour dédommager celui qui avait été si longtemps sans l’entendre. Mon fils, lui dit Albérique, j’ai pensé toute cette nuit à toi et à ton avenir. Tu es venu à nous dans un temps d’épreuve et de malheur, la persécution nous menace, et si la main puissante qui nous soutient encore se retirait de nous, je ne sais ce qui arriverait de nos destinées, de nos fortunes, de nos jours peut-être !
— Je suis donc venu au bon moment ! s’écria Alliaga ; mon sort ne se séparera plus du vôtre.
— Oui, au jour du danger nous t’appellerons, et tu viendras, j’en suis sûr, dit le vieillard en voyant l’ardeur qui brillait dans les yeux d’Alliaga.
— Tu viendras nous défendre, dit Yézid.
— Ou mourir avec vous, mon frère, répondit Piquillo.
— Bien, mes enfants, mais d’ici là, continua d’Albérique, et dans ton intérêt même, gardons pour tout le monde, excepté pour Pedralvi, notre fidèle serviteur, et pour don Fernand, notre ami, le secret de ta naissance. Quelle que soit la carrière où t’appellent ton éducation et tes talents, ton origine te serait plus nuisible qu’utile sous le ministère du duc de Lerma. Auprès de Fernand d’Albayda, premier baron de Valence, et dont la famille a toujours protégé les nôtres, ce sera un titre de plus à son amitié ; auprès de tout autre ce serait un titre de proscription.
— Eh ! qu’importe ?
— Il importe, mon fils, dit gravement le vieillard, qu’il ne faut pas braver un danger inutile. Il s’en présentera assez d’autres qu’on ne pourra peut-être pas éviter.
Que Fernand, par son crédit, vous élève à une position avantageuse et solide, c’est tout ce que je veux pour vous !… et pour nous aussi, ajouta-t-il en souriant ; cette dernière considération vous décidera peut-être à m’écouter.
Le pouvoir que vous pourrez acquérir viendra en aide à nous et à nos frères. Vous les servirez plus utilement à la cour qu’ici dans nos travaux d’agriculture ou d’industrie, où les bras ne nous manquent point. Ce qui nous manque, ce sont des gens influents dans les hautes classes, et d’après ce que je sais de vous, c’est par la plume ou la parole que vous défendrez nos droits.
Partez donc ; ayez de l’ambition, sinon pour vous, au moins pour nous. Ne songez qu’à votre élévation, et ne vous inquiétez pas de votre fortune : elle est faite, puisque nous sommes riches. Chaque année, mon cher enfant, nous vous donnerons…
— Tout ce qu’il voudra, interrompit vivement Yézid, comme vous le faites pour moi ! À quoi bon lui fixer une pension ?
— Il a raison, dit d’Albérique, vous demanderez à votre père ou à Yézid, le chef de la famille après moi, toutes les sommes dont vous aurez besoin pour votre bonheur, vos plaisirs ou même vos caprices…
— C’est trop, c’est trop, mille fois ! s’écria Alliaga, confondu de tant de bontés, et ne trouvant plus de termes pour exprimer sa reconnaissance.
Il fut convenu que, trois ou quatre jours après, Alliaga retournerait à Madrid, où Fernand d’Albayda devait être de retour, et quel que fût le bonheur qu’éprouvât Piquillo au sein de sa nouvelle famille, il discuta moins cette fois, et se soumit, après une légère résistance, aux ordres de son père.
— Bien, dit le vieillard, il se forme, il commence à obéir.
Ce que n’avouait pas l’heureux Alliaga, c’était son impatience de revoir Aïxa, de lui apprendre que lui aussi se trouvait maintenant dans une position riche et honorable ; de lui déclarer enfin ce que jamais il n’avait osé ni avouer, ni même laisser entrevoir, ses rêves, ses projets et son amour.
Pendant les trois jours qui s’écoulèrent encore, Yézid menait chaque matin son frère dans les riches plaines de Valence, dans ces champs fertilisés par leurs soins, dans ces nombreuses fabriques où l’industrie étalait ses prodiges.
Il lui montrait les trésors créés et renouvelés chaque jour par le travail ; et quand Alliaga ne pouvait retenir ses cris d’étonnement et d’admiration, Yézid lui serrait la main, et lui disait à demi-voix, avec un air de contentement :
— Tout cela est à toi, frère.
— Non, non, jamais !
— Eh bien, à nous… si tu l’aimes mieux.
Le soir, ils rentraient tous les deux près du vieillard. Au repas de famille succédaient les longs entretiens et les doux épanchements du cœur.
Combien alors Alliaga découvrait dans son père d’indulgence et de bonté, jointes à un savoir et à une raison si supérieurs ! Combien il appréciait dans Yézid cette généreuse franchise, cette grâce chevaleresque, cette noblesse de sentiments, et surtout cette amitié si naturelle, si vive, si expansive, à laquelle on ne pouvait résister, et qui semblait dire : Aimez-moi, car je vous aime !
Aussi, et excepté son amour pour Aïxa, jamais Alliaga n’avait éprouvé d’affection plus douce et plus tendre que celle qui le portait vers son frère Yézid.
Déjà même, clairvoyant par amitié, il s’était aperçu qu’au milieu de toutes les richesses et de toutes les jouissances qui l’environnaient, Yézid n’était pas complétement heureux.
Parfois un nuage obscurcissait son front, parfois un sourire triste et mélancolique errait sur ses lèvres.
Un jour, et dans une allée où il se croyait seul, Yézid avait tiré de son sein une fleur de grenade desséchée, qu’il avait portée à sa bouche.
En vain d’Albérique pressait son fils de faire un choix et de se marier : toujours bon et gracieux, Yézid ne discutait point avec le vieillard, il lui répondait en souriant : Nous verrons, mon père. Mais les jours, les années s’écoulaient, et Yézid n’avait pu encore se décider à choisir.
— Il aime, se disait en lui-même Piquillo, il aime sans espoir. J’en suis sûr, je m’y connais ! j’étais comme lui, autrefois, car maintenant je suis heureux !
Il n’osait, par discrétion, rien demander à Yézid. Il respectait son secret, mais s’il fût resté un jour de plus, il lui aurait dit le sien, il lui aurait dit : J’aime Aïxa ! persuadé que sa confiance eût attiré celle de son frère.
XXIX.
les alguazils.
Enfin arriva le jour du départ, et malgré la joie qu’il éprouvait de revoir celle qu’il aimait, Alliaga était désolé de quitter de si bons et de si tendres parents.
Heureusement, pour calmer ses regrets, il ne partait pas seul.
— Emmène-moi avec toi, lui avait dit Pedralvi.
Alliaga l’avait demandé, et on s’était empressé de lui donner, pour l’accompagner, ce fidèle serviteur.
Pedralvi voulait aller passer quelques jours à Madrid pour servir d’escorte à son maître, et puis aussi pour revoir Juanita, ses amours, qui, placée près de la reine, ne pouvait quitter le palais.
Montés tous deux sur de bons chevaux, ils venaient de quitter la vallée du Paradis, la riante habitation d’Albérique. Piquillo avait senti couler ses larmes en embrassant Yézid et son père qui lui avaient reproché sa faiblesse.
— À bientôt, lui disaient-ils tous les deux.
— Oui, bientôt, répétait Yézid, moi aussi j’irai à Madrid pour affaires importantes.
— Hâte-toi de réussir, lui criait le vieillard ; acquiers les honneurs et la puissance.
— Et aime-nous toujours, ajoutait Yézid.
Alliaga, couvert de leurs embrassements, comblé de leurs caresses, les poches remplies d’or, les quittait avec un serrement de cœur et une tristesse inexprimables. Il lui semblait que ces joies de la famille, que ces lieux enchantés où il les avait connues, ne faisaient qu’apparaître à ses yeux, et qu’éloigné de ce nouvel Éden, il ne devait plus y rentrer.
La gaieté intarissable, l’insouciante philosophie et les saillies de Pedralvi eurent bientôt dissipé ces nuages.
Les deux amis, sans distinction du maître et du valet, cheminaient tous deux côte à côte, se rappelant leur bon temps, c’est-à-dire le mauvais. Heureux de leur jeunesse, heureux du soleil, heureux surtout de leurs espérances, ils causaient et riaient à voix baute sur la grande route.
Puis il y avait des moments où, plus heureux encore, ils se taisaient tout à coup, et gardaient le silence pendant des demi-heures entières, croyant n’avoir point cessé de causer. L’un rêvait à Juanita, et l’autre à Aïxa, qu’il allait revoir.
Depuis deux jours ils marchaient ainsi, s’arrêtant dans les meilleures hôtelleries, se faisant servir en princes, demandant partout les plus riches appartements, la meilleure chère, les vins les plus délicats, faisant ainsi payer à la fortune le capital et les arrérages du bonheur qu’elle leur avait dus si longtemps !… Ils étaient sortis de la province de Valence, étaient entrés dans la Nouvelle-Castille, et le soir du quatrième jour, ils se dirigeaient vers Tolède.
Ils avaient encore six ou sept lieues à faire pour y arriver, et se trouvaient aux environs de la petite ville de Madrilejoz. Ils délibérèrent s’ils y passeraient la nuit, ou s’ils continueraient leur route, car la nuit était superbe et leur promettait quelques heures d’un voyage délicieux. Ils avaient pris ce dernier parti et marchaient sans défiance sur le grand chemin, où passaient de temps en temps des groupes de paysans qui revenaient du marché.
Tout à coup, d’un angle que formait le chemin, déboucha une troupe d’alguazils qui, pendant quelque temps, marcha à côté de nos voyageurs. Ils étaient ! assez nombreux, et ne disaient mot.
— Allez-vous comme nous à Tolède, seigneurs alguazils ? demanda au chef de la troupe Pedralvi, qui était d’humeur causante et interrogative, surtout en voyage.
Au lieu de lui répondre, celui à qui il venait d’adresser la parole lui saisit brusquement le bras droit ; un autre alguazil en fit autant du bras gauche, pendant que la même opération s’exécutait sur Piquillo, et avant que nos deux héros eussent pu se mettre en défense, ils avaient été désarmés, et on venait de leur lier les bras derrière le dos.
Il ne leur restait que la voix, et ils s’en servirent pour s’élever contre un pareil traitement, en en demandant la cause et en réclamant justice.
Comme on ne leur répondait pas, ils se mirent à appeler à leur secours les paysans qui passaient alors sur la grande route ; ceux-ci s’arrêtèrent et semblaient disposés à leur venir en aide. Mais un des alguazils dit gravement : Prenez garde, messeigneurs, nous agissons au nom du roi ; ce sont deux malfaiteurs dont nous avons le signalement détaillé et que nous venons d’arrêter.
— Par saint Jacques ! s’écria Pedralvi, à la nuit close il est facile de se tromper, et nous sommes, je le vois, victimes de quelque erreur ; daignez nous écouter, seigneurs alguazils.
— Tout s’éclaircira au point du jour, répondit le chef ; marchons toujours ! de par le roi, messieurs !
À cette phrase sacramentelle et redoutable, les paysans s’éloignèrent.
Tous ceux que l’on rencontra et que Pedralvi ou Piquillo appelaient, recevaient la même réponse et s’éloignaient de même.
Bientôt personne ne passa plus ; la nuit devint obscure, et les alguazils, entourant leurs captifs, les fouillèrent et les dévalisèrent.
Dieu sait pour eux quelle bonne aubaine, car nous avons dit que les poches de Piquillo étaient pleines d’or.
— Patience, mes drôles, disait Pedralvi furieux, à la prochaine ville, au prochain corrégidor, nous réclamerons ; on reconnaîtra l’erreur, on vous châtiera, on nous rendra justice… et peut-être même notre argent, ajoutait-il à part lui avec un soupir mêlé de crainte.
Mais au lieu de marcher vers la ville, on s’en éloignait, et l’on se dirigeait vers les montagnes de Tolède.
Pedralvi commençait à s’inquiéter. Un mouvement que fit l’escorte en entrant dans la montagne rapprocha le cheval de Pedralvi de celui de son camarade.
— Que penses-tu de ces gens-ci ? dit-il à voix basse.
— Je crains que ce ne soient pas de vrais alguazils.
— Qui te le fait présumer ?
— D’abord, ils m’ont volé…
— Moi aussi… Ce ne serait pas une raison.
— Allons donc ! des alguazils ?
— Pourquoi pas ? il y en a qui s’en mêlent, et des plus honnêtes.
Un alguazil, enveloppé d’un manteau noir, vint se placer entre eux deux, et interrompit leur conversation.
Depuis le commencement de cette expédition, cet homme n’avait pas prononcé une parole ; mais il n’avait jamais quitté Piquillo des yeux, et s’était constamment tenu à portée de lui, surveillant tous ses mouvements.
Piquillo, qui n’avait pas oublié sa rencontre au Faisan-d’Or et à l’hôtellerie de la Corbeille de Fleurs, n’était pas sans inquiétude. Cet alguazil, qui ne le perdait pas de vue, lui rappelait, par sa taille et par sa tournure, le capitaine Juan-Baptista.
Un instinct de terreur lui disait que c’était lui, et bientôt il n’eut plus de doute à cet égard.
— Piquillo ! lui dit une voix que, malgré le temps et l’absence, il lui était impossible de ne pas reconnaître ; c’était bien celle de Juan-Baptista.
Le capitaine regarda son prisonnier avec un sourire moqueur et continua :
— Piquillo est plus riche à présent qu’au temps où nous travaillions ensemble. Il voyage en gentilhomme… Il a de l’or plein ses poches, ou plutôt plein les miennes, dit-il d’un ton ironique, en frappant sur les pièces d’or qui, maintenant, étaient en son pouvoir.
— Bandit ! que veux-tu de plus ?
— Rien, que causer avec toi pour charmer les ennuis de la route, et apprendre tes secrets pour faire fortune ; tu me dois bien cela, toi, mon élève ! il n’est pas juste que tu vives en grand seigneur, tandis que ton bon et ancien maître est obligé de se faire alguazil !
— Infâme !
— C’est justement ce que je voulais dire. Infâme métier, qui ne vaut pas l’autre… Notre ancien état était à coup sûr plus honorable ; mais quand un honnête homme n’a pas le choix, il faut le plaindre. Rassure-toi, cependant, car je tiens à ton estime ; je suis passé dans les rangs ennemis, j’ai pris leurs couleurs, dit-il en frappant sur son habit noir, mais j’ai gardé mes principes !
Le capitaine disait vrai.
L’habit d’alguazil n’était qu’une ruse de guerre, un coup hardi, un trait d’imagination et de génie. Après la dispersion de sa troupe et l’incendie de l’hôtellerie de Bon-Secours, le capitaine n’avait plus rien trouvé à faire dans la Vieille-Castille et dans la Navarre. Le rapport et les réclamations de Fernand d’Albayda, et surtout la rumeur publique, avaient enfin forcé le duc de Lerma à s’occuper un peu de la sûreté des grandes routes.
Il avait pris des précautions, ou plutôt des alguazils, et augmenté considérablement le nombre des officiers et soldats de la Sainte-Hermandad, troupe oisive, qui ne voyait rien, n’empêchait rien, se promenait au soleil et touchait avec assiduité les nouveaux appointements dont on venait de grever l’État.
C’était un nouveau moyen de piller le royaume, moyen bien plus sûr, et en outre légal et régulier.
Le capitaine, qui venait alors de toucher, au nom et pour le compte de Piquillo, une somme considérable de la maison Delascar d’Albérique de Valence, comprit que, vu la circonstance, il y aurait simplicité et niaiserie de sa part à lever et à solder, comme autrefois, une troupe de bandits qui courait le risque d’être endommagée, inquiétée, poursuivie et même condamnée.
Il leva une troupe d’alguazils, et dès ce moment il jouit du monopole paisible de la grande route.
Au lieu de se cacher, il se montra ; au lieu de ne sortir que de nuit, il marchait en plein jour, voyait, examinait par lui-même les coups ou les entreprises à tenter.
Il avait abandonné la Navarre et la Vieille-Castille, mais il exploitait tranquillement la Nouvelle, et poussait de temps en temps sa surveillance jusque dans les provinces voisines, celles de Murcie et de Valence. Sa troupe, composée des anciens compagnons qu’il avait ralliés, ou de nouveaux qu’il avait enrôlés, avait trouvé dans l’uniforme d’alguazils, non-seulement impunité, mais appui, protection et estime.
Dans telle maison, telle métairie où ils venaient de voler, on s’adressait à eux, le soir, pour poursuivre et saisir les voleurs. On les traitait, on les hébergeait le reste de la nuit. Plus d’une fois, il était arrivé au capitaine de dresser procès-verbal du rapt qu’il venait de commettre, procès-verbal qu’il se faisait payer très-cher, car il était inflexible sur les droits.
Du reste, il s’était fait aimer de ses autres confrères, les véritables alguazils, par l’aménité de ses manières et la générosité de ses procédés.
Dès qu’il y avait rencontre entre deux brigades, c’étaient des salutations, des politesses, dont les Espagnols sont très-avides ; Juan-Baptista ôtait toujours son chapeau le premier, et cédait le haut du pavé à la brigade payée par le gouvernement.
Si l’on se trouvait près d’une hôtellerie, il offrait même à boire à ses confrères les fonctionnaires publics, qui ne refusaient jamais, et de plus il les aidait loyalement dans leurs recherches, en leur indiquant avec franchise tous les endroits où l’on venait de voler.
C’est ainsi que depuis plusieurs jours il avait suivi, épié et enfin arrêté Alliaga, avec qui il avait un ancien compte à régler. Certain maintenant de sa proie, que rien ne pouvait plus lui enlever, le capitaine continua la conversation.
— Te souvient-il, Piquillo, il y a sept ou huit ans de cela pour le moins, mais moi je n’oublie rien ! te souvient-il de la sierra de Moncayo et du chêne où je t’ai laissé… Il y faisait chaud, je crois.
Piquillo fit comme alors : il ne répondit rien ; il n’avait rien à répondre.
— Te souvient-il de la déclaration de guerre que tu me fis ? guerre à mort entre nous deux ! disais-tu ; j’ai accepté, car je suis beau joueur, et pendant longtemps, je l’avoue, j’ai cru avoir gagné la partie.
— Mais le ciel m’est venu en aide, s’écria Piquillo ; il m’aidera encore.
— Je ne crois pas, répondit avec ironie le capitaine, le ciel ne se mêle pas de ces parties-là, et je crois que définitivement elle est perdue pour toi. Vois-tu la gorge de montagnes où nous allons entrer ?… c’est là que je me déferai d’un ancien élève dont les révélations indiscrètes pourraient me nuire dans mon nouvel état d’alguazil ; c’est un état où il faut apporter de la considération, si on veut en avoir, car on n’en trouve guère.
Piquillo jeta sur lui un regard de mépris et continua à garder le silence.
Ce n’était pas le compte du capitaine. Il était cette fois bien fermement décidé à le tuer ; mais auparavant il voulait le faire parler. Il reprit donc :
— Si cependant Piquillo voulait, il pourrait encore sauver ses jours et ceux de son compagnon.
Piquillo leva la tête. Il pensait à Aïxa et tenait à vivre.
— Il n’aurait pour cela, poursuivit le faux alguazil, qu’à m’expliquer ses relations avec Delascar d’Albérique et me donner les moyens de pénétrer dans cette maison, qui renferme, dit-on, des tonnes d’or.
— S’il n’y a pas d’autres moyens de sauver ma vie, repondit froidement Alliaga, tu auras bientôt un crime de plus à te reprocher.
— Pourquoi ?
— Parce que je ne te dirai rien. Tu es maître de mes jours.
— J’aimerais mieux être maître du trésor. Faute de mieux, c’est toujours quelque chose que de se venger d’un ennemi, et ce plaisir-là du moins ne pourra pas m’échapper.
— Peut-être ! dit Alliaga en regardant le chemin creux où ils venaient de s’engager.
Une lueur rougeâtre, la lueur de plusieurs torches, se dessinait sur les rochers et les arbres qui, des deux côtes, bordaient la route. On entendait le bruit confus de plusieurs voix, le pas des chevaux et même le bruit des armes.
— À moi ! cria de toutes ses forces Pedralvi à qui ce secours, même éloigné, venait de rendre l’espoir et le courage.
— À moi ! à mon aide ! à mon secours !
— Nous aurions dû le bâillonner, se dit le capitaine ; on ne pense jamais à tout ; empêchez-le de crier.
— Impossible, dirent les alguazils, son compagnon se met aussi de la partie.
— Et l’écho de la montagne qui s’en mêle aussi ! se dit Juan-Baptista avec rage en entendant les cris des deux captifs répétés au loin.
— Cassez-leur la tête, et que ça finisse.
Mais avant qu’on osât exécuter cet ordre, des cavaliers avec des flambeaux apparurent sur la route. Ils précédaient deux carrosses que suivaient plusieurs gens armés.
Il n’y avait pas moyen de combattre ; l’avantage du terrain, des armes et du nombre était pour les nouveaux arrivants.
Aucun moyen de fuir, aucun moyen, dans cet étroit passage, d’éviter la rencontre.
D’ailleurs Pedralvi, que rien n’aurait pu contraindre au silence, continuait à crier de toutes les forces de ses poumons :
— Qui que vous soyez, seigneurs cavaliers, délivrez-nous de ces bandits, de ces faux alguazils qui nous ont arrêtés et dépouillés, contre toutes les lois divines et humaines.
— Qu’est-ce qui vient ainsi me réveiller en sursaut ? dit un homme vêtu de noir qui dormait dans la première voiture, assis seul sur les coussins de derrière, tandis que trois prêtres, extrêmement serrés, vu leur corpulence, étaient entassés sur la banquette de devant. — Eh bien ! mon grand vicaire, qu’y a-t-il ? me répondrez-vous ?
— Permettez, monseigneur, je ne sais pas bien de quoi il s’agit. Je vois des alguazils, ils sont sept et emmènent deux jeunes gens bien mis et de bonne mine qui se réclament de Votre Grâce.
— Interrogez-les sans descendre de voiture, car la nuit est noire et froide. Baissez la glace ! rien qu’une ! je suis enrhumé.
Alors le grand vicaire, s’adressant aux deux captifs :
— Sa Grâce monseigneur don Ribeira, patriarche d’Antioche et archevêque de Valence, me charge de vous demander qui vous êtes, et ce que vous voulez.
Pedralvi, qui eût été un avocat excellent, et très-rare, expliqua l’affaire en deux mots. Arrêtés et dépouillés sans motif, ils demandaient qu’on les remît en liberté et qu’on punît les alguazils.
— Et vous, demanda le grand vicaire à Juan-Baptista, qu’avez-vous à répondre ?
Le capitaine avait entendu parler du fougueux prélat, avec lequel nos lecteurs ont fait connaissance dans les premiers chapitres de cette histoire, lors de la consulta du roi.
C’était l’adversaire le plus implacable des Maures, l’ennemi le plus pieusement acharné à leur conversion ou à leur perte. Tuer ou convertir tout ce qui n’était pas chrétien, lui paraissait l’action la plus sainte et la plus méritoire, et il était tellement consciencieux et de bonne foi dans sa cruauté, qu’il eût mis le feu à son palais pour brûler un hérétique.
N’ayant pu encore, comme il le désirait, réussir à expulser les Maures en masse, il tenait du moins à les convertir en détail ; c’était la grande affaire, la grande vanité de sa vie, et malgré sa piété, il n’avait pu dernièrement dissimuler son dépit en apprenant le succès de l’évêque de Cuença, qui avait persuadé, convaincu et baptisé le Maure Sidi-Zagal et toute sa famille, y compris trois enfants en bas âge, dont un ne parlait pas encore.
Cette affaire avait fait grand bruit dans la Nouvelle-Castille : Juan-Baptista, en sa qualité d’alguazil, qui devait tout savoir, en avait entendu parler, et connaissant le faible du prélat, il s’avança près de la portière avec respect, et ôtant son chapeau, car il ne craignait pas, lui, de s’enrhumer :
— Ces deux jeunes gens, dit-il, sont des Maures qui n’ont pas été baptisés.
À ce mot seul, Ribeira bondit sur les coussins de sa voiture.
— Conformément aux nouvelles ordonnances publiées, à la demande de notre pieux archevêque, monseigneur l’archevêque de Valence, patriarche d’Antioche, par don Sandoval y Royas et la sainte inquisition, j’ai appréhendé ces hérétiques au corps.
— Bien ! dit l’archevêque, du fond de sa voiture.
— Je les ai dépouillés de tous les bijoux et ornements impies qu’ils n’avaient pas le droit de porter.
— Très-bien ! dit l’archevêque.
— Et je les conduisais dans les prisons de la Sainte-Hermandad.
— Non pas, s’écria vivement le prélat, non pas, seigneur alguazil !
— Il faut cependant qu’ils soient punis.
— Je ne dis pas non, mais avant tout ; il faut qu’ils soient convertis et baptisés. C’est moi que cela regarde. Je m’en charge.
— Permettez, monseigneur, dit Juan-Baptista, dont cette conclusion dérangeait un peu les projets… permettez.
— Silence ! répliqua avec autorité le prélat, toujours du fond de sa voiture. Monsieur mon grand vicaire, dit-il à son substitut, qui était toujours resté à la portière à tenir l’audience ; achevez d’interroger sommairement ces hérétiques, et partons, car la nuit est froide.
— Vous êtes donc un Maure ? dit le grand vicaire à Pedralvi.
— Oui, seigneur.
— Et vous n’êtes pas baptisé ?
— Au contraire… je le suis.
— Qu’est-ce qu’il dit ? s’écria l’archevêque avec humeur, ce n’est pas vrai !
— Je vous le prouverais, si j’avais les mains libres.
— Qu’on leur ôte ces liens, dit le grand vicaire.
Et Pedralvi, maître de ses mains, tira de sa poche un papier sans lequel il ne voyageait jamais, portant le sceau de l’archevêché, et constatant que, dans la cathédrale de Valence, il avait reçu, il y avait sept ans, lui cinquantième, le baptême, des mains de Sa Grâce monseigneur Ribeira.
Il ne parla pas du premier baptême qu’il avait reçu autrefois et qui avait coûté la vie à sa mère : il ne pouvait pas prouver celui-là, et d’ailleurs, c’était assez d’un.
Le prélat, avec un désappointement qu’il ne prenait pas la peine de cacher, s’écria :
— De quoi vient-on alors me parler ? Qu’il s’en aille ! qu’on le mette en liberté !
— Et mon compagnon ? s’écria Pedralvi.
— A-t-il aussi une attestation ? est-il aussi baptisé ? car je crois en vérité qu’ils le sont tous ! murmura le prélat entre ses dents. Qu’il le dise ! qu’il le prouve !
Alliaga garda le silence.
— Il a, comme moi, un parchemin scellé aux armes de l’évêché, dit hardiment Pedralvi.
— Jurez-le ! jurez-le ! répéta le vicaire.
— Je le jure ! dit Pedralvi sans hésiter.
— Et vous, dit le vicaire à Alliaga, votre serment ?
Piquillo continua à se taire.
— N’êtes-vous pas chrétien ? n’avez-vous pas été baptisé ?
— Non, monseigneur !
— Quand je le disais ! s’écria le capitaine alguazil d’un air de triomphe.
— À la bonne heure, au moins, dit l’archevêque avec satisfaction ; qu’on arrête d’abord le Maure, chrétien parjure, qui n’a pas craint de faire un faux serment.
Le grand vicaire fit signe de la main de s’emparer de Pedralvi ; les alguazils et les gardes de l’archevêque se retournèrent et ne virent plus personne.
En entendant la courageuse et imprudente déclaration de son jeune maître, Pedralvi avait compris qu’en restant il se compromettait sans le servir ; qu’il valait mieux encore se conserver libre, pour secourir Piquillo, que de se laisser emmener avec lui.
Il s’était donc prudemment retiré de quelques pas en arrière ; favorisé par la nuit et lâchant la bride à son bon cheval arabe, il était déjà loin de l’archevêque et de son grand vicaire, quand ceux-ci pensèrent à lui. Toute la sollicitude du prélat se concentra donc sur le seul Alliaga, qui devenait son bien, sa propriété, sa chose, et qu’il n’aurait cédé à aucun prix.
— Ainsi donc, répéta le grand vicaire à Piquillo, et pour être plus sûr de son fait, vous n’êtes point baptisé ?
— Non.
— Très-bien ! dit l’archevêque.
— Mais sans doute vos yeux fermés à la lumière ne demandent qu’à s’ouvrir, et vous désirez, vous demandez l’eau du baptême ?
— Non, répondit froidement Piquillo.
— Encore mieux ! répéta le prélat. Voilà une conversion qui pourra, je m’en flatte, nous faire quelque honneur. Que ce Maure descende de cheval, dit-il d’un air de bonté : faites-le monter dans ma voiture de suite avec mes deux aumoniers.
— Mais, monseigneur… hasarda encore Juan-Baptista d’un air interdit.
— Ce n’est plus votre prisonnier, seigneur alguazil, c’est le mien ; j’en réponds et je m’en charge.
— Ah ! ah ! murmura Alliaga à voix basse au capitaine en descendant le cheval, la partie n’est pas encore perdue pour moi, comme vous l’espériez.
— Ma foi, répondit celui-ci avec un sourire de joie, tu n’es pas, grâce au ciel, en meilleures mains, et je ne sais pas si tu gagneras au change.
— J’y gagnerai du moins de te faire connaître et de te faire pendre, dit à voix haute Piquillo.
— Qu’est-ce ? demanda à ce bruit le grand vicaire.
— Cet hérétique qui nous menace, répondit le capitaine, et qui, pour nous punir de l’avoir arrêté, prépare les plus insignes calomnies contre nous autres chrétiens…
— Toi chrétien ! s’écria Piquillo avec indignation.
— Oui, plus que toi !… plus que personne au monde, répondit avec une sainte indignation le digne capitaine, en pensant aux douze ou quinze baptêmes qu’il avait autrefois successivement reçus.
— Ne craignez rien, seigneur alguazil, dit l’archevêque ; vous et vos gens suivrez mon escorte et recevrez demain à Tolède la récompense qui vous est due pour avoir découvert et livré un Maure, un hérétique, à la sainte inquisition. De plus, je veux vous recommander au corrégidor de Tolède, un homme supérieur, le seigneur Josué Calzados de Las Talbas, que le duc de Lerma a placé à Tolède à ma recommandation. En route, messieurs, la nuit est froide.
— Et monseigneur se sera enrhumé, dit le grand vicaire en toussant.
— Je ne le regretterai point, dit avec exaltation le prélat, puisque Dieu m’a donné une occasion de convertir un hérétique ou de l’offrir au ciel en holocauste.

Il fit le signe de la croix, se rejeta au fond de la voiture et se rendormit. Alliaga, monté dans la voiture de suite, se trouva avec les deux aumôniers et le majordome de monseigneur. Les deux carrosses, entourés des cavaliers armés et des valets qui portaient des torches, partirent au grand galop.
Juan-Baptista, ainsi qu’on le lui avait ordonné, prit la suite du cortége.
Mais à un demi-quart de lieue de là, à un détour de la route, il s’arrêta, fit faire volte-face à ses gens, et disparut, peu soucieux d’aller toucher à Tolède la récompense promise, et surtout d’être recommandé au corrégidor Josué Calzado, qui aurait en de la peine à découvrir à quelle brigade de la Sainte-Hermandad il appartenait.
L’or qu’il avait pris à Alliaga était pour lui une capture suffisante ; il n’eût jamais espéré de la munificence de son ancien élève un pareil capital.
Il ne voulait d’abord que se venger de lui, et quoi qu’il arrivât, cette vengeance était désormais assurée, puisque le pauvre Piquillo était présentement dans les mains de l’impitoyable archevêque de Valence et avait en perspective un asile dont on ne sortait pas, les cachots de l’inquisition.
XXX.
la maîtresse du roi.
Le duc de Lerma, désormais tranquille du côté de la reine, qui avait tenu sa parole et n’avait point cherché à se rapprocher du roi, le duc de Lerma avait pris sur son maître un tel empire, que rien ne semblait désormais pouvoir le renverser.
Quelques audacieux osaient cependant former ce rêve, et s’occupaient lentement et sourdement des moyens de le réaliser.
La comtesse d’Altamira et son conseil privé, le révérend père Jérôme, Escobar et le duc d’Uzède, avaient reconnu qu’une seule influence au monde pouvait balancer celle du favori, c’était la séduction et la toute-puissance d’une favorite.

Comme le disait très-bien la comtesse, on est dévot et on à des passions, quitte à leur résister, et c’est là le mérite, ou à capituler avec elles, et c’est là l’affaire du confesseur.
Telle était la situation du roi.
Il avait eu, avant le carême, quelques entretiens avec le révérend père Jérôme, son prédicateur ordinaire. Les idées mises en avant par celui-ci avaient d’abord étonné le roi, mais ne lui avaient pas déplu. Il n’en avait pas parlé, ni au duc de Lerma, ni au frère Cordoya, son confesseur. C’était bon signe.
Il avait donc un secret pour eux, un secret qu’il avait quelque plaisir à garder pour lui, et qu’il craignait de confier à ses confidents ordinaires. En revanche, il ne craignait pas le duc d’Uzède, qui, suivant l’expression de la comtesse, s’était mis à sa portée, et qui n’avait pas eu beaucoup à baisser pour cela, vu qu’ils étaient presque de niveau.
Aussi, dès le soir même, le roi raconta au duc la conversation et les idées du père Jérôme. Pour des idées, le roi en avait peu, mais il avait des sens, et il suffisait d’éveiller ceux-ci pour faire naître les autres. Pendant plusieurs soirées, ce fut là le sujet de leurs entretiens, et le roi y prenait un plaisir qui semblait aux conjurés du plus favorable augure.
Il lui restait pourtant encore quelques scrupules que le père Jérôme aurait eu besoin de vaincre ; mais le saint temps du carême était passé. Il ne pouvait se montrer au palais sans faire naître les plus grands soupçons, et un jour que dans le jardin de Las Delicias le roi se promenait incognito avec le duc d’Uzède, lui faisant part de son trouble, de ses doutes, de ses hésitations, celui-ci dit au roi :
— Tenez, sire, voici un moine qui vient à nous. Votre Majesté ne pense pas le connaître ?
— Non, vraiment.
— Et il ne nous connaît ni l’un ni l’autre. Posons-lui la question sous des noms supposés.
— Soit, dit le roi en tremblant d’émotion. Ce moine, c’était Escobar.
Le duc d’Uzède lui expliqua le cas dont il s’agissait, lui demandant en son âme et conscience une solution.
L’habile casuiste réfléchit un instant et répondit :
— Vous me dites que c’est un bourgeois de Madrid ?
— Oui, mon père.
— Qu’il est marié ?
— Oui, mon père.
— Et vous m’assurez que sa femme, qu’il aime… le repousse et se refuse à ses vœux.
— Précisément, dit le duc. Peut-il adresser ses vœux à d’autres ?
— Le peut-il sans péché ? dit timidement le roi.
— S’il y avait péché, dit gravement Escobar, il ne retomberait point sur lui, qui est innocent, mais sur sa femme, qui en serait la cause première.
— Alors, dit le roi avec un peu d’hésitation, il peut donc à la rigueur…
— S’il le peut ! s’écria Escobar avec chaleur, s’il le peut !… Je ne crains point d’affirmer qu’il le doit… sous peine de manquement aux lois de l’Église et aux arrêtés des conciles.
— En vérité, s’écria le roi, si vous pouvez, mon révérend, nous prouver cela…
— Très-facilement ! Que dit l’Écriture sainte ? Vous connaissez comme moi ses commandements, mes frères ! vous savez ce qu’elle nous ordonne, quelle est l’œuvre qu’elle nous prescrit (en mariage seulement, il est vrai). Mais le bourgeois de Madrid dont vous me parlez est dans ce cas, il est marié. Il doit donc, ayant reçu le sacrement de mariage, en remplir tous les devoirs.
Vous me répondrez qu’il ne le peut, par le fait de sa femme !
Mais parce que la femme désobéit aux commandements de Dieu, cela ne donne point au mari le droit d’en faire autant. Si sa femme est coupable en s’abstenant, il le devient en faisant comme elle : voulez-vous savoir si un exemple est bon ou mauvais à suivre, posez-vous cette question : Si tout le monde l’imitait ; qu’adviendrait-il ?
Or, dans l’espèce dont il s’agit, si tout le monde s’abstenait, les volontés de Dieu, l’ordre de l’univers et les lois de la création seraient évidemment violés ; donc on ne peut, donc on ne doit point s’abstenir ; quod erat demonstrandum ! ce qu’il fallait prouver.
— C’est inconcevable, dit le roi tout étourdi, je ne m’étais jarnais fait cette suite de raisonnements. C’est clair, décisif !
— Logique et irréfutable ! s’écria le duc.
— Ainsi, dans ce cas-là, continua le roi, dont les yeux brillaient de plaisir, il est donc permis, sans offenser le ciel et sans pécher…
— Permettez donc ! s’écria Escobar avec une véhémence et une force de conviction qui fit frémir le duc, permettez ! nous ne sommes point gens si faciles, et avant tout, nous mettrons des conditions et des restrictions.
Règle générale : le péché n’est jamais dans le fait, mais dans l’intention ; et, dans l’espèce dont il s’agit. comme dans beaucoup d’autres, il faut bien prendre garde ; la limite est délicate et scabreuse.
Le ciel permet de pareils contentements, à la condition expresse que ce ne sera point dans une intention coupable ; à condition que ce ne sera point par désordre ou scandale, mais seulement pour obéir au vœu de la nature, aux intentions du Créateur et aux commandements de Dieu. Ce qui est bien différent !
— Je comprends ! je comprends ! s’écria le roi, ravi de la sévérité d’Escobar et émerveillé de la subtilité de ses distinctions. C’est une doctrine admirable. Votre nom, votre nom, mon révérend ?
— Il est bien obscur et bien inconnu encore… Escobar !
— Il deviendra célèbre, je vous en réponds : et s’il ne tient qu’à moi…
Le roi allait se trahir si un regard du duc ne l’eût arrêté.
Ils prirent congé du révérend, qu’ils remercièrent avec effusion, et continuèrent leur promenade.
Après un raisonnement aussi péremptoire, aussi victorieux, il n’y avait plus moyen de conserver des doutes ou des scrupules. Le roi n’en avait plus, et, fidèle aux conséquences déduites par Escobar, il était décidé à prendre une maîtresse pour rester fidèle… aux lois de l’Église. Cette nouvelle, transmise à la comtesse et au père Jérôme, les remplit de joie. Le point le plus difficile venait d’être emporté.
Il était évident, d’après le caractère du roi, qu’il s’enflammerait aisément, et que la première jeune femme, douée de quelques attraits, que l’on offrirait à ses regards, d’une manière imprévue, piquante, romanesque, ferait promptement sur lui une profonde impression.
La grande difficulté, c’était le choix de cette favorite ; ce choix demandait la réunion de tant de qualités !
Il fallait qu’elle fût jeune, jolie, agréable, qu’elle eût de l’esprit, et cependant pas trop ! qu’elle n’eût aucune ambition, une extrême docilité, une grande douceur, et surtout une confiance entière et aveugle dans la comtesse d’Altamira et dans le père Jérôme, qui se chargeraient de la diriger.
La comtesse, après avoir longtemps cherché, étudié, calculé, crut enfin avoir trouvé ce trésor.
C’était tout uniment Carmen, sa nièce.
L’idée de livrer au déshonneur une jeune fille qui lui était confiée, sa plus proche parente, la fille de son frère, rien de tout cela ne l’arrêta. C’eût été sa fille, qu’elle n’eût point hésité. Les gens de cour ont une conscience à eux, et une manière d’envisager les choses qui leur fait voir la gloire et l’illustration où de simples bourgeois ne verraient que la honte et l’infamie. Le tableau change avec le cadre, et la comtesse, en élevant sa nièce au rang des reines d’Espagne, se croyait presque des droits à sa reconnaissance.
Le duc d’Uzède trouva l’idée admirable. Carmen était la fiancée de Fernand d’Albayda, son ennemi, et cette combinaison servait à la fois sa vengeance et sa fortune.
Quant au père Jérôme et à Escobar, le choix leur était indifférent. Ils ne pensaient loyalement qu’à l’élévation de leur ordre, à la chute du duc de Lerma, à l’abaissement de l’inquisition, et pour arriver à ce but, tous les moyens leur étaient bons.
L’important, dans une pareille conspiration, c’était la promptitude et la discrétion ; c’était que le coup fût frappé avant que le duc de Lerma et le grand inquisiteur fussent en mesure de s’y opposer. Après tout, qui aurait pu exciter leurs soupçons ? Personne n’approchait le roi et ne vivait dans son intimité ; personne, si ce n’était le duc d’Uzède, qui ne le quittait pas ; et comment un père pouvait-il se défier de son fils ? Il fallait pour cela habiter la cour, et même en ce pays l’histoire offre rarement des exemples pareils.
Cette perversité exceptionnelle, ce fait rare, curieux et extraordinaire, était, à défaut d’autres, réservé au règne de Philippe III.
Il s’agissait donc, avant tout, sans que personne s’en doutât, pas même Carmen, de la faire voir au roi. Il y avait bien les bals de la cour, les fêtes, les galas ; mais Carmen n’avait pas encore quitté le deuil qu’elle portait depuis la mort de son père, elle n’allait point dans le monde, n’avait pas été présentée à la cour, et passait toutes ses journées avec sa sœur Aïxa.
Depuis le départ de Piquillo, elle ne voyait personne du dehors, si ce n’était parfois Juanita, qui apportait aux deux jeunes amies des nouvelles de la reine et du palais.
On essaya alors de faire trouver Carmen à la chapelle du roi un jour où il entendrait la messe ; mais ce jour-là, le roi, renfermé dans sa stalle, ne pouvait être vu et ne voyait rien. Humble et la tête baissée, il ne leva pas un instant les yeux, et la foule admirait le pieux recueillement de Sa Majesté.
Le roi pensait alors aux idées du père Jérôme, et surtout à sa dernière conversation avec le révérend Escobar.
Il ne vit donc point Carmen, et tout en rêvant ce bonheur, il passa à côté d’elle sans s’en douter.
Un autre jour, le roi devait assister à une revue, et la comtesse d’Altamira s’arrangea pour se trouver avec sa nièce sur un balcon placé en face du balcon royal.
Le duc d’Uzède, qui ne quittait point Sa Majesté, devait lui faire remarquer cette charmante jeune personne, lui demander son avis, et, selon la réponse du roi, entamer le second chapitre d’un roman dont Jérôme et Escobar avaient déjà préparé le premier.
Par malheur il faisait ce jour-là un soleil ardent, une chaleur accablante, le roi pensa que ses soldats auraient bien chaud, et lui aussi. Il décommanda la revue, préférant rester seul dans ses jardins et rêver sous l’ombrage de ses arbres à sa passion future, à la jeune fille qui d’avance lui faisait battre le cœur.
La comtesse et ses amis, contrariés dans leur projet, attendaient qu’une occasion favorable se présentât, et les choses en étaient là quand surgit pour eux un nouvel obstacle.
Don Fernand d’Albayda, envoyé par le duc de Lerma au quartier général de Spinola, revint enfin de la Hollande.
Son retour fut le signal d’une grande allégresse pour tout le royaume.
Il ne rapportait point la paix, mais une trêve de douze ans avec les Pays-Bas insurgés. L’Espagne, épuisée, ne pouvait plus continuer la guerre, et cependant le duc de Lerma ne voulait point faire la paix avec des rebelles. C’eût été un affront pour l’orgueil espagnol, c’eût été surtout reconnaître de droit l’indépendance que les Provinces-Unies avaient conquise et possédaient de fait.
Le duc de Lerma avait, comme toujours, choisi un terme moyen qui ne terminait rien et laissait les choses dans le même état, une trêve de douze ans qui donnerait à tout le monde le temps de respirer.
Il ne voyait pas que c’était consolider à jamais la puissance de la Hollande, et lui permettre d’augmenter sa marine, qui, déjà florissante et redoutable, le serait plus encore à cette époque. Il ne voyait qu’une chose, c’est qu’il avait douze ans devant lui !
Une existence de douze ans est beaucoup pour un ministre médiocre, et pour une renommée viagère, qui ne comptent point sur la postérité.
Quoi qu’il en soit, cette fin de la guerre, car cette trêve n’était pas autre chose, causa un grand enthousiasme à la cour et une joie extrême à Carmen et à Aïxa : à la première, parce qu’elle allait revoir Fernand, à la seconde, parce que son amie était heureuse.
Dès le soir même de son arrivée, après avoir remis ses dépêches au ministre, Fernand courut à l’hôtel d’Altamira et se présenta chez sa cousine : c’était la première fois qu’il la voyait depuis la mort de son père. À la vue des habits de deuil que portaient encore les deux jeunes filles, Fernand ne put retenir ses larmes.
— Mon oncle, s’écria-t-il en levant-les yeux au ciel, mon oncle, tu as reçu mes serments et je les tiendrai.
Carmen lui tendit la main et mêla ses larmes aux siennes ; mais ces larmes n’avaient plus pour la jeune fille la même amertume, Fernand était près d’elle et pleurait avec elle !
Le lendemain, Fernand revint, et tous les jours qui suivirent, il fut exact au rendez-vous. Il arrivait chaque soir avec un battement de cœur et un trouble inexprimables dont lui-même, sans doute, ne se rendait pas compte.
En vain la cour offrait les bals les plus brillants, les fêtes les plus splendides ; en vain chaque soir Calderon de la Barca, qui était alors dans l’aurore de son talent, dotait de ses chefs-d’œuvre tous les théâtres de Madrid, rien ne pouvait tenter don Fernand, ni l’attirer, rien ne valait pour lui la douce et tranquille soirée qui l’attendait à l’hôtel d’Altamira près des deux jeunes filles.
C’était tout naturel : il allait voir Carmen, sa cousine, sa fiancée, sa prétendue, qu’il aimait et dont il était adoré. Il ne pouvait plus vivre sans elle, et cependant, quand Aïxa avait à travailler ou à écrire, quand elle était indisposée et qu’elle restait par hasard dans sa chambre, il lui semblait que quelque chose lui manquait.
Carmen, il est vrai, était moins expansive en l’absence de son amie, et Fernand, seul avec la jeune fille. était également plus froid, plus réservé : c’était dans les convenances.
Aussi Carmen préférait qu’elle fût là ; Fernand était du même avis.
Loin de leur ressembler, Aïxa saisissait tous les prétextes de s’absenter, et quand son amie lui en faisait reproche :
— C’est tout simple, lui disait-elle, je crains de vous gêner.
— Mais au contraire, c’est quand tu n’es pas là que nous sommes gênés et embarrassés ; viens… je t’en prie !
Aïxa revenait, et la soirée était charmante.
Fernand leur racontait ses campagnes contre Maurice de Nassau, les prodiges de valeur, les traits de courage de ses ennemis ou de ses compagnons d’armes, il n’oubliait rien, que lui. Les jeunes filles lui en faisaient reproche. Aïxa, souriant, traitait sa modestie d’orgueil ; s’oublier si complétement était un moyen de se faire remarquer.
Carmen admirait toujours ; Aïxa discutait ; Carmen n’avait jamais qu’un avis, celui de Fernand ; Aïxa avait le sien à elle, qu’elle défendait, et parfois Fernand en changeait et passait dans le camp ennemi, bravant les éclats de rire des deux jeunes filles, qui raillaient le transfuge.
Combien dans ce moment Fernand appréciait le bonheur dont Piquillo lui avait parlé pendant leur voyage de Pampelune à Madrid ! ces douces conversations que minuit venait interrompre, quand on croyait qu’elles commençaient à peine ! Combien il comprenait alors ce charme inexprimable qu’Aïxa répandait sur tout ce qui l’entourait !
Aussi, dans tous les plans de bonheur qu’il formait avec Carmen, il était bien entendu qu’Aïxa ne les quitterait jamais. Aïxa les écoutait en souriant, mais d’un sourire triste et sans espoir, qui semblait croire à leur bonheur et non au sien.
Un soir que Fernand avait devancé l’heure, Carmen n’était pas encore sortie de son appartement. Aïxa était seule au petit salon où ils se réunissaient d’ordinaire.
Elle tenait à la main une lettre, et s’empressa de la serrer à l’aspect de Fernand, auquel ce mouvement ne put échapper.
Aïxa était en proie à une vive émotion, à un trouble visible qu’elle fit ses efforts pour réprimer.
— Eh mon Dieu ! senora, quelque malheur serait-il arrivé ? s’écria don Fernand.
— Aucun ; Carmen va venir, ne vous effrayez pas de son absence, répondit Aïxa en reprenant son doux sourire. Elle se porte bien.
— Mais vous, senora ?
— Moi, je n’ai rien.
— Je craignais… pardonnez mon indiscrétion, que vous n’eussiez reçu quelques fâcheuses nouvelles.
— Ah ! dit Aïxa froidement, cette lettre… je vous remercie, seigneur don Fernand, mais rassurez-vous : c’est une lettre d’affaires… des affaires de famille !
Fernand n’en était pas convaincu, et le doute qu’il éprouvait lui causait un malaise, une sensation qu’il ne s’expliquait point. Aïxa, maintenant calme et tout à fait revenue à elle-même, avait pris son ouvrage, sur lequel elle tenait ses yeux attachés.
Il y eut un moment de silence. Fernand se leva, alla à la cheminée, regarda quelque temps Aïxa, qui travaillait toujours, puis se rassit près d’elle, et dit en montrant l’ouvrage dont elle s’occupait :
— Voilà un travail admirable.
Aïxa leva les yeux d’un air étonné. Il était évident que don Fernand avait regardé, sans le voir, l’ouvrage admirable dont il parlait. C’était un ruban bleu, dont Aïxa essayait de faire un nœud.
— C’est un nœud de ruban, lui dit-elle en souriant, qui mérite peu votre admiration, et qui n’a pas grand prix.
— Et moi, je suis sûr, répondit Fernand d’un ton ému, je suis sûr qu’il est des personnes pour qui il en aura beaucoup.
— Pour qui donc ?
— Eh mais, continua Fernand en balbutiant et essayant de sourire plusieurs fois, pour le jeune et beau cavalier à qui peut-être vous le destinez.
— Ce jeune et beau cavalier, répondit Aïxa gaiement, c’est Carmen, votre prétendue.
— Carmen ! s’écria Fernand.
— Il faut bien s’occuper de ses parures pour le moment où elle quittera le deuil et marchera à l’autel.
Il y eut encore un long silence, qu’aucun d’eux ne savait comment rompre. Heureusement Carmen entra.
Aïxa fut charmante comme à l’ordinaire, bonne, aimable et prévenante pour tous les deux. Fernand fut rêveur et silencieux.
Dans le cours de la soirée, Carmen demanda gaiement à ses amis :
— Y a-t-il quelques nouvelles ?
— Aucune, répondit froidement Aïxa.
Elle ne dit pas un mot de la lettre qu’elle avait reçue. Fernand était trop délicat ou trop discret pour en parler ; mais lui, toujours si bon et si gracieux, fut dès ce moment brusque, impatient et irritable.
Au lieu de défendre, comme à l’ordinaire, ses opinions en riant, il semblait, sans s’en apercevoir et comme malgré lui, mettre de l’aigreur dans chaque discussion, surtout contre Aïxa, qui, à son tour, lui répondait avec sécheresse ; et Carmen, s’amusant de leur animosité, fut obligée plusieurs fois de clore les débats.
Le lendemain, Fernand revint, et, presque honteux de sa conduite de la veille, il chercha à la faire oublier en redoublant de soins et de prévenances pour les deux sœurs, qui déjà lui avaient pardonné.
Mais la pauvre Carmen s’inquiétait en lui voyant des moments de rêverie et de tristesse qu’il n’avait pas autrefois. Elle faisait part de ses craintes à Aïxa, qui s’efforçait de la rassurer.
— Peut-être quelque passe-droit, quelque injustice qu’on lui aura faite à la cour.
— Tu crois ?
— Le duc d’Uzède est son ennemi.
— C’est vrai… et c’est pourtant l’ami de ma tante, dona Altamira.
— Que veux-tu ! on ne conçoit rien aux haines et aux amitiés de la cour ! Ne l’inquiète pas de cela, ma bonne Carmen ; que nous importe à nous, pourvu que nous nous aimions ?
— Et pourvu qu’il m’aime, lui ?
— Et j’espère que tu n’as pas là-dessus le moindre doute ? dit vivement Aïxa.
— Oh non !… Il n’est heureux qu’ici, il me le disait encore dernièrement. Et dans ses actions, dans ses regards, dans ses moindres discours, il y a tant d’affection et de tendresse…
— Tant mieux, tant mieux ! s’écria sa compagne avec un accent qui partait du cœur.
— Et que je te raconte un trait de lui qui m’a vivement touchée.
— Dis-le vite !
— C’est un rien… un enfantillage…… mais il me semble, à moi, que c’est dans ces petites choses-là que l’amour se révèle. Hier matin, en venant apporter à la comtesse une invitation de bal pour le soir, Fernand est entré dans ma chambre. J’étais devant ma toilette avec Juanita à me coiffer.
— Je suis indiscret, s’est-il écrié, je me retire.
— Non, mon cousin, lui ai-je dit, restez. J’ai fini. Je suis à vous. Je ne veux pas perdre votre visite.
Il s’est alors promené derrière moi dans l’appartement, et de la glace de ma toilette d’où je le regardais sans rien dire, je l’ai vu s’arrêter devant un petit meuble où étaient plusieurs bagatelles que je porte d’ordinaire, des ajustements de femme. Il y avait entre autres un simple nœud de ruban… ces rubans bleus que tu m’as arrangés l’autre jour…
— Eh bien ? dit Aïxa en pâlissant.
— Eh bien ! il l’a pris tout doucement, l’a porté à ses lèvres et l’a caché vivement dans son sein. Et moi, craignant, je ne sais pourquoi, que Juanita ne l’aperçût, je me sentais troublée et charmée à la fois, je me sentais les joues brûlantes, et j’étais rouges… rouge… tiens, comme toi, Aïxa, dans ce moment.
En effet, Aïxa était pourpre et se soutenait à peine.
— Je le crois bien, dit-elle en portant la main à son front, il fait ici une chaleur !… et je ne sais pas comment tu y tiens, avec ce brasero ardent dont la vapeur monte à la tête.
— C’est vrai, dit Carmen.
Et elle appela pour faire enlever le brasero.
Fernand revint le soir, mais Aïxa ne parut pas. Elle était malade et resta dans sa chambre.
— C’est ma faute, dit Carmen à son cousin, c’est la suite de ce qui est arrivé ce matin. Il faisait trop chaud ici, cela lui a donné la migraine.
Le lendemain, Aïxa ne descendit pas encore au salon, et Fernand, inquiet et troublé, s’informa d’elle avec un intérêt si vrai, que Carmen en fut touchée, et l’en remercia vivement. Elle admirait sa bonté, et puis elle aimait tant Aïxa, qu’elle savait gré de l’amitié qu’on lui portait, et en était reconnaissante.
Le troisième jour, Aïxa parut enfin ; mais elle n’avait plus les belles couleurs vermeilles qui avaient inquiété Carmen. Elle était pâle, elle était changée elle était méconnaissable.
— Qu’as-tu donc ? lui dit Carmen avec effroi.
— Un grand chagrin… une inquiétude que tu partageras ainsi que don Fernand… car il est notre ami.
— Qu’est-ce donc ?… parle ! répéta vivement Carmen.
— Eh bien… je viens de voir Juanita, elle avait su par un message, une lettre qu’elle avait reçue d’un nommé Pedralvi, que Piquillo Alliaga, qui revenait de Valence, avait été arrêté dans la Nouvelle-Castille, entre Madrilejo et Tolède, par les ordres de Ribeira. Pedralvi, malgré ses recherches, n’a pu encore découvrir ses traces, et il craint qu’il n’ait été transporté à Madrid et jeté dans les cachots de l’inquisition.
— Ô ciel ! s’écria Carmen toute tremblante.
— Et de quel droit ? que lui reproche-t-on ? dit Fernand avec chaleur.
— Il est Maure d’origine, répondit Aïxa ; il n’a pas reçu le baptême.
— Eh bien, comme tant d’autres de ses frères, il protestera au fond du cœur et devant son Dieu, contre la violence qu’on veut lui faire, et il cédera.
— Il ne cédera pas ! s’écria Aïxa avec désespoir.
— Et pourquoi ?
— Parce que je le connais… et, s’il faut vous le dire, parce qu’il me l’a juré.
— À vous ! s’écria Fernand en pâlissant.
— Oui, à moi… le pauvre Piquillo ne sait pas manquer à un serment.
— C’est vrai, dit Carmen.
— Il se fera tuer, continua Aïxa, plutôt que de manquer à ce qu’il regarde comme son devoir, comme son honneur. Vous ne savez pas à quels supplices, à quelles tortures on expose ceux qui refusent d’abjurer.
— Si !… si, je le sais ! s’écria don Fernand.
— Et peut-être déjà n’est-il plus. Nous n’avons d’espoir qu’en vous, seigneur don Fernand !
— En moi ! s’écria celui-ci.
Il contemplait Aïxa, son agitation, son trouble, sa pâleur, et la chaleur avec laquelle elle plaidait pour Piquillo. Il se rappela tout ce que celui-ci lui avait dit autrefois de la jeune fille et de l’enthousiasme avec lequel il parlait d’elle.
Il sentit alors comme un frisson convulsif parcourir tout son être, puis une fièvre ardente fit bouillonner son sang dans ses veines, tandis qu’un dard glacé le frappait au cœur. « Ils s’aimaient… ils s’aiment ! » se dit-il en lui-même, et il poussa un cri de rage qui effraya les deux jeunes filles.
Apercevant alors Carmen qui lui tendait les bras, il leva les yeux au ciel et crut voir don Juan d’Aguilar ; il entendit les dernières paroles du vieillard qui lui recommandait sa fille. Toute sa colère tomba.
Le noble jeune homme fit taire les mouvements impétueux qui s’élevaient en lui. Il prit la main de Carmen, et tendant l’autre à Aïxa, il lui dit d’une voix tremblante d’émotion :
— Que puis-je pour vous, senora ? parlez, disposez de moi… Piquillo est mon ami… puisqu’il est le vôtre.
— Bien vrai ? s’écria-t-elle.
— Je le jure ! répondit-il avec fierté, et vous verrez que Piquillo n’est pas le seul qui sache tenir un serment.
Soit que la voix, soit que les yeux de Fernand eussent trahi ce qu’il éprouvait et les combats intérieurs qui venaient de se livrer en lui, Aïxa les avait devinés sans doute, car ses joues si pâles s’animèrent tout à coup, un rayon céleste brilla dans ses yeux, illumina son front, et, semblable à l’ange qui, après la peine, apporte la récompense, elle saisit la main de Fernand et s’écria :
— Bien… bien, Fernand ! Je t’estime et t’honore, car tu es un noble cœur !
XXXI.
le pavillon du parc.
La cour partait le lendemain pour Valladolid. Elle y allait souvent ; le but du duc de Lerma, en multipliant ces voyages, était d’habituer peu à peu le roi à s’y fixer, ce qui finit par arriver, et le siége du gouvernement y fut définitivement transporté, pendant le ministère du duc de Lerma.
Le ministre, et surtout son frère Sandoval y Royas, le grand inquisiteur, préféraient ce séjour à celui de Madrid. Une grande capitale, oisive et railleuse, les gênait. Ils étaient trop en vue. À Valladolid, ils se croyaient chez eux, grâce surtout aux magnifiques et nombreux couvents dont les habitants formaient la moitié de la population.
Valladolid est situé au fond d’une immense vallée qui semble avoir été formée par quelqu’une des grandes convulsions du globe ; car les flancs des collines qui l’environnent, sont escarpés et découpés en formes si bizarres, qu’ils ont été sans doute ravagés par quelque force volcanique.
Le tout donne un aspect sombre et triste à la ville, qui avait alors l’air d’une immense chartreuse.
La cour s’éloignant de Madrid, la comtesse d’Altamira était obligée de la suivre, puisqu’elle était attachée au service de la reine ; et Carmen, ainsi qu’Aïxa, devaient accompagner la comtesse, car il avait été décidé que, jusqu’à l’époque de son mariage, Carmen ne quitterait point sa tante.
Fernand aurait bien voulu partir avec sa fiancée ; mais il venait de promettre à Aïxa de faire toutes les démarches nécessaires pour découvrir les traces de Piquillo, et, une fois ce premier point obtenu, d’employer tous ses amis et tout son crédit pour le délivrer.
Aïxa comptait bien aussi un peu sur la reine, mais avant d’avoir recours à elle, il fallait d’abord savoir où était le prisonnier, et quel genre de danger le menaçait.
Don Fernand resta donc à Madrid, et les deux jeunes filles partirent pour Valladolid, avec la comtesse.
Quoique attachée au service de Sa Majesté, la comtesse était rarement au palais et n’y séjournait que pour son plaisir. Ses fonctions se bornaient à peu de chose ; la reine ne l’appelait presque jamais, et au lieu de demeurer à Valladolid même, elle habitait, non loin de Médina, et sur les bords du Duero, un antique château, dont le parc était traversé par cette rivière. Son onde, pure et fraîche, tantôt coulait doucement sur un lit de blancs cailloux, tantôt bouillonnait avec fracas sur des rochers aigus.
Ce lieu solitaire et pittoresque séduisit tout d’abord les deux jeunes filles. Ce qui est rare dans ce pays, les environs en étaient fort boisés, et une forêt, qui s’étendait assez loin, entourait le château, placé dans un ravin assez profond, agrément qui augmentait encore l’aspect mélancolique du lieu.
Carmen n’avait pas besoin d’occupation ; dans les allées du parc ou dans celles de la forêt, elle rêvait à Fernand, cela lui suffisait. Aïxa, qui, sans doute, ne voulait rêver à personne, ne restait pas un instant oisive ; elle faisait de longues promenades, parcourait les environs, allait surtout à une ferme voisine, d’où l’on découvrait des points de vue admirables : elle emportait ses crayons et ses pinceaux, et passait des heures entières à peindre.
La fermière, qui n’était pas riche, avait de nombreux enfants, une fille, entre autres, qu’elle aurait bien voulu marier.
Aïxa s’occupait déjà des moyens de réaliser ce rêve ; elle avait pensé à la dot au trousseau, elle y travaillait elle-même ; enfin cette âme ardente et noble, qui croyait tout possible à une volonté ferme et courageuse, sentait sans doute que quelque danger la menaçait, et, décidée à combattre, décidée à triompher d’elle-même et de ses pensées, elle savait les éloigner et les vaincre par le travail, par l’étude, par les distractions qu’elle demandait à la bienfaisance ; et ses combats, à elle, étaient encore des vertus.
Non loin de cet asile si pur et si chaste, dans le palais de Valladolid, s’agitaient bien d’autres passions. Le duc de Lerma avait, depuis quelque temps, remarqué dans le roi, d’ordinaire si calme et si tranquille, une espèce d’agitation et d’effervescence qui l’inquiétait.
— Qu’est-ce donc ? avait-il demandé à son fils, le duc d’Uzède. Qu’y a-t-il ?
— Rien ! une vague inquiétude qui a besoin d’air et de mouvement, et il reste toujours renfermé dans l’enceinte de ce palais.
— C’est juste, il faudrait organiser…
— Quoi donc ?
— Quelque cérémonie religieuse… quelque procession qui lui donnât un peu de bon temps et de distraction.
— Je ferais mieux.
— Auriez-vous une idée ?
— Oui… une partie de chasse.
— Exercice trop fatigant, auquel Sa Majesté n’est pas habituée.
— Aussi nous suivrons seulement la chasse en voiture, dans les bois de Médina.
— C’est possible.
— Par une belle journée… un beau soleil… quand le roi verrait de la verdure et des arbres…
— Oui, dit le ministre, ici, à Valladolid… il n’y a pas de danger.
Et une partie de chasse fut ordonnée pour le lendemain.
Elle se passa sans danger, et au bout de deux ou trois heures de promenade en voiture, le roi rentra enchanté de son expédition. Il avait vu galoper des chevaux, entendu le bruit des cors, l’aboiement de la meute ; il avait surtout humé un air vif et pur. Il dîna avec un grand appétit, ce qui n’arrive pas toujours aux estomacs royaux, et, quelques jours après, par les avis du duc d’Uzède, il voulut recommencer.
Le duc de Lerma et le grand inquisiteur, après en avoir délibéré en conseil, n’y virent aucun inconvénient.
Cette fois, le roi voulut suivre la chasse à cheval, toujours par l’avis du duc d’Uzède. Comme cette idée lui était venue presque au moment du départ, on n’avait pas eu le temps d’en délibérer, et l’on partit.
La journée était avancée lorsqu’on se mit en chasse. Le matin, le ciel était sombre, et l’on avait voulu attendre, pour plus de sûreté, que le soleil eût dissipé les nuages et fût dans toute sa force ; d’ailleurs, la chasse devait, comme la première fois, ne durer que quelques heures.
Il en fut autrement. Le cerf y avait mis de la mauvaise volonté et n’avait pas voulu se laisser forcer ; le jour baissait, et le roi, qui était resté un peu en arrière, avec le duc d’Uzède, paraissait fatigué de sa journée.
— Eh bien ! sire, abandonnons la chasse.
— Et le cerf qui n’est pas forcé !
— Votre Majesté y tient-elle infiniment ?
— Pas beaucoup ; c’est trop long.
— Laissons ce soin à vos piqueurs, et retournons à Valladolid.
— Mais que dirons-nous en arrivant ?
— Que nous nous sommes égarés, que nous avons perdu la chasse.
— C’est une idée, dit le roi en souriant.
— Justement nous sommes loin de votre suite ; on ne nous voit pas. Prenons cette allée à gauche.
— Tu la connais, duc ?
— Parfaitement, sire, elle nous conduira hors du bois.
Les deux cavaliers s’y élancèrent. Au bout de quelques minutes, le duc tourna à gauche, puis à droite, puis encore à gauche, et on ne voyait pas apparaître la grande route.
— C’est singulier ! dit le roi, il me semble que nous tournons le dos à Valladolid.
— Je ne le crois pas, sire.
— Tu n’en es donc pas sûr ?
— Je suis sûr de mon chemin, répondit le duc (qui le connaissait parfaitement), quand il fait jour ; mais voici la nuit arrivée, et je ne sais plus où je suis.
— Ah ! mon Dieu ! fit le roi avec un peu de crainte.
— Et personne dans ce bois pour demander la route ! Depuis longtemps nous n’entendons plus ni le bruit des chevaux ni le son des cors.
— Mais, duc, dit le roi en s’efforçant de sourire, nous sommes donc égares ?
— C’est probable, sire.
— Égarés réellement ?
— Grâce au ciel ! qui aura voulu nous épargner un mensonge ; et en le disant, comme nous en étions convenus, il se trouvera que nous dirons la vérité.
— Cela vaut mieux, dit le roi. Cependant, j’aimerais autant que ce ne fût pas… car enfin, seul ainsi dans une forêt, à sept ou huit heures du soir.
— Plus que cela, sire, huit heures et demie. L’Angelus est sonné.
— Tu vois bien, cela ne m’est jamais arrivé !
— Eh bien ! sire, ce sera dans votre vie un incident, une aventure de roman.
— C’est vrai !… Mais c’est que j’ai faim, et une faim très-vive, mon cher duc.
— Ah ! voilà qui est moins romanesque ! Mais, tenez, sire, au milieu de ces bois, ne voyez-vous pas là-bas, là-bas, briller une lumière ?
— Je la vois, dit le roi vivement.
— Dirigeons-nous de ce côté, nous sommes sauvés !
Le roi, dont cet incident venait de ranimer la gaieté, lança son cheval au galop et suivit une longue allée verte.
— Tu as raison, duc, disait-il en riant, tu as raison. Vivent les aventures ! c’est charmant ! c’est délicieux ! Je ne voudrais pas pour beaucoup que celle-ci ne me fût pas arrivée.
Mais tout à coup il arrêta son cheval, et dit en baissant la voix d’un air inquiet :
— Je ne vois plus la lumière !
— C’est vrai, sire ; elle a disparu.
— Alors, qu’allons-nous devenir ?
— Marchons toujours. Cela prouve qu’il y a de ce côté des habitations…… quelque chaumière, quelque ferme.
— C’est juste.
— Et la lumière qui brillait tout à l’heure aura été éteinte par ce paysan ou par ce fermier.
— Ce qui prouverait, dit le roi avec inquiétude, qu’il est plus tard encore que tu ne le disais d’abord.
— Qu’importe ! nous ne pouvons plus maintenant espérer dîner à Valladolid.
— Ah ! dit le roi en poussant un cri de joie… je revois la petite lumière !
Un groupe épais de vieux arbres la leur avait cachée pendant quelque temps, et le roi sentit renaître sa gaieté.
— Oui, oui, c’est quelque chaumière, quelque ferme. Nous ferons un mauvais dîner, c’est égal.
— C’est bien plus piquant, sire.
— Tu as raison, mon cher duc.
— Du lait et du pain bis.
— Repas dont j’ai entendu parler, mais que je ne connais pas.
— Vous ferez connaissance.
— Et puis le fermier ou le paysan ne saura pas qui nous sommes.
— Nous ferons de l’incognito.
— Ce sera charmant ! nous le ferons parler de ton père, le duc de Lerma.
— Dont il dira peut-être du mal.
— Cela m’amusera, et puis nous lui parlerons de moi-même, du roi !
— Vous entendrez leurs éloges, leurs bénédictions.
— Je le crois, dit le roi avec satisfaction, car moi je n’ai jamais voulu leur faire que du bien ; ce sera, pour moi, une soirée charmante.
— Votre Majesté est-elle encore fâchée de s’être égarée ?
— J’en suis ravi, au contraire !… mais cette allée est bien longue et ne finit pas.
— Nous approchons cependant.
— Oui, dit le roi, enfin nous y voici !
Le bâtiment devant lequel ils se trouvaient n’était ni une chaumière, ni une ferme. C’était un pavillon gothique, tenant à un parc considérable et dont les murs semblaient avoir une lieue de tour. La lumière qu’ils avaient aperçue s’échappait d’un des volets du pavillon qui était entr’ouvert.
Le roi appela ; personne ne répondit. Il y avait, au-dessous de la croisée, une petite porte donnant sur la forêt.
Le roi frappa ; personne ne vint.
Sa Majesté, qui d’ordinaire était obéie, avant même d’avoir commandé, regarda le duc d’un air consterné. C’était comme un désastre, comme une révolution qui changeait toutes ses habitudes.
Un froid assez vif, l’air du soir et de la forêt, commençaient à les saisir ; la gaieté du roi était dissipée. Pour comble de malheur, le ciel était sombre, nuageux, et une petite pluie fine se mit à tomber. Vue des fenêtres du palais, c’eût été à peine un brouillard, mais dans la forêt, c’était autre chose.
— Voici une averse horrible ! s’écria le roi, qui n’aimait plus les aventures ; c’est insupportable… on ne peut pas rester dans une position pareille. Le duc avait frappé de nouveau à la petite porte, et paraissait lui-même fort déconcerté qu’on ne vint pas lui ouvrir.
— Nous ne pouvons pas cependant passer la nuit dans cette forêt, dit le roi, totalement découragé ; et quant à remonter à cheval dans ce moment et avant de m’être reposé, cela m’est impossible.
— Attendez, sire… attendez, dit le duc ; il me semble que le volet de ce pavillon est entr’ouvert.
— C’est vrai, et la fenêtre aussi.
— Puisque personne ne répond, c’est qu’il n’y a personne.
— Eh bien, duc ?
— Eh bien ! si Votre Majesté y entrait, elle y trouverait du moins un abri contre le froid et la pluie. Moi, pendant ce temps, je remonterai à cheval, et rien qu’en suivant les murs de ce parc, quelque étendu qu’il soit, je finirai toujours par trouver la maison d’habitation, et je viendrai alors reprendre Votre Majesté.
— À merveille ! j’approuve ! Mais comment veux-tu que j’entre dans ce pavillon ?
— Comme je vous ai dit, sire, par cette fenêtre qui est entr’ouverte.
— Mais elle est à douze ou quinze pieds de terre.
— Dix tout au plus.
— C’est encore trop, sans échelle, pour un homme seul.
— Mais pour un homme à cheval.
— Que voulez-vous dire ?
— Si Votre Majesté veut le permettre, je vais descendre de cheval et ranger le sien le long de la muraille ; il est extrêmement doux… et puis il est fatigué.
— Il n’est pas le seul, dit le roi.
— Je vais le tenir par la bride… je réponds qu’il ne bougera pas.
— Eh bien ? dit le roi avec impatience.
— Eh bien ! si Votre Majesté, tout en s’appuyant contre la muraille, veut monter debout sur la selle, elle se trouvera presque à la hauteur de la croisée, et en s’aidant un peu des mains…
— C’est, ma foi, vrai, dit le roi d’Espagne, qui, à mesure que parlait son conseiller, venait d’exécuter tout ce qu’il lui avait indiqué. C’est charmant, c’est. comme qui dirait monter à l’assaut.
— En brave militaire, en fier Castillan… à l’escalade !
— Ça ne m’était jamais arrivé, dit le roi. M’y voici, ajouta-t-il en enjambant.
— À merveille, sire, dit le duc en remontant à cheval. Que Votre Majesté se repose et m’attende, dès que je saurai où nous sommes, je reviendrai vous avertir et vous reprendre, et quand je frapperai fortement trois coups à cette porte, n’oubliez pas de descendre ; c’est par là cette fois que Votre Majesté sortira, car je vais m’arranger, n’importe à quel prix, pour en avoir la clé.
Le duc partit au galop, emmenant son cheval et celui de Sa Majesté.
Le roi alors quitta la croisée qui donnait sur l’allée du bois et se retourna. Il était dans une espèce d’antichambre fort élégante, qu’éclairait une lampe d’albâtre, placée sur une table de marbre.
Une porte en bois des îles habilement sculptée était à sa gauche ; il l’ouvrit, et se trouva dans une pièce si richement illuminée, que l’éclat des bougies pensa l’éblouir, lui qui venait de l’obscurité. Cette salle, ornée de peintures rares et de meubles les plus précieux, offrait, entre autres singularités, une table sur laquelle on apercevait, non du lait et du pain bis, mais une splendide collation, avec un seul couvert.
Un feu brillant pétillait dans une cheminée de marbre.
Mais, du reste, personne, pas une âme vivante.
Le roi étonné se frottait les yeux ; il ne pouvait croire à ce qu’il voyait ; plus que jamais, les aventures lui paraissaient agréables, et il se disait, en lui-même, que si elles ressemblaient toutes à celle-ci, il était bien dupe de n’avoir pas commencé plus tôt.
Cette jolie salle avait encore une autre porte ; le roi, devenu intrépide, l’ouvrit hardiment.
Personne encore !
— Partout la solitude et le silence, mais le réduit le plus joli, le plus coquet, ce que de nos jours on appellerait un boudoir. Des girandoles garnies de bougies brillaient de tous côtés, et près de la cheminée, au brasier ardent, un large canapé offrait à Sa Majesté, pour se reposer de ses fatigues, des coussins soyeux et rebondis.
Le roi commençait à croire à la magie, et se demandait si, lui, le roi Catholique, pouvait rester plus longtemps en ces lieux… quand, vis-à-vis de lui, une porte cachée dans la tapisserie s’ouvrit tout à coup.
Une jeune fille d’un aspect ravissant, les yeux brillants de gaieté et le sourire sur les lèvres, parut devant lui.
Sa Majesté le roi d’Espagne et des Indes n’avait jamais rien vu de plus joli, de plus séduisant, de plus enchanteur que cette figure de jeune fille ; il la regardait d’un œil à la fois étonné et ravi ; il n’osait parler, de peur que cette apparition ne s’évanouit et ne se dissipât comme une ombre.
Étendant les bras vers elle pour la saisir et l’arrêter, il allait tomber à ses genoux, mais sa surprise redoubla, et il se releva en entendant ces paroles, qu’accompagnait une gracieuse révérence :

une fleur de grenade desséchée.
— Mille pardons, seigneur cavalier, de vous avoir fait attendre.
XXXII.
explications.
L’arrivée de don Fernand d’Albayda avait entravé, mais non arrêté les projets de la comtesse. Le père Jérôme et Escobar la pressaient chaque jour de les mettre à exécution. Pour eux, il y avait urgence.
Le duc de Lerma les eût volontiers laissés tranquilles ; mais le grand inquisiteur et l’ordre des Dominicains, dont il était le chef, ne pardonnaient point aux révérends pères jésuites les frayeurs que plus d’une fois ils leur avaient causées. Sandoval, malgré la bonne opinion qu’il avait de lui-même, comprenait que les bons pères avaient, sinon plus de pouvoir, du moins plus d’adresse et d’esprit que l’inquisition. Il les voyait, malgré toutes ses précautions, croître et multiplier autour de lui.
Presque aux portes de Madrid, le couvent et l’université d’Alcala de Hénarès étaient comme une immense pépinière qui se formait sous leur direction, et dont les produits se répandaient et s’implantaient dans toute l’Espagne.
Le frère Eusèbe, abbé instruit et révéré, supérieur de cette communauté, venait de mourir, et Sandoval avait juré de le remplacer par un moine à lui, dominicain pur, dévoué à l’inquisition corps et âme.
C’eût été la ruine de la Compagnie de Jésus. Aussi le père Jérôme et Escobar cherchaient-ils, pour s’y opposer, tous les moyens possibles ; le meilleur de tous était l’idée de la comtesse, mais il fallait hâter l’entrevue du roi et de Carmen. Il fallait, surtout, pour séduire du premier coup d’œil le timide souverain, une rencontre originale, romanesque, imprévue, de ces événements qui font impression et bouleversent souvent des cerveaux mieux organisés que celui du faible monarque.
Le départ de la cour pouvait offrir une de ces occasions, bien plus aisées à rencontrer à Valladolid qu’à Madrid.
Que le roi vît Carmen et en devint amoureux, c’est tout ce que demandait la comtesse ; c’était là le point important, le plus difficile ; le reste rentrait dans les intrigues ordinaires, et elle se faisait fort, avec l’aide de ses alliés, de brouiller Carmen et Fernand.
Il n’était pas bien sûr que, déjà, elle n’eût deviné l’espèce d’entraînement qui portait celui-ci vers Aïxa. Tout cela pouvait s’exploiter, ainsi que la jalousie et le désespoir de sa nièce. Elle se réservait d’éveiller et d’exalter plus tard son ambition ; quant aux principes et aux scrupules qui auraient pu rester à la jeune fille, ils ne résisteraient pas longtemps : elle lui avait donné Escobar pour confesseur.
Elle habitait, comme nous l’avons vu, le château du Duero. Il lui revenait de la succession de son mari, le comte d’Altamira, qui avait privé sa propre famille de toute sa fortune, pour la laisser à sa femme.
De temps en temps la comtesse allait à la cour, où l’appelait son service ; et avec le duc d’Uzède, qui ne quittait point le roi, elle avait tout préparé, tout concerté, pour frapper enfin le grand coup qu’ils méditaient depuis si longtemps.
Quelques troubles venaient d’éclater en Portugal. On y parlait même de sourdes conspirations contre l’autorité du roi.
Il fallait, pour calmer les esprits, envoyer en ce pays un homme ferme à la fois et conciliant ; Uzède fut le premier qui parla au roi et au duc de Lerma, son père, de don Fernand d’Albayda, dont la belle conduite dans les Pays-Bas méritait récompense.
Une telle proposition, de la part d’un ennemi, fit le plus grand honneur au duc d’Uzède. Le duc de Lerma consentit à la nomination de Fernand, d’abord pour plaire au roi, qui le lui demandait, ensuite pour donner à son fils une réputation de générosité ; et puis il se trouvait par hasard que le choix était excellent.
Fernand, qui était resté à Madrid, ne demandant rien, ne sollicitant rien que des renseignements sur Piquillo, reçut l’ordre de partir immédiatement, et sans le moindre retard, pour Lisbonne.
Tranquiile ainsi au dehors, la comtesse ne s’occupa plus que de l’exécution intérieure de la conspiration. Son plan n’était pas bien compliqué, tout lui venait en aide.
Depuis quelques jours, Aixa avait entrepris un tableau qui offrait de grands effets de lumière. C’était une vue prise de la ferme, un coteau hérissé de pins, de mélèzes et de rochers, au moment où le soleil, se levant derrière la montagne, venait en éclairer la cime de ses premiers rayons ; mais pour saisir le modèle au passage, il fallait être aussi matinal que lui et plus encore.
Aussi, pour être levée avant le jour, Aïxa avait pris le parti d’aller coucher à la ferme, où la bonne fermière, et surtout Mariquita, sa fille aînée, avaient d’elle tous les soins possibles.
Ainsi, quand venait le jour, la comtesse et Carmen se trouvaient seules dans ce vaste château… circonstance dont fut prévenu le duc d’Uzède, qui se hâta d’agir en conséquence.
Le matin du jour dont nous venons de parler, et après avoir reçu un message de Valladolid, la comtesse fit de grands préparatifs, surtout dans un petit pavillon situé sur la lisière du bois, mais qui communiquait au château par une longue serre ou orangerie.
— Eh ! mon Dieu ! ma tante, lui dit Carmen, pourquoi donc vous donner tant de peine ?
— Est-ce que madame la comtesse attend quelque grand seigneur ? ajouta Aïxa en souriant.
— Non vraiment, répondit la comtesse d’un air indifférent, j’attends mieux que cela.
— Et qui donc ? demandèrent les jeunes filles avec curiosité.
— Un parent à moi, ou plutôt à feu mon mari, le seigneur don Augustin de Villa-Flor, un cousin.
— Je croyais, dit Aïxa, que madame la comtesse ne voyait aucun parent du côté de son mari ?
— C’est vrai !… le comte d’Altamira, qui m’adorait, m’a laissé tous ses biens, et, sous prétexte que je les ai ruinés, ses parents croient tous devoir me détester… excepté don Augustin, qui, plus aimable ou plus juste, m’a promis de venir passer quelques jours dans ce château.
— Tant mieux ! dit gaiement Aïxa.
— Pourquoi ? lui demanda Carmen.
— Je ne sais… il me semble que le seigneur don Augustin doit être amusant ! À la campagne, c’est quelque chose, et je le retiens pour moi.
— Je suis alors bien fâchée, dit la comtesse, de ne pouvoir vous donner ce divertissement : la lettre que je viens de recevoir m’apprend qu’à peine pourra-t-il disposer ce soir d’un moment.
— Voilà qui est fâcheux. Et comment cela ?
— Arrivé hier soir à Valladolid, obligé de repartir demain pour Burgos avec une mission importante, le roi l’a invité à le suivre aujourd’hui à la chasse.
— Par Notre-Dame del Pilar, dit Aïxa en riant à Carmen, il paraît que notre cousin Augustin est bien en cour.
— De sorte, poursuivit la comtesse, qu’il ne pourra, il me l’a écrit, venir que ce soir, entre huit et neuf heures, après la chasse.
— C’est trop tard, dit Aïxa, je serai partie.
— Et pourquoi vient-il, ma tante ? demanda Carmen.
— Pour faire connaissance avec nous, accepter en chasseur une légère collation, embrasser ses cousines et repartir aussitôt.
— C’est bien à lui.
— Et vous comprenez, ma chère enfant, continua la comtesse, de quelle importance il est pour moi de bien recevoir un parent de mon mari, le seul qui se rapproche de moi et qui me fasse des avances. Aussi je serais désolée de ne pas lui faire l’accueil le plus digne. le plus honorable, et surtout le plus affectueux.
— Vous avez raison, ma tante.
— J’espère bien, Carmen, que vous me seconderez.
— Je vous le promets, dit la jeune fille dans toute la sincérité de son âme.
Cela dit, la comtesse continua ses préparatifs, donna ses ordres et en surveilla elle-même l’exécution.
On devait placer la collation dans le pavillon, parce qu’il donnait sur la forêt, et qu’il serait plus facile et plus commode au chasseur d’entrer par la petite porte du parc, que de faire une demi-lieue pour gagner la grande grille.
Les jeunes filles laissèrent faire la comtesse et ne s’occupèrent plus d’elle ; sans cela, elles se seraient peut-être étonnées de certaines précautions que prenait la dame châtelaine, des commissions qu’elle confiait ou des courses qu’elle donnait à presque tous ses gens pour une heure de la soirée où, au contraire, elle aurait besoin d’eux.
Carmen était rentrée chez elle avec son amie ; elles lisaient, elles causaient ; et quand vint le soir, Aïxa embrassa Carmen, et se rendit à la ferme.
La comtesse se trouvait donc, dans cet immense château, seule avec sa nièce, ou à peu près ; car elle n’avait gardé près d’elles que deux domestiques qui lui étaient dévoués, une femme de chambre et un valet de pied.
Le matin, elle avait bien prétendu ressentir quelques maux de tête, des vapeurs, des mouvements fébriles, et comme cela lui arrivait souvent, les deux jeunes filles y avaient fait peu d’attention ; mais après le départ d’Aïxa, cette indisposition d’abord augmenta, devint plus grave et prit une telle intensité, que Carmen commença à s’effrayer.
Elle voulait envoyer à la ville prévenir un docteur. La comtesse s’y opposa formellement ; cette idée seule redoublait son mal. Ce n’était qu’une crise nerveuse des plus violentes, il est vrai, mais quelques heures de repos et de sommeil finiraient par l’apaiser. On venait de la déshabiller et de la mettre au lit, huit heures sonnèrent.
— Ah ! mon Dieu ! s’écria Carmen, et le seigneur don Augustin de Villa-Flor que vous attendiez !
— C’est vrai ! c’est vrai ! s’écria la comtesse, je n’y pensais plus ; et cette idée lui causa une rechute, une attaque de nerfs des plus violentes.
— Ma nièce, ma chère nièce, disait-elle à Carmen d’une voix douloureuse, il m’est impossible, tu le vois, de le recevoir dans l’état où je suis.
— Oui, ma tante, ne vous inquiétez pas, je vais le lui faire dire.
— Ah ! par un de mes gens ! c’est bien peu convenable. Il vaudrait mieux que ce fût toi-même.
— Oui, ma tante, rassurez-vous, je vais y aller.
— Et même, ne pourrais-tu pas recevoir sa visite… à ma place, pendant quelques instants seulement… C’est une fatalité ! c’est si mal à moi, pour la première fois qu’il vient dans ce château visiter des parentes… car tu es sa parente aussi, cousine par alliance.
Et elle fit alors un mouvement convulsif et poussa un cri en disant :
— Ah ! mon Dieu ! que je souffre !
— Calmez-vous, chère tante.
— Je ne le puis. La contrariété que j’éprouve, en ce moment, réagit tellement sur tout le système nerveux…
— Je ferai ce que vous voudrez. Je lui dirai combien vous êtes souffrante ; je recevrai sa visite à votre place.
— Ah ! je vais mieux, murmura la comtesse en serrant avec reconnaissance la main de sa nièce. Vas-y donc ; voici l’heure où il doit arriver. Tiens-lui compagnie… et tu assisteras même à la collation qui lui est préparée…
— Croyez-vous que ce soit convenable, ma tante ?
— Ah ! fit la duchesse en tressaillant, je crains une nouvelle crise.
— J’obéis, ma tante, j’obéis !
La crise annoncée ne vint pas. La comtesse, essuyant avec un mouchoir la sueur qui coulait de son front et que l’exercice qu’elle venait de prendre ne justifiait que trop, la comtesse fit signe à sa nièce, en lui montrant la pendule, qu’il était l’heure de partir.
— Oui, oui, je m’en vais ; mais je crains de vous quitter.
— Je vais mieux… beaucoup mieux !… et si seulement on me laissait dormir tranquille… pendant une heure… je suis sûre que je serais guérie !…
Elle ferma les yeux. Carmen, marchant bien doucement sur la pointe du pied, sortit de l’appartement et descendit l’escalier.
Elle avait tellement hâte de se rendre au pavillon, que, malgré la petite pluie qui commençait à tomber, elle prit une allée du parc qui y conduisait directement.
Tout à coup elle vit venir une personne qui marchait vivement et se trouva en face d’elle.
C’était Aïxa.
— Toi, en ce lieu, à cette heure ! d’où viens-tu ?
— De la ferme.
— Et pourquoi ?
— Un billet que j’ai reçu de Fernand.
— De Fernand… pour toi… à la ferme ! comment cela ?
— Parce que son messager, son valet de chambre de confiance, qui avait ordre de me remettre ce billet à moi-même, ne m’ayant pas trouvée ici, est venu me rejoindre où j’étais.
— Que nous veut-il donc ?
— Tu vas le savoir.
Elles rentrèrent au château, montèrent dans la chambre de Carmen, et leur étonnement fut grand de ne rencontrer sur leur passage aucun domestique. Ils étaient tous absents.
La lettre de Fernand était ainsi conçue :
« Je viens de recevoir une mission fort honorable, sans doute ; mais l’ordre exprès de partir à l’instant même, et l’insistance que l’on met à ce départ, excitent en moi des soupçons que d’autres indices semblent confirmer. J’ai obéi ; tout le monde me croit sur la route de Lisbonne, mais je viens d’arriver à Valladolid, et il faut ce soir que je vous voie sans que la comtesse d’Altamira se doute de ma visite ; il y va du repos de Carmen, de son honneur et du mien. »
— Eh bien ! dit Carmen tremblante, qu’as-tu répondu à son message ?
— Que je ne pouvais recevoir don Fernand à la ferme.
— Pourquoi ? dit vivement Carmen.
— Pourquoi ? répondit Aïxa en rougissant… c’est qu’il me semblait plus convenable, puisqu’il s’agissait de toi, qu’il te confiât à toi-même ce secret important… et puis, ajouta-t-elle en balbutiant, n’a-t-il pas des adieux à te faire ?
Carmen lui serra la main.
— Mais, continua Aïxa, il ne pouvait venir ici, puisqu’il ne veut être vu ni des gens de la maison, ni de la comtesse.
— Tous les domestiques sont sortis, et ma tante, malade, est renfermée dans sa chambre.
— Je l’ignorais, et je lui ai fait dire, par son valet de chambre, que ce serait toi qui, sur les huit heures, te rendrais à la ferme.
— Seule ! s’écria Carmen avec crainte.
— Et la fille de la fermière, cette bonne Mariquita, qui m’a escortée et qui te conduira !… et puis, si tu le veux absolument, je ne te quitterai pas, je retournerai avec toi.
— Je l’aime mieux, dit Carmen. Viens, partons.
Elles descendirent ; mais à peine furent-elles dans le parc, où elles trouvèrent Mariquita qui les attendait, que Carmen s’écria :
— C’est impossible ! j’oubliais mon cousin Augustin de Villa-Flor, que j’ai promis à ma tante de recevoir… là-bas dans le pavillon… Si tu savais comme elle y tient !
— Tu n’iras pas.
— Alors il est capable de venir au château… et ma tante verra que je lui ai manqué de parole.
— Il n’y a pas grand mal.
— Elle enverra à ma chambre, et elle saura par là que je suis sortie… pourquoi ? pour quels motifs ?… où ai-je été ? que répondrons-nous ?
— C’est plus grave… mais s’il ne tient qu’à cela, ne t’en inquiète pas, et va recevoir Fernand qui t’attend. Je recevrai ton cousin, le seigneur Augustin.
— Ah ! la bonne idée !
— Il ne te connaît pas, n’est-il pas vrai ?
— Nullement. C’est sa première visite.
— Il perdra au change, dit Aïxa en souriant, mais enfin je ferai de mon mieux.
— Je t’en prie en grâce ! ma tante m’a si fort recommandé de lui faire bon accueil.
— Je serai aimable… je serai charmante ; va vite à la ferme.
— Et toi au pavillon.
— Tu me raconteras ton entrevue ?
— Et toi la tienne ?
Et les deux amies se séparèrent.
Carmen, s’appuyant sur le bras de Mariquita, sortit avec elle du parc. Aïxa courut au pavillon, où elle entra tout essoufflée, pour se préparer à recevoir le seigneur Augustin ; et, tout étonnée d’être reçue par lui, elle lui adressa les paroles que nous avons entendues :
— Mille pardons, seigneur cavalier, de vous avoir fait attendre.
XXXIII.
le tête-a-tête.
Cette jolie fille et son gracieux accueil avaient un peu déconcerté le roi, qui se dit à part lui :
— Il paraît que, décidément, et sans m’en douter, j’étais attendu.
Mais cela ne lui expliquait ni où il était, ni pour qui on le prenait, et son air troublé, inquiet et embarrassé rassura singulièrement la jeune fille, qui lui dit de l’air le plus gracieux :
— Asseyez-vous donc, seigneur Augustin.
Le roi apprit ainsi son nom. C’était un premier point, et un point très-important. Il s’assit en regardant Aïxa.
— Pour la première fois que ma tante, la comtesse d’Altamira, a l’honneur de vous recevoir, continua la jeune fille, toujours avec son air gracieux, elle est bien malheureuse et bien désolée de ne pouvoir vous faire elle-même les honneurs de son château.
Pour le coup le roi respira plus à l’aise. Il était chez la comtesse d’Altamira, une des dames d’honneur de la reine ; il était en pays de connaissance ; et de plus il apprenait que la charmante jeune personne qui venait d’exciter son admiration était la nièce de la comtesse. Il pouvait sans danger se donner, comme il le disait, les plaisirs de l’incognito ; ses joues, un peu pâlies par le froid et par un sentiment de timidité ou de crainte, reprirent leurs couleurs naturelles. Il s’enfonça avec satisfaction dans le bon et large fauteuil dont il n’occupait que le bord, et étendit ses jambes vers le brasier, pendant qu’Aïxa continuait ainsi :
— La comtesse est obligée de garder sa chambre ; elle est très-souffrante.
— J’espère que cette indisposition n’aura point de suite, et je vous prie de lui faire savoir combien j’en suis contrarié.
— Elle l’est plus que vous, seigneur Augustin ; elle se faisait une fête de voir un parent de son mari, un cousin dont elle est fière.
— C’est vrai, dit le roi, avec une hardiesse dont il fut étonné et ravi, nous sommes cousins.
— Et de très-près, à ce qu’elle nous a dit.
— Alors, balbutia le roi en hésitant un peu, et en regardant Aïxa, nous devons être également parents.
— Oui, sans doute, dit gaiement la jeune fille, mais de plus loin, cousins par alliance.
— C’est beaucoup ! dit le roi, enchanté de la parenté et surtout de la tournure que prenait la conversation. Il se trouvait joyeux et à son aise, heureux comme un prisonnier en liberté, comme un écolier en vacances ; et puis cette jeune fille aux beaux yeux noirs, à l’air insouciant, qui le traitait sans façon et sans cérémonie, donnait à cette aventure un piquant et une nouveauté qui le charmaient. Jamais Sa Majesté ne s’était trouvée dans une situation pareille, et l’extase qu’il ressentait lui faisait tout oublier, même son appétit.
Aïxa le lui rappela.
— Avez-vous fait une bonne chasse, seigneur Augustin ? lui demanda-t-elle.
— Quoi ! ma cousine, lui dit-il d’un air interdit, vous savez…
— Oui, mon cousin, répondit-elle en riant, je sais par la comtesse qu’arrivé hier soir à Valladolid, vous partez demain pour Burgos, et que cela ne vous a pas empêché de suivre aujourd’hui la chasse du roi… c’est là de l’activité ! aussi vous devez être fatigué.
— Un peu, ma cousine.
— Et vous avez peut-être faim ?
— Beaucoup, ma cousine.
— La comtesse a dû vous faire préparer une collation.
— Que j’ai vue en entrant.
— On m’a recommandé de vous en faire les honneurs, dit Aïxa en lui offrant de passer dans l’autre pièce.
— Ma foi, cousine, je vous avouerai sans façon que je ne demande pas mieux !
— Et vous faites bien.
— Oui, dit le roi en lui-même, hâtons-nous ! car si l’autre Augustin arrivait en ce moment…
Et présentant la main à Aïxa, il se disait, en regardant les doigts roses et effilés et le bras rond de la jeune fille :
— Ce seigneur Augustin est bien heureux d’avoir ne cousine pareille !
Aïxa refusa de se mettre à table, comme le roi le lui offrait, mais elle le regardait manger et même lui versait à boire. Sa Majesté n’avait jamais eu de plus joli échanson.
— Vous avez donc suivi le roi, mon cousin ?
— Oui, sans doute, répondit gaiement Sa Majesté en découpant une perdrix ; j’étais avec le roi, je ne l’ai pas quitté.
— Vous avez dû bien vous ennuyer ?
— Ah bah ! dit le roi tout étonné, et laissant tomber sur son assiette l’aile de perdrix qu’il venait d’enlever, m’ennuyer ; pourquoi cela ?
— Parce que le roi ne doit pas être amusant !
— Qui vous le fait croire ?
— D’abord, il est si dévot !
— Il est pieux !… dit le seigneur Augustin en baissant les yeux.
— Comme vous voudrez ! Permettez-moi de vous verser à boire.
Volontiers, ma cousine. Vous n’aimez donc pas le roi ?
— Lequel, mon cousin ?
— Est-ce qu’il y en a deux… en Espagne ?
— À ce que tout le monde dit, du moins, car moi, cela ne me regarde pas !
— Quels sont-ils donc ? dit le monarque un peu déconcerté.
— Eh mais, le duc de Lerma et Philippe III : l’un qui règne, et l’autre qui laisse faire. Beaucoup de gens détestent le premier.
— Et vous méprisez le second, dit le roi en rougissant.
— Mon cousin… je le plains, car on dit qu’il est bon, mais faible…
— C’est donc un grand crime que la faiblesse ? s’écria le roi avec ironie.
— Pas chez les particuliers tels que vous, seigneur Augustin ; mais chez un prince qui devrait faire ses affaires lui-même…
— On dit que son ministre a du talent.
— Celui de s’enrichir !
— Il veut la gloire du pays, dit le roi en suçant une seconde aile de perdreau, il aime l’Espagne !
— Comme vous aimez les perdrix, mon cousin, lui dit-elle. Mais vous ne buvez plus.
Il est de fait que la bonne humeur du roi venait d’éprouver une rude atteinte. Lui qui s’était fait un si doux rêve des plaisirs de l’incognito, venait d’entendre de dures vérités ; et le plus cruel, c’est que la jeune fille avait parlé dans toute la franchise de son âme, et que, sans prévention comme sans haine, n’ayant jamais vu le roi, ne désirant point le voir, elle semblait n’avoir d’autre opinion que l’opinion générale.
Peu à peu cependant il se remit.
Aïxa était si jolie qu’il n’avait pas la force de lui en vouloir. Il était obligé de s’avouer qu’elle avait de l’esprit, et rien qu’en regardant ses yeux noirs pleins de feu, tout lui disait qu’elle avait de la fierté, de la tête et du caractère.
Les idées du père Jérôme, celles du duc d’Uzède lui revinrent à l’esprit, et tout en buvant coup sur coup et par distraction deux verres de vin de la Fronteira, il ne put s’empêcher de faire en lui-même le raisonnement suivant :
— Par saint Jacques, s’il est dans ma destinée d’être gouverné, il vaudrait mieux l’être par une jeune fille comme celle-ci, que par un vieux ministre comme le mien.
Étonnée du silence que gardait le roi et de l’expression singulière avec laquelle il la regardait en ce moment, Aïxa lui dit :
— Qu’avez-vous donc, seigneur Augustin ?
— Ma cousine, répondit le seigneur Augustin d’un air distrait, et cependant en suivant toujours son idée, êtes-vous mariée ?
— Ah ! mon Dieu, se dit Aïxa en elle-même, c’est peut-être un prétendu, et s’il vient avec des vues sur la main de Carmen, je ne peux pas usurper plus longtemps sa place ! — Non, mon cousin, dit-elle en balbutiant, je ne suis pas mariée. Et vous ?
— Moi, je le suis ! dit le roi en poussant un soupir.
Rassurée par cette déclaration, Aïxa reprit toute sa franchise et son enjouement.
— Vous vous êtes marié bien jeune, mon cousin ?
— Hélas ! oui.
— Comment, hélas !… est-ce que vous n’êtes pas heureux ?
— Moi, heureux ! se dit le roi avec un accent de profonde conviction, je ne l’ai jamais été.
— Est-ce que votre femme n’est pas jeune… jolie et aimable ?
— Si vraiment… mais elle ne m’aime pas !
— Ce n’est pas possible… vous avez l’air si bon !
— Il paraît que ce n’est pas une raison… au contraire !… moi, d’abord, personne ne m’aime.
Il prononça ces derniers mots avec un sentiment de douleur si vrai et si profond qu’Aïxa en fut touchée. Dès qu’on souffrait, on ne lui était plus indifférent, et le malheur, peur elle, était presque l’amitié !
Elle jeta sur le pauvre roi un regard de compassion et d’intérêt si tendre, qu’il en fut ému jusqu’au fond du cœur.
— Quel dommage, mon cousin, lui dit-elle, que vous partiez demain pour Burgos !
— C’est vrai, dit le roi, qui l’avait oublié, je pars pour Burgos.
— Sans cela, vous seriez venu nous voir ; et ici, en famille, parmi vos cousines, on aurait tâché de vous distraire, de vous égayer… et peut-être de vous consoler… Moi, d’abord, j’y aurais fait mon possible, continua-t-elle avec un sourire gracieux et caressant auquel on ne pouvait résister ; et peut-être y aurais-je réussi ; car, après tout, nos chagrins ne sont bien souvent que ce que nous les faisons, et les vôtres ne sont peut-être pas aussi terribles que vous le pensez.
— Ah ! si vous les connaissiez ! dit le roi… j’en ai de toutes sortes !
— Dans votre fortune ?
— Non, je suis riche, très-riche même.
— Dans votre ambition… vous voulez parvenir ?
— Non, j’ai une bonne place, très-bonne.
— Dans votre santé ?
— Je me porte à merveille, malgré tous les médecins que j’ai.
— Et je viens de voir, ajouta Aïxa en riant, que vous soupez à merveille ! Qu’avez-vous donc, mon cousin ?
— Je m’ennuie !
— Qu’est-ce que je vous disais ? comme le roi !… Vous voyez bien que ça se gagne !
— Oui, je m’ennuie mortellement, et toujours… excepté aujourd’hui, ma cousine !
Et l’air ému dont il la regardait prouvait que ce n’était point là une vaine galanterie.
— Il faut vaincre ce mal-là, mon cousin, car on dit qu’on en meurt.
— Je le sens bien ! et il n’y aurait qu’un moyen… un seul que l’on m’a conseillé, et je crois qu’on a eu raison.
— Eh bien ! ce moyen, il faut l’employer, et le plus tôt possible…
— Ma volonté ne me suffit pas !
— Qu’est-ce donc ? dites-le-moi, de grâce, mon cousin !
À cette question, faite si naïvement et avec tant de candeur, le roi demeura interdit et troublé. Pour rien au monde maintenant, il n’eût pu dire ce que le duc d’Uzède et le père Jérôme lui avaient conseillé.
— Voyez-vous, ma cousine, s’écria-t-il en balbutiant, il y a dans ma vie un rêve, un bonheur que je poursuis et que je ne puis obtenir… une idée sans laquelle je ne pourrais vivre… une idée trop ambitieuse, sans doute…
— Parlez au roi, puisque vous êtes si bien avec lui !
— Cela ne dépend pas du roi, il ne peut rien.
— J’entends ! comme je vous le disais tout à l’heure, cela dépend du ministre, et vous êtes mal avec lui.
— Du tout. Nous sommes très-bien ensemble.
— Cela dépend donc du grand inquisiteur Sandoval, qui a la haute main ? et si vous n’êtes pas de ses amis…
— Il est des miens et ne me refuse rien.
— Est-il possible ! fit Aïxa en poussant un cri de joie et de surprise.
— Qu’avez vous donc ? dit le roi en voyant l’émotion et le plaisir qui rayonnaient dans ses yeux.
— Le grand inquisiteur ne vous refuse rien ! s’écria-t-elle.
— Non vraiment.
Entre toutes ses bonnes qualités, Aïxa en avait une : c’était de ne jamais oublier ses amis, de s’en occuper sans cesse et en tous lieux ; de profiter de toutes les occasions de leur être utile ou même de faire naître ces occasions. Elle venait de penser au pauvre Piquillo, arrêté, prisonnier, gémissant dans les prisons de l’inquisition, et elle oublia les chagrins chimériques du seigneur Augustin, pour venir en aide au malheur véritable.
— Mon cousin, dit-elle en prenant un de ses plus séduisants sourires, puisque vous prétendez avoir tant de crédit… et je n’en doute pas, j’aurais un service à vous demander.
— Parlez ! parlez ! dit le roi au comble de la joie.
— En tant, cependant, que cela ne pourra ni vous exposer, ni vous compromettre.
— Plût au ciel !… s’écria le prince avec une chaleur dont il ne fut pas le maître ; puis, craignant de s’être trahi, il reprit avec plus de calme : Je serais si heureux, ma cousine, de reconnaître votre bon accueil et l’hospitalité que vous venez de me donner ! je vous écoute.
— Eh bien, dit Aïxa, il y a un ancien serviteur de la maison d’Aguilar…
— Oui… oui, dit le roi, Juan d’Aguilar, votre père et le frère de la comtesse d’Altamira… Eh bien ! cet ancien serviteur…
— Que l’on nomme Piquillo d’Alliaga, a été, dit-on, jeté dernièrement dans les prisons de l’inquisition.
— C’est grave, dit le roi.
— C’est-à-dire, on n’en est pas sûr… on n’en sait rien… parce que les cachots de l’inquisition sont bien sombres, et nul ne sait ce qui s’y passe…
— Je le saurai… je vous dirai s’il y est renfermé.
— C’est tout ce que je vous demande.
— Vous vous y intéressez donc beaucoup, ma cousine ?
— Infiniment.
— Et s’il est prouvé qu’il est prisonnier de l’inquisition. que ferez-vous ?
— Je tâcherai d’obtenir sa liberté… par la protection de quelques amis. J’en chercherai du moins.
— Eh bien… et moi, dit le roi avec une bonhomie qui n’était pas sans charmes, ne suis-je pas là, ma cousine ?
— Ah ! c’est trop de bonté.
— Je n’ai pas beaucoup de crédit… mais enfin… j’en ai autant que d’autres… et je vous promets que je l’emploierai à faire délivrer Piquillo d’Alliaga, votre protégé.
Il écrivit ce nom sur des tablettes qu’il tira de sa poche.
Et Aïxa, touchée jusqu’au fond du cœur de ces offres d’amitié si simples, si franches et si loyales, devint naturellement et par reconnaissance aussi expansive, aussi aimable qu’elle avait promis à Carmen de l’être pour lui faire plaisir.
Le roi était ravi. Il n’avait pas idée d’une grâce et d’un charme pareils ; la cour ne pouvait lui en offrir de souvenir ni de modèle, car l’étiquette se glissait même dans les relations les plus intimes ; le roi était toujours le roi, tandis que là il n’était que le seigneur Augustin de Villa-Flor, le cousin de la plus jolie fille des Espagnes, et celle-ci se croyait obligée de payer en gracieusetés le service généreux qu’on promettait de lui rendre.
Aïxa plaisait sans le vouloir, à plus forte raison quand elle le voulait, et le pauvre monarque, hors de lui, enchanté, séduit par cette coquetterie de la reconnaissance, n’était déjà plus maître de sa tête ni de son cœur : il allait tomber aux pieds de sa cousine en lui disant : Prenez pitié de moi… je suis le roi !
Par bonheur pour Sa Majesté royale, on frappa fortement à la petite porte du pavillon qui donnait sur la forêt, et on entendit le hennissement et le piaffement des chevaux.
— Qu’est-ce que cela ? dit Aïxa.
— Ce sont mes gens et mes chevaux qui viennent me prendre.
— Partez donc… et adieu, mon cousin.
— Oui, je pars, dit le roi, qui restait toujours ; veuillez dire à ma cousine, la comtesse d’Altamira, combien je suis touché de sa réception… c’est-à-dire de la vôtre ! Dites-lui aussi que je n’oublierai jamais cette soirée… son souper à elle… et vos bons conseils à vous…
— Dites mon amitié, mon cousin.
— Oui… oui… dit le roi avec émotion… c’est de l’amitié… de l’amitié bien sincère… de ma part du moins… je vous le prouverai.
— Et j’en suis persuadée… Adieu donc !
— Oui, je pars, dit le roi… et il restait toujours, Dieu sait à présent quand je pourrai vous revoir !
— Quand vous reviendrez de Burgos.
— Oui… et ce ne sera pas long ! Mais jusque-là… et puisque je vais partir…
Il avait un air si timide et si confus, qu’il ne pouvait achever… il rougissait… et baissait les yeux.
— Qu’est-ce donc ? dit Aïxa, ne comprenant pas son embarras. Que voulez-vous dire, mon cousin ?
— Je veux dire que peut-être une cousine peut donner à son cousin le baiser du départ… J’ose du moins le réclamer, ajouta-t-il en balbutiant.
— Et moi je l’accorde, dit gaiement Aïxa en lui présentant franchement sa joue fraiche, rose et rebondie.
Les lèvres du roi effleurèrent cette peau fine et satinée, et il sentit au cœur une commotion si forte et si douce, qu’il pensa défaillir. Les trois coups qui retentirent de nouveau à la porte du parc le firent revenir à lui.
— Adieu ! dit-il, en mettant un instant sa main devant ses yeux, adieu, je pars, cette fois.
Il retira sa main et fit quelques pas vers Aïxa. Elle venait de disparaître ; sans cela, peut-être le roi ne serait pas encore parti. Il ne restait d’elle aucune trace… rien que son souvenir ! Et le roi s’arracha enfin de ces lieux dangereux où il laissait sa raison et sa liberté.
XXXIV.
guerre à la cour. — bataille rangée.
Aïxa avait quitté le roi par la petite porte cachée dans la tapisserie et qui conduisait à l’orangerie. De là on se trouvait dans le parc.
Enchantée d’avoir tenu sa promesse envers Carmen et d’avoir si bien reçu le seigneur don Augustin de Villa-Flor, ravie surtout de ce qu’elle venait de tenter en faveur de Piquillo, Aïxa se rendait à la chambre de Carmen pour lui rendre compte de sa soirée.
Au détour d’un massif d’arbres qu’elle venait de franchir, elle aperçut un homme qui s’avançait en rêvant. Elle reconnut Fernand d’Albayda qui sortait de chez sa fiancée.
Il tressaillit en apercevant Aïxa ; mais il ne vit point sa pâleur soudaine ; grâce au ciel, il faisait nuit.
Ce fut la jeune fille qui parla la première en cherchant à cacher l’émotion de sa voix.
— C’est vous, don Fernand ? vous venez de quitter Carmen ?
— Oui, senora, il m’a fallu lui dire ce qu’il eût peut-être été mieux de ne confier qu’à vous ; mais vous n’avez pas voulu recevoir mes adieux !
— Me voici, dit-elle en lui tendant la main avec noblesse. Je les reçois, seigneur Fernand, puissiez-vous être heureux, et pour que vos amis le soient aussi, revenez vite.
— Mes amis ! répondit-il d’un air triste, vont accuser mon talent ou mon zèle, car je pars sans avoir pu remplir leurs ordres. Oui, senora, malgré les démarches et les recherches les plus actives, je n’ai rien pu découvrir encore sur le sort de Piquillo.
— Que cela ne vous inquiète pas.
— Si, vraiment, car j’ai été obligé de partir. Je suis en ce moment, du moins tout le monde le croit, sur la route de Lisbonne, j’y arriverai dans quelques jours, et comment vous servir d’aussi loin !
— Rassurez-vous, j’espère connaître par un autre moyen ce que je voulais savoir, et peut-être même obtenir la liberté du pauvre prisonnier.
Fernand tressaillit et dit avec amertume :
— Ainsi je n’aurai pas même pu vous être utile, ni acquérir un droit à votre reconnaissance.
— Vous vous trompez…… ma reconnaissance est la même que si vous aviez tout à fait réussi, croyez-le bien.
Elle fit un pas pour s’éloigner.
— Oui… oui, s’écria Fernand avec égarement, moi qui maudissais ce départ, je dois le bénir… c’est un bonheur, il ne pouvait m’arriver rien de plus favorable. Puisse cette absence durer toujours !
Aïxa, effrayée de cette espèce de délire, s’arrêta, et lui dit avec sa douce voix :
— Toujours, seigneur Fernand, ce n’est pas possible ! les troubles pour lesquels on vous envoie à Lisbonne seront bien vite apaisés… Je m’en rapporte à votre habileté et à votre courage. Bientôt vous reviendrez près de vos amis, vous reviendrez pour tenir vos serments, pour épouser Carmen, qui vous aime tant, qu’elle perdrait la vie si elle perdait votre tendresse.

de nouveau le silence, et disparut.
Ces mots, prononcés à demi-voix et comme une prière, allèrent droit au cœur de Fernand ; il éprouva une émotion qu’il ne chercha point à cacher, et s’il n’eût fait nuit, Aïxa eût vu les deux grosses larmes qui s’échappèrent de ses yeux.
— Oui, vous avez raison, Fernand d’Albayda doit tenir sa parole… mais il y a des moments, murmura-t-il d’une voix sourde, où l’on voudrait mourir !
— Mourir est toujours facile, répondit Aïxa avec fermeté ; ce qui l’est moins et ce qui est plus digne d’un noble cœur… c’est de rester et de combattre.
Puis, levant vers le ciel un regard plein de courage et d’espoir, elle ajouta :
— Et de vaincre.
Elle s’élança dans l’allée qui était devant elle et disparut. Elle trouva Carmen qui l’attendait tout inquiète, et qui se hâta de lui raconter que Fernand venait de la quitter.
— Je le sais… je l’ai rencontré… mais il n’a eu le temps de me rien dire ; que venait-il t’apprendre ?
— Les choses les plus singulières. Tout en m’avouant que s’il avait pu ne pas m’effrayer par une pareille confidence, il l’aurait fait, mais qu’il le fallait absolument ; il me conjure, sans vouloir entrer dans aucun détail, de me tenir sur mes gardes. Il craint qu’on n’ait sur moi des projets ambitieux et dangereux, qui ne tendraient à rien moins qu’à nous séparer et à nous désunir. Est-ce possible ?
— En effet, comment cela ?
— Il n’avait pas assez de certitude pour affirmer… mais il craignait qu’il n’y eût quelque complot dont le but fût de me jeter dans les bras d’un autre ; voilà ses propres expressions !
— Ô ciel ! dit Aïxa.
— Et jusqu’à ce qu’il y eût des preuves plus évidentes, il me suppliait de me méfier du père Jérôme, qui vient si souvent à notre hôtel… du père Escobar, qui, depuis quelque temps, est mon confesseur.

— Don Fernand n’a peut-être pas tort.
— Enfin, ce que tu ne croirais jamais… tout en balbutiant… et en hésitant beaucoup, il m’a conjurée de me défier… même de la comtesse d’Altamira.
— Ta tante ! s’écria Aïxa.
— Et la sienne aussi !
— Eh bien, dit Aïxa en réfléchissant, j’ai peu étudié la comtesse, je n’avais aucun intérêt à la connaître ; mais dans ce qui m’est apparu j’ai cru entrevoir d’étranges choses, ne fût-ce que la présence continuelle de ce duc d’Uzède, ennemi mortel de don Fernand, son neveu ; et quand même ton fiancé se tromperait, dans le doute vois-tu bien, je n’hésiterais pas un instant entre la comtesse d’Altamira et le noble Fernand d’Albayda l’époux choisi par ton père.
— Tu as raison, tu as raison ! s’écria Carmen en l’embrassant.
Il fut convenu entre les deux jeunes filles qu’on observerait, qu’on se tiendrait sur ses gardes, et que surtout on ne dirait rien à la comtesse des recommandations, ni de la visite nocturne de Fernand.
— Maintenant, dit Carmen, raconte-moi la réception que tu as faite à notre cousin Augustin ; car ma tante ne manquera pas, demain matin, de m’interroger, et il faut que je puisse lui répondre avec détails.
Aïxa n’oublia rien et raconta à son amie tout ce qu’avait fait, tout ce qu’avait dit don Augustin Villa-Flor, la manière dont il avait soupé, le baiser qu’il avait demandé, et enfin son départ pour Burgos.
Pendant ce temps, le roi galopait avec son fidèle confident, qui avait joué en cette circonstance un rôle que la qualité du maître ennoblissait à ses yeux. Le roi ne pensait plus à l’humidité de la nuit, ni à la forêt qu’il fallait traverser. Il était gai, il était spirituel, il était brave : il était amoureux !
— Charmant, mon cher duc, charmant ! une aventure qui tient de la magie !
— Je viens d’apprendre, sire, que ce château appartenait à la comtesse d’Altamira.
— Je le savais déjà, dit le roi d’un air triomphant. Je viens de souper en tête-à-tête… c’est-à-dire non… j’ai soupé seul, mais je viens de passer une soirée délicieuse avec sa nièce.
— L’adorable Carmen !
— On la nomme Carmen ! s’écria vivement le roi.
— Oui, sire, et je la connais beaucoup.
— Tu la connais ! Eh bien ! n’est-il pas vrai qu’il n’y a rien au monde de plus frais, de plus gracieux, de plus séduisant ?
— En effet, Votre Majesté me paraît séduite…
— Ma foi, j’en conviens… Si tu savais que de finesse, que d’esprit, que de bonté… Elle m’a dit les choses les plus gracieuses… C’est-à-dire pas toujours… mais c’était sans le vouloir ! Elle croyait parler à son cousin… son cousin Augustin… Je te raconterai cela… C’est délicieux, l’incognito !
— Je vois, sire, ce que vous ne me dites pas… que Votre Majesté a été fort aimable…
— Mais oui !… Jamais du moins je ne me suis senti plus à mon aise… et puis tu ne sais pas… tu ne le croiras jamais…
— Quoi donc, sire ?
— Je l’ai embrassée.
— En vérité !
— Moi-même !… et ce baiser, vois-tu bien… Je crois le sentir encore… Il me brûle, il me fait chaud aux lèvres et au cœur ! Mon ami, mon cher duc… il faut que je la revoie encore, que je lui parle.
— Prenez garde, sire…
— Il n’y a qu’à toi que je puisse me confier ! toi qui puisses me procurer ce bonheur.
— C’est si difficile ! si l’on se doutait de quelque chose…
— On ne se doutera de rien.
— Votre Majesté me promet donc le plus profond silence avec le duc de Lerma, mon père, qui m’en voudrait…
— Je ne lui en parlerai pas…
— Avec Sandoval ou le père Cordova.
— À personne au monde, je te le jure. Toi seul es mon ami, mon véritable ami.
En effet, et comme cela arrive toujours en pareil cas, le roi ne pouvait plus quitter le duc d’Uzède, son confident, le seul avec lequel il lui fût permis de parler de sa passion ; car déjà c’en était une, et les obstacles devaient l’irriter encore.
L’absence du roi, qui s’était égaré à la chasse dans la forêt de Médina, fut pendant deux jours le sujet de toutes les conversations, puis on n’y pensa plus, et d’autres événements vinrent occuper la cour.
Dès le lendemain, la duchesse, qui était rétablie de son indisposition, se hâta d’interroger Carmen, et celle-ci raconta de son mieux les détails de la soirée qu’elle était censée avoir passée avec le seigneur don Augustin de Villa-Flor.
Vu le manque d’habitude, elle n’avait pu mentir aussi complétement sans se troubler et sans rougir un peu, ce qui parut à la comtesse d’un favorable augure.
— Tu l’as donc trouvé fort aimable ?
— Mais oui ! j’ai surtout admiré, dit Carmen en se rappelant le récit d’Aïxa, sa franchise, sa bonhomie et sa timidité.
— Il t’a embrassée cependant.
— Je n’ai pas cru devoir le refuser au seigneur don Augustin, notre cousin.
— Tu as bien fait… très-bien, certainement.
— Et lui… comment t’a-t-il trouvée ?
— Ah ! je n’en sais rien !
On annonça en ce moment la visite du duc d’Uzède. Carmen se retira, enchantée de ce bon hasard qui mettait un terme aux questions assez embarrassantes de sa tante.
Le confident du roi venait annoncer à la comtesse le merveilleux effet produit par la visite de la veille. Le roi était amoureux !
C’était tout ce que demandaient les conjurés.
Il fallait maintenant ménager avec art les retards et les refus, assez pour augmenter cet amour, pas assez cependant pour le décourager, et en attendant l’exploiter à leur profit et en tirer contre leurs ennemis tout le parti possible. Il fallait, surtout dans le commencement d’une pareille intrigue, éviter de donner des soupçons au duc de Lerma, jusqu’au jour où l’ascendant de la favorite serait assez assuré pour n’avoir rien à craindre.
Le roi demandait avec instance une seconde entrevue. Ce n’était pas possible. Il était nécessaire d’y préparer Carmen ; la comtesse s’en serait bien chargée ; mais une sortie du roi, une nouvelle absence, serait remarquée, surtout à Valladolid : un roi ne se perd pas tous les jours. Il fut donc décidé qu’on attendrait le retour à Madrid, et l’impatience du roi fit tellement hâter le départ, que, la semaine suivante, Sa Majesté se trouvait réinstallée dans sa capitale, et la comtesse d’Altamira dans son hôtel.
Les instances du roi recommencèrent auprès du duc d’Uzède, qui, selon lui, ne menait pas cette affaire assez vivement, et cependant le duc prétendait avoir déjà fait un pas immense, car il avait, disait-il, mis dans ses intérêts la tante de Carmen. Et le monarque, dans l’effusion de sa reconnaissance, cherchait les moyens de s’acquitter envers la comtesse, décidé à ne rien lui refuser de ce qu’elle demanderait.
Il était impossible de s’exécuter de meilleure grâce ; le roi, en échange, n’exigeait qu’une faveur, c’était de revoir Carmen avec sa tante, de loin, à la promenade ; il promettait, si on l’exigeait, de ne pas lui parler ; il ne voulait que la voir, mais il le voulait, et l’on ne pouvait le refuser.
Le conseil s’assembla à l’hôtel d’Altamira, et cette fois les révérends pères Jérôme et Escobar y assistaient.
Escobar et Jérôme étaient déjà au fait de la tournure favorable que prenait la conspiration, mais on avait besoin de leurs conseils et du secours de leurs lumières sur la marche à suivre.
Le roi demandait à voir Carmen, sans lui parler, sans même que celle-ci s’en doutât. Rien de plus innocent et de plus facile. Fallait-il y consentir ?
— C’est mon avis, dit le duc d’Uzède.
— Ce n’est pas le mien, répondit le père Jérôme.
— Je suis de l’opinion du révérend, dit Escobar. Quand on veut aller vite, il faut attendre ; moins nous avancerons, plus le roi viendra à nous.
— Il ne faut rien accorder qu’avec des garanties, ajouta Jérôme, c’est plus sûr. Le roi peut changer, les garanties restent.
— Eh bien ! dit la comtesse, que demanderons-nous ? nous n’avons qu’à choisir, Sa Majesté accepte d’avance.
— Si j’exigeais qu’on me nommât du conseil privé ! s’écria d’Uzède, je vous tiendrais au courant de toutes les délibérations.
— Si je réclamais la place de la duchesse de Candia, celle de la camariera mayor ? dit avec bonhomie la comtesse, je serais toujours là à la cour pour vous servir.
Le père Jérôme haussa les épaules de pitié, et répondit gravement :
— Dans une affaire aussi importante, aussi majeure, il ne faut pas songer aux intérêts particuliers ; ils trouveront plus tard leur place ; l’essentiel, c’est de voir les choses de haut, de penser à l’avenir, et si nous ne voulons pas voir nos espérances promptement renversées, de bâtir non sur le sable, mais sur le granit.
Escobar approuva de la tête.
— Quel est le point de la question ? Quels sont nos véritables ennemis ? continua le révérend père : ce sont les dominicains, c’est l’inquisition, car le duc de Lerma lui-même n’existe que par l’appui de son frère, le grand inquisiteur.
— Il faut donc élever et fortifier le seul ordre qui puisse tenir tête à l’inquisition, s’opposer à ses envahissements et défendre vos intérêts comme les siens. Cet ordre, c’est le nôtre, et il va être détruit si l’on place, comme le veut Sandoval, un moine qui lui est dévoué, à la tête de la communauté d’Alcala de Hénarès ; le péril est imminent.
— Il n’est que trop vrai, dit Escobar avec un soupir, c’en est fait de l’ordre, qui cependant vous eût prêté en tout temps son appui…
— C’en est fait de nous-mêmes ! qui serons obligés de quitter l’Espagne.
— Nous ne le souffrirons pas ! dit la comtesse.
— Que faut-il faire pour l’empêcher ? dit le duc d’Uzède.
— Demander au roi de nommer pour abbé, pour supérieur du couvent d’Alcala de Hénarès, un révérend père jésuite.
— Et lequel ? demanda le duc.
— Peu importe, répondit le père Jérôme d’un air détaché, pourvu qu’il ait de la foi et un zèle aveugle pour nos intérêts.
— Il me semble alors, dit Escobar d’un air paterne, que nul ne réunit à un plus haut degré que le révérend, toutes les qualités requises.
— C’est juste, répondit la comtesse ; et le duc fut de son avis.
— Je n’accepterais, s’écria le révérend, qu’à une condition, à une seule, sine qua non.
— Faites-nous-la connaître.
— C’est qu’on nommerait notre frère Escobar à la place de prieur du couvent et en même temps à celle de recteur de l’université de Hénarès, où il peut nous rendre les plus grands services.
— Comment cela ?
— Par son influence sur les fils des premières maisons de Madrid, qu’on envoie à Alcala.
— Je comprends bien, dit la comtesse ; mais dans l’esprit du roi quel rapport cela peut-il avoir avec Carmen ?
— Un très-grand, très-intime, répondit Escobar d’une voix douce et en baissant les yeux. On peut avoir besoin très-incessamment de diriger vers un but essentiellement monarchique les idées et la conscience de la senora Carmen, et alors quoi de plus avantageux pour Sa Majesté que de pouvoir compter sur le père Jérôme et le frère Escobar, l’un directeur, l’autre confesseur de votre nièce !
— Admirable de raisonnement ! s’écria la comtesse.
— Je crois seulement, dit Escobar avec modestie, que l’argument n’est point dépourvu de justesse.
Le duc d’Uzède ne manqua point de le faire valoir auprès du roi, en donnant à entendre qu’après cela il n’y aurait aucun obstacle à la promenade du lendemain.
— Escobar ! dit le roi en écrivant les noms qu’on lui dictait, n’est-ce pas ce moine que nous rencontrâmes dernièrement ?
— Je crois que oui, sire.
— Celui qui raisonne si habilement et tire des conséquences si imprévues… et si commodes !
— Oui, sire… vous lui avez promis votre royale protection.
— Et nous la lui devons, c’est un homme de talent ! et nous le nommerons, dites-vous…
— Prieur du couvent et recteur de l’université…
— C’est bien… il apprendra à raisonner à la jeunesse !
— Qui déraisonne si souvent, dit le duc en se mettant à rire.
Et le roi l’imita, comme si la plaisanterie eût été excellente ; le duc était en faveur !
Mais le lendemain la rumeur fut grande à l’hôtel du duc de Lerma et au palais de l’inquisition. Le roi, sans consulter personne, pas même son ministre, avait signé lui-même la nomination du père Jérôme comme abbé supérieur de la communauté d’Hénarès ; et un moine inconnu, nommé Escobar, avait été élevé à la dignité de prieur !
Le ministre se rendit chez le roi pour lui demander l’explication d’une pareille conduite.
— Est-ce que c’est important ? dit le roi d’un air très-calme.
— Oui, sire, à ce que prétend le grand inquisiteur.
— Tant pis ! dit le roi… Je m’ennuyais… Je n’avais rien à signer ; et puis je me rappelle maintenant, c’est pour vous ce que j’en ai fait.
— Pour moi, sire ?
— Oui, j’ai cru voir, au carême dernier, que vous aviez peu de plaisir à l’entendre prêcher.
— C’est vrai, je n’aime pas sa manière.
— En le nommant supérieur du couvent d’Hénarès… une place qui l’oblige à la résidence, il ne prêchera plus à la cour, vous en voilà délivré ; vous voyez que j’ai agi dans vos intérêts.
— Mais, sire, c’est une très-considérable et très-riche abbaye…
— Quand un roi donne, il doit donner… en roi.
— Si au moins Votre Majesté avait daigné me consulter…
— Je réparerai mes torts, mon cher duc, dit le roi gaiement. Le régiment des gardes wallonnes est vacant… voyons ? qui nommerons-nous ?
— Mais, sire, dit le duc, un peu embarrassé.
L’huissier de la chambre du roi annonça en ce moment le marquis de Pombal, colonel des gardes wallonnes.
— Ah ! dit le roi étonné… ce régiment vacant…
— Pardon, sire, j’ai cru pouvoir en disposer.
— Sans me consulter ! dit le roi d’un air piqué et en se mordant les lèvres ; il pensa dans ce moment à ce que lui avait dit Aïxa, et pour la première fois peut-être il allait se fâcher contre son ministre, mais c’était ce jour-là, dans quelques heures, qu’il devait voir celle qu’il aimait ; le bonheur rend indulgent ! le roi n’avait ni le cœur ni le temps de se mettre en colère.
Il regarda seulement son ministre d’un air joyeux et ironique, et lui dit :
— Ah ! monsieur le duc, je ne suis point exigeant ! partageons. Je vous laisse les colonels, laissez-moi les abbés !
C’est tout ce que le ministre put obtenir de renseignements sur cette affaire. Ce qui l’effrayait encore plus, c’était l’air leste et dégagé de Sa Majesté, et surtout ce ton ironique que le souverain ne s’était jamais permis avec lui.
Il confia ses craintes à son frère Sandoval, qui lui-même ne laissait pas d’être soucieux.
La veille, le roi avait fait venir fray Ambrosio, attaché au secrétariat de l’inquisition, et lui avait ordonné de vérifier si un nommé Piquillo d’Alliaga n’était pas enfermé dans les prisons du saint-office ; demande, du reste, sans importance, mais qui prouvait que dans ce moment le roi avait la manie inquiétante de s’occuper, de s’informer, et surtout de donner lui-même des places dont le ministre comptait disposer. Toutes ces innovations agitaient le duc de Lerma à un tel point qu’il ne put s’empêcher de dire au duc d’Uzède, son fils :
— Vous ne quittez point Sa Majesté, savez-vous, mon fils, ce qui lui est arrivé ? n’avez-vous pas remarqué quelque chose de nouveau ?
— Rien, mon père, répondit froidement le traître.
Et il alla rejoindre son souverain, qui se préparait à sortir incognito pour la promenade.
C’était une froide mais superbe journée d’automne.
Le soleil, qui depuis longtemps ne s’était pas montré, dardait ce jour-là ses rayons. Toute la belle société s’était donné rendez-vous à Buen-Retiro, résidence royale qui occupe, avec ses jardins, une grande étendue dans la partie orientale de Madrid. Buen-Retiro était alors la promenade plus particulièrement fréquentée par les personnes de la cour, comme le Prado l’était par les bourgeois de la ville. Là, les nobles dames étalaient leurs riches toilettes, et les élégants d’alors venaient se montrer avec leurs barbes pointues, le feutre à longs poils sur l’oreille, le pourpoint serré, le large haut-de-chausses à demi détaché et la fraise à la confusion.
C’était l’Espagne qui, pour les modes et l’élégance, donnait le ton à toute l’Europe. La France, qui depuis a pris sa revanche, s’empressait alors d’adopter et d’imiter tout ce qui venait de Madrid. C’était à Buen-Retiro que se donnaient tous les rendez-vous galants, que se lançaient toutes les coquettes œillades, que se glissaient tous les billets doux qui n’avaient pu être échangés, le matin, à l’église Saint-Isidore ou Sainte-Isabelle.
Depuis leur retour à Madrid, Carmen et Aïxa n’étaient presque point sorties, et par cette belle matinée, par ce beau soleil, la comtesse d’Altamira n’eut point de peine à décider sa nièce à prendre l’air et à aller se promener à Buen-Retiro.
Carmen accepta sur-le-champ pour elle et pour Aïxa, et après vêpres le carrosse de la comtesse conduisit les trois dames dans le palais du roi, dont les jardins servaient de promenade publique. Il était trois heures à peu près quand elles arrivèrent.
Deux hommes étaient arrêtés dans les allées latérales. Le froid qu’il faisait, ce jour-là, et surtout le désir de ne pas être reconnus, les avaient fait s’envelopper de larges manteaux. Un sombrero élégant retombait sur leur front et les cachait jusqu’aux yeux.
Depuis longtemps le plus jeune des deux cavaliers semblait attendre avec une vive impatience. Voyant enfin ces dames descendre de carrosse, il ne put maitriser un léger cri de joie que son compagnon se hâta de réprimer ; mais son trouble et son émotion furent tels, qu’il s’appuya contre un des arbres antiques derrière lesquels ils étaient abrités et qui formaient un des plus beaux ornements de la promenade.
La comtesse et les deux jeunes filles s’avancèrent dans l’allée du milieu, celle où se pressait la foule des promeneurs, et furent bientôt l’objet de tous les regards. La noble dame ne perdait point de vue les deux cavaliers, enveloppés de manteaux, qui les suivaient assidûment et de loin dans les allées latérales ; quant aux jeunes filles, elles ne se doutaient de rien, occupées du spectacle mouvant qui s’offrait à leurs yeux.
Plusieurs fois, se dégageant de la foule, la comtesse se rapprocha du bord de l’allée. Il y eut un moment où la mantille d’Aïxa effleura presque le manteau d’un des cavaliers ; un groupe de promeneurs les sépara.
Depuis l’arrivée des dames, le roi n’avait pas adressé un mot au duc d’Uzède ; l’émotion l’empêchait de parler ; il regardait et suivait tous les mouvements, tous les gestes d’Aïxa ; il éprouvait un ravissement inconnu auquel le mystère ajoutait un nouveau charme. Heureux de la contempler de loin, ce bonheur lui suffit d’abord ; mais bientôt entraîné par un mouvement fébrile, par une agitation involontaire, il chercha à se rapprocher d’elle.
Une fois entre autres, et sans savoir ni ce qu’il faisait ni ce qu’il voulait, il s’élança témérairement dans la foule, et le duc d’Uzède, qu’il n’avait point prévenu, s’aperçut que son compagnon n’était plus près de lui. Il s’efforça de le rejoindre ; le roi, s’avançant, toujours n’était plus qu’à deux pas d’Aïxa ; il allait lui parler et se compromettre, se faire reconnaître sans doute au milieu de tout ce monde composé de personnes de la cour.
Par malheur, ou plutôt par bonheur pour Sa Majesté, le marquis de Miranda, président de l’audience de Castille, venait dans un sens opposé et s’était rencontré dans la foule avec la comtesse d’Altamira. Il la saluait et s’informait de ses nouvelles au moment où le roi arriva derrière elle.
À la vue du marquis, le monarque, troublé et rappelé à lui-même, enfonça plus que jamais son manteau sur ses yeux ; tout interdit et étonné de sa hardiesse, il recula quelques pas, et se sentit saisir rudement par le bras : c’était le duc d’Uzède, qui l’avait enfin rejoint et retrouvé, et qui jurait de ne plus le quitter.
Effrayé pour son propre compte de l’imprudence que le roi avait manqué de commettre, il l’aida à sortir de la foule, le reconduisit au palais, qui n’était qu’à deux pas, le laissa sur les premières marches de l’escalier dérobé qui menait au cabinet du roi, et sans écouter les réclamations ni les prières du monarque désolé, s’enfuit, craignant d’être rencontré lui-même par le duc de Lerma, son père.
Mais le roi, quoique abandonné de son timide et prudent compagnon, n’avait nulle envie de rentrer chez lui. Ce n’était plus le même homme. Il voulait à toutes forces voir encore Aïxa et lui parler, et à peine le duc se fut-il éloigné, que, redescendant les marches du petit escalier, il se trouva dans les jardins de Buen Retiro.
Les jours sont courts en automne. Le soleil venait de disparaître, le crépuscule arrivait, le roi n’en fut que plus rassuré. Mais craignant de ne plus rencontrer et reconnaître celle qu’il cherchait dans la foule de dames qui déjà quittaient la promenade, il n’hésita pas un instant, et se dirigea intrépidement vers l’hôtel d’Altamira.
Il était nuit quand le carrosse de la comtesse rentra.
La comtesse descendit d’abord, puis Carmen ; Aïxa, embarrassée dans sa mantille, resta dans la voiture quelques instants après elles. Elle s’apprêtait à les suivre et à monter le grand escalier de l’hôtel, quand un homme enveloppé d’un manteau lui prit la main. Elle allait crier ; il lui fit signe de se taire et ôta respectueusement son chapeau.
— Don Augustin ! dit-elle.
— Lui-même, senora.
— Que je croyais à Burgos.
— Revenu pour vous, pour vous servir.
Il lui glissa dans la main un petit papier, lui recommanda de nouveau le silence et disparut.
Aïxa, fort étonnée, monta à la chambre de Carmen, et lui raconta ce qui venait de lui arriver.
— Voyons, dit Carmen, voyons avant tout le billet.
— Le devons-nous ?…
— Sans doute !… d’abord il n’est pas cacheté. Elle l’ouvrit et lut ces mots :
« Ma cousine, Piquillo d’Alliaga n’est pas dans les prisons de l’inquisition, sans cela il serait déjà libre. Usez de moi et de mon crédit ; si je peux vous servir et vous prouver mon affection, le plus heureux des hommes sera
— C’est singulier ! dit Carmen.
— Oui, singulier et original… comme lui ! répondit Aïxa. Mais il y a là une simplicité et une franchise qui me plaisent, sans compter qu’il m’a rendu, et bien promptement, le service que je lui demandais.
— Écoute-moi, dit Carmen en secouant la tête, j’ai une idée !
— Laquelle ?
— C’est que notre cousin Augustin est amoureux de toi.
— Allons donc ! il m’a à peine vue une soirée !
— Il n’en faut pas tant… un mot et un regard de toi ont bien du pouvoir.
— Y penses-tu ? dit Aïxa en riant. Voilà une phrase…
— Qui n’est pas de moi… elle est de don Fernand, et Fernand s’y connaît.
— Vous vous trompez tous deux, dit Aïxa en rougissant, car don Augustin est marié !
— C’est différent, dit Carmen naïvement, je n’y pensais plus.
Il fallait bien, à moins d’avouer toute la vérité à la comtesse, ne pas lui parler de cette lettre, qui d’ailleurs n’intéressait que Piquillo. C’est le parti que prit Aïxa.
Seulement, quand Juanita, la camariera de la reine, vint la voir, elle lui montra ce billet, et Juanita s’empressa d’écrire à Pedralvi, son ami : « Le pauvre Piquillo n’est point dans les prisons de l’inquisition, nous en sommes certaines. Où donc peut-il être ? Cherche bien, Pedralvi. »
Et Pedralvi, au reçu de cette lettre, se remit de nouveau en campagne.
Le roi cependant était rentré au palais sans danger, sans encombre, et enchanté de son audace ; mais depuis qu’il avait revu Aïxa, qu’il lui avait parlé, qu’il lui avait serré la main, rien n’égalait son impatience ; toute espèce de délai lui devenait insupportable.
Le roi, qui jusque-là n’avait jamais eu de volontés, en avait une maintenant ferme et inébranlable ; il voulait plaire à Aïxa, il voulait s’en faire aimer, il voulait enfin qu’elle fût à lui, et, avec l’égoïsme ordinaire de l’amour, tout le reste lui était indifférent.
Vainement le duc d’Uzède s’efforçait de lui démontrer que pour amener une jeune fille, telle que Carmen, à écouter les vœux mêmes d’un roi, il fallait du temps et des précautions infinies ; que Sa Majesté devait s’en rapporter au zèle et au dévouement de la comtesse d’Altamira et du pieux Escobar, qui déjà employaient à cette œuvre tous leurs soins et leur adresse.
À tout cela le roi ne répondait rien, mais sans se l’expliquer, sans s’en rendre compte à lui-même, il était froissé et mécontent de tous les soins qu’on se donnait pour lui.
Il se rappelait la délicieuse soirée qu’il croyait avoir passée près de Carmen ; il lui semblait que s’il lui était seulement permis de la voir, il finirait par se faire aimer lui-même et sans l’aide de ses conseillers. Il aurait voulu, par une idée romanesque toute naturelle, ne pas se faire connaître pour le roi, et continuer, comme don Augustin, l’intrigue si heureusement commencée sous ce nom. Mais c’était impossible.
Il sentait bien qu’il fallait que Carmen apprît tôt ou tard la vérité. Alors pourquoi ne pas se hâter ? pourquoi ne pas présenter tout simplement la jeune fille à la cour ? La voir, lui parler tous les jours, c’est tout ce qu’il voulait, tout ce qu’il demandait. Pour le reste, l’amour-propre ou l’amour lui faisait croire à la réussite, et pour mettre à exécution ce dessein, il n’attendit pas plus longtemps que le soir même.
La comtesse était venue au cercle de la reine. Il l’avait emmenée dans l’embrasure d’une croisée et lui parlait à voix basse et avec chaleur. La comtesse pendant ce temps voyait les yeux inquiets du duc de Lerma épier toutes les paroles du roi, comme s’il eût pu les saisir et les entendre du regard.
Le roi s’exprimait avec une telle passion, le moment semblait si favorable, si décisif, que la comtesse, ne prenant conseil que d’elle-même, résolut de brusquer les événements. Il y a des occasions où l’audace est prudence ; il lui semblait d’ailleurs doublement piquant, pour son orgueil blessé et pour sa vengeance de femme, de préparer la chute du duc de Lerma, son ennemi mortel, en sa présence, devant lui ; et pendant que le ministre, furieux et inquiet, la menaçait de loin :
— Oui, sire, répondit-elle à demi-voix, je comprends bien ! Rien ne serait plus facile que de présenter ma nièce Carmen à la cour de Votre Majesté ; à coup sûr, la fille de don Juan d’Aguilar, vice-roi de Pampelune, a des droits à cette faveur autant qu’aucune autre noble dame d’Espagne ; mais c’est justement à cause de son nom et de sa naissance, que je ne veux point l’exposer aux inimitiés et aux intrigues dont elle serait l’objet.
— Que voulez-vous dire ?
— Qu’il y a ici, Votre Majesté ne l’ignore pas, un ennemi mortel à moi ! lequel deviendrait bientôt celui de ma nièce.
— Et qui donc, s’il vous plaît ?
— Que Votre Majesté veuille bien lever les yeux, elle le verra en face de nous, derrière le fauteuil de la reine, lançant sur moi et même sur Votre Majesté des regards où respirent la colère et la vengeance.
Le roi tourna les yeux dans la direction indiquée, et aperçut le duc de Lerma, qui rougit et pâlit tour à tour en voyant, à n’en pouvoir douter, qu’il était question de lui.
— Vous aviez raison, dit le roi, un peu inquiet et un peu effrayé lui-même de la frayeur de son ministre ; mais croyez bien que le duc m’est dévoué, qu’il m’aime, et que les objets de mon affection deviendraient bientôt pour lui…
— Des objets de jalousie et de haine ! Bientôt nous serions calomniées par lui près de Votre Majesté ; l’influence qu’il exerce nous serait fatale.
— Ne le croyez pas.
— Je le crois tellement que, pour rien au monde, je ne voudrais y exposer Carmen.
— Que dites-vous ?
— Qu’elle n’entrera dans ce palais que le jour où le duc n’y sera plus.
— Vous n’y pensez pas, madame la comtesse !
— Je vous jure, sire, que ce sera ainsi. Jusque-là, je vous demande en grâce qu’il ne soit question de rien entre nous et Votre Majesté.
— Silence ! dit le roi, car voici le duc qui vient à nous. Plus tard vous aurez ma réponse.
En effet, irrité, et impatienté d’une si longue conversation, dont il ne pouvait deviner le motif, car presque jamais le roi n’adressait la parole à la comtesse, le ministre, n’y pouvant plus tenir, s’avançait furieux et d’un air riant vers son souverain.
— Je vois Votre Majesté dans une discussion bien animée avec madame la comtesse.
Pâle et immobile, n’ayant ni assez de sang-froid pour cacher son trouble, ni assez d’habitude de la cour pour inventer à l’instant un mensonge agréable, le roi ne répondait rien, et se contentait de regarder les magnifiques rideaux de soie qui décoraient la croisée.
— Il m’a semblé, continua le ministre, que j’étais pour quelque chose dans la discussion… Est-ce une déclaration de guerre que nous faisait madame la comtesse ?
— Ah ! monsieur le duc, répondit celle-ci avec un calme admirable et le sourire sur les lèvres, voyez comme vous êtes injuste ! je pariais pour vous contre le roi !
— En vérité ! fit le ministre d’un air de doute.
— Sa Majesté prétendait, en regardant ces tentures, qu’elle regarde encore, que ce salon était la plus belle pièce du monde, et je soutenais, moi, en bravant pour vous, monsieur le duc, la colère de Sa Majesté, je pariais, Moi, que ce salon ne pouvait pas même entrer en comparaison avec le vestibule de votre château de Lerma.
— C’est vrai… c’est vrai ! dit vivement le roi, qui, pendant cette longue phrase, avait eu le temps de se remettre, et avait cessé de regarder les rideaux du salon ; c’est ce que me disait madame la comtesse.
— Et Votre Majesté pouvait le croire ?
— Pourquoi non, monsieur le duc ? dit le roi d’un air gracieux ; chacun assure que le château de Lerma est une des merveilles du monde.
— Est-ce dix-huit millions de réaux qu’il vous a coûtés ? demanda la comtesse.
— Est-il possible !
— Oui, sire, d’autres disent quinze seulement, mais à la cour on tend à tout déprécier, et je parierais, moi, pour dix-huit !
— Est-ce vrai ? demanda le roi étonné.
— Non, sire, loin de déprécier, on exagère. Je ne suis pas en état de déployer un pareil luxe. Un peu de goût, voilà tout ! et encore ai-je à peine le loisir de m’en occuper : les affaires me laissent si peu de temps !
— Justement ce que je disais, répliqua la comtesse en lançant au roi un regard significatif ; c’est vraiment bien dommage de ne pas habiter plus longtemps un si beau château.
Cette dernière phrase ne rassura pas le ministre ; au contraire, il connaissait l’audace de la comtesse, la faiblesse du roi, et sans savoir au juste quel danger le menaçait, il comprit qu’il y en avait un, et mit tout en œuvre dès ce moment pour le deviner et le déjouer.
Quand la reine disait au duc de Lerma : « Le roi vous subit parce que vous lui êtes nécessaire, mais il ne vous aime pas, il n’aime rien, » elle avait raison.
Mais il aimait alors, et c’est encore plus terrible. Le renvoi de son ministre qui, en toute autre occasion, l’aurait épouvanté, lui semblait alors tout naturel ; l’intérêt de son amour le voulait ; c’était le seul moyen d’avoir auprès de lui celle qu’il aimait.
Il avait répondu à la comtesse : « Plus tard vous aurez ma réponse. »
Mais cette réponse ne pouvait être douteuse, et la comtesse assembla son conseil pour lui faire part de l’heureuse situation de leurs affaires. D’Uzède, ravi, approuva tout ; le père Jérôme réfléchit sans rien dire, et Escobar, secouant la tête, trouva que, dans sa précipitation, la comtesse avait agi…
— Trop brusquement ! s’écria-t-elle.
— Non, trop franchement.
— Quel inconvénient, puisque je suis sûre de l’emporter !
— Puisque le succès est certain ! s’écria le duc.
— Alors, dit Escobar gravement, alors, monsieur le duc, si vous êtes sûr du succès, il y a pour vous et pour vos intérêts un parti à prendre sur-le-champ.
— Et lequel ?
Escobar s’arrêta, persuadé que le duc l’avait deviné ; mais voyant qu’il ne devinait rien, il ajouta froidement :
— C’est de prévenir votre père du complot.
— Y pensez-vous ! s’écrièrent à la fois Uzède et la comtesse en poussant un éclat de rire.
— Monsieur le recteur s’égare, dit le duc ; la joie de sa nouvelle place lui a fait perdre la raison.
Escobar le regarda d’un air où perçait une légère nuance de mépris, et il continua :
— Si vous tenez à la succession d’un homme que l’on dit plus riche que le roi d’Espagne ; si vous tenez à l’opinion de quelques personnes timorées qui se formaliseront peut-être de voir le père renversé par le fils, il faut que ce soit le duc de Lerma lui-même qui, forcé de quitter le pouvoir, vous force à le prendre, espérant ainsi le continuer en vous.
— Escobar a raison, dit le père Jérôme en contemplant le moine avec admiration.
— Voilà pour vos intérêts, continua Escobar du même ton, lentement et gravement. Voici maintenant pour les nôtres. En avertissant le ministre qu’il y a un complot contre lui, sans entrer dans aucun autre détail, vous ne lui servez à rien et vous conservez toute sa confiance. Il vous dira ce qu’il a fait, ou vous préviendra de ce qu’il compte faire ; il est toujours utile et loyal de connaître le plan de son ennemi ; quand on possède le secret de son adversaire, quand ce secret est connu de vous comme de lui, c’est ce que j’appelle combattre à armes égales.
Le père Jérôme se leva, prit la main d’Escobar qu’il serra en témoignage d’estime, et se retournant vers le duc, il lui dit :
— Croyez ses maximes et suivez-les.
— Quel dommage, mon père, dit la comtesse, que vous ne les réunissiez pas en un corps de volumes !
— Je m’en occupe, dit froidement Escobar, et je l’achèverai dans notre pieuse retraite d’Alcala d’Hénarès.
Uzède suivit l’avis d’Escobar. Il se rendit le lendemain de bon matin chez le duc de Lerma et le trouva prenant des mesures d’ordre pour un bal que le roi donnait le soir même à la cour.
— Qu’avez-vous donc, Uzède ? dit le ministre en lui voyant un air grave et sombre.
— Je crains, monseigneur, d’avoir de mauvaises nouvelles à vous annoncer, et je suis d’autant plus contrarié, que les appréhensions que j’éprouve ne reposent sur rien de réel et de positif. C’est un vague sentiment d’inquiétude, un instinct peut-être qui me fait craindre pour vous. Tenez-vous sur vos gardes… il y a quelque complot.
— Je le sais, dit à voix basse le ministre.
— En vérité ! dit Uzède avec terreur.
— Un complot de la comtesse d’Altamira.
— Ce n’est pas possible ! dit le fils coupable en pâlissant.
— Allons, mon fils, vous voilà tout pâle et tout défait… ne tremblez pas pour moi, et rassurez-vous… je sais tout… ou presque tout !
— Ah ! se dit le duc en lui-même, Escobar avait bien raison. La comtesse d’Altamira, poursuivit-il tout haut et en balbutiant, veut vous renverser… Quelques mots échappés hier soir au roi… me l’ont fait supposeïr ; voilà tout ce que j’ai pu découvrir.
— Et moi, je connais le reste. La comtesse veut donner au roi pour maîtresse sa nièce Carmen, la fille du loyal et brave don Juan d’Aguilar !… c’est indigne !
— C’est infâme ! dit Uzède en tremblant, mais elle ne pourra réussir.
— Elle y était parvenue ! elle demandait mon renvoi, et, ce que vous ne croirez jamais… car on ne peut se douter combien il y a d’ingratitude à la cour !… croiriez-vous, mon fils, s’écria-t-il en lui prenant la main, que le roi y consentait !
— Il a donné son consentement ? dit Uzède.
— Mieux encore ! il l’a signé. Je l’ai là dans ma poche, écrit de sa main.
— Voilà qui est bien singulier, balbutia Uzède, et comment avez-vous eu le talent… et l’habileté…
— Rien de plus simple !… Le roi n’écrit jamais… Hier, une lettre de sa main, adressée à la comtesse d’Altamira, a été envoyée…
— Comment le savez-vous ?
— Par le valet de confiance chargé de la remettre et qui me l’a apportée. Depuis deux jours, mon fils, le roi est environné d’espions, et ne fait pas un seul pas dont on ne me rende compte.
— Mais songez que c’est vous exposer…
— À quoi ?
— Il y va de la tête !
— Mais de l’autre côté… il y va du pouvoir !
— Et pour le conserver, vous sacrifieriez…
— Tout au monde… tout ! dit-il avec un accent qui fit trembler Uzède, à commencer par moi !
— Et cette lettre… que disait-elle ?
— La voici, dit le ministre, elle n’est pas longue.
Il la tira de sa poche et lut :
« Madame la comtesse, je n’ai point oublié notre dernière conversation ; si, pour vous convaincre de mon amour, si, pour obtenir celui de votre nièce, il ne faut que le sacrifice exigé par vous, je tiendrai ma parole. Mais vous tiendrez d’abord la vôtre. Il y a demain un grand bal à la cour ; jusque-là, et comme je vous l’ai promis, je ne ferai aucune tentative pour vous voir, mais vous, vous viendrez à ce bal, vous amènerez la charmante Carmen, et le lendemain, ainsi que vous le désirez, son ennemi et le vôtre ne sera plus au palais ; c’est à elle seule désormais à y régner. »
On comprend pourquoi le roi n’avait point parlé de cette lettre au duc d’Uzède, son confident.
Il y était question de la disgrâce et de la chute du premier ministre, et il ne pouvait venir à l’idée du roi, à l’idée de personne, que le fils fût d’accord avec la comtesse pour renverser son père.
— Eh bien ! mon fils, dit le ministre en froissant la lettre, qu’en pensez-vous ? est-ce assez clair ?
— Très-clair… et comment espérez-vous déjouer cette trame ?
De la manière la plus simple. Je garde cette lettre. La comtesse ne la recevant point et ignorant ce qu’elle contient, n’amènera pas ce soir sa nièce à ce bal. Je connais le caractère du roi, et je vois sa fureur.
Tout entier, comme les hommes faibles, à l’impétuosité du premier moment, il se croira joué, trompé ; nous y aiderons s’il le faut… le reste nous regarde. C’est à nous de profiter de ce premier moment, et pour éviter les explications, nous éloignerons dès demain la comtesse et sa nièce.
— Par quels moyens ?
— Ne vous inquiétez pas, vous dis-je. Sandoval et moi nous nous chargeons de tout, et en cas de besoin nous aurions pour nous la reine, auprès de qui cette lettre ne nous serait pas inutile ; mais c’est le dernier moyen, et il faut, s’il est possible, n’y point avoir recours. Il suffit pour nous que Carmen ne soit pas présentée à la cour et ne vienne pas ce soir au bal.
— Ô Escobar, dit à part lui Uzède, tu avais bien raison !
Encore tout effrayé de ce qu’il venait d’entendre, il courut chez la comtesse et lui apprit tout. Il n’y avait pas de temps à perdre.
On était au milieu de la journée ; on avait à peine le temps nécessaire pour préparer les costumes de bal, et tous ces apprêts devaient se faire en silence et dans le plus grand mystère, pour laisser l’ennemi dans la sécurité et dans la confiance de son triomphe.
La comtesse se rendit d’abord chez Carmen.
— Ma nièce, lui dit-elle, que cela vous plaise ou non, le temps de votre deuil est expiré depuis longtemps, il faut vous décider à paraître ce soir à la cour et à aller au bal.
— Moi, ma tante ! s’écria Carmen interdite.
— Le roi le veut, le roi l’exige, il vient de me le faire dire par un page qu’il m’a envoyé exprès ; il veut que la fille de don Juan d’Aguilar lui soit présentée ce soir, à lui et à la reine.
— D’où vient une invitation si prompte, si extraordinaire ! et pour quel motif ?
— Le roi le veut, ma nièce, il n’y a rien à répondre cela.
La pauvre Carmen, désolée, vint raconter à Aïxa toutes ses douleurs. Aller à la cour pour la première fois, et sans Fernand d’Albayda, lui semblait, disait-elle, une chose absurde ; elle avait compté n’être présentée qu’après son mariage.
— À coup sûr, c’eût été bien mieux, dit Aïxa en soupirant. Mais cependant à ton âge quelques heures passées au bal ne sont pas un si grand supplice, qu’il faille pour cela désobéir à son roi. L’as-tu déjà vu ?
— Jamais, et cela me fait peur.
— On dit la reine si bonne, si affable ! elle te protégera.
— Si encore tu pouvais, Aïxa, y venir avec moi !
— Cela est impossible ! Moi, grâce au ciel, je ne suis pas invitée, mais j’aurai du moins un plaisir
— Lequel ?
— Celui de te faire belle et de m’occuper de ta toilette.
— Justement !… je n’ai rien de frais… ni d’élégant, ni de riche.
— N’est-ce que cela ? dit Aïxa, sois tranquille ! aucune de ces belles dames ne t’éclipsera.
L’heure venait de sonner, heure importante, heure décisive, et la comtesse, comme un général qui va livrer un combat d’où dépendent sa fortune et sa renommée, éprouvait déjà ce qu’on nomme l’émotion du champ de bataille.
Elle tremblait maintenant que sa nièce ne fût pas assez brillante, assez séduisante. Le roi l’aimait, mais cela ne suffisait pas ; il fallait que cet amour fût légitimé et doublé par l’admiration de tous.
Inquiète et impatiente, elle allait monter dans la chambre de Carmen, quand elle la vit descendre dans le salon. Elle portait une robe du tissu le plus précieux, et sa tête, ses bras, sa poitrine, étincelaient de diamants.
La comtesse poussa un cri d’admiration.
— D’où te vient donc cette riche parure ? dit-elle en tremblant de joie.
Le roi pouvait seul en donner une pareille, et elle eut un instant l’idée qu’elle avait été envoyée par lui.
— De qui elle me vient ? dit Carmen, presque honteuse de sa beauté… c’est Aïxa qui me l’a prêtée.
— Donnée ! s’écria celle-ci en l’embrassant. Je te la destinais pour le jour de tes noces. Il vaut mieux que ce soit pour aujourd’hui. Le roi t’en saura gré, et don Fernand n’en a pas besoin. Il t’aimera sans cela.
— Quoi ! dit la comtesse stupéfaite et admirant les diamants, qui étaient de la plus belle eau et d’une valeur inappréciable, vous aviez, senora Aïxa, cette parure de reine ?… Et où donc ?
— Dans un tiroir où elle ne me servait à rien… Voici la première fois qu’elle m’aura fait plaisir.
Et se mirant dans son amie comme dans une glace :
— Voyez, madame, s’écria-t-elle avec fierté, voyez comme Carmen est belle !
En ce moment, on vint annoncer que la voiture était prête.
La comtesse porta la main à son cœur, et son émotion fut si vive qu’elle chancela.
— Qu’avez-vous donc, ma tante ? dit, en la soulevant, la pauvre Carmen, qui ne voyait dans ce plaisir qu’un chagrin, celui de quitter Aïxa.
— Rien !… je n’ai rien, ma nièce, dit l’ambitieuse comtesse… Allons, s’écria-t-elle en se levant, le sort en est jeté !
Carmen et sa tante montèrent en voiture : l’une calme, indifférente, paisible ; l’autre agitée par la crainte et par l’espérance, et à peine si on entendit quand elle cria au cocher d’une voix étouffée :

lui a fait perdre la raison.
— Au palais du roi !
Les appartements resplendissaient de lumières et de l’éclat des parures. Toutes les premières familles étaient là rivalisant de luxe, d’élégance et de brillants insignes. Une foule dorée se pressait dans les vastes et spacieux salons de Buen-Retiro.
La reine, douce et mélancolique comme à l’ordinaire, semblait se résigner au plaisir qui lui était imposé. Elle aussi regrettait sa retraite, et eût préféré, pendant cette bruyante soirée, demeurer dans son oratoire, à lire, à prier, à penser peut-être.
Persuadée que tous ceux qui venaient au palais étaient aussi malheureux qu’elle, elle les accueillait avec une bonté pleine de compassion ; elle croyait leur devoir de la reconnaissance pour l’ennui qu’ils venaient chercher.
Le duc de Lerma, fier et la tête haute, distribuant les saluts et les sourires protecteurs, parcourait les salons, redoublait de zèle et de prévenance pour ses amis, dont il semblait vouloir s’entourer et se faire un rempart. Mais tout en parlant de l’éclat du bal, de l’animation de la danse et de mille autres futilités, tout en adressant aux dames de gracieux compliments sur leur beauté ou, faute de mieux, sur leur toilette, le ministre ne perdait pas de vue son souverain, et observait tous ses mouvements.
Quant au roi, il était dans une situation de corps et d’esprit qui excitait un étonnement général. Il avait l’air de s’amuser, ou du moins de prendre part à tout ce qui l’environnait.
Au lieu de rester dans son immobilité et dans son silence ordinaires, il se levait, marchait, parcourait toutes les salles. On aurait dit qu’il prenait plaisir au bruit, à la foule, aux sons de la musique ; il souriait d’un air satisfait et joyeux ; il adressa même deux ou trois fois la parole à ceux qui approchaient.
Jamais le roi n’avait eu tant de grâce dans l’esprit et la conversation.
— Il fait bien chaud, n’est-il pas vrai, messeigneurs ? — Voilà une belle soirée. — Bonsoir, duc. — Bonsoir, comte. — Bonsoir, monsieur l’ambassadeur ; — et autres phrases toutes faites à l’usage des princes qui reçoivent.
Mais une demi-heure après, la figure du roi n’était plus la même ; on lisait sur ses traits de l’impatience et de l’inquiétude.
Il ne parlait plus, mais il regardait d’un air soucieux ; il parcourait tous les salons, et s’arrêtait de préférence dans le premier, dans celui par lequel on arrivait, et à chaque instant ses yeux se tournaient vers l’horloge de la grande salle. Hélas ! ce qu’éprouvait le roi se manifestait chez lui par les mêmes symptômes que chez le dernier de ses sujets. Il aimait et il attendait.
Le ministre s’était rapproché de lui et ne le quittait point du regard. S’appuyant sur le bras du duc d’Uzède, son fils, il disait à celui-ci à voix basse et en souriant : « Voyez-vous le roi ? son trouble et son inquiétude commencent déjà et bientôt ne feront qu’augmenter ; car il attendra toute la nuit et ne verra rien venir…
— C’est curieux ! répondit Uzède en essayant de sourire.
— C’est délicieux ! répliqua le ministre dans toute la joie de son cœur.
Tout à coup il tressaillit et crut avoir mal entendu ; la voix stridente d’un huissier du palais venait de proférer à haute voix ces paroles :
— Madame la comtesse d’Altamira et la senora Carmen d’Aguilar !
La foudre tombant sur le duc de Lerma n’aurait pas produit un effet plus terrible.
Le pauvre ministre, atterré, anéanti, ne pouvant rien comprendre à un coup de théâtre aussi imprévu, aussi fatal, sentit toute sa présence d’esprit l’abandonner ; il chancela, et, s’appuyant dans sa détresse sur le bras qui aurait dû le soutenir et qui venait de le renverser, il murmura à demi-voix ces mots : Tout est perdu, mon fils !
Les paroles foudroyantes de l’huissier avaient produit un effet tout contraire sur le roi ; quoiqu’il fût alors dans le salon voisin, son oreille attentive n’en avait pas perdu une syllabe. Un éclair de plaisir brilla dans ses yeux assombris, il sentit son cœur oppressé se dilater et bondir de joie ; et, le sourire sur les lèvres, il se dirigea vers le premier salon pour faire une gracieuse et royale réception aux deux nobles dames qu’on venait d’annoncer.
La foule qui s’était ouverte à l’entrée de la comtesse et de sa nièce, celle qui venait de s’ouvrir pour le passage du roi, le murmure flatteur qu’avaient excité la beauté et la parure éblouissante de Carmen, tout avait détourné l’attention ; personne, excepté le duc d’Uzède, n’avait pu voir le trouble du ministre, et le roi, quoique frémissant de plaisir, s’avançait d’un pas ferme vers la comtesse et sa nièce.
Elles venaient de s’incliner et de saluer le souverain par leur plus belle et leur plus respectueuse révérence ; mais, à la grande surprise de la comtesse, au moment où le roi présentait la main à Carmen, au moment où ses yeux rencontraient ceux de la jeune fille, il changea de couleur et se trouva mal, en murmurant à peine ces mots :
— Ce n’est pas elle !
Ils ne furent entendus que de la comtesse, du duc d’Uzède et du duc de Lerma, qui s’étaient déjà précipités autour du monarque ; et le ministre, retrouvant tout son sang-froid, s’écria à voix haute :
— La chaleur… Messieurs… la chaleur a sans doute incommodé Sa Majesté. Ouvrez des fenêtres… ou plutôt sortons le roi de cette pièce. Ce ne sera rien, madame, dit-il à la reine, qui s’avançait effrayée. Que Votre Majesté se rassure : je vais suivre le roi et ne le quitterai pas.
Puis se penchant vers le duc d’Uzède, il lui dit à voix basse :
— Rien n’est perdu, mon fils !
Il sortit joyeux et triomphant.
D’Uzède n’y comprenait rien ; la comtesse était anéantie, et Carmen, regardant tranquillement autour d’elle, admirait les danses qui venaient de recommencer.
XXXV.
changement de front.
Fidèle à la promesse qu’il venait de faire à la reine, le duc de Lerma, dans son zèle intéressé, ne quitta point le roi.
Il s’installa près de son lit, pendant que les gens de service remplissaient la chambre ; mais, fidèles à l’étiquette, ceux-ci se tenaient tous à distance, et personne n’eût osé porter de secours au roi avant qu’on eût prévenu le premier médecin de la cour, le seigneur Enrique Galiano, qui était dans un des derniers salons, occupé à regarder danser sa femme.
Avant qu’il n’arrivât, le duc se pencha vers le roi, qui proférait à demi-voix quelques paroles entrecoupées et inintelligibles pour tout autre :
— Oui, oui… la promenade de Buen-Retiro… Non, à l’hôtel d’Altamira. Courez, Vous la trouverez… Je l’ai vue… Je lui ai parlé… Qu’elle vienne, je le veux ! Moi, moi, moi le roi !
Le seigneur Enrique Galiano arriva dans ce moment.
Il lui fut facile de faire revenir le roi qui, un instant plus tard, serait revenu de lui-même. Il défendit à Sa Majesté de rentrer dans la salle du bal, et lui prescrivit de se coucher à l’instant, vu que le pouls royal annonçait un mouvement fébrile assez prononcé.
De plus, après en avoir conféré avec le ministre, à qui il devait sa place, le docteur défendit que personne du dehors, personne de la cour ne pénétrât dans la chambre du roi, excepté, bien entendu, le ministre, qui avait toujours à parler à Sa Majesté pour les affaires du royaume.
Le duc de Lerma en avait assez entendu pour savoir aisément le reste.
Aussi, dès le lendemain de bon matin, il était chez le duc d’Uzède, son fils, qui tressaillit à son entrée, mais qui se rassura en voyant sa figure radieuse.
— Je sais tout, lui dit-il ; il y a dans la maison de la comtesse une jeune fille, compagne de sa nièce et nommée Aïxa. Une jeune orpheline, fille d’un officier tué en Irlande, et élevée par les soins de feu don Juan d’Aguilar ; c’est d’elle que le roi est épris.
— Ce n’est pas possible ! s’écria d’Uzède stupéfait, qui croyait tout savoir, et qui, pas plus que la comtesse, ne se doutait de la vérité. Comment cela serait-il arrivé ?
— Je l’ignore encore. Voilà tout ce que mes espions m’ont appris depuis hier. Pour le reste, tâchez de le savoir, vous qui avez accès dans la maison de la comtesse ; car les mêmes espions m’ont appris, mon fils, que vous étiez au mieux avec elle.
— Quoi ! Monseigneur… vous pourriez croire…
— Se seraient-ils trompés ? tant pis !… La comtesse, que je déteste, mais que vous pouvez aimer, est encore fort bien… et si vous ne lui avez pas fait la cour, tâchez de la lui faire, sinon pour vous, au moins pour moi. Cela peut être utile.
— Oui, mon père… je tâcherai… j’obéirai.
Le duc lui prit la main en signe de remercîment et continua :
— Tâchez surtout de savoir quelle est cette jeune fille, cette Aïxa, ses principes, son caractère. Est-ce par la fortune, par l’ambition, par la vanité qu’on pourrait la séduire ?
— Quoi ! mon père, vous voudriez…
— Achever glorieusement ce que la comtesse avait entrepris et n’a pu mener à bien.
— Vous !… est-il possible ?
— Pourquoi pas ? dit le ministre en souriant d’un air de mépris ; un tel obstacle doit-il arrêter un instant un homme d’État ? Si le roi, comme je le présume, est sérieusement amoureux, il sera beaucoup plus facile et plus prompt de céder à cet amour que de le combattre. Ce sera fini plus tôt d’abord, et dans quelques jours il n’en sera plus question.
— Vous croyez ?
— J’en suis sûr. Allez prendre les informations que je vous demande, et venez me retrouver chez le roi, où personne ne peut entrer que moi… et vous, mon fils. Je vais en donner l’ordre.
Le duc d’Uzède consterné se rendit chez la comtesse, et le ministre chez son souverain.
Il le trouva pâle et souffrant. Il avait passé une mauvaise nuit, il avait eu la fièvre ; mais elle était tombée, et il ne restait au roi qu’un extrême abattement.
Il était redevenu lui-même, c’est-à-dire incapable de prendre aucune résolution. Sa faiblesse l’empêchait, dans ce moment, de lier deux idées ensemble, et il ne pouvait rien s’expliquer des événements de la veille.
Le duc s’arrêta près du lit de son maître, le regarda avec intérêt, avec douleur ; une larme même, une larme ministérielle roula dans ses yeux et vint tomber sur le royal couvre-pied.
Le roi, effrayé, se crut très-malade.
— Est-ce qu’il y a du danger ? s’écria-t-il.
— Oui, mon maître, oui, mon auguste maître, si vous cessez d’avoir confiance en votre fidèle serviteur, ou plutôt en votre meilleur ami. Que vous ai-je fait, mon roi, pour que vous vouliez ainsi me cacher vos peines, quand mon devoir est de les partager ?
— Que dis-tu ? dit le roi étonné en se levant sur son séant.
— Que je suis profondément affligé et malheureux d’avoir appris autrement que par Votre Majesté les tourments qu’elle endure.
— Quoi ! tu les connais !
— Oui, oui, mon roi… et je viens les soulager.
— Serait-il possible ! tu ne les désapprouves pas !… tu ne me blâmes pas !…
— Moi, vous blâmer, sire ! N’est-il pas des sentiments dont on n’est pas le maître ? dont on ne peut se défendre ? M’appartiendrait-il de blâmer une affection exclusive et sans borne, moi qui n’ai jamais pu cesser de l’éprouver pour Votre Majesté, moi qui, dans ce moment encore, suis prêt à me dévouer pour elle… malgré son ingratitude !
— Ah ! s’écria le roi attendri, tu dis vrai… j’étais un ingrat… j’aurais dû te confier tout… mais comment le faire en ce moment, où je ne comprends plus rien à ce qui m’arrive ?
— Je viens vous l’expliquer, sire… et y porter remède.
— Mon ami, mon sauveur ! s’écria le roi… quoi ! tu viendrais toi-même… tu consentirais…
— À tout au monde plutôt que de voir souffrir Votre Majesté ; n’est-ce pas le premier et le plus sacré de mes devoirs ? Voyons, sire, ajouta-t-il d’un ton paternel, voyons, qu’y a-t-il ?
Le roi, qui, depuis longtemps s’était attendu à des remontrances et à des reproches, et qui, pour cette seule raison, s’était caché de son ministre ou plutôt de son précepteur, le roi se sentit délivré de toutes ses craintes. Sa confiance était gagnée… et, comme tous les amoureux qui ont le bonheur d’avoir des peines, il ne put résister au plaisir de les raconter.
— Imaginez-vous, mon cher duc, dit étourdiment le roi à son ministre, que c’était le jour où je me suis égaré à la chasse avec le duc d’Uzède, votre fils.
— Comment ! s’écria le duc en fronçant le sourcil, Uzède ne m’en avait rien dit.
Un instinct de délicatesse et de convenance fit comprendre au roi qu’il allait compromettre près de son père son ancien confident, qui s’était exposé pour le servir ; et par un sentiment de générosité ou de prévoyance, car le duc pouvait encore lui être utile, il s’écria :
— Uzède n’en savait rien. J’étais entré seul dans un pavillon pour me mettre à couvert de la pluie, et lui, pendant ce temps, allait à la découverte pour reconnaître où nous étions et demander notre chemin.
À cette restriction près et en taisant la part que le duc d’Uzède avait prise à cette intrigue, le roi raconta à son ministre à peu près tout ce qui s’était passé entre lui et une jeune fille inconnue, et comment cette jeune fille l’avait cru don Augustin, tandis que lui-même la croyait la nièce de la comtesse.
Il lui avoua que depuis ce moment il n’avait cessé de penser à elle et de l’aimer. Puis, passant légèrement à côté de la vérité, il expliqua comment il avait supplié la comtesse de la présenter à la cour, et comment celle-ci, persuadée qu’il s’agissait de Carmen d’Aguilar, sa nièce, s’était empressée d’arriver la veille au bal, sur une lettre de lui, le roi !
— Ah ! Votre Majesté avait écrit elle-même à la comtesse ? dit le duc d’un air indifférent.
— Eh oui, sans doute… une simple lettre d’invitation.
— C’est ce qu’il y avait de mieux, dit froidement le ministre.
— N’est-il pas vrai ?… Parce que cet engagement… je veux dire cette invitation, balbutia le roi en se reprenant, était dans la supposition qu’elle avait quelque pouvoir sur cette jeune fille.
— Elle n’en a aucun, dit le ministre avec aplomb.
— Vous le croyez ?
— J’en suis certain.
— C’est bien différent alors ! s’écria le roi vivement.
— Comme je le disais à Votre Majesté, il ne s’agit que de s’entendre.
— Mais quelle est donc cette belle inconnue ?
— Une orpheline élevée par don Juan d’Aguilar avec la senora Carmen, qui ne la quitte jamais, et qui la traite comme sa sœur.
— Voilà d’où vient l’erreur, dit joyeusement le roi… au château du Duero, à la promenade… à l’hôtel d’Altamira, toujours ensemble.
— C’est, en effet, à l’hôtel d’Altamira qu’elle habite, dit le ministre… mais avec Carmen et non avec la comtesse.
— Et son nom, mon cher duc, son nom ?
— Aïxa.
— Et vous me répondez que je pourrai la voir, qu’il n’y aura pas d’obstacle ?
— Il y en aura sans doute ; mais pour ne pas en triompher, il faudrait que les amis ou les serviteurs de Votre Majesté eussent bien peu de zèle ou d’adresse.
— Mon cher duc, s’écria le roi, je n’espère qu’en vous ! c’est de vous seul désormais que dépendra mon bonheur.
Et guéri par cette seule idée, le roi, qui passait aisément de l’accablement le plus profond à la joie la plus vive, se leva et déjeuna comme s’il eût été déjà assuré de plaire à celle qu’il aimait.
Le duc d’Uzède, cependant, s’était rendu près de la comtesse, et lui avait raconté comment le ministre, s’appropriant son idée, prétendait l’exploiter à son avantage et donner lui-même une maîtresse au roi, maîtresse qui, choisie et présentée par lui, n’agirait que par son influence et ses conseils, et que cette favorite sur laquelle reposaient désormais toutes ses espérances, n’était autre qu’Aïxa.
— Aïxa ! s’écria la comtesse stupéfaite et qui ne pouvait s’expliquer un pareil événement. Mais, furieuse de ses projets renversés, et plus furieuse encore de ceux que méditait le duc, elle jura en elle-même de les déjouer. Il n’y avait pas de temps à perdre, elle monta à l’instant même chez Aïxa.
Avec une feinte bonté et une feinte indignation, elle se hâta de lui raconter les infâmes complots qui se tramaient contre elle.
— Ce n’est pas possible ! dit Aïxa étonnée.
— Cela est, mon enfant, je vous le jure. On veut vous tromper, vous séduire, trafiquer de votre honneur. Le duc de Lerma l’a promis ; mais il oublie que vous m’êtes confiée, que vous êtes sous ma garde et que je veillerai sur vous comme sur ma nièce, comme sur ma propre enfant.
— Expliquons-nous, madame, dit Aïxa froidement et sans se laisser émouvoir par ces protestations de tendresse ni par cet étalage de grands principes. L’amour-propre ne m’aveugle pas au point de me faire croire à des passions surnaturelles. Le roi m’aime, dites-vous ! Comment cela serait-il arrivé ?
— Je l’ignore… mais il vous aime.
— Où m’aurait-il vue ?
— Je n’en sais rien, senora… C’est à vous que je le demanderai… ou plutôt à Carmen ; je saurai comment elle n’a pas même reconnu hier soir, ce don Augustin avec qui elle a passé toute une soirée.
— Que dites-vous senora ?… le seigneur don Augustin.
— C’était le roi !
Ô ciel !… qu’avez-vous ? dit la comtesse en voyant Aïxa qui changeait de couleur… d’où vient ce trouble ?
— D’une cause toute naturelle, répondit Aïxa avec franchise : c’est que c’est moi qui, au château de Duero, ne connaissant point l’hôte que vous attendiez, ai reçu le seigneur don Augustin…
— Vous ! dit la comtesse, pâle de colère.
— Moi-même.
— Dans quelle intention ? dans quel but ?
Aïxa allait le lui dire, puis se rappelant la recommandation et les soupçons de don Fernand, qui, dans ce moment plus que jamais, lui paraissaient vraisemblables, elle répondit froidement :
— Je vous ai dit ce qui était… Le reste est inutile et me regarde seule.
La comtesse poussa un cri et se frappa le front de sa main.
Cette substitution qu’elle ne comprenait point et qu’Aïxa refusait d’expliquer, le mystère qui environnait cette jeune fille, la singularité de son existence, de sa conduite, de son caractère, et jusqu’à cette fortune inconnue dont elle paraissait disposer, tout faisait croire à la comtesse qu’elle était jouée, qu’il y avait pour séduire le roi quelque intrigue secrète tramée par cette jeune fille et les siens, intrigue qu’elle-même avait secondée et fait réussir sans le savoir.
— Je saurai le motif de cette ruse, de cette indigne trahison.
— Une trahison, senora ! répondit Aïxa avec fierté.
— Oui… vos projets me sont connus. Le danger contre lequel je venais vous prémunir était depuis longtemps désiré, ambitionné par vous !
— Qu’osez-vous dire ?
— Vous vouliez captiver le roi, vous en faire aimer, le voir à vos pieds, pour arriver au pouvoir, pour régner sous son nom !
— Ah ! s’écria Aïxa avec indignation, j’y vois clair maintenant ! Vous vous êtes trahie, madame ; vous venez de m’apprendre vos projets, de m’initier à vos idées et à votre plan ; ce que vous me reprochez, vous vouliez le faire, et l’infamie dont vous m’accusez est la vôtre !
— À moi !
— À vous ! sœur de don Juan d’Aguilar et tante de Carmen ! Vous vouliez vendre votre nièce, trafiquer de son honneur, pour arriver par elle au pouvoir suprême, et gouverner le faible monarque.
La comtesse fit un geste de colère ; mais Aïxa, sans se laisser intimider et la foudroyant de son regard, continua avec force :
— C’est pour déshonorer votre nièce, votre fille, celle qui vous était confiée par son père à son lit de mort, c’est pour la faire trouver seule et en tête-à-tête avec le roi au château de Duero, que vous avez éloigné tous vos gens, que vous avez prétendu être malade, que vous avez envoyé Carmen à ce pavillon où, sous le nom d’un parent à vous, du seigneur Augustin de Villa-Flor, le roi l’attendait.
— Et en amie généreuse, s’écria la comtesse, vous lui avez dérobé le déshonneur qui la menaçait ! Vous lui avez enlevé à votre profit le cœur et l’amour du roi ! Dévouement sublime ! vertueuse spéculation qui vous place sur le trône du monarque ! vous, maîtresse adorée ! favorite toute-puissante !
Aïxa jeta sur elle un regard de mépris :
— Je ne suis point la maîtresse du roi, et ne la serai jamais.
À ces mots, et malgré sa colère, la comtesse sentit un rayon d’espoir se glisser en son cœur.
— Si vous me connaissiez, senora, vous sauriez que je regarde comme un opprobre ce que vous autres, nobles dames de la cour d’Espagne vous regardez comme un honneur. Cet honneur, je saurai m’en préserver, je vous le jure, vous pouvez vous en rapporter à moi. Et maintenant, madame la comtesse, veuillez m’écouter. Par égard pour le sang dont vous sortez, par reconnaissance pour don Juan d’Aguilar qui fut votre frère et mon protecteur, je ne dirai à personne, pas même à Carmen, ce que je viens de découvrir. Mais si vous osez donner suite à vos projets sur elle, si vous tentez de la ravir à don Fernand d’Albayda son fiancé, ou d’empêcher d’aucune manière leur mariage, je publierai votre infamie. J’en demanderai justice à la cour, à la reine, et… ajouta-t-elle en souriant avec ironie, au roi lui-même ! c’est la seule manière dont j’userai du pouvoir que vous me supposez sur lui. Que je ne vous retienne plus, senora, continua-t-elle avec dignité.
La comtesse sortit, la rage dans le cœur, et rêvant déjà sa vengeance…
Pour comble de dépit, elle rencontra dans l’escalier un page du roi portant une magnifique corbeille.
— D’où vient, seigneur Cardenio, cette masse de fleurs ?
— De la part de Sa Majesté.
— Et pour qui ?
— Pour la senora Aïxa.
La comtesse indiqua de la main l’appartement d’Aïxa, et rentra dans le sien.
Le soir même Uzède se rendait chez le roi ; il y trouva le duc de Lerma qui ne le quittait plus.
— Sire, lui dit-il, il faut renoncer à un amour impossible et sans espoir.
Le roi pâlit, et le tremblement dont il fut saisi prouva au ministre la violence de la passion qui déjà maitrisait son cœur. À peine si ses lèvres blanches et tremblantes purent répéter ces mots :
— Impossible !… sans espoir ! et pourquoi ?
— Parce que rien n’égale la fierté et l’insolence de cette jeune fille, qui regarde comme un opprobre les soins et les vœux dont l’honore Votre Majesté… Je n’oserais même répéter ici les termes injurieux dont elle s’est servie ; il n’y aurait pas même assez de justes châtiments pour elle !
— Dis toujours, murmura le roi.
Le duc, à qui la comtesse avait fait la leçon, mit alors sur le compte de la pauvre Aïxa plus d’offense de lèse-majesté qu’il en aurait fallu pour lui faire passer le reste de ses jours dans les cachots de l’inquisition ; mais au lieu de se montrer furieux, le roi ne parut qu’accablé. Il laissa tomber sa tête sur sa poitrine, et dit avec douleur, en joignant les mains :
— Mon Dieu ! que lui ai-je fait pour me traiter ainsi ! moi qui la respecte et qui l’aime tant !
Un rayon d’espoir vint alors briller à ses yeux.
— Tout ce que tu me dis là, s’écria-t-il en s’adressant à Uzède, l’as-tu entendu d’elle-même ?
Uzède hésita un instant et dit en balbutiant :
— Non, mais je l’ai appris de la comtesse… qui en était indignée…
— La comtesse est suspecte, dit le ministre avec un air de profondeur.
— N’est-il pas vrai ! s’écria le roi avec joie.
— Mais ce qu’il y a de certain, reprit le duc d’Uzède en voyant que la victoire allait encore lui échapper de ce côté, ce qu’il y a de positif, c’est qu’elle a renvoyé la corbeille de fleurs que Sa Majesté lui avait fait l’insigne honneur de faire porter chez elle par un de ses pages ; galanterie bien innocente et bien permise sans doute !
— Elle l’a renvoyée ! dit le roi avec désespoir, et comme si quelque grand fléau fût venu fondre sur la monarchie espagnole.
— Elle l’a renvoyée, reprit le duc d’Uzède avec force, en déclarant qu’il y avait sans doute erreur, que ce n’était point pour elle, attendu qu’elle n’était point et ne serait jamais la maîtresse du roi. Voilà ses propres paroles.
— Mon Dieu ! reprit le roi avec douceur. Je n’en demande pas tant. Je ne veux ni la forcer, ni la contraindre. elle m’aimera… si elle le veut… si elle le peut ! Tout ce que je désire, c’est de la voir, de la voir tous les jours. Vous ne savez pas, dit-il, en s’adressant au ministre, combien il y a de charme et de douceur dans sa conversation. J’ai passé presque toute ma soirée avec elle… cette soirée a été la plus douce de ma vie, et tout ce que vient de me dire d’Uzède est si loin de son ton et de ses manières, que cela me semble impossible ; je voudrais l’entendre d’elle-même, de sa bouche, pour le croire !
— Votre Majesté, dit le duc d’Uzède en pâlissant, ne peut cependant se rendre chez elle tous les jours, sans se compromettre et s’abaisser à tous les yeux.
— Il a raison, dit le ministre.
— D’ailleurs, j’ignore si la fière Aïxa consentirait même à recevoir Votre Majesté.
— Comment donc faire ? dit le roi, qui se désolait et se dépitait comme un enfant à qui l’on refuse ce qu’il désire. Qu’elle vienne alors ici, au palais ; je la verrai de temps en temps le soir, comme toutes les autres dames présentées à la cour.
— Impossible, reprit encore le duc d’Uzède. Le roi le regarda avec impatience et colère.
— Qui, sans doute, sire, reprit celui-ci sans s’apercevoir du mauvais effet que produisit son insistance ; la fille de don Juan d’Aguilar, la noble Carmen, pouvait être présentée à la cour ; mais Aïxa, fille d’un roturier, d’un officier de fortune tué en Irlande, n’a aucun droit, aucun titre à cette faveur.
— Taisez-vous ! dit le roi furieux.
— Ce serait soulever contre vous toute la grandesse d’Espagne, tous les nobles de la cour, qui tiennent à leurs droits et privilèges plus qu’à la vie.
— Je vous ait dit de vous taire ! répéta le roi hors de lui-même. Il est bien étonnant que je ne trouve autour de moi que des gens mal intentionnés, des ennemis de mon repos et de mon bonheur.
— Vous oubliez que je suis là… près de vous, dit le ministre avec douceur, et je vous promets, moi, que, d’ici à quelque temps, la senora Aïxa sera présentée à la cour, sans exciter aucun murmure, aucune réclamation.
— Est-il possible ! s’écria le roi avec joie.
— Et Votre Majesté la verra tous les jours.
— C’est tout ce que je demande… Elle finira, j’en suis sûr par être touchée de mon amour… Je me rappelle ce qu’elle m’a dit au pavillon du parc, sa bonté, sa douceur… j’avais déjà gagné son amitié… elle me l’avait promise… elle me l’avait donnée. Ainsi, tu comprends ! que je la voie seulement, je n’en demande pas davantage.
— Votre Majesté sera satisfaite, je vous le jure.
— Tu me le jures ! Ah ! s’écria le monarque avec enthousiasme, ils ont beau dire et vouloir te renverser, personne n’aura jamais cette habileté, ce talent, ce génie des affaires qui triomphe de toutes les difficultés, et surtout, ajouta-t-il avec effusion, ce dévouement sans bornes qui t’assure à jamais notre royale affection.
Dès ce moment, le monarque ne fit plus attention au duc d’Uzède, qui lui était devenu complétement indifférent, et le duc de Lerma, possédant la confiance exclusive et l’amitié de son souverain, se vit plus que jamais assuré du pouvoir.
Il n’oubliait pas que c’était à la condition de réussir. Il l’avait juré ! Son seul but maintenant était d’attirer Aïxa à la cour et de l’y fixer, n’importe par quel moyen.
Autant il avait été opposé à la passion du roi, autant maintenant il comprenait la nécessité de la seconder. La comtesse, de son côté, n’avait plus qu’une pensée et qu’un espoir : entraver les desseins du ministre et empêcher l’élévation d’Aïxa.
C’était, comme on le voit, un changement complet de manœuvres.
Quant à Escobar et au père Jérôme, toujours prêts à servir les desseins de la comtesse, ils se disaient, en partant pour prendre possession du magnifique couvent d’Alcala de Hénares : — Nous avons eu raison d’exiger des garanties. Les places inamovibles sont bien rares, et l’affection des rois bien ambulatoire ! Un matin, après le déjeuner, Carmen était restée dans le salon près de sa tante, et à côté d’Aïxa, qui maintenant ne la quittait plus. Depuis sa conversation avec la comtesse, Aïxa avait tenu parole. Rien dans ses manières n’avait pu faire soupçonner ce qui s’était passé ; mais dans sa défiance, elle veillait sur la fiancée de don Fernand.
Les deux jeunes amies parlaient de celui-ci et d’une lettre qu’on venait de recevoir de lui ; elle avait été apportée à Madrid par un courrier de cabinet chargé pour le ministre de dépêches importantes arrivant également de Lisbonne.
Les deux battants de la porte s’ouvrirent, et au grand étonnement des trois dames, un valet de la comtesse annonça à voix haute :
— Son Excellence monseigneur le duc de Lerma, premier ministre !
Depuis longtemps la comtesse, brouillée avec le duc, ne le recevait plus chez elle, et d’après les derniers événements, une semblable visite devait encore plus exciter sa curiosité.
Le duc salua avec grâce les dames, et s’adressant à la comtesse :
— Pardon, senora ! ma présence dans l’hôtel d’Altamira vous paraîtra sans doute bien audacieuse.
— Elle ne nous paraîtra qu’agréable, monseigneur ! répondit la comtesse, moins irritée de sa visite qu’impatiente d’en connaître le motif.
— Mais l’ordre de Sa Majesté sera mon excuse, dit le duc. Je viens, au nom du roi, apporter un message. et en mon nom réparer une injustice.
Il se retourna alors vers Aïxa et s’arrêta un instant. En contemplant ses traits si beaux et si réguliers, l’éclat de ses yeux, la fierté de son front et le charme répandu sur toute sa personne, il comprit la passion du roi.
Ce qui lui paraissait absurde et extravagant, lui sembla dès ce moment tout naturel ; et sa seule crainte fut qu’un pareil amour ne devint un jour une puissance capable de balancer et de renverser la sienne.
— Senora, dit-il à la jeune fille, vous êtes orpheline ?
— Oui, monseigneur !
— Mais non pas sans famille, s’écria Carmen, car c’est ma sœur !
— Votre père, continua le ministre, Diégo Lopez (c’est le nom que l’on m’a dit), était un brave militaire, sergent dans l’infanterie espagnole ?
Aïxa fit un signe affirmatif, et la comtesse un geste d’étonnement.
— Diégo Lopez a été tué sous les murs de Baltimore, lors de l’expédition de don Juan d’Aguilar en Irlande.
— Oui, monseigneur.
— Sa Majesté, qui ignorait ces circonstances, les a apprises par moi. La récompense que l’on n’a pu donner au brave soldat, revient de droit à sa fille, et j’ai proposé au roi… pour elle…
— Quoi donc ? dit la comtesse d’un air railleur…
— Un établissement honorable, répondit gravement le duc, un mariage digne d’elle et de son auguste protecteur.
— Un mariage ?… à moi ?… dit Aïxa tout étonnée.
— Oui, senora : le duc de Santarem, l’un des plus nobles seigneurs de l’Alentejo et de tout le Portugal, demande votre main…
— Il serait vrai ! s’écria Carmen avec joie.
— Un vieux seigneur, dit la comtesse avec dédain ; je l’ai connu autrefois.
— Celui que vous avez connu n’est plus, dit le duc. Son fils, le duc de Santarem, est jeune, c’est un beau et brillant cavalier qui apporte à celle qu’il choisit des biens immenses en Portugal et en Espagne, un très-beau château situé aux environs de Tolède, un hôtel à Madrid, et de plus le titre de duchesse.
Tout cela paraissait si beau, si loyal, si extraordinaire, que la comtesse d’Altamira ne pouvait y croire. Elle devinait bien, elle si habituée aux intrigues des cours, le motif secret qui guidait le duc ; mais elle ne pouvait comprendre comment le duc de Santarem consentait à s’y associer ; car c’était réellement l’héritier d’une des premières familles de la monarchie, et même, sans arrière-pensée d’une position encore plus brillante, ce mariage seul offrait déjà, pour Aïxa, un rang et des avantages dont s’indignait la comtesse.
Quant à Aïxa, froide et immobile, ne témoignant ni joie ni surprise d’une pareille alliance, elle semblait plongée dans une profonde réflexion dont elle sortit en disant :
— Je vous remercie, monsieur le duc, ainsi que Sa Majesté, de l’honneur qu’elle veut me faire en s’occupant de mon avenir ; mais dans une affaire aussi importante et aussi grave, on ne peut prendre sur-le-champ une résolution, et je demande à Votre Excellence le temps d’y réfléchir.
— C’est trop juste, senora ; quel temps demandez-vous ?
Aïxa sembla calculer et répondit :
— Je demande dix jours, monseigneur.
— Impossible, senora ; songez donc que le duc de Santarem et que le roi lui-même attendent une réponse plus prompte… et je vous supplie en grâce…
Aixa, sans prendre le moins du monde en considération la prière et l’insistance du duc, répliqua froidement et du même ton :
— Je demande dix jours.
— Mais cependant, senora…
— Pas un de moins, dit Aïxa.
Le duc s’inclina jusqu’à terre avec respect ; puis, saluant moins profondément les deux autres dames, il sortit de l’hôtel d’Altamira.
Un instant après, on entendit rouler sa voiture, et la comtesse, contemplant le sang-froid d’Aïxa, se dit en elle-même avec dépit :
— En vérité, elle serait sultane favorite depuis six mois, qu’elle ne parlerait pas au ministre avec une dignité plus insolente et plus royale.
Sans adresser la parole à la comtesse, Aïxa sortit avec Carmen, qui lui dit : — Quelle est ton idée ?
— Mon idée, à moi, répondit vivement Aïxa, serait de refuser.
— Et comment le faire sans mécontenter le roi ?
— Je l’ignore.
— Et surtout son ministre ?
— J’ai dix jours devant moi ; Dieu m’inspirera quelque bonne idée.
Aïxa se retira dans son appartement pour réfléchir à loisir, mais dès qu’elle se vit seule, elle ferma sa porte au verrou, et courut à son secrétaire.
Pendant qu’elle écrit vivement et longuement, voyons ce qui avait donné au duc de Lerma l’idée de ce mariage, et quel concours de circonstances lui avait permis d’en tenter l’exécution.
Il cherchait, comme nous l’avons dit, les moyens de tenir la promesse faite par lui à son auguste maître, celle d’amener Aïxa à la cour.
Il avait reçu, quelques jours auparavant, des dépêches importantes de Fernand d’Albayda, datées de Lisbonne. Fernand apprenait au ministre que quelques rassemblements sans consistance, quelques révoltes partielles avaient été promptement dissipés par son activité et par son zèle.
Il pensait qu’on ne devait point sévir contre de malheureux paysans, pris les armes à la main, qui n’étaient coupables, après tout, que de s’être laissé entraîner par les suggestions de quelques grands seigneurs dont ils étaient les vassaux ; que c’était contre ceux-là qu’il était plus juste de déployer de la sévérité ; qu’il regardait, comme fauteurs secrets de ces troubles, le comte de Pombal, le marquis d’Atalaïa et le duc de Santarem ; qu’il avait des preuves évidentes contre les deux premiers et qu’il ne tarderait pas à en obtenir contre le troisième.
Il finissait en demandant les ordres du roi et de son ministre.
Le duc répondit : S’assurer du comte de Pombal et du marquis d’Atalaïa et leur faire leur procès ; quant au duc de Santarem, l’envoyer sur-le-champ à Madrid, sous bonne escorte, tout en continuant la recherche des preuves qui peuvent le faire condamner.
Don Fernand expédia sur-le-champ le prisonnier qu’on lui demandait, et écrivit au ministre qu’il le suppliait de suspendre à l’égard des coupables les voies de rigueur, persuadé que leur seule arrestation suffirait pour tout pacifier.
Le duc de Santarem actuel était le fils de celui dont nous avons parlé dans les premiers chapitres de cette histoire ; de celui qui, dans une partie de chasse dans les montagnes de l’Alentejo, s’était arrêté chez Géronima, la femme du contrebandier, hasard malheureux pour le contrebandier Balseiro, pour sa femme et surtout pour le pays, puisque, sans cette rencontre, le capitaine Juan-Baptista Balseiro, dont nous avons plus d’une fois entretenu nos lecteurs, n’aurait probablement pas vu le jour ! perte précieuse pour tous ceux qui plus tard eurent le malheur d’avoir des relations avec le capitaine.
Nous ne prétendons pas dire que le même sang eût produit les mêmes effets, et qu’il y eût la moindre comparaison à établir entre le bâtard du duc de Santarem et son héritier légitime.
Celui-ci, élevé en fils de bonne maison, avait de la tenue, du courage et des principes en dose suffisante, un peu de fatuité et de recherche dans les manières, beaucoup d’importance et pas le moindre jugement. Après la mort de son père, qui venait de lui laisser une fort belle fortune, il s’ennuya dans ses terres, s’indigna de ne rien être, et s’avisa de conspirer contre l’Espagne et contre le duc de Lerma, pour passer son temps et faire quelque chose.
Mais trop grand seigneur pour mettre la main à l’œuvre, il se contenta de tracer les plans, de donner des ordres du fond de son château, et de mettre en avant ses vassaux, qu’il enrégimenta et solda généreusement.
Tout cela lui paraissait charmant et l’amusait beaucoup.

Mais dès l’arrivée de Fernand et aux premiers coups de mousquet, il trouva déjà les conspirations moins agréables, et il fut tout à fait dégoûté, lorsque, sans respect pour son nom, son rang, et sa naissance, on vint le prendre dans son château, le jeter dans une voiture très-dure, très-cahotante, et quand, escorté par un détachement d’alguazils, il roula jour et nuit, sans s’arrêter, jusqu’à Madrid.
Pendant la route il eut le temps de réfléchir et de se dire que lorsqu’on était jeune et riche, qu’on avait de belles terres et de beaux châteaux en Portugal et en Espagne, qu’on pouvait boire, manger, chasser, avoir à son aise des passions et des défauts, jouir enfin gaiement de la vie, il était bien absurde d’aller l’exposer dans des complots dont personne ne lui saurait gré, excepté ses héritiers. Mais le mal était fait, et sa frayeur redoubla, lorsque, arrivé à Madrid, il fut amené devant le duc de Lerma.
— Monsieur de Santarem, lui dit froidement celui-ci, vous avez conspiré, dans l’Alentejo. Vous avez fomenté une révolte contre le roi.
— Moi, monseigneur, s’écria le duc, qui comprit qu’a tout hasard il y avait plus de profit à nier crime qu’à l’avouer, cela n’est pas ! on m’a calomnié !
— Nous avons les preuves, dit le ministre avec le même sang-froid.
Il ne les avait pas encore ; mais il vit, à l’air terrifié du jeune conspirateur, qu’il n’en avait pas besoin.
— J’ai écrit à don Fernand d’Albayda, qui les a en son pouvoir, de me les envoyer, continua-t-il, et dès qu’elles seront arrivées et soumises au conseil, aucune puissance ne pourra vous sauver ni empêcher votre tête de tomber sous le glaive du bourreau.
À ces paroles, prononcées avec une emphase et une sévérité officielles, le jeune duc de Santarem sentit tout son sang refluer vers son cœur.

Il n’avait aucune bonne raison à donner ; rien ne plaidait en sa faveur ; c’était étourdiment, gratuitement et sans prétexte personnel ni plausible, qu’il s’était jeté dans une pareille échauffourée. Il baissa donc la tête et murmura les mots de clémence royale et de pardon.
Un pardon, reprit le duc, certainement, eu égard à votre étourderie et à votre jeunesse… Sa Majesté pourrait peut-être, à ma recommandation, consentir à l’accorder ; mais qui nous dit que, de retour dans vos terres et parmi vos vassaux, vous ne recommencerez pas ?
— Jamais, monseigneur… Jamais, je vous le jure.
— Les affaires d’État ne se traitent pas ainsi. Il nous faudrait, si l’on vous faisait grâce, prendre des précautions rigoureuses.
— Toutes celles que vous voudrez, monseigneur, je m’y soumets d’avance.
— D’abord, vous seriez obligé de résider à Madrid, de n’en point sortir sans notre permission.
— J’y consens.
— Il faudrait ensuite, pour calmer la fougue et l’effervescence de vos passions, vous établir, vous marier.
— S’il ne tient qu’à cela !
— Un instant ! Nous nous chargerions de choisir nous-même la femme qui vous conviendrait, car nous connaissons l’influence que peut exercer une femme sur l’esprit et les résolutions de son mari.
— Trop heureux, monseigneur, de tenir une épouse de votre main.
— J’y songerai, dit le ministre, et j’en parlerai au roi.
Le jeune prisonnier fut reconduit dans son cachot ; cachot humide et infect, qui convenait fort peu aux habitudes élégantes et recherchées du duc de Santarem, lequel était tant soit peu petit-maître. Les trois jours qu’il y passa lui parurent des siècles.
— Par saint Jacques ! s’écria-t-il, prison pour prison, j’aimerais mieux me marier, fût-ce avec l’infante du Congo.
Il était dans cette disposition d’esprit lorsqu’il parut de nouveau devant le ministre.
— Le roi a eu égard aux raisons que j’ai fait valoir en votre faveur, il vous donne Madrid pour prison.
Le jeune homme tressaillit de joie.
— Il vous choisit pour femme la fille d’un ancien serviteur, un brave soldat tué en Irlande, Aïxa Lopez.
— Une vieille fille ? dit Santarem en hésitant.
— Non, elle est jeune,
— Et laide ? continua le jeune homme ; mais c’est égal,
— Non, elle est charmante, mais sans fortune.
— S’il ne tient qu’à cela, je ne sais que faire de la mienne.
— À merveille, jeune homme. Eu égard à votre générosité et à votre désintéressement, le roi, j’en suis persuadé, vous permettra da lui présenter votre femme, madame la duchesse.
— Je ne demande pas mieux.
— Votre grâce pleine et entière dépendra alors de vous et de votre conduite. Si elle est ce qu’elle doit être, nul doute que vous ne rentriez en faveur auprès de Sa Majesté, mais si l’on avait à se plaindre de vous, si vous osiez encore vous révolter contre l’autorité royale…
— M’en préserve le ciel !
— Les preuves de votre première rébellion existeront toujours, elles seront là… et la prison d’où vous sortez peut se rouvrir à l’instant.
— Ce que j’en ai vu me suffit, et Sa Majesté peut compter désormais sur le sujet le plus fidèle, le plus dévoué et le plus soumis.
— Bien ! je vais rendre compte au roi de notre conversation.
Santarem fut reconduit dans une chambre plus élégante, mieux éclairée, plus convenable, en un mot, et il attendit cette fois avec plus de patience sa liberté définitive.
Le duc, pendant ce temps, se rendait près d’Aïxa, et nous avons vu le résultat de sa visite. Le roi, tout en se désolant des délais qu’il avait encore à subir, ne pouvait s’empêcher de rendre justice à l’habileté et au talent de son ministre.
Ce mariage, il est vrai, lui avait d’abord grandement coûté ; mais il fallait alors renoncer à voir Aïxa, car c’était le seul moyen de l’amener à la cour, et de l’y placer dans une position honorable.
Ce qui le consolait, c’est que ce n’était qu’un mariage de convenance ; qu’Aïxa ne pouvait aimer un homme qu’elle ne connaissait pas. Et puis ce mari qui restait toujours sous le poids d’un jugement capital, et que l’on pouvait, d’après sa docilité, amnistier ou faire disparaître à volonté, lui paraissait une combinaison diplomatique d’une grande supériorité, et il ne pouvait se lasser d’admirer l’esprit facile et inventif du ministre auquel il avait remis le gouvernement de l’Espagne.
Le duc de Lerma cependant, loin de s’abandonner à la confiance que donne le succès, redoutait toujours quelque sourde et adroite manœuvre de la comtesse, et quoiqu’il y eût entre eux, en ce moment, comme une trêve tacite, le duc ne désarmait pas, et restait toujours sur le pied de guerre. L’hôtel d’Altamira était entouré d’espions ; les moindres démarches étaient observées ; tout ce qui entrait dans l’hôtel, tout ce qui en sortait était l’objet de la surveillance la plus active.
Les dix jours étaient expirés. On entendit, à la même heure que la première fois, rouler le carrosse du duc, et lui-même se présenta dans le salon. Aïxa et Carmen venaient d’y arriver, et pour rien au monde la comtesse n’eût voulu manquer à cette séance.
— Je viens, senora, dit gracieusement le duc, chercher votre réponse.
— Je suis désolée, monseigneur, d’avoir fait attendre aussi longtemps Votre Excellence.
— Peu importe, senora, si je dois recevoir une bonne nouvelle.
— Dans le sens que vous daignez y attacher, monseigneur. elle ne l’est pas… car après m’être bien consultée… il m’est impossible…
— D’accepter ! s’écria la comtesse…
— Oui, madame, répondit froidement Aïxa.
Il était dit que la comtesse ne pourrait jamais s’expliquer la conduite de la jeune fille ; mais elle voyait, en ce moment, le duc déconcerté dans ses projets ; c’était un triomphe pour elle, et elle l’acceptait comme tel, de quelque manière que lui vint la victoire. Elle jeta sur son ennemi un regard de joie qui s’atténua tout à coup, en voyant le duc beaucoup moins humilié qu’elle ne l’espérait.
Il contemplait Aïxa d’un air calme et avec un sourire à demi railleur.
— Je ne doute point, dit-il lentement, que, pendant ces dix jours, la senora n’ait pesé toutes les raisons pour et contre ce mariage ; mais je crois qu’elle en a oublié quelques-unes qui ne lui auraient pas permis d’hésiter.
— Je ne le pense pas, dit Aïxa.
— Et moi, j’en suis sûr, et si la senora veut me permettre, non pas de les faire valoir auprès d’elle, mais seulement de les lui rappeler, je suis persuadé qu’à l’instant même elle changera de résolution.
— La senora n’a pas cette habitude, dit la comtesse d’un air railleur, et malgré tous vos talents, monsieur le duc, je crains que votre négociation ne réussisse pas.
— Je ne saurais partager vos craintes, madame la comtesse, répondit gravement le ministre, et si la senora veut m’honorer d’un entretien particulier… ajouta-t-il en regardant la comtesse.
— Quoi ! monseigneur, dit celle-ci d’un air piqué, un tête-à-tête !…
— Mon âge le rend peu dangereux. Celui-ci d’ailleurs ne durera que quelques minutes ; je suis persuadé d’avance du consentement de la senora.
Aïxa le regarda d’un air de doute, et faisant signe à Carmen de s’éloigner, elle dit au ministre :
— Je suis à vos ordres, monseigneur.
Carmen emmena sa tante, laissant Aïxa seule avec le duc de Lerma.
Ainsi que celui-ci l’avait promis, il resta à peine un quart d’heure auprès de la jeune fille, et quand il la quitta, l’œil le plus clairvoyant n’eût pu lire sur ses traits impassibles la honte d’une défaite ou la joie d’un triomphe. Il disparut après avoir salué respectueusement les deux dames.
Celles-ci se hâtèrent de rentrer dans le salon. Aïxa, pâle, les traits décomposés, les yeux baissés et dans une immobilité, dans une stupeur effrayantes, ne les entendit seulement pas entrer.
— Aïxa, ma sœur, s’écria Carmen, qu’as-tu donc ?
— Laisse-moi, laisse-moi, je te prie !
— Apprends-moi ce qu’il t’a dit.
— Je ne le puis, ma sœur ; je ne le puis.
Et cherchant à bannir les idées sinistres qui l’occupaient, elle se leva, passa une main sur son front, porta l’autre à son cœur, et, comme si elle y eût puisé de la force et du courage, elle dit d’une voix ferme :
— Allons, il le faut ! je le dois ! j’épouserai M. le duc de Santarem !
XXXVI.
l’œuvre de la rédemption.
Nous avons laissé Piquillo dans la voiture de suite de l’archevêque de Valence, avec le majordome et les deux aumôniers de monseigneur.
Le majordome ne disait rien ; les deux aumôniers dormaient, et le fils de Giralda pensait avec quelque inquiétude à sa situation.
À coup sûr, il ne céderait pas à ce qu’on semblait vouloir exiger de lui ; il ne consentirait pas à cette conversion et à ce baptême forcés. Il l’avait promis à Aïxa, et ce n’était pas au moment où d’Albérique venait de le reconnaître pour son fils, où Yézid le nommait son frère, qu’il voudrait renier la religion de tous les siens, et embrasser la croyance de leurs ennemis.
Il se doutait bien qu’on l’enverrait, comme le barbier Gongarello et sa nièce Juanita, dans les prisons de l’inquisition ; mais il comptait sur ses amis ; il se disait d’avance, que Pedralvi, resté libre, n’était pas homme à l’abandonner ; qu’il verrait Juanita à Madrid ou qu’il lui écrirait ; que Juanita préviendrait Aïxa, don Fernand d’Albayda, peut-être même la reine, et que, grâce à tant de protections, sa captivité ne serait que momentanée.
Il ne fallait donc que de la patience et du courage, et Alliaga n’en manquait point.
Il avait déjà calculé, par la direction que suivait la voiture, que l’archevêque n’allait point à Tolède : il en venait. Il était donc probable qu’il se rendait à Valence.
Le jour commençait à paraître, et par les glaces de la portière Piquillo s’aperçut qu’on avait quitté la grande route, et qu’on était entré dans un chemin de traverse. Les voitures n’allaient plus qu’au pas, et bientôt s’arrêtèrent. On était presque à l’extrémité des monts de Tolède, cette chaîne de montagnes qui commence aux frontières du Portugal, traverse l’Estramadure et une partie de la Nouvelle-Castille, s’abaisse entre Madrilejos et Alcazas de Saint-Jean, et remonte vers la sierra de l’Albarracin. On était arrivé à un endroit où les voitures ne pouvaient plus marcher.
Monseigneur l’archevêque descendit, et appuyé sur les bras de son grand vicaire, gravit un petit sentier extrêmement rapide, qui s’élevait entre des rochers. On avait fait aussi descendre Piquillo, et trois hommes de l’escorte qui avaient mis pied à terre montèrent avec lui sur les traces de monseigneur.
Tous trois étaient armés d’escopettes, prêts à faire feu sur le prisonnier, s’il tentait de s’échapper, et l’idée ne pouvait pas lui en venir, car à droite et à gauche de l’étroit sentier taillé dans le roc, l’œil n’apercevait que d’horribles précipices, les uns à pic, les autres rendus impraticables par l’eau des torrents qui s’y précipitaient. On monta ainsi pendant une heure.
De temps en temps on s’arrêtait. Le prélat reprenait haleine, essuyait la sueur qui coulait de son front, et quand le grand vicaire s’inquiétait de sa fatigue, il répondait :
— C’est pour la foi !
On aperçut le clocher d’une petite église qui dominait la montagne, et l’on arriva enfin à une espèce de plate-forme où l’on découvrit le portail d’une église et d’un presbytère, et à quelques centaines de pas plus loin, un édifice assez imposant.
C’était un château fortifié, construit autrefois par les Maures. Ses murailles tombées en ruines, mais en grande partie réparées, offraient encore plusieurs hautes tourelles bien solides et garnies de bons barreaux de fer.
Cet endroit s’appelait Aïgador, du nom d’une rivière qui prend sa source dans ces montagnes. Cette église sans paroissiens, et même sans village, car on ne pouvait donner ce nom à une douzaine de cabanes, en bois disséminées sur les rochers, cette église était desservie par un curé qui s’empressa de venir au-devant de monseigneur, et de le faire entrer dans le presbytère.
— Eh bien ! Romero, lui dit l’archevêque en s’approchant d’un bon feu qui pétillait dans la cheminée, comment va l’œuvre de la Rédemption ?
— À merveille, monseigneur, l’année sera bonne. L’œil du prélat rayonna de joie.
— Combien de conversions et de néophytes ?
— Huit, monseigneur.
— C’est deux de plus que le mois dernier.
— Aussi, nous y déployons un zèle ! je suis exténué à force de prêcher, et ce pauvre Acalpuco, qui me seconde de son mieux, est sur les dents.
— C’est pour, la foi ! dit le prélat en levant les yeux au ciel ; puis tirant une bourse de sa poche : Tu avais trente pistoles, tu en toucheras dorénavant soixante par an, et cette petite cure au milieu des montagnes vaudra les meilleures de la vallée.
— Grâce à vous, monseigneur.
— C’est bien. Continue à être zélé et surtout discret. Il faut cacher le bien que l’on peut faire. C’est dans un autre monde que nous attend la récompense.
— Mais il n’est pas défendu, dit le curé en serrant la bourse, de recevoir quelques à-compte en celui-ci.
— Combien nous reste-t-il d’âmes à racheter de la damnation éternelle ?
— Cinq, monseigneur… des âmes obstinées qui appartiennent toutes à des juifs ; aures habent et non audiunt ! Voilà trente jours consécutifs que je les exhorte en vain !
— Ah ! ils ne sont ici que depuis ce temps ?
— Oui, monseigneur. C’est le premier mois ; je compte sur le second.
— Et moi aussi. En attendant, dit le prélat avec satisfaction, voici une nouvelle œuvre de rédemption qui réclame tes soins…… encore un hérétique que je t’amène… un Maure !
— Tant mieux. Cela me changera un peu.
— Il faudrait que tout fût terminé pour Pâques prochain, c’est important, c’est le grand jour ! Sais-tu bien, Romero, qu’en y comprenant ces derniers… cela ferait soixante ?
— Dieu aidant, cela sera, monseigneur !
— Bien ! Fais avertir Acalpuco. Je rejoins ma voiture et mes gens, que j’ai laissés au bas de la montagne.
— Monseigneur va à Madrid ?
— Non, je retourne à Valence ; mais dans deux mois je reviendrai moi-même, entends-tu ? moi-même, savoir ce qu’aura produit la parole de Dieu semée par toi.
— Dieu bénira la moisson, monseigneur… elle sera abondante.
— Je vois, Romero, qu’elle l’est déjà.
— Et quand monseigneur enverra-t-il prendre la récolte ? Il serait temps de la rentrer.
— Nous rentrerons tout à la fois… dans deux mois. J’enverrai un détachement du saint-office ou de la Sainte-Hermandad, qui m’amènera le tout à Valence sous bonne garde.
— Je comprends, monseigneur. Voici Acalpuco.
— Bien ; remets-lui le nouveau catéchumène, et que Dieu fasse fructifier vos soins à tous deux. Pour s’expliquer la conversation précédente, il faut savoir que l’archevêque de Valence, Ribeira, jouissait dans toute l’Espagne d’une réputation de piété prodigieuse.
Il y avait tel village où on le regardait comme un
saint, et le valet de chambre du prélat se faisait un
revenu considérable, rien qu’en vendant par parcelles
les soutanes et les habits de son maître, destinés un
jour à faire des reliques, genre de spéculation que l’on
entend très-bien en Espagne.
Quand le prélat passait dans les rues de Valence, on s’agenouillait pour lui demander sa bénédiction, et les bulles du pape étaient moins respectées que le moindre mandement du saint archevêque.
Cette haute estime et cette immense réputation, qui avaient retenti jusqu’à Madrid et dans toutes les Espagnes, provenaient des nombreuses conversions faites depuis longtemps par Ribeira. Il en opérait plus à lui seul que le saint-office et tous les autres primats du royaume.
Tous les ans, aux fêtes de Pâques, la cathédrale de Valence offrait un spectacle auquel on venait assister de toutes les provinces environnantes.
Une longue file de nouveaux convertis, juifs, Arabes, protestants, calvinistes, enfin hérétiques de toutes les couleurs et de toutes les croyances, formaient, en habits blancs et un cierge à la main, une immense procession qui traversait la ville, et venait communier entre les mains du prélat. C’était lui qui avait ouvert leurs yeux à la lumière ; c’était lui qui les avait arrachés à la damnation éternelle il n’y avait pas assez d’éloges pour une foi si vive, si ardente, si durable ! chacun criait hosanna, et chaque année la cérémonie Se terminait par un Te Deum qui célébrait les pieuses victoires du prélat.
Mais, à défaut d’autres péchés, l’orgueil s’était glissé dans le cœur du saint archevêque, et le trouvant vacant, il l’avait occupé en entier. Ribeira, placé à ce haut rang dans l’administration publique, ne voulait point en descendre ni rester au-dessous de lui-même. Or, chaque année, sa tâche devenait plus difficile ; il éprouvait le sort de tous les conquérants : à force de vaincre, il n’y avait plus de victoires à remporter. Le peu de conquêtes qui restaient à faire lui étaient vivement disputées par les évêques et archevêques ses rivaux et surtout par l’ordre des Jésuites.
Le père Jérôme et Escobar, ayant compris l’influence qu’on exerçait par là sur les esprits, poussaient aussi aux conversions, et le couvent d’Alcala de Hénarès en comptait déjà quelques-unes qui empêchaient Ribeira de dormir.
Celui-ci avait heureusement, pour soutenir sa supériorité, des moyens créés par lui et qu’on ne lui connaissait pas. Avec l’autorisation de l’inquisition, dont il était un des chefs influents, il avait fondé de ses propres deniers, et sur ses revenus, qui étaient immenses, une sainte maison, appelée l’œuvre de la Rédemption.
C’était, si l’on peut s’exprimer ainsi, une pieuse pépinière qui ne le laissait jamais manquer de sujets.
Tous les hérétiques que l’on dénonçait à sa surveillance étaient saisis par ses ordres et livrés entre ses mains ; mais au lieu de les envoyer, comme on le croyait dans les prisons du saint-office, il les adressait d’abord au curé Romero, desservant de la paroisse d’Aïgador. Cette paroisse était, comme on l’a vu, située au milieu des montagnes et dans un endroit presque inaccessible.
Le catéchumène, ou plutôt le patient, était livré aux soins du curé et des frères rédempteurs, avec lesquels nous ferons connaissance tout à l’heure.
Si, grâce aux moyens employés par eux, et qui étaient presque immanquables, la conversion était opérée, on envoyait le néophyte à l’archevêque, qui le recevait comme l’enfant prodigue, le choyait dans son palais, et l’y gardait jusqu’à la grande solennité de Pâques, jour où le nouveau chrétien contribuait pour sa part à l’édification des fidèles, à la gloire de Dieu et surtout à celle de l’archevêque.
Si, au contraire, ce qui était rare, l’hérétique endurci résistait à tous les efforts, on l’envoyait définitivement dans les cachots de l’inquisition, et il n’était plus question de lui. Ou si, par hasard, il revoyait la lumière du jour, c’était pour figurer dans quelque auto-da-fé, occasion dont on allait même être privé, puisque la reine s’était prononcée contre ce genre de solennité et prétendait le proscrire.
L’archevêque venait de prendre congé du curé, et celui-ci, montrant du doigt Piquillo, avait fait signe à Acalpuco de s’en emparer.
Acalpuco était un Indien de race croisée, provenant d’un père mexicain et d’une mère espagnole. Sa taille athlétique, ses formes musculeuses, lui avaient valu, plus que son mérite intellectuel, la place importante qu’il occupait dans l’œuvre de la Rédemption.
Lui, quatrième, formait tout le personnel des frères rédempteurs, moines ou plutôt laïques portant le froc, établis dans les bâtiments qui tenaient presque à l’église. Ces bâtiments, ainsi qu’on l’a dit, étaient d’anciennes constructions élevées par les Maures, et l’archevêque avait cru voir le doigt de Dieu dans cette coïncidence, ou dans ce hasard qui faisait servir l’œuvre des ancêtres à la conversion et au salut de leurs descendants.
Piquillo, conduit par ses gardiens, franchit la première enceinte ; c’était une poterne fermée par une grille ; au-dessus étaient écrits ces mots :
archevêque de Valence, anno Dei 1602.
On se trouvait ensuite dans une cour flanquée de cinq ou six tourelles, lesquelles étaient bâties avec la pierre du rocher, c’est-à-dire en granit.
Joignez-y des portes en chêne doublées de fer, de triples barreaux à toutes les fenêtres ou ouvertures, et vous aurez une idée du logement ou plutôt du cachot destiné aux pauvres malheureux qu’il s’agissait de convertir et de mener en paradis ; la route qui y conduisait n’avait rien d’engageant et aurait plutôt fait rebrousser chemin.
Chaque tourelle contenait deux étages, chaque étage un prisonnier.
Acalpuco ouvrit la troisième tourelle à droite, alors vacante, et dit à Piquillo :
— Frère, voici votre cellule ; elle s’ouvrira pour vous quand vos yeux s’ouvriront à la lumière.
Et la porte se referma au bruit des serrures et des verrous, laissant le pauvre Alliaga livré à ses réflexions.
Il y avait une fatalité qui le poursuivait. Après avoir été si longtemps pauvre, malheureux et abandonné de tous, la fortune venait de lui sourire ; il avait retrouvé sa place au foyer paternel, une famille lui ouvrait les bras, un sort brillant s’offrait à lui. Ses talents personnels et les richesses des d’Albérique pouvaient le porter aux premiers rangs ; alors rien ne s’opposait plus à son amour pour Aïxa, à son mariage avec elle ; Aïxa lui avait dit : « Patience et courage, et on arrive à tout. »
Mais la patience lui manquait, et le courage était bien prêt à l’abandonner, lorsqu’il voyait tous ses rêves détruits, tous ses projets renversés par un hasard fatal, la rencontre de ce Juan-Baptista et la captivité où il se trouvait réduit.
Quelles en seraient les conséquences, et surtout quel en serait le terme ? voilà ce qu’il lui était impossible de prévoir.
La première pensée qui s’offrit à son esprit, celle de tout prisonnier, fut celle-ci : Comment sortir de prison ? Par la force ? Impossible ! Par ruse ou par adresse ? Il n’en voyait jusqu’alors aucun moyen. Un espoir lui restait encore, et cet espoir fut presque déçu.
Nous avons dit que, grâce à la générosité paternelle, ses poches étaient pleines d’or. Le capitaine Juan-Baptista et les siens y avaient mis bon ordre, tout avait été visité, il ne restait rien. Mais quand Yézid voyageait, il y avait toujours dans les fontes de la selle, à côté de ses pistolets, une bourse remplie de réaux pour que le généreux jeune homme y puisât à son aise et distribuât sur la route les pièces de monnaie à ceux qui lui tendaient la main, que cette main fût celle d’un juif, d’un Maure ou d’un chrétien.
Yézid, qui s’était occupé de tous les apprêts du voyage, avait fait pour son frère comme pour lui, et en montant à cheval, Alliaga avait trouvé une bourse pleine de réaux à côté de deux pistolets de poche richement ciselés et damasquinés.
Ces armes et cette faible somme ainsi placées, avaient été négligées d’abord par le capitaine Balseiro, plus empressé de voler le maître que de voler le cheval, et plus tard, les poignées d’or qu’il avait retirées des poches d’Alliaga l’avaient, non pas rassasié, mais occupé, vu qu’il ne songeait, chemin faisant, qu’à en dérober une partie aux exigences de ses associés, les autres alguazils.
Donc, quand l’escorte du capitaine eut rencontré celle de l’archevêque, quand on eut délié les mains des deux captifs, et intimé à Alliaga l’ordre de monter dans l’une des deux voitures épiscopales, celui-ci, en descendant de cheval, avait saisi vivement la bourse oubliée, ainsi que l’un des pistolets de poche, et pendant le trajet, il les avait cachés à tous les yeux, d’autant plus facilement que ceux qui l’amenaient alors n’en voulaient point à son argent, mais à son âme.
Le prisonnier avait pensé qu’il y avait une foule d’occasions où une bourse pouvait être utile aux gens qui possédaient leur liberté, et à plus forte raison à ceux qui ne l’avaient plus. C’est alors que cette ressource lui revint à l’esprit.
Il s’empressa de se fouiller, il avait toujours sa bourse.
Il compta, calcula, et tout ce qu’il possédait n’était malheureusement pas assez considérable pour faire ouvrir les portes de sa prison. Quatre-vingts à cent réaux, il n’y avait pas là de quoi séduire ses geôliers, ni acheter la conscience d’un curé ! Passe encore pour celle d’un porte-clés ! Et encore !… Il y en avait souvent qui étaient hors de prix. Quant au pistolet, qu’il examina, il lui devenait inutile ; il n’était pas même chargé.
Il en était là de ses réflexions et venait de serrer sa bourse, lorsqu’il entendit s’ouvrir un guichet, donnant dans l’intérieur du bâtiment.
Il vit apparaître-la tête du curé Romero, qui lui dit d’une voix paterne :
— Mon fils, je suis chargé, par le ciel qui me bénit, et par l’archevêque qui me paie, de vous convertir à la foi catholique, apostolique et romaine : y êtes-vous disposé ?
— Non, mon père, tant que je serai sous les verrous. Qu’on me mette en liberté, et nous verrons.
— Ce n’est pas là la question. Êtes-vous disposé à ouvrir les yeux à la lumière et les oreilles à la vérité ?
— Quand on m’aura ouvert les portes de cette prison.
— Encore une fois, mon fils, ce n’est pas là la question. Ma foi, comme chrétien, et mon devoir, comme curé de cette paroisse, m’ordonnent de vous prêcher et de vous convertir. Le saint archevêque de Valence ne m’a installé ici que pour vous montrer le chemin du ciel, et si vous ne tenez point à le gagner, moi, qui suis consciencieux, je tiens à gagner mes appointements. Je viendrai donc, durant le présent mois, vous exhorter tous les jours, pendant une demi-heure, avant mon diner.
— Dispensez-vous de ce soin, mon père, je n’écouterai pas.
— Vous en êtes le maître. Je ne puis pas vous forcer d’écouter, mais je ne puis pas me dispenser de parler. Quand vient le temps des semailles, le bon laboureur doit semer son grain, et si le grain ne germe pas, ce n’est pas la faute du laboureur, c’est celle de la terre, qui n’était pas assez bien préparée et qu’il faudra sillonner de nouveau et déchirer par le soc de la charrue ; c’est ce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il !
Et le curé se retira.
Le lendemain, il revint ; même proposition, même réponse. Le curé Romero, sans se déconcerter, sans se fâcher, sans témoigner la moindre impatience, parla pendant une demi-heure à sa montre, pas une minute de moins, pas une de plus. Quand il eut fini, il dit à son pénitent :
— Après la nourriture spirituelle, la nourriture temporelle.
Il sonna une cloche, et un repas assez convenable ; placé dans un tour, s’offrit aux regards de Piquillo.
— Merci, mon père, je vais diner.
— Et moi aussi, dit le curé en s’éloignant vivement.
Pendant plusieurs jours tout se passa exactement de même ; le captif seul, toujours seul depuis le matin jusqu’au soir, n’apercevait que le curé, lequel arrivait à onze heures et demie précises, parlait sans s’arrêter pendant une demi-heure, et, à midi sonnant, refermait le guichet, puis s’en allait diner.
— Pardieu ! se disait en lui-même Piquillo ; si tout doit se passer ainsi, c’est ennuyeux, voilà tout, mais cela l’est beaucoup ; et il ne savait comment occuper les heures si longues de la captivité.
L’intérieur de sa prison ne pouvait lui offrir de grandes distractions. Il avait déjà plusieurs fois fait l’inventaire de son mobilier : un lit, une table, un fauteuil en bois et une espèce de prie-Dieu, d’une forme bizarre et comme il n’en avait jamais vu encore. Ce prie-Dieu était en fer et semblait cacher quelque ressort qu’il essaya vainement de faire jouer. Il y renonça.
En élevant les yeux, il avait aperçu à quinze ou dix-huit pieds au-dessus de sa tête une petite lucarne fermée avec de larges barreaux ; c’était de là que lui venait la lumière. Cette lucarne était placée du côté opposé à la porte d’entrée ; donc, elle ne devait pas donner sur la cour, et le pauvre prisonnier n’eut bientôt qu’un désir : ce fut de connaître au juste la situation de ses domaines.
Pour atteindre à quinze ou dix-huit pieds, ce n’était pas facile ; Piquillo placa la table sur son lit ; sur la table il mit le fauteuil, et sur le fauteuil le prie-Dieu ; en y joignant sa hauteur à lui, c’était plus qu’il n’en fallait, et au risque de se casser le cou, il monta bravement à l’assaut.
Il arriva à la lucarne. On apercevait au loin les montagnes ; mais sa tourelle donnait sur une espèce de plate-forme, vis-à-vis de l’église, endroit où le gazon était rare et foulé aux pieds, ce qui prouvait que c’était le lieu le plus fréquenté, peut-être même la grande place de ce misérable village.
Au moment où il s’approchait de la lucarne, un oiseau perché sur la fenêtre s’enfuit effrayé.
— Ah ! s’écria Piquillo en enviant son sort et le suivant des yeux, comment, lui, qui a des ailes et la liberté, pouvait-il rester près de ces barreaux ?
Il regarda plus attentivement et vit que derriète ces barreaux l’oiseau avait bâti son nid, et que ce nid renfermait sa jeune couvée. Il se douta alors qu’il reviendrait.
Il émietta sur le rebord de la lucarne le pain de son diner, et au bout de quelques jours ; le fugitif ne s’enfuyait plus, il s’était apprivoisé ; Piquillo ne fut plus seul, c’était une distraction, une compagnie, un ami !
Et cependant les jours s’écoulaient avec une monotonie et surtout une lenteur qui le désespéraient. Devait-il donc passer ainsi tout le reste de sa vie ?
Chaque matin le curé reparaissait à la même heure, et lui faisait la même exhortation ; exhortation que Piquillo était forcé d’écouter ; et qu’en dépit de lui-même, il commençait presque à savoir par cœur ; triomphe dont le curé eût été bien fier, s’il l’avait connu ; mais son captif se garda bien de lui donner cette satisfaction. Enfin, le trentième jour ; après avoir, pour la trentième fois, répété son sermon ; le curé lui dit :
— Mon frère, êtes-vous converti maintenant ?
— Non, mon père.
— Voulez-vous recevoir le baptême ?
— Non, mon père.
— Vous n’êtes donc pas encore éclairé ?
— Pas plus qu’auparavant :
— C’est bien étonnant, dit le curé avec bonhomie. J’ai fait cependant tout ce que je pouvais. Alors, mon frère, et comme je vous l’ai expliqué ; ce n’est pas la faute du laboureur, c’est celle de la terre. Il faut qu’elle soit fortement et soigneusement labourée. Nous nous en occuperons dès demain ; vous ne me reverrez plus maintenant que quand vous serez converti.
— Adieu alors, mon père, et pour jamais !
— Peut-être ! Mais dès que le sillon sera disposé à recevoir le bon grain, vous n’aurez qu’un mot à dire, je reviendrai.
— Je ne vous donnerai pas cette peine.
Le curé Romero alla diner ; Alliaga attendit le jour suivant avec quelque curiosité et non sans inquiétude.
À l’heure ordinaire, le guichet ne s’ouvrit pas, le curé ne parut pas. Mais une porte qui jusque-là avait toujours été fermée et qui donnait sur le corps de logis principal, cria avec force sur ses gonds, et le prisonnier vit venir à lui un moine couvert d’une ample robe brune.
C’était le colossal et farouche Acalpuco.
Il tenait à la main une longue discipline formée de plusieurs bandes d’un cuir souple et flexible ; chaque bande de cuir était armée aux extrémités d’un morceau de fer ou de plomb. Il ferma la porte derrière lui, et dit d’un ton doucereux et béat qui contrastait avec son air brut et hébété :
— Mon frère, le curé Romero m’envoie vers vous, et chaque jour, pendant un mois, je viendrai vous visiter.
— Dans quel but ?
— Le voici. Je suis chargé par lui et par monseigneur l’archevêque, à mon grand regret, mon frère, de vous administrer aujourd’hui, sur les épaules nues, dix coups de disciplines ; chaque jour j’augmenterai d’un seul coup, de sorte que, le dernier jour du mois, j’aurai trente coups de plus à vous donner, ce qui sera bien pénible pour vous et bien fatigant pour moi, qui ne fais que cela ; tandis que, d’un seul mot, vous pouvez nous épargner à tous deux ce désagrément.
— Et ce mot quel est-il ?
— Déclarez que vous êtes converti, et que vous consentez à recevoir le baptême, c’est bien peu de chose ; auprès de ce que vous auriez à recevoir de l’autre manière.
— Je comprends, dit Alliaga, vous êtes le bourreau.
— Je suis, selon l’expression du curé, le frère laboureur, celui qui trace le sillon dans la mauvaise terre pour la forcer à rapporter et à produire.
— Vous aurez donc ma mort à vous reprocher ; car, dussiez-vous me tuer, vous n’aurez rien de moi.
— C’est ce que nous allons voir, dit le moine ; mais n’oubliez pas que vous m’y avez forcé, et que vous l’avez voulu ! Le ciel m’est témoin que je ne demandais qu’à me dispenser de ce surcroit de travail ; les autres me donnent déjà assez de mal.
Il s’avança alors vers Piquillo pour le saisir et le dépouiller de ses vêtements.
Il était tellement fort et vigoureux, et son adversaire paraissait si faible, qu’il ne doutait pas d’en triompher à lui seul et sans avoir besoin d’appeler à son aide les autres frères rédempteurs.
Piquillo sentit une sueur froide couvrir son front. Ce moment venait de lui rappeler les supplices de son jeune âge, les horribles traitements du capitaine Baptista et de son lieutenant Caralo ; aujourd’hui comme alors, il n’avait de secours à attendre de personne ; mais aujourd’hui il avait le sentiment de l’honneur et de sa propre dignité.
Décidé à mourir plutôt qu’à souffrir un tel opprobre, il avait choisi un pan de la muraille, contre lequel il allait se précipiter et se briser la tête, lorsqu’une idée lui vint, un dernier moyen de salut, que dans ce moment suprême il ne risquait rien d’employer, ou de tenter du moins.
Il tira de sa poche le pistolet que lui avait donné Yézid, et qui par malheur n’était pas chargé.
— Si tu fais un pas vers moi, dit-il au moine, je t’étends à mes pieds.
Le moine s’arrêta et pâlit.
Piquillo, jetant sur lui un regard ferme, et le tenant toujours en joue ; le vit trembler de tous ses membres. Il comprit que, malgré sa force d’Hercule, le frère rédempteur était un lâche qui ménageait peu la peau des autres, mais qui tenait beaucoup à le sienne. Il lui cria d’un ton menaçant :
— Bas les armes ! où je tire !
Le moine jeta à ses pieds la discipline aux pointes de fer dont il était armé.
Dès ce moment, Piquillo fut le maître, et Acalpuco l’esclave. Mais il ne suffisait pas de l’avoir effrayé ; il était probable qu’en sortant du cachot, le moine courrait donner l’alarme, et qu’on reviendrait en force ; il s’agissait donc de le gagner.
Le prisonnier baissa son pistolet, le frère rédempteur respira, les couleurs revinrent sur ses joues pâles.
— Vous faites là un triste métier, mon frère.
— Il faut vivre.
— On vous paie donc bien cher ?
— Fort peu ! tous les bénéfices sont pour le curé Romero. Toute la peine est pour nous.
— Et pour vos prisonniers.
— Je ne dis pas non, s’écria vivement le moine ; mais ils peuvent sortir d’ici quand ils veulent ; ils n’ont qu’un mot à prononcer, et ils sont envoyés à Valence, dans le palais de monseigneur. Là, ils sont bien traités, bien nourris jusqu’à la fête de Pâques, et on ne les oblige à rien, qu’à communier, tandis que nous, forcés de rester en ce lieu, dont nous ne pourrions sortir sans encourir la colère de l’archevêque, et par suite, celle de l’inquisition, nous n’avons qu’un modique salaire.
— Combien ?
— Un réal par jour et nourris en ermites, en anachorètes ! du pain et des oignons !
— En vérité, dit Piquillo d’un air touché, vous êtes à plaindre !
— Bien plus que vous, mon frère ; vous, au moins, vous avez du vin, et nous ne buvons que de l’eau ; à peine quelquefois le dimanche, quand les prisonniers sont dociles et que l’ouvrage ne donne pas trop, pouvons-nous descendre à l’hôtellerie, située au bas de la montagne, pour nous refaire des fatigues de la semaine ; et encore faut-il pour cela que nous ayons des économies.
— Écoutez, dit Piquillo, je veux que vous en fassiez avec moi.
— Comment cela ? reprit le frère étonné.
— Je vous donnerai trois réaux par jour.
— Ce n’est pas possible !
— Nous commencerons dès aujourd’hui ; les voici.
Il les tira de sa poche et les lui mit dans la main. Le frère, encore plus étonné, les prit et fit avec les trois pièces de monnaie le signe de la croix.
— Tous lez jours, poursuivit Piquillo, quand vous viendrez ici, je vous en donnerai autant ; de plus, la bouteille de vin que l’on m’apporte pour mon repas et à laquelle je ne touche pas. Celle d’aujourd’hui est encore intacte, vous pouvez vous en assurer.
Le moine tenait à se convaincre que tout cela n’était pas un rêve. Il déboucha la bouteille, qui était bien réelle, et son estomac, glacé depuis longtemps par l’eau du rocher, ne fut pas plutôt réchauffé par cette liqueur réconfortative, qu’il devint gai, causeur et bonhomme.
— Que faut-il faire pour cela ? demanda-t-il.
— Rien, répondit Piquillo. Vous viendrez tous les jours, comme frère laboureur, travailler à la terre, mais vous laisserez la terre en friche et votre charrue oisive.
— C’est facile ! ça me donnera moins de mal.
— Et à moi aussi. Vous déclarerez après cela, à la fin du mois, que malgré le zèle que vous y avez mis, les coups de discipline n’ont pas produit plus d’effet que les exhortations du curé.
— Je comprends… et après ?
— Nous verrons ! ce sera toujours cela de gagné pour moi.
— Et pour moi ! ajouta le moine en serrant les trois pièces de monnaie sous son froc ; mais cependant, dit-il avec un mouvement de crainte et d’hésitation, si cela venait à se savoir…
— C’est que vous l’aurez voulu, mon frère ; on peut bien découvrir ce que je vous donne là, dit Piquillo en montrant les réaux, mais on ne peut pas découvrir ce que vous ne me donnerez pas.
— C’est juste, répondit le moine tout à fait convaincu par ce raisonnement.
Fidèle à ce qui avait été convenu, il revenait chaque jour à la même heure avec autant d’exactitude que le curé. Il touchait ses trois réaux, buvait sa bouteille de vin, et sortait enchanté de son marché ; Piquillo ne l’était pas moins que lui.
Maintenant que son bourreau était devenu son confident et son complice, il lui avait plusieurs fois parlé d’évasion, lui promettant, s’il voulait le seconder, non pas trois réaux, mais trois ducats par jour.
Le frère rédempteur n’eût pas demandé mieux, mais cela lui était impossible.
La porte de la tourelle et celle de la première enceinte étaient fermées avec des barres de fer et de triples serrures dont les clés étaient entre les mains du curé. Les trois autres frères rédempteurs étaient dévoués à l’archevêque, sans compter que lui, Acalpuco, ne se sentait point l’audace téméraire qui porte à braver les dangers, et qu’au moindre bruit, au moindre cri d’alarme, les vingt ou trente paysans qui composaient le village ne manqueraient point d’accourir, prêts à défendre leur curé, et à se faire tuer pour le saint archevêque.
Quant à une évasion par ruse, elle était encore plus impraticable : aucun moyen de sortir de la tourelle. Une porte donnait, il est vrai, sur la cour, mais une fois dans la cour, on n’en serait pas plus avancé, puisqu’il fallait franchir une poterne. Or, le frère portier ne laissait passer personne sans un ordre exprès et par écrit du curé ou de l’archevêque, et encore après avoir bien examiné celui qui sortait ou qui entrait.
Piquillo était désespéré ; les jours s’écoulaient ; sa situation ne changeait pas et pouvait empirer. Son modeste trésor diminuait chaque jour, et avec lui devait probablement expirer le dévouement d’Acalpuco.
— Comment, lui disait-il, ne s’étonne-t-on pas au dehors de n’entendre de cette tourelle ni résistance, ni plainte, ni gémissement ?
— Rassurez-vous, lui répondit le moine en lui montrant une espèce de bâillon à l’usage des prisonniers ; nous avons ordre d’abord de nous servir de ceci pour que nulle parole, nul cri ne se fasse entendre, et qu’on puisse croire au dehors que la seule éloquence du curé suffit à la conversion des plus obstinés. Quant à la résistance, elle serait impossible, car dès que le prisonnier s’est mis à genoux sur ce prie-Dieu, voyez plutôt !
Le frère rédempteur lui apprit alors le secret qu’il n’avait pu découvrir.
En poussant un bouton de cuivre, un ressort partait qui enveloppait le patient, lui saisissait les bras et les jambes, et le forçait à courber son front vers la terre, comme s’il priait de la manière la plus fervente et la plus humble. Ce mouvement mettait à découvert ses épaules et ses reins, et il subissait, sans pouvoir se défendre, la fustigation qu’il plaisait à ses bourreaux de lui infliger.
Piquillo tressaillit à cet aspect, et toute la soirée, toute la journée du lendemain, il ne put se défendre des plus tristes et des plus sombres pressentiments.
Pour les chasser et se distraire, il fit, ce qui lui arrivait souvent quand il était seul, une visite à sa jeune couvée, c’est-à-dire qu’il établit son échafaudage, plaça sur son lit sa table, son fauteuil et le fatal prie-Dieu, qu’il ne regardait plus maintenant sans un frisson ; mais il en connaissait le secret, et en montant il se garda bien de toucher au ressort.
Il était parvenu à la hauteur de la lucarne, et à travers les barreaux il regardait le ciel et la cime des montagnes qui bordaient l’horizon ; soudain un bruit de mandoline ou de guitare dont on râclait d’une manière effroyable, l’arracha à ses rêveries et le força d’abaisser ses regards vers la terre, d’où partait ce concert infernal et sauvage.
Il aperçut le curé Romero et une trentaine d’hommes, de femmes et d’enfants, formant la population déguenillée de la paroisse d’Aïgador, rangés en cercle autour de cinq ou six bohémiens qui dansaient ou jouaient de la guitare.
Ils avaient été attirés par cet horrible charivari qui aurait mis en déroute une armée entière. Pour entendre une pareille musique sans prendre la fuite, il fallait être sourd, ou comme Piquillo, renfermé sous les verrous. Il resta donc.
Mais quelle fut sa surprise, lorsque, dans le bohémien. qui maniait la guitare d’une manière si extraordinaire, il crut reconnaître son ami Pedralvi : bientôt il lui fut impossible d’en douter, quand celui-ci se mit à chanter ou plutôt à crier à tue-tête, en s’accompagnant de la mandoline :
— Tra, la, la, la, la, toi qui m’entends du haut de ces créneaux, reconnais un ami !
Ces paroles étaient en arabe, et ce jargon inconnu amusait beaucoup le curé et les assistants.
— Tra, la, la, la, la, continuait Pedralvi en chantant, écoute-moi bien ! Consens, dès ce soir, à être baptisé, tra, la, la, la, la, parce qu’alors demain, de bon matin, on te conduira à l’église que tu vois d’ici… tra, la, la, la, la, et je t’enlèverai, tra, la, la, la, la, et si l’on veut s’y opposer, tra, la, la, la, nous les rosserons tous, à commencer par ce curé qui est là devant moi, et qui m’écoute en ce moment comme un imbécile, tra, la, la, la, la, la, la, la, la !
Pedralvi termina sa sarabande ou séguidille par des arpèges et des from-from de guitare si originaux et si imprévus, que le curé et tous les auditeurs applaudirent et crièrent bis !
C’est ce que demandait Pedralvi, et pour que Piquillo l’entendit mieux, il répéta en criant encore plus haut la chanson ou plutôt le programme qu’il désirait faire comprendre à son ami.

Quand il eut fini, il fit le tour du cercle, recueillit une somme de quelques maravédis, et en signe de remercîment il agita en l’air son chapeau en regardant du côté de la tourelle.
Une petite pierre, lancée à travers les barreaux, lui fit croire qu’on l’avait reconnu et qu’on l’avait compris.
Il descendit avec ses compagnons coucher à l’hôtellerie qui était au bas de la montagne, et, enchanté de sa journée, il passa une excellente nuit, persuadé que le lendemain il délivrerait son ami Piquillo.
Hélas ! celui-ci avait bien reconnu Pedralvi ; il avait écouté de toutes ses oreilles, et devinant, qu’on lui envoyait un bon avis, il n’avait pas perdu un mot de la chanson, mais il n’en avait pas compris une syllabe, par une raison infiniment simple dont Pedralvi ne se doutait pas, c’est que le pauvre Piquillo savait beaucoup de choses, mais ne savait pas l’arabe.
Aussi, le lendemain, de bon matin, suivi de ses amis, qui, sous leurs habits de bohémiens, avaient comme de l’or et du fer, Pedralvi avait gravi la montagne.
Il rôda vainement pendant toute la journée autour de l’église, espérant à chaque instant que les portes de la prison allaient s’ouvrir et que le néophyte serait conduit à l’église ; personne ne parut : toutes les portes restèrent closes, et le soir venu, Pedralvi désespéré fut obligé de retourner coucher à l’hôtellerie de la montagne.
Cependant le terme s’écoulait. Il y avait cinquante-neuf jours que Piquillo était prisonnier, et le dernier jour du second mois venait d’arriver.
Fidèle à la promesse qu’il avait faite au curé Romero, et impatient de connaître les nouveaux résultats de l’œuvre de la Rédemption, l’archevêque de Valence avait quitté sa résidence et s’était dirigé vers le petit village d’Aïgador.
Parvenu à Madrilejos, et avant d’entrer dans la montagne, il avait pris une escouade d’alguazils qu’il avait fait demander à Josué Calzado, corrégidor mayor de la province de Tolède, et que celui-ci s’était empressé de mettre à sa disposition.
Cette escouade devait d’abord servir d’escorte à l’archevêque, et puis ramener à Valence les nouveaux convertis que Romero devait lui livrer.
Le prélat, arrivé assez tard, fut reçu au presbytère par le curé, qui lui offrit son modeste appartement ; quant à l’escorte de monseigneur, qu’il était impossible de loger, elle descendit à l’hôtellerie de la montagne.
Ribeira se hâta d’interroger le curé, qui lui raconta avec satisfaction comment, par son zèle évangélique et ses pieuses exhortations, il avait arraché à l’erreur les cinq israélites qui lui avaient été confiés. Ils étaient convertis ou du moins ne demandaient qu’à l’être, et quelques mots de monseigneur suffiraient pour achever ce miracle.
Mais avec la même franchise et avec une profonde douleur, le curé était obligé d’avouer que tous ses efforts avaient été impuissants contre l’hérésie du Maure qui lui avait été amené.
Ni ses ferventes remontrances, ni les efforts et les fatigues d’Acalpuco n’avaient pu triompher de cet hérétique obstiné et endurci, dont l’Âme était rebelle aux effets de la grâce, et le corps insensible aux arguments de la discipline ; résistance d’autant plus étonnante qu’on était au dernier jour du mois, au moment des échéances les plus fortes ; car la veille il avait reçu trente-neuf coups de discipline, quarante le matin, et, à ce que disait le frère rédempteur chargé de ces détails, il n’y paraissait point, pas même sur sa peau !
— Quel endurcissement ! répéta le prélat avec un soupir. Est-il possible, mon Dieu ! qu’il y ait des hérétiques que rien ne puisse toucher ? Nous verrons cela demain, dit-il au curé, disposez tout pour que je puisse l’exhorter moi-même ; je veux, s’il faut y renoncer, n’avoir du moins rien à me reprocher. Nous devons pour cela n’épargner ni nos soins, ni nos peines !… c’est pour la foi ! et Dieu nous le rendra !
Le lendemain, Piquillo, couché sur son humble grabat, rêvait à Pedralvi et à la liberté, lorsqu’on entra brusquement dans la tourelle. C’était le curé Romero et les quatre frères rédempteurs, et avant que le prisonnier, à moitié endormi, eût pu se défendre, il fut arraché de son lit, bâillonné, dépouillé de son dernier vêtement et précipité au pied du prie-Dieu fatal.
Le curé fit jouet le ressort, et Piquillo, forcément prosterné, le front contre terre, ne put opposer aucune résistance à ses bourreaux ; nul espoir ne lui restait, pas même celui de mourir pour se soustraire à ce supplice infamant.
Acalpuco, tout en gémissant du devoir qui lui était imposé, se résignait à le remplir ; au moins, se disait-il en lui-même, ce bon jeune homme qui m’enrichit depuis un mois comprendra que c’est malgré moi, et que je ne puis pas faire autrement :
En ce moment, l’archevêque entra ; il fit signe au curé de l’attendre dans la pièce voisine, et dit aux frères rédempteurs.
— Attendez-moi, mes frères, je vous ferai avertir quand il en sera temps ; je veux rester seul avec ce malheureux et lui adresser mes paternelles et dernières exhortations.
Le prélat s’assit dans le fauteuil en bois, et s’approchant de Piquillo, toujours prosterné et toujours garrotté par des liens de fer :
— Mon frère, lui dit-il, pourquoi repousser avec cette obstination les trésors de la grâce ? J’espère encore vous convaincre. Vous ne me répondez pas…
Voyant alors le bâillon qui lui fermait la bouche :
— Vous ne le pouvez pas… je le vois… tant mieux ! ce sont des hérésies et des impiétés que l’on vous épargne. Écoutez-moi seulement : Si l’on a fait souffrir votre corps, c’est pour sauver votre âme ! Au lieu de nous en vouloir, mon frère, vous devez nous en remercier ! Qu’importe, après tout, cette enveloppe périssable dont nous ne devons aspirer qu’à nous dégager ?
N’agitez pas ainsi la tête avec colère, dit-il en s’interrompant, car, après tout, mon frère, ces tourments corporels, vous ne devez les imputer qu’à vous-même ! ce n’est pas nous, c’est vous qui êtes votre propre bourreau dans ce monde et surtout dans l’autre. En effet, d’après les douleurs légères, passagères, que vous venez d’endurer, jugez ce que doit être l’éternité de douleurs à laquelle vous condamnerait le Dieu que vous vous obstinez à repousser et qui vous prie, par ma bouche, d’avoir pitié de vous-même !
Piquillo, qui tremblait de rage, fit un nouveau geste de fureur.
— Pitié pour vous ! s’écria le prélat avec une componction qui allait jusqu’aux larmes ; pitié pour vous ! mon frère, je vous en conjure à mains jointes, et je vais, s’il le faut, m’agenouiller auprès de vous sur la pierre ! Pitié pour le salut du volte âme ! Consentez à vous convertir et à recevoir le baptême…
Ne me répondez pas… vous ne le pouvez pas ; mais faites-moi seulement signe de la tête que vous le désirez… que vous le demandez… et je fais à l’instant tomber ces entraves qui retiennent votre corps, comme les liens de l’hérésie retiennent votre âme et l’empêchent de s’élever au ciel.
Piquillo resta immobile.
— Un geste seulement, et vous êtes libre, et je vous emmène avec moi à Valence, dans mon palais, où des : délices ineffables vous attendent. Vous qui êtes l’enfant prodigue, vous trouverez en moi un père… Vous le voulez, mon fils, n’est-il pas vrai ?
Piquillo ne fit pas un geste.
— Mais si vous persistez dans l’impénitence finale, reprit le prélat avec colère, je n’oublierai point que le Dieu qui pardonne et châtie m’a remis ses pouvoirs sur la terre, et que si vous repoussez le premier de ces droits, il m’est ordonné d’user du second ! Je vais appeler les frères rédempteurs… C’est vous qui l’aurez voulu ! Un geste, un signe de consentement, peut m’arrêter encore.
Piquillo resta immobile, et le prélat se leva pour appeler.
XXXVII.
l’amitié.
Cependant, après avoir attendu toute la journée aux environs de l’église, après avoir erré autour des vieux bâtiments de la Rédemption, Pedralvi, convaincu que quelque obstacle impossible à prévoir ou à surmonter avait retenu le prisonnier, Pedralvi désolé, mais non découragé ; avait craint que sa présence et celle de ses compagnons n’excitassent des soupçons.
Il quitta donc à regret le presbytère, et redescendit à l’hôtel d’Aïgador, pour y réfléchir et méditer un nouveau plan de campagne.
Cette hôtellerie était l’une des plus misérables de l’Espagne ; qui en compte beaucoup de ce genre-là ; mais du moins il y trouvait un abri pour lui et les siens, et puis il ne s’éloignait pas de Piquillo, qu’il avait juré de délivrer ; et il était à portée de profiter de tous les événements.
Vers le soir, une troupe assez considérable passa non loin de la posada, se dirigeant vers la montagne. Deux heures après, redescendirent une demi-douzaine d’alguazils venant chercher un asile à l’hôtellerie.
On leur répondit que, pour tout logement, il n’y avait qu’une seule chambre, assez vaste ; mais elle était occupée par des bohémiens qui payaient bien. Quant aux provisions, si on en voulait, il fallait en apporter avec soi !… Tel était l’usage à peu près généralement répandu en Espagne.
— Comment ! s’écrièrent les alguazils avec colère, recevoir ainsi des gens de la suite et de l’escorte de monseigneur l’archevêque de Valence ; c’est une indignité !
L’hôtelier, son bonnet à la main, s’excusait de son mieux, et plus il déployait d’humilité, plus ses interlocuteurs élevaient la voix et montraient d’insolence : si bien que la discussion devenant des plus vives, Pedralvi, qui avait écouté de la fenêtre et qui était au fait de la question, s’empressa de descendre et de s’interposer.
— Qu’est-ce ? seigneur hôtelier, s’écria-t-il ; laisser à la porte des gens de la suite de monseigneur l’archevêque de Valence ? Ne pas donner à souper à l’escorte de monseigneur l’archevêque, de ce saint prélat, la lumière de la chrétienté ! Ce n’est pas possible et je ne le souffrirai pas.
Tous les alguazils saluèrent.
— Je ne suis qu’un pauvre bohémien vivant de ma guitare et de mes chansons ; mais j’aimerais mieux passer la nuit en plein air, au milieu de la montagne, et ne souper de ma vie, que de voir faire un tel affront à des personnes de cette importance.
— Alors ! s’écria l’hôtelier, vous consentez donc à leur céder votre chambre ?
— Non, dit Pedralvi, mais à la partager avec eux. Ils sont six et nous sommes cinq. La chambre est grande, on peut y tenir onze. Il y a des dortoirs de couvent où l’on est moins à l’aise.
— C’est juste ! s’écrièrent les archers de la Sainte-Hermandad.
— Ces messieurs d’un côté, nous de l’autre, continua Pedralvi. Tout le monde par terre ; mais à tout seigneur tout honneur ; vous leur donnerez tous les matelas et tous les draps de la posada, s’il y en a six !
— Il y en a huit ! répondit l’hôtelier avec orgueil, y compris ceux de ma femme et les miens.
— À merveille, dit Pedralvi, et à nous, vous nous donnerez quelques bottes de paille de la plus fraiche ; nous ne sommes pas difficiles.
Les chambres à coucher furent donc ainsi réglées. Quant au souper, c’était plus difficile. Les nouveaux venus n’avaient avec eux aucune provision, l’hôte pas davantage. Mais Pedralvi et les bohémiens avaient tous leur bissac bien garni. Ils offrirent à souper aux archers, qui n’eurent garde de refuser, et à l’hôtelier lui-même, qui ne se fit aucun scrupule d’accepter, attendu qu’après tout c’était toujours chez lui que l’on soupait, et qu’il n’abdiquait ainsi ni son titre, ni sa dignité de maître de maison.
Le repas fut copieux et délicat. On y vit même circuler le vin de Valdepenas, imprudence dont ne s’aperçurent ni l’hôte ni les archers, qui n’en avaient pas l’habitude ; mais le bon vin, et surtout les bons procédés, avaient rendu les convives expansifs et communicatifs, et, au bout de quelques minutes, Pedralvi savait déjà que le corrégidor mayor Josué Calzado avait donné au chef des alguazils l’ordre par écrit d’attendre à Madrilejos l’archevêque de Valence et de se tenir à sa disposition ; que, de plus, l’archevêque leur avait ordonné de le conduire au haut de la montagne, au petit village d’Aïgador, et d’y retourner le lendemain matin pour y prendre et conduire à Valence les prisonniers qu’on devait leur confier.
Cette dernière phrase frappa Pedralvi ; de tout le récit des archers ce fut la seule qui lui parut mériter quelque intérêt. Il avait fait circuler plusieurs fois l’outre qui renfermait le vin de Valdepenas, de sorte que les archers, après la fatigue de la journée, après un bon souper et d’abondantes libations, furent enchantés de se retirer dans la chambre à coucher commune, où ils ne tardèrent point à ronfler sur tous les tons.
Pedralvi, placé à l’autre côté de la chambre, expliqua alors à voix basse aux bohémiens ses amis ce qu’il comptait faire ; ils avaient promis à d’Albérique et à son fils Yézid de rendre leur jeune maître à la liberté. Ils pouvaient y réussir par cette ruse, et si ce moyen échouait, ils étaient tous gens de cœur et bien armés, valant chacun deux archers, et il serait toujours temps d’employer la force quand on n’aurait plus d’autre ressource.
Le jour commençait à peine à poindre, que Pedralvi songea à exécuter son projet. C’était une idée que Juan-Baptista lui avait donnée ; mais il lui était bien permis de voler une idée à l’ennemi qui lui avait volé son or ; c’était d’ailleurs faire retomber sur le capitaine la responsabilité de l’expédition et se sauver peut-être en le faisant pendre. Il n’y avait pas à hésiter, c’était double avantage.
Les Maures, étendus sur la paille, furent bien vite levés et sur pied. Leurs compagnons de chambre, qu’on avait gratifiés de matelas et de draps, s’étaient mis plus à leur aise : tous s’étaient complétement déshabillés et continuaient à dormir comme dort le juste ou le guet à pied, deux professions où il y a plus de fatigue que de profit à acquérir.
Chacun des bohémiens, s’avançant avec précaution, s’empara du manteau, du pourpoint, du costume complet de son voisin, sans oublier le chapeau à plume noire et la rapière.
Ils sortirent sans bruit, fermèrent la porte de la chambrée à double tour. Personne n’était réveillé dans la maison, pas même l’hôte, qui se levait toujours le dernier. Ils eurent donc tout le loisir de faire leur toilette à la cuisine, et quand ils se virent complétement équipés en archers, ils s’élancèrent hors de la maison, et commencèrent à gravir la montagne d’un pas rapide.
Malgré leur marche forcée, il était grand jour quand ils arrivèrent au pied des tourelles. Pedralvi se hâta de frapper à la poterne.
— Qui va là ? demanda le frère portier.
— Archers de la suite de monseigneur l’archevêque.
— Ce sont eux, cria le curé Romero, qui apparut en ce moment dans la cour ; ouvrez, frère Balthazar, ouvrez !
Pedralvi et les siens se trouvèrent dans la cour. C’était un premier retranchement d’emporté. Inutile de dire que le bohémien qui, la veille, chantait sur la plate-forme du presbytère, n’avait ni le même teint, ni les mêmes cheveux, ni la même voix que le grave archer qui s’adressait dans ce moment au curé.
— Nous venons, mon père, vous demander les prisonniers que vous devez nous remettre pour les conduire à Valence.
— Nos âmes rachetées, nos nouveaux convertis, dit le curé ; entrez, entrez, seigneurs archers.
Et il leur ouvrit l’intérieur du bâtiment, le corps de logis du milieu.
— Attendez-moi ici, continua-t-il, ce ne sera pas long, le temps de les délivrer. J’ai cinq néophytes tout disposés à vous suivre. Cinq israélites qui ne le sont plus… au contraire… tous bons chrétiens !
— Des israélites, dit à part lui Pedralvi ; ce n’est pas là ce que nous venions chercher. N’y a-t-il donc que ceux-là, mon père ? poursuivit-il tout haut.
— Il y en a bien encore un autre, mais il ne peut pas vous suivre, celui-là, c’est un Maure.
— Un Maure ! dit vivement Pedralvi.
— Un obstiné hérétique auquel on n’a pu faire entendre raison, et qui restera ici.
— C’est lui, se dit Pedralvi, qui, voyant encore une fois tous ses projets renversés, ajouta : tout est perdu ! Puis s’adressant encore au curé :
— N’y a-t-il donc, mon père, aucune espérance de l’amener à la bonne voie ?
— Bien peu, dit le curé en secouant la tête ; on a employé tous les moyens possibles, les plus doux comme les plus rigoureux, il a résisté.
Pedralvi avait peine à retenir son émotion.
— Ah ! il a résisté ? dit-il ; c’est qu’on ne s’y est pas bien pris.
— Pas bien pris ! répondit le curé, qui avait cru voir un reproche dans ce mot ; imaginez-vous, dit-il à voix basse, que tous les jours, mon frère, on l’a déchiré jusqu’au sang ! Que voulez-vous faire de mieux ? Et malgré cela, il a résisté, l’enragé hérétique !
Pedralvi manqua de sauter au cou du curé et de l’étrangler.
— Enfin, croiriez-vous, poursuivit le curé d’un air d’admiration, croiriez-vous que, dans ce moment, monseigneur lui-même est là, à l’exhorter !
Et il lui montrait une porte à droite qui donnait sur la tourelle.
— Je crains bien, continua-t-il, que Sa Seigneurie n’y perde ses peines, et que ni raisonnement ni torture ne puisse réussir ; mais du moins, dit monseigneur, nous n’aurions rien à nous reprocher. Je vais toujours vous chercher les autres, ceux dont les yeux se sont ouverts à la lumière. Asseyez-vous, seigneurs archers ; je vous demande à peine un quart d’heure.
À peine avait-il disparu, que Pedralvi, ne pouvant contenir son impatience, s’était élancé vers la porte que le curé lui avait désignée, et qui conduisait à la tourelle. Ses compagnons le suivirent. Le spectacle qui s’offrit à eux fut celui du pauvre Alliaga bâillonné et agenouillé devant l’archevêque, qui achevait de l’exhorter ! Le prélat, irrité d’avoir perdu ses frais d’éloquence, venait de se lever au moment où la porte s’ouvrit. Et voyant les habits noirs des archers, il s’écria :
— Que justice se fasse, et que le ciel soit vengé !
— Vous serez obéi, monseigneur, répondit Pedralvi en courant à Piquillo, dont il défaisait le bâillon.
— Qu’est-ce à dire ! s’écria le prélat avec surprise.
Mais sans lui donner le temps de s’étonner davantage ou d’appeler, à son aide, Pedralvi arrêta le cri qu’il allait proférer en fermant sa bouche entr’ouverte avec le bâillon qu’il venait d’ôter à Piquillo. Libre de parler, celui-ci indiqua le ressort du prie-Dieu qu’il fallait toucher pour le délivrer.
— Vite, s’écria Pedralvi, il n’y a pas de temps à perdre !
Et on lui jeta la défroque du sixième alguazil, dont les bohémiens s’étaient emparés et qu’ils s’étaient partagée entre eux par prévision et par ordre de leur chef.
— Aidez-le dans sa toilette, et hâtons-nous, car on peut venir.
— Et celui-ci, dit un bohémien en montrant Ribeira, qu’en faire ? où le mettre ?
— À la place de Piquillo !… Dépêchez.
Cet ordre était à peine donné, que deux des compagnons de Pedralvi s’étaient chargés de l’exécuter. Le prélat était loin d’inspirer à des Maures le même respect qu’à des Espagnols. Au contraire, ceux-ci ne voyaient en lui, comme dans le grand inquisiteur, que les chefs de leurs bourreaux, leurs persécuteurs les plus acharnés ; c’était servir Dieu et leur religion que de venger leurs frères torturés ou immolés par milliers, et l’on ne peut se figurer avec quel plaisir, avec quelle rapidité, ils eurent, en quelques minutes, dépouillé Ribeira de ses vêtements. Ne pouvant proférer une parole ni pousser un cri, celui-ci, forcé de s’agenouiller devant le prie-Dieu, se vit en un instant renversé, garrotté, agenouillé en touchant la terre de son front renversé.
— Bien, dit Pedralvi, advienne maintenant que pourra ! sortons !
Emmenant Piquillo habillé comme eux et confondu dans leurs rangs, ils repassèrent par la pièce où le curé les avait laissés et qui occupait le bâtiment du milieu. Ils s’élancèrent de là dans la cour, et au moment où ils entraient, ils aperçurent le curé arrivant avec ses néophytes, les cinq juifs convertis malgré eux et chrétiens de fraiche date.
— Les voici, dit le curé d’un air triomphant, je vous les livre.
— Bien, dit Pedralvi, qui avait hâte de sortir, et qui gagnait à grands pas la poterne.
— Où allez-vous ? dit le curé.
— Rejoindre monseigneur qui nous attend.
— Il n’est donc plus dans la tourelle ?
— Non, dit Pedralvi, à qui tout était indifférent, pourvu qu’il fût dehors. Monseigneur vient de se rendre au presbytère, vous abandonnant le prisonnier, pour que vous ayez sur-le-champ à en faire bonne et prompte justice.
— Bien, fit le curé, je vais avec vous prendre les ordres de monseigneur.
— Ses ordres sont que vous vous occupiez d’abord du prisonnier, et que vous veniez après lui rendre compte de ce qui se sera passé.
— J’obéis, dit le curé, et ferai de mon mieux… Puis il cria à un des frères qui traversait la cour : Dites au frère rédempteur Acalpuco de descendre sur-le-champ, nous avons besoin de lui. Seigneur archer, dit-il à Pedralvi en faisant signe d’ouvrir la poterne, je vous rejoins dans l’instant au presbytère, vous et monseigneur… le temps d’exécuter ses ordres… Nous ferons coups doubles, s’il le faut, pour le satisfaire et lui être agréable.
La poterne s’était ouverte : Pedralvi, ses compagnons et les néophytes défilaient un par un, feignant de se diriger vers le presbytère et prêts à descendre la montagne dès qu’ils seraient hors de vue. En ce moment le curé, en se retournant, aperçut Acalpuco qui venait à lui.
— Ah ! c’est toi, s’écria-t-il, viens, suis-moi.
— Où allons-nous, monsieur le curé ?
— À la tourelle, où le prisonnier nous attend…
— Pauvre jeune homme ! dit le frère en lui-même.
— As-tu ta discipline ?
— Toujours, monsieur le curé.
— Où en étions-nous hier ?… à la quarantaine, je crois ?
— Oui… oui… monsieur le curé, dit le frère en hésitant.
— Alors, et puisque monseigneur l’exige, nous ferons mieux que cela aujourd’hui.
— Ô ciel !
Dix de plus !
— Permettez, monsieur le curé…
— Paresseux !… tu réclames…
— Pas pour moi ?
— Qu’est-ce que c’est ? dit le curé, en le regardant d’un air sévère ; ne t’ai-je pas dit que monseigneur l’ordonnait et le voulait ?
— C’est différent, dit le frère effrayé.
C’est dans cette disposition d’esprit que le frère et le curé se rendirent dans la tourelle.
Quelques jours après, des bruits sourds et dont on ne pouvait au juste apprécier la valeur, circulaient à Tolède, à Valence et même à Madrid.
Le patriarche d’Antioche, l’archevêque de Valence, le saint et révéré Ribeira, retenu par une grave indisposition, était malade au milieu des montagnes, dans un misérable village, où quelque bonne œuvre sans doute l’avait conduit. Il n’y avait pas le moindre doute là-dessus ; mais ce qui en offrait beaucoup, c’était la nature de sa maladie. Le curé Romero, dans le presbytère duquel le saint prélat était alité, avait raconté aux médecins accourus en toute hâte, que Sa Seigneurie avait glissé le long d’un précipice, où des pointes de rochers l’avaient cruellement déchirée ; heureux encore que le pieux archevêque en fût quitte à ce prix ; et malgré la défense du prélat, le chapitre de Valence avait absolument voulu célébrer un Te Deum en actions de grâce de cette heureuse aventure. D’un autre côté, les ordres les plus sévères avaient été donnés au corrégidor mayor de la province de Tolède, Josué Calzado, de poursuivre dans toutes les directions une escouade de faux alguazils qui parcourait les grands chemins. Le corrégidor avait d’abord repoussé avec mépris une pareille assertion, tant il était sûr de la manière dont se faisait la police, mais il fut bientôt forcé de croire à cette nouvelle, lorsqu’on eut saisi plusieurs soldats de la Sainte-Hermandad complétement étrangers à cette milice, et qui n’étaient autres que les compagnons du capitaine Juan-Baptista.
Arrêtés, ainsi que leur chef, dans une posada, au moment où ils arrêtaient eux-mêmes l’hôtelier, en commençant par saisir les clés de sa cave, ils furent dirigés vers Madrid ; l’ordre avait été donné de les livrer à l’inquisition comme coupables et complices d’attentat impie sur la personne d’un archevêque.
— Par saint Jacques, se disait Juan-Baptista, qui n’y comprenait rien, c’est jouer de malheur ! être arrêté pour le seul crime que, peut-être, je n’aie pas commis !
Il trouvait cette décision si injuste que, dès le second jour, il en avait appelé, en s’échappant des mains de ses gardes, regrettant, non pas ses compagnons qu’on allait brûler ou pendre, mais l’or qu’il avait volé comme alguazil à Piquillo et à Pedralvi, et que d’autres alguazils venaient de lui reprendre. En attendant, rien ne peut donner une idée de la perturbation que cet événement avait jetée dans la police de Tolède et de la Nouvelle-Castille ; c’était à ne plus s’y reconnaître. Impossible de distinguer les vrais des faux alguazils, et chaque jour, par exemple, on voyait en pleine rue deux de ces messieurs se mettre mutuellement la main sur le collet et s’arrêter réciproquement de par le roi. L’emploi n’était plus tenable ; aussi Baptista Balseiro s’était décidé à en changer ; il avait abandonné la police pour l’armée, et portait maintenant l’uniforme de capitaine dans l’infanterie espagnole.
Pedralvi cependant et ses compagnons, sans s’inquiéter de la situation où ils laissaient l’archevêque, avaient évité le presbytère et descendaient de la montagne par un autre sentier que celui qu’ils avaient parcouru le matin ; ils ne se souciaient pas de repasser devant l’hôtellerie d’Aïgador, quoiqu’ils l’eussent pu sans danger, car les archers qu’ils avaient laissés étaient hors d’état de les poursuivre, vu la brièveté, ou plutôt l’absence totale de costume où ils se trouvaient.
Ils furent même obligés, pendant deux ou trois jours, de garder l’hôtellerie, attendant les nouveaux vêtements qu’ils avaient fait demander à Tolède, et que Josué Calzado leur envoya, mais trop tard ; ils étaient tous enrhumés ! nouvelle fatalité à ajouter à toutes celles qui accablaient en ce moment le corps respectable des alguazils.
Pedralvi avait pris un chemin plus difficile, mais plus sûr, au milieu des rochers. Au bout d’une heure de marche, et à un endroit où deux ou trois routes praticables se présentaient, Pedralvi dit aux juifs qu’ils avaient jusque-là escortés en silence :
— Vous êtes libres, mes amis !
— Libres ! s’écrièrent ceux-ci ; libres !
— De ne pas être chrétiens, si cela vous convient. Il ne tient qu’à vous d’aller à Valence, cette route y conduit ; ces deux autres chemins conduisent ailleurs.
Les juifs prirent les deux autres chemins et disparurent.
Quand les Maures se trouvèrent seuls :
— Mes amis ! mes frères ! s’écria Piquillo en se jetant dans les bras de Pedralvi et de ses compagnons ; que ne vous dois-je pas !
— Tu ne nous dois rien, et nous ne sommes pas encore quittes envers toi, répondit Pedralvi. Ne nous as-tu pas donné l’exemple ? N’as-tu pas délivré Gongarello ? N’as-tu pas deux fois sauvé Juanita ? Quand nos ennemis s’unissent pour nous opprimer, unissons-nous, mes frères, pour nous défendre et nous aimer.
Tous se prirent les mains et se les serrèrent en signe d’alliance et d’amitié.
— Maintenant, dit Pedralvi, continuons notre marche, nous ne sommes pas en sûreté ici.
Ils descendirent encore pendant près de deux heures et arrivèrent au versant de la montagne, bien avant Madrilejos, à une plate-forme environnée d’arbres et de rochers. Devant eux, à leurs pieds, on découvrait un gros bourg, circonstance heureuse pour la caravane. Leurs provisions étaient épuisées et leur appétit se faisait vivement sentir, après une longue marche entreprise de grand matin et par l’air vif de la montagne. Pedralvi détacha un des siens, garçon alerte et intelligent, qui partit, chargé d’une large besace vide, mais prudemment et avant son départ, il quitta le manteau noir, la rapière et tout son costume d’alguazil.
— Il a raison, s’écria Pedralvi, imitons-le, mes amis, et de peur de poursuites, faisons disparaître d’abord toutes les traces de notre expédition.
Il y avait derrière eux, au milieu des rochers, un précipice dont on ne voyait pas le fond et où tombait un large torrent, formé par la réunion des eaux de la montagne. C’est là que s’engouffrèrent toutes les dépouilles des archers, et, vu que Pedralvi et ses compagnons avaient par-dessous leurs habits de bohémiens, la métamorphose fut bientôt complète. Piquillo ne s’était point débarrassé de sa noire défroque, et pour cause. Il n’avait point d’autre vêtement. Mais un instant après, le pourvoyeur revint avec une besace bien garnie, et portant sous son bras un paquet destiné à Piquillo. C’était un habillement complet, et de plus, une robe de pèlerin, le tout acheté chez un fripier du village. La toilette ne fut pas longue, et tous, assis sur l’herbe, firent gaiement honneur au repas étalé devant eux. C’était un pâté de venaison, deux volailles rôties, du pain blanc et en outre de bon vin, qui fit plus d’une fois le tour du cercle.
Le repas terminé, la parole fut à Pedralvi, qui dit :
— Quelque plaisir que nous ayons à voyager ensemble, il faut nous séparer et retourner à Valence, chacun de notre côté ; réunis, nous pourrions exciter des soupçons qu’il importe d’éloigner, sinon pour nous du moins pour le seigneur d’Albérique notre maître, et son fils Yézid, qui seraient perdus si l’on se doutait seulement qu’ils ont eu connaissance de notre expédition. Je conduis le seigneur Alliaga pendant quelques lieues encore, et je vous rejoindrai… Adieu donc, et à bientôt.
Ils prirent tous des sentiers différents et disparurent, se dirigeant vers Valence.
— Toi, frère, dit Pedralvi, quand il fut seul avec Piquillo, tu ne vas pas de ce côté, car on t’attend à Madrid.
— Qui donc ? dit Piquillo avec émotion.
— La senora Aïxa !
— Aïxa !… qui t’a dit !… comment connais-tu ce nom ?
— Par la camariera de la reine… par Juanita.
— C’est vrai… tu as vu Juanita ?
— Impossible… puisque depuis deux mois, frère, je n’ai été occupé que de toi ; mais j’ai écrit à Juanita, je lui ai appris notre mésaventure et ta disparition ; elle en a parlé à la senora Aïxa et à sa sœur Carmen.
— Mes anges tutélaires.
— Tu as raison… car ces deux jeunes filles, surtout la senora Aïxa, ont été dans des inquiétudes, dans une douleur dont je ne te parle pas.
— Au contraire, s’écria Piquillo avec ivresse, dis-moi tout.
— Ne pouvant découvrir ce que tu étais devenu, je te croyais à Madrid dans les prisons de l’inquisition ; la senora Aïxa, par ses soins, par son crédit, a enfin acquis la certitude du contraire ; elle l’a appris à Juanita, qui m’en a prévenu, la suppliant de la tenir au courant de tout, offrant pour ta délivrance toutes les sommes nécessaires.
— Merci, merci ! répétait en lui-même Piquillo attendri.
— Mais nous n’avions besoin de rien, poursuivit Pedralvi avec fierté, et Yézid m’avait déjà dit : Il faut tout sacrifier pour retrouver mon frère ; il faut le délivrer à tout prix ; n’épargne ni l’or ni les recherches. Et pendant que je cherchais, c’est lui, c’est Yézid, qui a découvert ta prison. Il avait interrogé un de nos ouvriers que Ribeira avait autrefois baptisé par force ; il a appris de lui les détails de ces tortures, de ce cachot qu’ils appellent l’œuvre de la Rédemption. Il a soupçonné que c’était là qu’on t’avait renfermé. Il à organisé alors l’expédition, et s’il m’en a donné le commandement, c’est qu’un événement, un malheur qui nous menace tous, l’a forcé de partir pour Madrid.
— Quel événement ? quel malheur ? dit vivement Piquillo.
— Je l’ignore. Il te l’apprendra sans doute. Mais il était hors de lui, et Albérique, son père, bien plus agité encore ; ses traits étaient tout bouleversés ; il s’écriait : Pars à l’instant, il le faut ! Et je l’ai entendu murmurer à demi-voix : Si Piquillo était là pour te seconder ! Mes fils ! mes deux fils ! ce ne serait pas trop !
— Et tu m’assures que Yézid est à Madrid demanda Piquillo.
— Il doit y être maintenant. Et au moment où je partais moi-même pour te délivrer, continua Pedralvi, je recevais une lettre de Juanita, qui m’écrivait : « Je ne sais ce qui arrive à la senora Aïxa ; elle est depuis quelques jours dans un désespoir affreux. Carmen, qui pleure avec elle, essaie en vain de la consoler ; et j’ai entendu les deux jeunes filles s’écrier : Si du moins Piquillo était là pour nous aider et nous sauver ! »
— Tous ceux que j’aime avaient besoin de moi, et j’étais loin d’eux. Je pars, je pars ! dit Piquillo, pâle d’émotion et pouvant respirer à peine. Adieu, frère, adieu ! Retourne à Valence, où d’Albérique t’attend, car le voilà seul et privé de ses deux fils… Moi, je vais à Madrid retrouver mon frère Yézid.
— Et la senora Aïxa, fit Pedralvi en souriant.
— Oui… oui… je ne pourrais vivre sans elle !
— Comme moi sans Juanita, dit Pedralvi. Allez donc, et que le Dieu d’Ismaël vous conduise ; mais auparavant laissez-moi remplir les ordres d’Yzid.
Il donna alors à son jeune maître presque tout l’or qu’il avait sur lui, de plus des armes, et lui recommanda bien, quelque diligence qu’il eût envie de faire, de prendre des chemins détournés, d’éviter les villes et les villages. Nul doute qu’on ne le poursuivit, que son signalement ne fût donné, et qu’il n’y eût ordre de l’arrêter. Son costume de pèlerin était une sauvegarde ; c’était, après la robe de moine, l’habit le plus respecté en Espagne, et une fois à Madrid, don Fernand d’Albayda et les protections qu’il pouvait avoir assoupiraient cette affaire ; le tout était d’arriver à Madrid sans encombre.
Enfin, après mille autres recommandations et bien des marques de tendresse, les deux amis se séparèrent.
Piquillo se dirigea ver Tolède, il en était à six ou sept lieues ; de Tolède à Madrid il y en a dix-huit ; il pouvait être arrivé le lendemain au soir, s’il ne lui survenait aucun accident, et il voyageait avec prudence.
Il avait dépassé Consuegra et longeait un bois dont les arbres touffus le préservaient de la chaleur du soleil. Il entendit derrière lui les pas d’un cheval. Il tourna légèrement la tête. Il vit un cavalier, un militaire qui faisait la même route que lui. Piquillo ne hâta ni ne ralentit sa marche, pour ne donner aucun soupçon à son compagnon de voyage.
Le cavalier qui était derrière lui semblait ne point vouloir fatiguer sa monture, et il n’allait qu’au pas. Il eut cependant bien vite atteint Piquillo, mais il ne le dépassa point, et se tint pendant quelque temps sur la même ligne que lui. Piquillo, enveloppé de sa robe de pèlerin, le front couvert d’un chapeau à large bord, ne disait rien, ne levait pas la tête et marchait sans faire la moindre attention au cavalier, qui, sans doute blessé du silence ou du dédain du piéton, toussa d’un air de supériorité, et laissa du haut de son cheval tomber ces paroles :
— Ami… suis-je bien ici sur la route de Tolède ?
À cette voix trop bien connue et dont la vibration le laissait toujours tressaillir, Piquillo leva les yeux.
Ce militaire, paré d’un bel uniforme et portant les insignes de capitaine, avait toute l’allure et les manières de Juan-Baptista ; quant à la voix, c’était la même. Piquillo baissa vivement les yeux, et répondit à la demande du voyageur par un signe de tête affirmatif.
— C’est donc bien la route de Tolède ?
— Oui, dit brièvement Piquillo.
Il paraît qu’il y avait dans cette seule syllabe, ou dans la manière dont elle était prononcée, une émotion qui n’était pas naturelle ; car depuis ce moment le capitaine fit tous ses efforts pour apercevoir les traits de son compagnon de voyage. Le large chapeau le gênait beaucoup. Il fit faire alors à son cheval quelques pas en avant, se retournant et se baissant pour regarder. Plusieurs fois il renouvela cette manœuvre, qui, à ce qu’il paraît, ne le satisfaisait qu’imparfaitement, et Piquillo impatienté se dit en lui-même :
— Je suis bien bon de me laisser espionner par ce misérable, qui doit avoir encore plus que moi la crainte d’être arrêté ; ce nouveau déguisement même me le prouve.
Levant alors son chapeau, et tirant de sa poche un pistolet qu’il arma :
— Capitaine Juan-Baptista ! s’écria-t-il.
Celui-ci à son tour tressaillit.
— Gagnez le large ou je tire sur vous ; il y aura dans un instant un bandit de moins en Espagne.
À l’air ferme du jeune homme, à sa voix menaçante, et surtout au pistolet dont sa main était armée, Juan-Baptista n’eut plus de doutes.
— Au revoir ! s’écria-t-il en regardant Piquillo d’un air moqueur.
Il piqua son cheval, et un instant après il disparut dans un nuage de poussière. Alliaga en était débarrassé ; mais cette vue seule lui avait laissé dans le cœur une impression pénible, et dans l’esprit de fâcheux présages. Jamais le capitaine ne s’était offert à ses yeux, que cette rencontre ne fût pour lui comme l’annonce de quelque grand malheur, et cette fois ce n’était point un vain pressentiment, ni une crainte chimérique. Le capitaine était homme à le dénoncer au prochain village, à donner du moins son signalement, qui était bien reconnaissable.
La prudence défendait à Piquillo de suivre le chemin qu’il avait pris. Il abandonna donc la grand’route et en suivit une de traverse qui s’offrait à lui. Il marcha environ trois quarts d’heure au milieu d’un pays riche et bien cultivé, et arriva à une belle forêt, traversée par cette route. Il s’y engagea sans hésiter, persuadé que cela devait conduire à quelque habitation. En effet, il se trouva, au bout d’une demi-heure, en face d’un château d’architecture gothique, demeure seigneuriale s’il en fut, avec pont-levis, corps de logis principal, deux ailes, vastes jardins et une cour immense, alors remplie de monde. C’étaient sans doute les habitants du joli village qu’on apercevait sur le coteau, et il y avait probablement quelque grande fête chez le seigneur de l’endroit. Les gens qui s’amusent sont peu dangereux, et ce rassemblement n’inspira nulle défiance à Piquillo. D’ailleurs il avait déjà été vu, et des jeunes filles s’étaient levées à l’aspect du pèlerin, et courant au-devant de lui, l’avaient entrainé à une table Piquillo accepta donc, pour détourner le soupçons, le verre que lui offrait la jeune paysanne. où l’on traitait généreusement tous ceux qui se présentaient. Or, les pèlerins ont toujours faim et soif ; se montrer autrement aurait paru extraordinaire. Piquillo accepta donc, pour détourner les soupçons, le verre que lui offrait la jeune paysanne.

— À qui appartient ce château ? demanda-t-il.
— À un seigneur portugais qui a des biens en Espagne, mais qui les visite rarement, à preuve qu’il n’était jamais venu ici, et que c’est la première fois que je le vois, moi, qui suis la jardinière du château.
— Et pourquoi y vient-il aujourd’hui ?
— Pour se marier.
— C’est différent ! dit Piquillo. Et quel est-ce seigneur portugais ?
— Le duc de Santarem.
XXXVIII.
le mariage.
— Je comprends alors ces réjouissances et ces fêtes, dit Piquillo, puisque le propriétaire de ce riche domaine se marie. Et qui épouse-t-il ?
— Une demoiselle de Madrid, répondit la jardinière. La fille d’un ancien militaire.
— Est-elle riche ?
— Elle n’a rien.
— Est-elle jolie au moins ?
— Charmante ! quoique bien pâle et triste ! elle ne rit jamais. Ça m’effraierait bien une mariée comme celle-là ! Il est vrai que monseigneur n’est guère plus gai. Il regarde toujours autour de lui avec un air de terreur… comme si quelque malheur allait lui arriver ! Et ce malheur… c’est sans doute son mariage, car sa fiancée ne paraît pas folle-de lui. C’est une drôle de noce que celle-là !

— En vérité ? dit Piquillo, qui s’intéressait malgré lui au récit de la jeune jardinière. Et quand se célèbre ce mariage ?
— Dans ce moment même. N’entendez-vous pas les cloches ? La chapelle du château, dont vous voyez d’ici portail, est si petite, que tout le monde n’y peut tenir ; voilà pourquoi la moitié du village reste ici sur la pelouse. Imaginez-vous, seigneur pèlerin, continua la jeune fille, enchantée de pouvoir causer, imaginez-vous que les mariés sont arrivés hier soir. La noce ne devait se faire que demain, mais il est survenu un ordre de la cour pour que le mariage eût lieu aujourd’hui même.
— C’est étonnant ! dit Piquillo. Mais en êtes-vous bien sûre ?
— Je tiens tous ces détails d’une jeune fille qui est arrivée ici avec la mariée, et qui l’a habillée ce matin, Juanita.
— Juanita ! s’écria Piquillo avec émotion, tout en se disant en lui-même que toutes les femmes de chambre s’appelaient Juanita.
— Tenez, tenez, continua la jardinière, le bruit des cloches redouble, et j’entends les orgues ; c’est sans doute le moment de la bénédiction ; venez, seigneur pèlerin, approchons-nous, nous verrons peut-être de loin.
Piquillo la suivit par un mouvement machinal, et se tint quelque temps devant la porte de l’église.
Mais il ne distinguait rien, il y avait trop de monde devant lui. Tout à coup un flot de curieux venant du dehors et faisant irruption en avant, porta Piquillo d’une seule secousse presque au milieu de la chapelle, et sans un pilier qui servit de digue aux vagues mouvantes de la foule, il aurait été jusque sur les marches de l’autel.
Appuyé contre le pilier qui le soutenait, et cherchant à s’élever sur le bâton d’une chaise, Piquillo dominait en quelque sorte tous ceux qui l’entouraient. La cérémonie venait de finir. Le marié avait donné le bras à sa femme qu’il emmenait. Le suisse marchait en avant, faisant faire place avec sa hallebarde, manœuvre qui avait produit dans l’assistance les mouvements onduleux que nous venons de décrire. Piquillo, placé du côte du marié, ne pouvait d’abord voir que lui : il leva les yeux et se crut en proie à un vertige, à une hallucination : dans ce grand seigneur revêtu de riches habits de fête et décoré de plusieurs ordres, il crut reconnaître, il reconnut les traits du capitane Juan-Baptista, qu’il avait laissé une heure auparavant, habillé en militaire et galopant sur la grande route.
— Encore lui ! toujours lui ! se dit-il, je le vois partout ! Et il mit un instant sa main devant ses yeux.
Ce qui lui paraissait incompréhensible le sera moins pour nos lecteurs, s’ils veulent bien se rappeler que le père du duc de Santarem était également le père de Juan-Baptista. La rencontre que Piquillo avait faite le matin, et l’impression sous laquelle il se trouvait, lui avaient fait paraître plus frappante encore la ressemblance qui existait entre eux et qui était déjà très-grande.
Honteux cependant de sa faiblesse et de sa crédulité, il retira vivement la main qu’il avait portée à ses yeux, et regarda de nouveau.
Mais cette fois quels furent les battements de son cœur, quel froid glacial se glissa dans ses veines, quelle pâleur couvrit son visage ! Il voyait à dix pas de lui et donnant le bras au duc de Santarem, son seul amour, son seul rêve, le bonheur de sa vie, son ange adoré, Aïxa belle et pâle, habillée en mariée, l’œil hagard et immobile, s’avançant sans rien voir et sans rien entendre.
Il voulut appeler : Aïxa ! Aïxa ! c’est moi ! Sa langue ne put articuler une parole. Il voulut s’élancer… la foule l’en empêchait, et ses jambes tremblantes se dérobaient, sous lui ; enfin, du fond de sa poitrine oppressée sortit un long sanglot, un cri horrible de désespoir, et il s’évanouit.
Tout était fini pour lui, il avait cru mourir. Le ciel n’avait même pas daigné lui accorder ce bonheur.
Le tumulte de la foule qui se heurtait en sens divers, les cris des femmes que l’on pressait contre la porte de sortie, empêchèrent d’entendre le cri de douleur de Piquillo. Tous ceux qui l’entouraient s’éloignaient pour suivre le cortége des deux mariés. Le pauvre jeune homme se serait brisé de toute sa hauteur sur les dalles de l’église ; mais soutenu d’abord par le pilier, puis par les chaises qui le reçurent au moment où il tombait, il resta là, immobile et privé de tout sentiment.
Un instant après, cette petite chapelle si tumultueuse et si pleine était devenue silencieuse et déserte. Il n’y avait plus personne autre que Piquillo ; le jardinier avait refermé du dehors les deux grandes portes, empressé de courir comme tout le monde aux divertissements et aux jeux qui les attendaient.
Piquillo resta longtemps sans connaissance, et bien des heures s’étaient écoulées lorsqu’il revint à lui ; il était couvert de sueur, et l’air humide et froid qui régnait dans l’église l’avait réveillé. Une nuit profonde l’environnait, et il fut quelques instants avant de pouvoir se rappeler où il était et ce qui lui était arrivé. Enfin, et peu à peu, il sentit en lui la vie renaître, et avec elle le sentiment de ses maux. Il écouta l’horloge du château qui sonnait dix heures. Il se leva avec rage, avec une jalouse fureur ; il courut à la grande porte de l’église, elle était fermée.
Un léger bruit se fit entendre alors à l’autre extrémité de la chapelle, et Piquillo vit briller une petite lumière qui s’avançait lentement. Il se dirigea de ce côté. Une femme venait de s’approcher de l’autel ; elle s’y était agenouillée, et priait avec ferveur. Il entendit prononcer le nom d’Aïxa.
Ce nom avait conservé pour lui un charme irrésistible. Il s’avança… Il écouta en respirant à peine cette voix qui avait deviné sa pensée et qui priait pour Aïxa ! Il entendit murmurer aussi le nom de Fernand, et enfin le sien, celui de Piquillo… et lui qui, s’abandonnant à son désespoir, allait maudire le ciel et la terre, sentit tout à coup son cœur se fondre. Il tomba à genoux en sanglotant et s’écria :
— Soyez bénie, vous qui ne m’avez pas oublié ! vous qui priez pour moi !
La jeune fille s’était levée effrayée, mais à cette voix bien connue, elle s’arrêta, et tremblante d’émotion et de joie, elle dit :
— Qui est là ?… qui a parlé ?
— Piquillo.
— Lui !… s’écria Carmen ; car c’était elle qui, dans l’ombre et le silence de la nuit, venait prier Dieu pour tous ceux qu’elle aimait ! Lui, Piquillo ! Ah ! quel bonheur pour la pauvre Aïxa, qui tout à l’heure encore me disait : Si je pouvais du moins le voir ! le voir une seule fois avant de mourir !
Elle a dit cela ! s’écria Piquillo, tremblant maintenant de joie et d’ivresse.
— Silence ! répondit Carmen en mettant sa main devant la bouche de Piquillo ; pas un mot ! et suivez-moi. Venez ! venez !
Elle le prit par la main, ouvrit la petite porte par laquelle elle était entrée et qui communiquait avec le château. Ils s’avançaient dans l’obscurité, le long d’un vaste corridor qui semblait traverser tout le bâtiment principal. On entendait au loin le bruit et le tumulte de la noce, les éclats joyeux des villageois qui dansaient dans la grande salle basse, et les sons de l’orchestre qui faisaient vibrer les fenêtres gothiques du château. Piquillo suivait sa conductrice en silence, sans rien lui demander. Enfin ils arrivèrent à une petite pièce, une antichambre à peine éclairée.
— Attendez-moi, dit Carmen, je vais prévenir Aïxa, car la surprise et la joie lui feraient mal.
Et elle entra dans la chambre à coucher de la mariée.
Piquillo sentait le cœur lui battre à lui ôter la respiration. Il fut obligé de s’asseoir, et il attendait, et il lui semblait que chaque minute avait pour lui la durée d’une existence.
Carmen sortit enfin.
Elle n’avait été qu’un instant.
— Entrez… entrez, lui dit-elle, je vous laisse !
Piquillo se précipita dans la chambre d’Aïxa. Elle était assise, pale, les cheveux en désordre et à demi vêtue ; près d’elle, un secrétaire était ouvert, et elle tenait à la main des papiers qu’elle laissa échapper en apercevant Piquillo. Elle poussa un cri et se jeta dans ses bras.
— Te voilà ! te voilà donc enfin ! tu nous es rendu !
— Oui, mais le plus malheureux des hommes puisque j’arrive trop tard… puisque je n’ai pu vous sauver !
— Je te vois du moins… je te vois… je n’espérais plus ce bonheur, lui dit-elle.
Et tout en parlant ainsi, elle le serrait contre son cœur, le couvrait de ses larmes et de ses baisers, et Piquillo, hors de lui, était prêt à succomber sous le poids d’un bonheur qu’il n’osait espérer ni comprendre, mais qui l’enivrait, qui l’égarait, lorsqu’Aïxa, suspendue à son cou, s’écria en l’embrassant :
— Mon frère !… mon frère bien-aimé !
Piquillo la repoussa loin de lui, chancela et tomba sur le parquet, pâle, haletant, inanimé.
La foudre venait de le frapper ! il éprouvait une souffrance horrible. Deux commotions si violentes et si imprévues, le passage subit d’un bonheur inouï à un extrême désespoir, surpassait les forces de sa raison. Il se releva brusquement, balbutia quelques mots sans suite, regarda Aïxa d’un air farouche et menaçant, et voulut s’éloigner.
C’était la folie qui commençait.
— Fils d’Albérique, mon frère, que vous ai-je fait ! répéta Aïxa de sa douce voix. Pourquoi me fuyez-vous quand je n’ai plus que vous pour me consoler ?
Cette voix enchanteresse produisit sur Piquillo son effet ordinaire. Plus puissante encore que la secousse qu’il venait d’éprouver, elle arrêta sa raison prête à l’abandonner, dissipa son égarement, le rendit à la vie et en même temps au devoir et à l’honneur, qui étaient sa vie, à lui. Se roidissant contre la douleur, il redevint homme, il retrouva cette puissance de volonté qui peut tout dompter, jusqu’à nous-même. Il fut assez fort pour commander à son trouble, pour ordonner à ses traits de sourire, à son cœur de ne plus rien éprouver, et pour dire à l’orage qui grondait en lui-même ce que Dieu dit à l’Océan : Tu n’iras pas plus loin !
— Pardon de ma faiblesse, lui dit-il. Moi qui ai tant de fois triomphé de la douleur, je viens de me laisser vaincre par la joie. Mais depuis deux jours tant d’émotions ! tant de souffrances ! J’étais déjà malade. J’ai la fièvre, voyez-vous, et dans la fièvre on a parfois le délire.
Il ne mentait point. Aïxa saisit sa main brûlante, le fit asseoir près d’elle et lui prodigua les soins les plus tendres, sans se douter qu’elle redoublait encore les tourments qu’elle voulait calmer.
— Vous, ma sœur ! murmurait Piquillo d’une voix tremblante, ma sœur ! Et il répétait ce mot, maintenant son salut, son talisman et sa seule défense : Ma sœur !
Puis, tournant vers elle ses yeux tristes, où le sourire cherchait à briller au milieu des larmes :
— Ce nom n’apprend rien à mon cœur, lui dit-il ; depuis longtemps j’avais pour vous la tendresse d’un frère. Mais ce que mon cœur avait deviné, mon esprit ne peut encore le comprendre.
— Et moi, je vais te l’expliquer, s’écria Aïxa… Et voyant qu’il regardait autour de lui avec inquiétude : Ne crains rien ! M. le duc ne peut entrer ici sans mon ordre. Si je n’ai pu me soustraire à ce fatal mariage, j’ai réservé du moins mes droits et ma liberté, et nul, pas même lui, n’y peut porter atteinte !
Elle ne remarqua point l’éclair de joie qui brilla dans les yeux de Piquillo, et continua en lui tenant toujours la main :
— Tu sais, mon frère, que les Maures de Valence et de Grenade ; ne pouvant supporter les maux et surtout le joug honteux dont on les accablait, se révoltèrent sous le dernier roi, Philippe II, et coururent aux armes pour défendre leur religion, leurs femmes et leurs enfants.
— Oui… dit Piquillo en pensant à Alliaga, plus d’un brave soldat perdit la vie dans les montagnes des Alpujarras.
— Trente mille des nôtres y trouvèrent un tombeau, dit Aïxa ; mais auparavant, plus de soixante mille Espagnols étaient tombés sous leurs coups, et le roi Philippe, effrayé d’une victoire qui lui coûtait si cher, devint clément par terreur. Il promit de ne plus persécuter les Maures et de ne plus les obliger par force à changer de religion. Il fut dit, par une ordonnance royale, que ceux qui refuseraient d’abjurer ne pourraient occuper aucune place, aucun emploi en Espagne ; qu’on ne pourrait les forcer à faire baptiser ceux de leurs enfants qui alors auraient plus de sept ans, mais qu’à l’avenir, tous ceux qui viendraient au monde seraient présentés au baptême au moment de leur naissance, et cela sous peine des plus cruels châtiments.
Maintenant, frère, tu vas comprendre aisément la situation de toute notre famille.
Cette ordonnance inquiétait peu le Maure Delascar d’Albérique, qui n’avait aucune envie de demander au roi d’Espagne des emplois et des dignités. Son travail et son industrie lui procuraient plus de richesses qu’il n’en désirait pour lui et les siens. D’un autre côté, son fils Yézid, ayant alors plus de sept ans, ne pouvait être contraint à recevoir le baptême et par conséquent à changer de religion. Il n’avait donc rien à craindre de ses oppresseurs, et ceux-ci, sous le coup de la terrible leçon qu’ils avaient reçue, exécutèrent pendant quelques années et assez fidèlement les promesses qu’ils avaient faites. On était alors aux dernières années du règne de Philippe II, et voilà que la compagne d’Albérique, sa femme bien-aimée, Amina, devint enceinte. Juge alors, mon frère, des angoisses et des craintes de cette pauvre famille ! Il fallait donc que l’enfant qui allait naître fût d’une autre religion que la leur ; il fallait élever autour d’eux un chrétien, un infidèle, un ennemi de leur foi, sous peine d’être dénoncé à l’inquisition, jeté dans un cachot, torturé, brûlé… que sais-je ! Tu as vu toi-même, par Gongarello et par la pauvre Juanita, qu’on envoyait les Maures au bûcher pour bien moins que cela.
— C’est vrai ! c’est vrai ! s’écria Piquillo. Je comprends maintenant…
— Ma mère, continua Aïxa, ma mère, qui était d’une extrême dévotion, fut tellement tourmentée de cette idée, qu’elle croyait toutes les nuits entendre la voix menaçante du Prophète, ou voir l’épée flamboyante de l’ange Gabriel. Elle devint si dangereusement malade que l’on craignit pour ses jours et pour ceux de l’enfant qu’elle portait dans son sein. Et après avoir longtemps hésité, voici le parti auquel on s’arrêta : ma mère, qui n’était enceinte que de quelques mois, fit un long voyage, puis revint secrètement à Grenade, chez une ancienne esclave à elle, établie mercière près de l’Alhambra. Cette brave femme, qui nous était dévouée, venait de mettre au monde un enfant qu’elle avait présenté au baptême. On prit soin de cet enfant, dont moi je pris la place. Ma mère aimait mieux se priver ainsi de ma présence que de me savoir à jamais perdue pour sa croyance et pour son Dieu. Elle préférait une séparation de quelques années à la séparation éternelle que le baptême eût établie entre nous. Il faut dire aussi qu’il ne se passait pas de semaine sans que des relations d’affaires appelassent Albérique ou sa femme dans la ville de Grenade ; que souvent Palomita, la mercière, avait besoin, pour son commerce, de faire des acquisitions à Valence ; qu’elle restait plusieurs jours en voyage, m’emmenant toujours avec elle, et que je recevais ainsi à la dérobée les caresses de mes vrais parents. Mais quand mon père eut perdu la pauvre Amina, plus que jamais il se mit à m’aimer, plus que jamais il eut besoin de moi. Il venait me voir si souvent, et sa tendresse était si vive qu’à chaque instant il se trahissait à mes yeux. J’avais à peine cinq ou six ans qu’il m’avait déjà avoué son secret.
— Eh bien, oui ! me disait-il, oui, ma bien-aimée Aïxa… tu es mon enfant, tu es ma fille. Mais prends bien garde que personne ne s’en doute ; sans cela, vois-tu bien, ils me jetteraient dans un cachot… ils nous traîneraient sur un bûcher, moi et ton frère Yézid.
Dans ce qu’il me disait, je ne comprenais qu’une chose, c’est que, si je parlais, on tuerait mon père et Yézid ; et l’on m’eût tuée moi-même plutôt que de me faire prononcer leur nom. Tu l’as vu, frère, continua Aïxa, quoique bien jeune encore, je m’étais fait de ce secret un devoir si sacré, que pas même Carmen, pas même toi, ne me l’auriez fait trahir. La vie de mon père en dépendait, et prête à parler, je me serais arrêtée, croyant entendre murmurer à mon oreille le nom de parricide !
— Eh bien ! dit Piquillo, oppressé par un douloureux souvenir, achevez, ma sœur.
Aïxa poursuivit :
— J’avais à peu près sept ans quand la reine Marguerite, à l’époque de son mariage, traversa le royaume de Valence et vint avec toute sa suite faire une visite à mon père, Delascar d’Albérique. Et il a tant de mérite, mon père, tant de savoir et de vertus ! dit Aïxa avec orgueil.
— Je le sais, je le sais, dit Piquillo ; comme vous, ma sœur, je le révère et je l’aime.
— Et la reine, poursuivit la jeune fille, la reine aussi se mit à l’estimer et à l’aimer, et lui promit sa protection… toujours ; c’est le mot dont elle se servit, c’est mon frère Yézid qui me l’a dit. Alors comptant sur l’appui de la reine, mon père devint plus hardi. Palomita, la mercière, venait de mourir ; il confia à Yézid le dessein qu’il avait de me prendre ouvertement avec lui et de m’avouer pour sa fille ; mais il n’osait le tenter sans prendre l’avis de la reine et sans la certitude d’être protégé par elle. Yézid partit alors pour Madrid, et, ce qui était bien difficile, il obtint une audience secrète de la reine.
— Comment cela ? dit Piquillo.
— Je ne le sais pas, dit naïvement Aïxa ; il ne me l’a jamais dit : ce que je sais, c’est qu’il revint effrayé, désespéré… Il avait tout raconté à la reine, et celle-ci lui avait répondu : « Dites à votre père de renoncer à son dessein et de se tenir plus que jamais sur ses gardes. On ne cherche dans ce moment qu’un prétexte pour le perdre ; c’en serait un infaillible et immanquable. Si on savait qu’Aïxa est sa fille et qu’il l’a dérobée au baptême, je ne pourrais le sauver ; je ne pourrais lutter, moi, la reine, ni contre le pouvoir du duc de Lerma, ni contre la haine du grand inquisiteur, qui, cette fois, aurait la loi pour lui. Dites donc à d’Albérique que, dans son intérêt, dans celui de sa fille, il s’éloigne d’elle en ce moment, au lieu de s’en approcher. »
Telles furent les paroles de la reine. Et quel parti restait à mon pauvre père ! Il ne pouvait me garder auprès de lui ; Palomita n’était plus ; à qui me confier, moi, sa vie et son bonheur ! Au milieu de ses angoisses, il songea à don Juan d’Aguilar, son noble ami, mais il craignait, en me remettant entre ses mains, de compromettre sa position, sa fortune et même ses jours.
— Tant mieux ! s’écria le digne vieillard. Je pourrai donc m’acquitter envers vous. Votre fille sera la mienne ; ce sera la sœur de Carmen, car je jure à toutes les deux désormais la même affection.
— Et il a tenu parole, dit Piquillo en essuyant une larme et en se rappelant les jours passés dans la maison d’Aguilar, jours d’illusions, rêves de la jeunesse, espérances de bonheur à jamais détruites maintenant !
— Je n’ai pas besoin de te dire, continua Aïxa, que, dans sa tendresse paternelle, d’Albérique croyait ne pouvoir jamais assez m’accabler de présents ; moi, enfant, j’avais de l’or, des diamants, des parures, dont je ne me servais pas et qu’au contraire je cachais de mon mieux. Voilà, mon frère, dit-elle, en lui tendant la main, l’origine des richesses qui vous étonnaient. Souvent aussi, et vous l’ignoriez, on me faisait appeler chez le général, Carmen elle-même croyait que c’était pour quelques recommandations ou quelques reproches. C’était pour recevoir les embrassements de mon père ou de Yézid. Mon sort s’écoulait ainsi, en secret, et digne d’envie.
— Et le mien donc ! dit à part lui Piquillo en soupirant.
— Mais, poursuivit Aïxa, quand, pour notre malheur à tous, le noble, l’excellent d’Aguilar eut fermé les yeux, il fut décidé que je suivrais Carmen chez sa tante, chez la comtesse d’Altamira… une infâme !
— Que dites-vous ?
— Que pendant votre absence, que depuis deux mois, mon frère, bien des dangers nous ont environnées Carmen et moi ; Carmen avait un défenseur, son fiancé, son époux, Fernand d’Albayda, dit-elle en baissant les yeux… mais moi, je n’avais point d’ami… car vous n’étiez plus là… et mon père était loin de moi. Un homme est venu alors… c’était le ministre du roi, le duc de Lerma. Il est venu me proposer un mariage à moi, qu’il croyait la fille d’un soldat tué en Irlande. Il est venu me dire que le roi voulait cette union. Que pouvais-je répondre, sinon que je demandais le temps de réfléchir ou de me consulter, ou plutôt de consulter mon père et Yézid ? Je me hâtai de leur apprendre mes craintes, mes inquiétudes, demandant leurs avis et leurs conseils, enfin épanchant dans leur âme tout ce que l’âme d’une fille et d’une sœur peut renfermer d’intime et de caché ; confiant ainsi mes plus secrètes pensées à un écrit que je croyais inviolable et qui devait me trahir… oui, un ministre du roi, un duc de Lerma, n’a rien respecté.
— Qu’entends-je ! s’écria Piquillo avec indignation.
— Un matin, poursuivit Aïxa, je le vois entrer dans ma chambre. « Je vous ai proposé, senora, me dit-il, d’épouser le duc de Santarem, et vous êtes une fille trop dévouée et trop tendre pour refuser cette union, car en refusant vous condamnez à la prison et au bûcher votre père et tous les siens.
— Comment cela ? m’écriai-je épouvantée.
— Fille du Maure d’Albérique, sœur d’Yézid Delascar, voici la lettre que vous leur avez adressée. Il ne faut pas d’autres preuves pour les condamner, et les preuves, c’est vous qui les aurez fournies. Si je livre cette lettre à don Sandoval, le grand inquisiteur, ils sont perdus tous les deux, tandis que si vous épousez le duc de Santarem…
— Vous me rendrez cette lettre ?
— À l’instant même.
— Donnez-la-moi donc, m’écriai-je, je consens !
— Ce sera mon présent de noces, répondit le duc, je vous le jure ! Le matin même du mariage, elle vous sera remise par le prêtre même qui bénira votre union.
— Maintenant, frère, s’écria Aïxa, tu sais tout. Pourquoi vouloir absolument me marier ? Pourquoi tenir à ce duc de Santarem ? c’est ce que j’ignore encore… mais il y a là-dessous quelque mystère que nous découvrirons. Par malheur, toi qui pouvais seul m’éclairer ou me donner conseil, tu n’étais pas là.
— Oui, par malheur ! s’écria Piquillo avec rage.
— Tu m’avais caché le but et la cause de ton voyage, et c’est quelques jours après ton arrivée à Valence, que Yézid m’apprit quel était le frère que le ciel nous donnait… ce frère que je chérissais déjà ! Que n’es-tu venu alors ?
— J’accourais vers vous, dit Piquillo avec désespoir… vous faire part de ma joie, de mon bonheur… mais arrêté par nos ennemis… emprisonné par eux…
Et il lui racontait en peu de mots les dangers auxquels il venait d’échapper et qui le menaçaient encore ; dangers que depuis quelques heures il avait oubliés, lorsqu’en ce moment un grand bruit se fit entendre dans le château. Des cris, des pas précipités retentirent au milieu de la nuit.
— Va-t’en ! dit Aïxa à son frère.
— Oui, si l’on me voyait ainsi près de vous, au milieu de la nuit… ce serait vous perdre.
— Non, répondit Aïxa d’une voix ferme… je leur avouerais que tu es mon frère… Je ne crains rien pour moi… mais c’est toi peut-être qu’ils poursuivent, et je ne veux pas que tu retombes entre leurs mains.
— Ah ! peu m’importe maintenant ! répondit Piquillo en laissant tomber ses mains avec découragement.
— Tu oublies donc, mon frère, que j’ai besoin de ton appui maintenant, et de ton amitié toujours ?
— Oui… j’étais un égoïste et un ingrat. Vous avez raison.
— Et pourquoi me dire vous ? lui demanda-t-elle.
— Ah ! l’habitude de vous respecter…
— Oui, autrefois peut-être !… mais à présent tu n’es plus obligé qu’à m’aimer, n’est-ce pas, frère ?
Le bruit redoublait dans le château et semblait se diriger vers l’appartement d’Aïxa.
— Va-ten donc, s’écria-t-elle, pour que je puisse te revoir !
Et joignant les deux mains d’un air suppliant :
— Je t’en prie, frère… va-t’en si tu m’aimes !
— Je pars, dit Piquillo avec émotion… mais comment ? mais par où ? les voilà à cette porte… les entends-tu ?
— Oui, dit Aïxa… mais quoique arrivée ici depuis hier seulement, cet appartement est le mien… et l’on m’en a enseigne les secrets.
Ouvrant alors un panneau de la boiserie richement sculpté :
— Tiens ! tu descendras par un petit escalier tournant, jusqu’à une porte qui donne sur le parc ; en voici la clé que l’on m’avait remise pour mes promenades à moi. Le parc est contigu à la forêt… et de là, la fuite est facile… Adieu donc, et bientôt à Madrid !
— À Madrid, dit Piquillo ; avez-vous d’autres ordres à me donner ?
— Encore un.
— Et lequel ?
— De m’embrasser, mon frère !
— Adieu ! adieu ! s’écria Piquillo hors de lui.
Et se dégageant de ses bras, il s’élança par l’escalier dérobé, pendant que de la pièce voisine on frappait rudement à la porte de la chambre à coucher de la nouvelle mariée.
XXXIX.
la nuit des noces.
Le jour où le duc de Lerma s’était rendu à l’hôtel d’Altamira, le jour où, bien malgré elle, Aïxa s’était engagée à épouser le duc de Santarem, Carmen, désespérée du malheur de son amie, s’était hâtée de le raconter à celui à qui elle disait tout. Elle avait écrit tous les détails de cet événement à Fernand d’Albayda, son fiancé, alors à Lisbonne, lui demandant s’il connaissait quelque moyen de sauver Aïxa.
À la lecture de cette lettre, à la nouvelle de ce mariage, Fernand d’Albayda avait pâli, le papier s’était échappé de ses mains ; puis à sa stupeur avait succédé un accès de rage contre le ministre et contre Santarem, qu’il regrettait maintenant d’avoir envoyé à Madrid et de n’avoir pas fait fusiller sur-le-champ à Lisbonne. Les preuves de ses complots étaient évidentes, il les avait adressées au ministre, et celui-ci, au lieu de punir, récompensait. Le duc de Lerma, qui avait été sans pitié pour des gens imprudents ou égarés, faisait grâce à un des chefs, devenait son protecteur et lui donnait pour femme la plus aimable, la plus jolie fille d’Espagne ! C’était, selon Fernand, une injustice et une tyrannie intolérables à laquelle il était de son devoir de s’opposer ; car il allait épouser Carmen, qui était presque la sœur d’Aïxa. Donc, Aïxa était de sa famille ! donc, il devait la défendre, et, à force de se le répéter, il avait fini par se le persuader. La seule chose qu’il ne s’avouât pas, c’est qu’il était jaloux, c’est qu’il voulait bien, par devoir, renoncer à Aïxa, mais non la voir au pouvoir d’un autre.
Pendant qu’il changeait à chaque instant de résolution, hésitant et ne sachant quel parti prendre, le duc de Lerma, qui avait les siens bien arrêtés, pressait la conclusion d’un mariage auquel se rattachaient toutes ses espérances. Il aurait désiré que cette cérémonie ne fît aucun éclat et n’excitât point l’attention publique, ce qui était impossible à Madrid : les parents et les amis du duc de Santarem, c’est-à-dire une partie de la cour, s’empresseraient d’assister à ce mariage. On ne manquerait point d’examiner la tenue des deux époux et d’en tirer mille commentaires dont plusieurs mettraient peut-être sur les traces de la vérité, surtout lorsqu’on verrait, quelques jours après, la duchesse de Santarem présentée à la cour.
Le duc de Lerma prit alors une de ces résolutions hardies qu’emploient toujours les ministres qui ont peur : ce fut de se cacher et de traiter cette affaire en secret d’État. Il fit venir Santarem.
— N’avez-vous pas, lui dit-il, une fort belle terre aux environs de Tolède ?
— Oui, monseigneur.
— C’est là que se célébrera votre mariage.
— Pour quelle raison ?
— Pour raison d’État, répondit gravement le duc.
— C’est que je n’y suis jamais allé ; nul n’est averti et rien ne sera préparé.
— C’est ce que je veux. Vous n’inviterez personne de Madrid ; la cérémonie aura lieu seulement au milieu de vos vassaux. Vous donnerez des ordres en conséquence dès demain ; vous partirez deux jours après, et dans six jours tout sera terminé, à la condition, par vous, de n’en parler d’ici là à qui que ce soit.
— Et pourquoi cela, monseigneur ?
— Je croyais vous avoir fait comprendre, répondit gravement le duc, que c’était pour des raisons…
— D’État… J’entends bien ; je me conformerai aux intentions de monseigneur.
Le duc de Santarem ne demanda plus rien et obéit. Tous les préparatifs se firent en secret et dans le plus profond silence.
Quelques jours après cet incident, d’Albérique et Yézid se promenaient à Valence dans les jardins du Valparaiso et combinaient ensemble les moyens de délivrer Piquillo, alors prisonnier de l’archevêque. Yézid devait partir le lendemain pour cette expédition, qu’il voulait diriger lui-même. En ce moment on apporta à d’Albérique un billet qui ne contenait que ces mots :
« On veut marier en secret Aïxa au duc de Santarem. Si c’est sans votre aveu et à votre insu, hâtez-vous, vous n’avez pas de temps à perdre. »
D’où vient un tel avis ? s’écria Albérique effrayé, en remettant vivement la lettre à son fils.
Yézid la lut de nouveau ; elle ne portait point de signature : il regarda le cachet et vit en caractères arabes le mot toujours ! ce mot gravé sur la turquoise que Marguerite avait acceptée de lui… Il se mit alors à trembler d’émotion et de crainte, et dit au vieillard à voix basse :
— Il faut croire à cet avis. Il est certain.
— Pourquoi ?
— Il vient de la reine, mon père.
— Il faut partir alors, partir à l’instant, dit le vieillard.
Yézid avait remis à Pedralvi le soin de délivrer Piquillo et était parti pour secourir sa sœur bien-aimée.
Mais déjà, et d’après les ordres du ministre, le duc de Santarem avait écrit à son intendant de tout disposer pour son mariage. Lui-même était arrivé à sa terre un samedi soir pour se marier le lundi suivant. Aïxa avait refusé l’offre de la comtesse d’Altamira, qui lui avait proposé de la conduire à l’autel. Ce mariage s’annonçait déjà sous des auspices assez tristes sans y joindre celui-là. Elle avait prié Carmen et Juanita de partir avec elle et de ne point la quitter. Quoique résignée et forte de son courage, elle se trouvait bien malheureuse, et loin de tous les siens, loin de Yézid, de Piquillo et de son père, à qui elle ne pouvait dire le sacrifice qu’elle acceptait pour eux, Aïxa éprouvait quelque douceur à avoir auprès d’elle Carmen et Juanita, ses amies et presque ses sœurs, l’une par l’amitié, l’autre par la reconnaissance.
Le jour même de leur départ, le duc de Lerma, qui avait entouré de ses affidés l’hôtel d’Altamira et l’hôtel de Santarem, reçut l’avis qu’un cavalier, que l’on croyait être don Fernand d’Albayda, était arrivé secrètement à Madrid ; sans descendre à son hôtel, ni faire part à personne de son retour, il s’était rendu directement chez le duc de Santarem et l’avait fait demander. On lui avait répondu que le duc n’était pas visible, ce qui avait paru le contrarier beaucoup, et après l’avoir attendu plusieurs heures avec les signes de la plus vive impatience, il s’était rendu chez la comtesse d’Altamira, avec laquelle il avait causé ; à la suite de cet entretien, il était remonté à cheval, était sorti de Madrid, et avait pris la route qui conduisait à Tolède.
Qui pouvait amener don Fernand à Madrid, secrètement et sans permission ? Pourquoi avoir quitté Lisbonne sans en prévenir le ministre ?
Cette nouvelle avait inquiété le duc, et une heure après, il reçut un nouvel avis qui ne l’intrigua pas moins. Un second cavalier, que les affidés n’avaient pu reconnaître, et qui d’ordinaire n’habitait pas Madrid, était également arrivé, mais beaucoup plus tard, à l’hôtel de Santarem. Ses habits poudreux et son cheval fatigué indiquaient assez qu’il venait de loin et qu’il avait hâté sa marche. Il avait demandé à parler au duc de Santarem ; le majordome avait fait la même réponse qu’à don Fernand d’Albayda : son maître n’était pas visible. « Il faut pourtant bien que je le voie, » avait répondu d’un ton menaçant l’étranger, qui se trouvait seul avec le majordome, dans une salle basse. Le majordome, peu brave de sa nature, et qui, d’ailleurs, dans l’emploi qu’il remplissait, n’était pas payé pour l’être, avait avoué que son maître n’était réellement pas à Madrid, et qu’il était parti depuis le matin.
— Tu vas alors me dire où il est allé ! s’était écrié l’étranger en tirant un poignard.
Peu habitué à cette manière d’interroger, le majordome s’était hâté de donner tous les renseignements désirables, et à l’instant même, l’étranger remontant à cheval, était sorti de Madrid et avait pris la route qui conduisait à Tolède.
Cette ceïncidence d’événements, ces arrivées successives de voyageurs et surtout cette manie qu’ils avaient tous de se diriger vers Tolède, avaient fait craindre au ministre quelques obstacles pour le mariage auquel il tenait tant et duquel dépendait pour lui la faveur du maître. Il avait écrit à l’instant même au duc de Santarem que, toujours pour des raisons d’État, le roi désirait que le mariage fût avancé d’un jour : qu’ainsi donc, au reçu de la présente, il se rendit sur-le-champ à l’autel pour y être marié par frey Gaspard de Cordova, confesseur de Sa Majesté, qui avait reçu les instructions du ministre et qui lui remettrait la présente missive. Il ajoutait en forme de postscriptum que, faute par le duc de Santarem de se conformer aux intentions de Sa Majesté, des ordres avaient été donnés aux corrégidors et officiers de justice de la province de Tolède, pour s’emparer de lui, dès le soir même, et le réintégrer dans sa prison, attendu les nouvelles preuves de culpabilité qui a chaque instant arrivaient de Lisbonne.
En même temps le ministre écrivait à un homme dont le dévouement devait lui être acquis, au corrégider de Tolède, Josué Calzado, d’avoir à se rendre à la terre du duc : d’abord, pour être bien sûr que le mariage serait célébré, et pour en donner sur-le-champ avis au ministre ; secondement, il lui était ordonné de veiller sur le duc de Santarem, lequel lui était expressément recommandé, et dont il répondait sur sa tête ; l’engageant par là à prendre, lui et ses gens, les précautions nécessaires pour empêcher toute embûche, guet-apens ou même toute provocation, duel ou combat qui mettraient en danger la personne du mari qu’il était tenu de protéger et de représenter plus tard corps pour corps.
Le duc, arrivé de la veille, avait passé dans son château une très-bonne nuit. Ne comprenant que fort peu de chose à la conduite du ministre à son égard, il soupçonnait toujours quelque piége et avait répété durant toute la route son refrain ordinaire : Pourquoi ai-je été me mettre à la tête d’une conspiration ! Cependant Aïxa était arrivée au château, et depuis que le duc avait passé la soirée avec elle, ses idées avaient pris un autre cours ; il trouvait Aïxa charmante : c’était une des plus jolies femmes qu’il eût jamais vues. Son air froid et glacé lui avait paru de la réserve et de la dignité. Il commençait à trouver qu’il n’avait peut-être pas eu si grand tort de se mettre à la tête d’une conspiration ; qu’après tout, la conduite du ministre avait un côté raisonnable et satisfaisant ; que si elle était obscure, c’était le propre de la politique, et que la plupart des hommes d’État étaient souvent incompris.
Le duc de Santarem était donc livré à toutes ces réflexions qui n’avaient pour lui rien de pénible, lorsqu’il avait reçu un message qui était venu mettre le comble à sa satisfaction. Aïxa le priait de vouloir bien passer chez elle. Il acheva à la hâte et avec les plus flatteuses espérances sa toilette déjà commencée. Si sa prétendue lui avait paru charmante la veille, elle lui sembla délicieuse en négligé du matin, et au premier coup d’œil jeté sur elle, il se sentit définitivement réconcilié avec la politique du duc de Lerma.
— Monsieur le duc, lui dit Aïxa gravement, j’ai cru cette entrevue nécessaire.
— Nécessaire… je l’ignore, agréable, j’en suis sûr, répondit le duc d’un air galant.
— Il m’a semblé que nous devions, avant tout, nous expliquer avec franchise, et dût la mienne vous déplaire, je la regarde comme un devoir.
Un air d’inquiétude remplaça le sourire qui errait sur les lèvres du duc.
— Je vous ai vu hier pour la première fois, et demain je vous épouse, c’est vous dire, monsieur, que ne pouvons pas nous aimer.
— Vous me permettrez, s’écria le duc, d’abord, de ne pas être de votre avis, et ensuite, d’espérer que vous-même ne serez pas toujours du vôtre.
— Au contraire, monsieur, je vous déclare que je n’en changerai jamais.
— Voilà, vous l’avouerez, dit le duc en s’efforçant de sourire, une constance bien terrible et bien fâcheuse pour moi. Puis-je savoir au moins sur quoi elle est fondée ?
— Je vais vous l’expliquer, monsieur, car je vous ai promis toute la vérité, et la voici : c’est malgré moi, c’est contre mon gré que je vous épouse.
Le duc se mordit les lèvres, et dit d’un air dégagé :
— Pourquoi alors, senora, m’épousez-vous ?
— Parce qu’en refusant, monsieur, j’exposais les jours de mon père et de tous ceux qui me sont chers.
— Ah ! c’est là le motif, senora… dit le duc en ricanant ; vous n’en avez pas d’autres ?
— Il me semble, monsieur le duc, qu’ils sont assez puissants. Mais si le refus venait de vous, ce ne serait point la même chose, le ministre alors ne pourrait plus me contraindre, je serais libre et vous aussi. Voilà, monsieur, ce que je voulais vous apprendre.
— Je vous remercie infiniment, senora, et ma franchise égalera la vôtre. Je vous dirai donc que moi aussi c’est malgré moi et contre mon gré que je vous épouse.
— En vérité ! s’écria Aïxa avec une expression de joie ; eh bien, alors, pourquoi ne pas renoncer à ce mariage ? pourquoi y consentir ?
— Parce que j’y suis forcé et contraint par le ministre… parce que si je refuse… il y va pour moi de la prison et de mes jours peut-être…
— Ah ! dit Aïxa avec mépris, c’est là le motif ?
— Il me semble assez puissant, s’écria le duc ; et vous voyez, senora, que je ne suis pas plus maître de vous rendre la liberté que de reprendre la mienne.
Aïxa garda quelques instants le silence, et reprit :
— Il y a là, monsieur le duc, un mystère que je ne puis comprendre et que peut-être vous avez pénétré.
— En aucune façon, je vous le jure.
— J’aime à le croire, répondit Aïxa, mais daignez, monsieur le duc, m’écouter encore un instant, plus qu’un instant, et vous pourrez vous retirer.
Le regardant alors d’un air ferme et assuré, elle lui dit :
— Je pensais en vous épousant sauver les jours de mon père ; je vois que je fais plus encore…
— Et quoi donc, senora ?
— Je préserve les vôtres, monsieur le duc. Vous devez être content de ce sacrifice ; n’en demandez pas d’autre. Je me réserve la liberté de mes sentiments, et je saurais la défendre même au prix de ma vie à moi !
— Ne craignez rien, senora, dit le duc en s’inclinant ; je la respecterai, je vous le jure.
— J’y compte, monsieur le duc, et maintenant, quand vous le voudrez, je suis prête à obéir aux ordres du ministre.
Avec la majesté d’une reine, elle lui fit un signe de la main de se retirer, et le duc honteux, humilié, furieux, remonta chez lui en répétant entre ses dents :
— Pourquoi, diable, ai-je été me mettre à la tête d’une conspiration !
Il cherchait en lui-même s’il n’y aurait pas quelque moyen de rompre ou du moins d’ajourner un mariage qui s’annonçait aussi mal, lorsqu’était arrivé de Madrid frey Gaspard de Cordova, confesseur du roi, apportant la lettre du ministre. Cette lettre, comme nous l’avons dit, enjoignait au futur époux de hâter la cérémonie et de se marier le jour même. Pour le coup, la colère de Santarem fut au comble, mais devant les menaces que contenait le dernier paragraphe il n’y avait point à hésiter.
— J’obéirai, mon père, dit-il au moine, j’obéirai ! Veuillez prévenir la senora Aïxa, ma fiancée, et fixer avec elle, pour aujourd’hui même, l’heure qui vous conviendra le mieux, toutes me sont indifférentes. Il reprit la lettre et la relut ; il était clair qu’il fallait que le jour même il fût marié ou qu’il retournât en prison ; on y tenait, et il murmurait avec rage :
— Pourquoi se mettre à la tête d’une conspiration !
Son valet de chambre entra et lui annonça la visite d’un cavalier qui arrivait de Madrid.
— Son nom ?
— Don Fernand d’Albayda.
— Celui qui m’a fait arrêter en Portugal, et qui vient sans doute de la part du ministre pour presser et surveiller ce mariage ! Allons, allons, dit-il entre ses dents, le duc de Lerma avait raison, c’est une affaire d’État.
Don Fernand entra, et pendant qu’il saluait, Santarem s’écria avec impatience :
— Je sais ce qui vous amène, seigneur cavalier ; il était inutile de vous déranger et de venir de Madrid pour cela ; je consens à tout !
— En vérité ! répondit Fernand, qui n’espérait pas réussir aussi complétement ni surtout aussi vite,
— Oui, monsieur, reprit Santarem, vous serez satisfait, et puisqu’il le faut, dans quelques heures ce mariage sera célébré.
— De quel mariage parlez-vous, monsieur le duc ? demanda Fernand en pâlissant,
— Du mien avec la senora Aïxa.
— Quoi ! vous y persistez ?
— Eh ! par saint Jacques ! le moyen de faire autrement ? Tout le monde le veut, à commencer par vous.
— Je veux au contraire qu’il n’ait pas lieu ! s’écria Fernand, et je viens, monsieur le duc, pour m’y opposer.
— Vous !
— Moi-même.
Santarem resta stupéfait, et Fernand continua gravement :
— La personne que vous prétendez épouser est l’amie, la sœur de ma fiancée ; elle est presque de ma famille et n’a que moi pour défenseur. Or, comme j’ai quelque raison de croire que ce mariage se fait contre son gré…
— J’ai mieux que des soupçons, seigneur cavalier, j’en ai la certitude. Elle me l’a avoué elle-même.
— Et vous passez outre ? s’écria Fernand avec colère.
— J’ai mes raisons, répondit froidement Santarem.
— Et moi, je n’ai qu’un mot à vous dire, si vous faites ce mariage, vous aurez ma vie ou j’aurai la vôtre !
— À merveille ! et si je ne le fais pas, s’écria Santarem furieux, ce sera exactement la même chose.
— Qu’est-ce que cela signifie ?
— Que c’est une fatalité qui me poursuit, un labyrinthe inextricable, dont je ne puis sortir, continua Santarem, dont la colère allait toujours en augmentant.
— Expliquez-vous, de grâce, continua Fernand.
— Je n’ai point d’explication à vous donner.
— Voulez-vous vous marier ?
— Je ne le veux pas ! cria Santarem avec rage, et pourtant je me marierai.
— Votre intention n’est pas de vous jouer d’un gentilhomme tel que moi !
— Parbleu ! seigneur cavalier, il y a d’autres gentilshommes qui vous valent bien et dont chacun se fait un jeu.
— Ils ont tort de le souffrir.
— Eh ! je ne le souffrirai plus, répliqua Santarem avec hauteur ; je me marierai ou ne me marierai pas, selon mon bon plaisir. Je n’en dois compte à personne, et n’ai rien de plus à vous dire.
— Que le lieu et l’heure où il me sera permis de vous rencontrer, répondit Fernand en s’inclinant.
— Un défi ? s’écria Santarem enchanté de pouvoir faire enfin tomber sa colère sur quelqu’un. Un défi ! c’est le premier bonheur qui m’arrive d’aujourd’hui. Choisissez vous-même, seigneur Fernand, tout me va, tout me convient.
— Votre mariage est, je crois, fixé à demain ?
— Aujourd’hui, demain, peu importe ! s’écria Santarem en pensant à la conversation qu’il venait d’avoir avec Aïxa ; il n’y aura pas au monde de mari moins occupé que moi !
— À ce soir donc.
— Soit, à ce soir, huit heures… au dehors du parc, sous les murs de la tourelle… du côté de la forêt.
— Je m’y trouverai, monsieur le duc.
— Je vous y précéderai, seigneur cavalier.
Tous les deux se séparèrent. :
— Par saint Jacques ! se dit le duc, la belle idée que j’ai eue de me mettre à la tête d’une conspiration ! Il y en a une ici contre moi, c’est évident, et je commence enfin à y voir clair. Le seigneur Fernand est l’amant de ma femme. Il l’aime, il est aimé, et moi ! Allons, poursuivit-il avec rage, je permets au duc de Lerma de se moquer de moi, il est ministre. Mais, à d’autres, non pas ; et nous verrons !

C’est sous la préoccupation de cette idée qu’il s’était rendu à l’église, et le mariage avait eu lieu, comme nous l’avons vu, en présence seulement de frey Cordova, de Carmen, de Juanita, et de tous les vassaux du duc. Puis, comme il sortait de la chapelle, était arrivé le corrégidor Josué Calzado, qui, d’après la dépêche ministérielle, se hâtait d’accourir, suivi du jeune Pacheco, son neveu et son greffier.
Le corrégidor apprit avec satisfaction que le mariage venait d’être célébré.
C’était un point important de ses instructions ; il se hâta d’en écrire au ministre et d’expédier la lettre le jour même à Madrid. Il s’occupa ensuite des autres dispositions qui lui étaient expressément recommandées pour la sûreté du duc de Santarem. Il fit d’abord demander au duc, par son neveu Pacheco, la permission de présenter à Sa Seigneurie ses respects, et ses compliments. Le nouveau marié tenait peu aux respects du corrégidor, et toute espèce de compliments lui étaient insupportables ; il reçut donc assez mal Pacheco, le regarda à peine et fit répondre au digne magistrat que, tout entier aux devoirs que ce jour lui imposait, il lui était impossible de le voir, mais que le lendemain il aurait ce plaisir.
Josué Calzado n’insista pas et ne songea qu’à remplir avec adresse, fidélité et discrétion la mission qui lui était confiée. Au lieu de retourner à Tolède, il s’établit pour toute la soirée et toute la nuit dans la seule hôtellerie qui existât au village et qui touchait presque les murs du parc ! Il avait ordonné à une escouade de ses affidés les plus intelligents de venir plus tard le rejoindre, et dès que la nuit commença à paraître, plusieurs rondes organisées par lui exercèrent autour du château la police la plus active.
Ses instructions étaient remplies, Santarem était marié, aucun danger ne le menaçait ; d’ailleurs on veillait sur lui.
Le corrégidor alla se coucher, ainsi que son neveu Pacheco, ordonnant qu’on l’éveillât au moindre incident, et il s’endormit en rêvant aux récompenses honorifiques et aux gratifications qu’il aurait droit de demander au duc de Lerma.
Cependant, et dès qu’il avait vu la nuit venir, Fernand s’était dirigé vers le lieu du rendez-vous. Il s’était tenu caché toute la journée à quelques lieues de là, et quoique Carmen fût au château, il n’avait point voulu s’y présenter. Il aurait fallu expliquer le motif de son arrivée, et, si le ciel le secondait, s’il sortait vainqueur de ce combat, il désirait que personne, pas même Aïxa, ne sût ce qu’il avait tenté pour elle ; il lui suffisait, à lui, de l’avoir arrachée au danger qui la menaçait, et quant à sa récompense, il n’en voulait… il n’en espérait même aucune ; il est vrai que le sort pouvait lui être fatal, qu’il pouvait succomber dans ce duel, mais c’était pour Aïxa ! et jamais, il faut le dire, il n’avait moins tenu à la vie que dans ce moment. Il cherchait à se rappeler le lieu du combat ; Santarem avait dit : « Sous les murs de la tourelle, en dehors du parc, du côté de la forêt. » Il traversait donc ce parc solitaire, et s’avançait dans une allée qui devait le conduire à la forêt, sans songer à l’adversaire et au péril qui l’attendaient : ses pensées n’étaient pas là ; elles erraient près de Carmen et d’Aïxa ; il rêvait à l’une, si dévouée, si tendre, si digne d’être aimée, et à l’autre, qu’il aimait tant ! Il trouvait dans son cœur tant de trouble et d’hésitation, son bonheur lui semblait désormais tellement impossible qu’il désirait presque la mort, et peut-être, grâce au ciel, allait-il la rencontrer ! En proie à ces idées, il s’arrêta au milieu du bois. Il avait quitté l’allée sans s’en apercevoir et s’était égaré. Il entendit marcher et vit passer auprès de lui un homme enveloppé dans un manteau.
— Seigneur cavalier, lui dit-il, êtes-vous du château ?
— Oui, certes !… Je suis invité, je suis de la noce ; je m’y rends en ce moment.
— Pourriez-vous m’indiquer de quel côté est la tourelle du parc ?
— Très-aisément, dit l’inconnu en rabattant son chapeau sur ses yeux.
— Et le plus court chemin pour m’y rendre ?
— Celui-ci, répondit l’homme au manteau en désignant de la main une allée à laquelle il tournait le dos, et qui devait promptement éloigner de lui don Fernand.
Mais au moment où ce dernier se préparait à suivre cette indication, la lune sortit radieuse des nuages et lui fit voir à cent pas de lui, dans une direction tout opposée, la tourelle qu’il cherchait.
— Que me dites-vous donc, seigneur cavalier ! s’écria-t-il avec impatience, en se tournant vers son prétendu guide. Mais celui-ci venait de s’éloigner à toutes jambes, et Fernand ne put distinguer de loin que son manteau noir et la plume rouge qui flottait sur son feutre gris. Sans chercher à deviner quelle pouvait être l’intention de cet homme, Fernand s’avança vers la tourelle.
Il était le premier au rendez-vous. Personne n’était encore arrivé. Il attendit en se promenant. Aucun bruit ne frappait son oreille. Aucun cavalier ne s’avançait vers lui, et cependant la lune, qui continuait à briller dans tout son éclat, lui permettait d’apercevoir au loin tous les objets qui l’entouraient. Depuis longtemps, la grande horloge du château avait sonné huit heures, et la cloche du village lui avait répondu en sonnant l’Angelus ! Enfin, et après une heure d’attente, il se leva, ne pouvant s’expliquer un pareil retard. Décidé à en connaître le motif, il rentra dans le parc et se dirigea comme il le put et à peu près au hasard du côté du château. Il avait à peine fait deux cents pas dans les allées, qu’il vit un homme étendu à terre. Il courut à lui, il était sans mouvement ; le sable de l’allée, foulé récemment par plusieurs pieds, indiquait que cet endroit avait été le théâtre d’une lutte ou d’un combat acharné ; il releva le malheureux qui venait de succomber, et les rayons de la lune, éclairant un visage pâle et livide, Fernand poussa un cri de terreur ; il venait de reconnaître le duc de Santarem. Il essaya vainement de le secourir ; il ne respirait plus. Un coup d’épée lui avait traversé la poitrine ! Fernand, saisi d’effroi et livré à toutes les conjectures que lui inspirait cet horrible spectacle, ne savait à quelle idée s’arrêter.
Le duc avait-il succombé en duel ? Quel adversaire avait pu le précéder, lui, Fernand, et prendre ainsi sa place ? Le duc avait-il été victime d’un meurtre ? Il se rappela alors l’homme au manteau noir et au feutre gris qu’il avait rencontré une heure auparavant. Il venait, il est vrai, et autant qu’il pouvait se le rappeler, d’un côté tout opposé à celui où il se trouvait alors. Et d’ailleurs comment le poursuivre maintenant ? comment même transporter le corps au château ? Impossible ! Fernand était seul, au milieu d’un parc immense dont il ne connaissait ni les sentiers ni les issues, et quand la lune cessait de l’éclairer, il marchait au hasard et ne pouvait se reconnaître au milieu de ces arbres séculaires et de ces épais massifs. Après s’être sans doute beaucoup éloigné de l’endroit où il avait laissé le pauvre Santarem, Fernand arriva enfin à une des grilles du parc qui donnait sur le village. Il frappa vainement à plusieurs portes, personne ne répondit.
Tous les habitants, hommes, femmes, et surtout jeunes filles, étaient à danser dans la grande salle du château, où un bal champêtre à grand orchestre avait été organisé par les soins du majordome ; s’il faut même l’avouer, une grande partie des gens du corrégider, de ses affidés les plus fidèles, voyant que tout était tranquille, avaient pris part aux réjouissances générales. Ils buvaient, ils mangeaient avec les gens du château, et plusieurs même dansaient aussi bien et aussi gaiement que peuvent danser des alguazils. Cela explique comment le village était désert ; il était au château, et Fernand n’apercevait de lumière à aucune fenêtre, excepté à une seule, celle d’une hôtellerie.
Il se mit à frapper à grands coups, et l’hôtelier ouvrit sa croisée en lui criant :
— Silence donc, vous qui frappez ainsi vous allez réveiller le corrégidor et son neveu, qui m’ont fait l’honneur de loger chez moi et d’y dormir.
— Vous avez chez vous un corrégidor ?
— Celui de Tolède, rien que cela ! Le corrégidor mayor.
— C’est justement ce qu’il me faut. Prévenez-le.
— Mais il dort.
— On ne dort pas quand on est corrégidor. Réveillez-le. Il faut absolument que je lui parle, moi, don Fernand d’Albayda.
L’hôtelier ordonna à ses garçons d’aller ouvrir à don
Fernand et se rendit de sa personne dans la chambre
du corrégidor.
Celui-ci rêvait en ce moment que le duc de Lerma, enchanté de sa conduite, en avait parlé au roi, qu’on le faisait venir à Madrid, qu’on le nommait conseiller à l’audience de Castille, qu’on lui donnait le choix entre une pension de trois mille ducats et le titre de chevalier dans l’ordre d’Alcantara, et il s’écriait :
— Les deux, sire !… les deux !
En ce moment, on ouvrit brusquement la porte ; l’hôtelier entra, suivi l’instant d’après de don Fernand.
— Qu’est-ce ? s’écria le corrégidor, en portant machinalement la main à son cou, pour y sentir le ruban et la croix de l’ordre ; qu’y a-t-il ?
— Il y a, seigneur corrégidor, que le duc de Santarem, le maître de ce château, n’est plus ; il vient d’être tué d’un coup d’épée.
Le corrégidor poussa un cri perçant, un cri de douleur ! Ce coup d’épée venait de tuer le conseiller à l’audience de Castille et le chevalier d’Alcantara.
— Ce n’est pas possible, continua-t-il, c’est une erreur ; vous vous trompez, seigneur cavalier.
— Je le désire autant que vous… mais je l’ai vu.
— Où ?
— Dans le parc.
— À quel endroit ?
— Je n’en sais rien… car ce parc… je ne le connais pas… mais nous allons le parcourir ensemble.
— Il a trois cents arpents, dit le corrégidor désolé, en se jetant à bas du lit et en appelant Pacheco, son neveu. Et tous mes gens qui devaient être sur pied, où sont-ils ?
— Ce qu’il y a de plus important, s’écria Fernand, est de poursuivre et de saisir le meurtrier.
— Le meurtrier ! répondit le corrégidor avec désespoir, vous êtes donc sûr que le duc n’est plus ?
— Mais oui, monsieur, je vous l’ai déjà attesté.
— Et moi je ne puis le croire ! Si vous saviez combien j’y tenais ! Je répondais de lui et de ses jours sur ma tête. C’était l’ordre exprès du duc de Lerma… et s’il se trouve qu’il est mort…
— C’est terrible.
— Pour moi, seigneur cavalier, pour moi !
— Du reste, dit vivement Fernand, je vous répète qu’il est facile de saisir son meurtrier ; il y a à peine une heure que le crime a été commis, et en envoyant tout votre monde battre les environs…
— C’est juste, cria le corrégidor à son neveu, cela le regarde. Va vite.
— Et pourquoi ne pas courir vous-même ? demanda Fernand.
— Je voudrais avant tout m’occuper du duc et lui donner mes soins.
— Mais puisqu’il n’est plus.
— Cela ne m’est pas prouvé, et tant que je n’en serai pas matériellement sûr… Du reste, soyez tranquille, Pacheco, mon neveu, est intelligent et courageux, c’est un autre moi-même… N’est-ce pas, mon garçon, tu me réponds de tout ?
Pacheco, malgré l’intelligence que lui soupçonnaît son oncle, le regarda d’un air hébété et effrayé, à l’idée de parcourir la nuit la forêt et ses environs. Pacheco était brave, mais surtout le jour, et il eût préféré dormir. Il sortit cependant et courut rassembler les alguazils disponibles, ceux qui n’étaient pas au bal.
Le corrégidor cependant s’était habillé, il était prêt à suivre don Fernand, Il fut décidé qu’on se rendrait d’abord au château où le bal et les réjouissances continuaient toujours. Avant de semer l’alarme et d’ébruiter cette nouvelle, il était convenable de l’annoncer à madame la duchesse de Santarem ; c’est elle qu’il fallait prévenir la première, ne fût-ce que pour demander son avis et ses ordres.
Précédés par quelques gens du château, ils étaient arrivés à la porte d’Aïxa. De là provenait le bruit qu’elle venait d’entendre et qui l’avait effrayée pour Piquillo. Elle attendit que celui-ci eût disparu, et quand elle eut calculé qu’il devait avoir descendu l’escalier et se trouver maintenant dans le parc, elle ouvrit à ceux qui frappaient.
XL.
la nuit des noces. (suite).
En apercevant don Fernand d’Albayda et le corrégidor, la surprise d’Aïxa fut grande, plus grande encore à la nouvelle qu’on venait lui apprendre ; et Josué Calzado, soit qu’il se crût obligé de donner des consolations à cette jeune marié déjà veuve, soit qu’il voulût lui faire partager une conviction qu’il cherchait à se donner à lui-même, ne cessait de répéter :
— Ne vous désolez pas, senora, il est possible que ce ne soit pas ; rien n’est encore prouvé, le seigneur don Fernand a pu se tromper.
— Je l’espère encore, monsieur, mais votre position et la mienne, lui répondit gravement Aïxa, nous imposent des devoirs qu’à tout événement nous devons remplir. Ils nous prescrivent les recherches les plus actives et les plus sévères ; s’il existe un coupable, il doit être puni. Je le veux, je le demande ; c’est à moi de le poursuivre, et je le ferai rigoureusement.
— Comme une noble dame que vous êtes, dit Fernand, et je suis prêt à vous seconder de mon crédit et de mon pouvoir.
En ce moment on vit entrer Pacheco, qui semblait avoir couru vivement, tant il était essoufflé.
— Qu’y a-t-il ? s’écria le corrégidor ; as-tu vu le noble duc ? existerait-il encore ?
— Je n’en sais rien, mon oncle, dit le jeune homme en reprenant haleine.
— Que venez-vous donc nous annoncer dit Fernand, avez-vous trouvé le coupable ?
— Je ne sais pas si c’est celui-là, répondit Pacheco, mais je crois que j’en ai un.
— Qui vous le fait croire ?
— Voici les faits, continua le jeune greffier, comme s’il posait déjà en qualité de témoin devant quelque cour de justice : moi, Inigo Pacheco, âgé de vingt-trois ans, greffier du corrégidor de Tolède, j’étais sorti par l’ordre de mon oncle, ledit corrégidor, pour courir à la recherche de ses gens, lesquels étaient dans la grande salle du château à boire et à danser, ce que je certifie véritable, l’ayant vu de mes yeux. Mais avant d’entrer au château, je rencontrai un paysan, un charron, nommé Antonio, avec un paquet de linge et de charpie, lequel, interrogé par moi, répondit qu’il rentrait à son logis avec ces objets pour panser un blessé qui, perdant tout son sang, lui avait demandé l’hospitalité à lui et à sa femme, il y avait près de deux heures.
Fernand tressaillit et se dit :
— Ce doit être lui !
— J’ai pensé alors, continua Pacheco, que ledit individu pouvait être pour quelque chose dans la cause dont il s’agit, ne fût-ce qu’à titre de renseignement et de témoin. Je suis entré dans la salle du bal où j’ai trouvé nos gens, les gens de mon oncle, qui dansaient un bolero. J’ai dit tout bas à quatre d’entre eux de descendre dans le village chez Antonio, le charron, d’y saisir un prétendu blessé ou qualifié tel, et de l’amener ici.
— Très bien ! dit tristement le corrégidor.
— Et si vous voulez, mon oncle, dit Pacheco, vous pouvez dresser du tout un procès-verbal.
— Comme tu voudras, répondit Calzado accablé, toi, pendant ce temps, tu iras avec nos gens et des flambeaux parcourir le parc dans toutes les directions pour tâcher de découvrir le corps du pauvre duc, si toutefois c’est bien lui ; et si décidément il n’est plus, s’écria-t-il avec un mouvement de rage, nous nous en vengerons sur ses meurtriers, à commencer par celui qu’on amène et que rien ne pourra soustraire à notre justice.
En ce moment tous les yeux se levèrent sur un jeune homme qui marchait avec peine et que soutenaient quatre alguazils. Des linges tachés de sang indiquaient que sa blessure était entre la poitrine et l’épaule gauche.
Il leva avec fierté son front pâle et calme, et que devint Fernand, que devint surtout Aïxa, quand ils reconnurent, l’un son ami, l’autre son frère : c’était Yézid !
Un alguazil remit à son chef les papiers saisis sur le prisonnier, et le corrégidor dit brusquement :
— Approchez et répondez.
— Répondre, s’écria Aïxa toute tremblante, il ne le peut. Il n’est pas en état… c’est évident !
— Eh oui, sans doute, ajouta Fernand, la marche qu’il vient de faire l’a épuisé… vous le voyez bien !
— Il va se trouver mal, dit Aïxa en lui approchant un fauteuil.
— Et s’il perd connaissance, vous ne pourrez rien en tirer.
— C’est juste, pensa le corrégidor, et cela nous retarderait encore.
Il fit signe à Pacheco d’aller exécuter les ordres qu’il lui avait donnés. Pacheco, à qui cette commission convenait peu, sortit lentement.
— Monsieur le corrégidor, reprit Fernand, faites mettre deux de vos gens dehors, à cette porte, pour veiller sur le prisonnier. C’est plus qu’il n’en faut, sans compter que je reste ici et que je réponds de lui.
— Et moi, dit Aïxa, qui venait de prendre un flacon et le faisait respirer au blessé, je vous préviendrai quand il pourra subir votre interrogatoire.
— Très-bien, murmura le corrégider en parcourant les papiers qu’on venait de lui remettre. Je vois déjà par la suscription de ces lettres qu’on nomme l’accusé Yézid d’Albérique, et qu’il demeure à Valence.
Aïxa tressaillit d’effroi, et Fernand s’écria avec impatience :
— Dans un instant, monsieur le corrégidor, nous examinerons tout cela ensemble.
— Comme vous voudrez, monseigneur ; en attendant, je puis toujours, ainsi que le proposait mon neveu, commencer mon procès-verbal ; auriez-vous pour cela une pièce où je ne dérangerais point madame la duchesse ?
— Ici, monsieur, ici…, dit vivement Aïxa, en ouvrant un petit salon attenant à sa chambre à coucher et dont les croisées donnaient sur le parc. Vous trouverez là tout ce qu’il faut pour écrire.
Le corrégider et deux ou trois de ses gens entrèrent dans le petit salon où ils s’établirent, et enfin Yézid se trouva seul avec Fernand et Aïxa, et celle-ci s’écria avec désespoir :
— Toi ! Yézid ! toi ! mon frère ! |
À ce nom de frère, Fernand fit un geste de surprise. :
— Oui, mon ami, lui répondit Yézid en le regardant et en serrant la main d’Aïxa ; ma sœur bien-aimée, que je n’ai pas voulu laisser immoler, et que je venais défendre.
— Toi aussi ! s’écria Fernand.
— Ah ! dit Aïxa en rougissant… c’est donc pour cela, seigneur Fernand, que vous avez quitté Lisbonne ?
— Oui… oui… senora, j’ignorais alors que vous eussiez un frère, et je pensais que le mari de Carmen pouvait vous en servir.
— Je comprends, dit Yézid en parlant avec peine ; je comprends maintenant. J’arrivais de Madrid où je n’avais pas trouvé ce duc de Santarem… Il était près de sept heures, je voulais lui parler… Une jeune fille m’a répondu : « Monseigneur ne recoit personne, il n’a pas même voulu voir le corrégidor… mais voilà monseigneur qui sort du château et qui va sans doute faire sa promenade du soir dans le parc ; » alors j’ai : doublé le pas et j’ai rejoint le duc. Nous nous trouvions tous deux dans une allée solitaire.
— Pour épouser une jeune fille, monseigneur, il faut avoir le consentement de ses parents, et vous ne m’avez pas demandé-le mien.
— Qui êtes-vous ?
— Le frère d’Aïxa.
— Que m’importe !
— Il importe que vous ne ferez point ce mariage.
— Il est fait devant Dieu et devant les hommes !
— Eh bien ! ce que Dieu et les hommes ont laissé faire, moi je le déferai. Et je tirai mon épée.
— Vous venez trop tard, n’a-t-il répondu ; un autre vous a devancé, il m’attend près de la tourelle, hors des murs du parc, et je lui dois la préférence. Vous après !
Je me mis devant lui et lui barrai le passage.
— Moi d’abord, lui dis-je.
— Impossible ! on m’attend.
— Je vous empêcherai bien de faire un pas de plus. Et je le frappai au visage. Furieux, il tira son épée ; il m’attaqua avec vigueur, et le combat dura longtemps. Je me sentis blessé, et mes forces m’abandonnaient… mais j’ai pensé à toi, ma sœur, j’ai pensé à mon père qui m’avait dit : délivre ta sœur… Alors je me suis élancé sur mon adversaire, je l’ai frappé, je l’ai tué… J’ai rempli ma promesse… tu es libre, ma sœur.
— Et tu es perdu ! s’écria la jeune fille en sanglotant, tu t’es battu en duel, et ce corrégidor connaît ton nom… Yézid, fils du Maure d’Albérique.
— Et les Maures, dit Fernand, ne peuvent ni porter d’armes ni se battre en duel ; les lois de Philippe II le leur défendent.
— Je le sais bien, dit Yézid ; je le savais quand je l’ai défié… Il y a peine de mort pour celui de nous qui tue un chrétien ! Et nos ennemis, le duc de Lerma et le grand inquisiteur, ne manqueront pas de faire valoir… la loi !
— Mais nous aurons aussi des protecteurs ! s’écria Fernand.
— Peut-être, répliqua Yézid en secouant la tête d’un air de doute.
— Moi, j’en suis sûre, dit Aïxa ; nous obtiendrons ta grâce, pourvu que tu ne tombes pas entre leurs mains et que tu ne sois pas livré à l’inquisition ; sans cela, tout est perdu.
— Elle à raison, s’écria Fernand ; si nous pouvions : le dérober aux premières recherches, le tenir caché dans quelque endroit impénétrable !
— J’en connais bien un, murmura Yézid.
— Où donc ?
— Chez mon père ! Je défierais l’inquisition de m’y trouver.
Et il pensait au souterrain qui renfermait leurs richesses.
— Mais pour cela, répondit Aïxa, il faudrait sortir d’ici… Et te voilà prisonnier du corrégidor.
— Il faudrait qu’il pût se rendre à Valence, ajouta Fernand ! et dans l’état où il est, comment fuir assez vite pour échapper aux poursuites ?
— Si nous avions seulement vingt-quatre heures d’avance…
Et nous n’en avons pas une, pas même quelques minutes ! ma sœur, continua Yézid en souriant. Il faut donc nous résigner. Le corrégidor va revenir. Je lui avouerai tout.
— Non, non, je t’en conjure, mon frère, n’avoue rien encore ?
— Et à quoi bon ?… Je voudrais en vain cacher la vérité, on la saura toujours.
— Silence ! s’écria Fernand, on revient.
C’était Pacheco, pâle, tremblant. Ses dents se choquaient les unes contre les autres, et cependant au milieu de sa frayeur perçait un air de satisfaction.
— Mon oncle ! mon oncle ! dit-il en entrant.
— Qu’est-ce ? demanda Fernand, que venez-vous annoncer au corrégidor ?
— Qu’il avait raison ! monseigneur le duc de Santarem n’est pas mort.
— À cette nouvelle, Aïxa pâlit, Fernand porta la main à son épée, Yézid se souleva sur son fauteuil !
— Vous l’avez trouvé dans le parc, dit Fernand en cherchant à cacher son trouble, il était revenu à la vie…
— Non… je viens de le voir descendre le grand escalier ! Il marchait si vite qu’il a manqué me renverser.
— Ce n’était pas lui.
— C’était lui ! je ne l’ai vu qu’un instant ce matin, mais je l’ai bien reconnu, je ne me suis pas trompé. La preuve, c’est que je l’ai arrêté par son manteau en lui disant : Monsieur le duc ! et il m’a répondu avec impatience : Qu’est-ce ? que me voulez-vous ?
— Il vous a répondu ! s’écria Fernand avec émotion.
— Oui, il m’a dit brusquement : J’ai à sortir, je reviens… laissez-moi. Et en effet, il se dirigeait vers la grande porte du château, et je me suis écrié : Ce n’est pas possible, monseigneur, il faut que mon oncle le corrégidor vous voie et vous parle en ce moment…
— Le corrégidor, a-t-il repris en tressaillant, je n’ai pas affaire à lui.
— Mais lui a affaire à vous… à cause de son procès-verbal. Il ne me pardonnerait pas de vous laisser sortir, et comme il insistait encore, j’ai fait signe à deux de nos gens, en demandant bien pardon à monseigneur de la liberté que je prenais, et malgré sa résistance on l’amène ici devant madame la duchesse et devant mon oncle… où est-il mon oncle ?
— Là, dans cette pièce, dit Aïxa en montrant le petit salon.
Pacheco s’y élança, et au même moment parut à la porte principale de la chambre à coucher un homme trainé par deux alguazils ; il était enveloppé d’un manteau noir, et sa tête était cachée par un feutre gris où se balançait une plume rouge.
— C’est l’homme du parc, dit Fernand, ma rencontre. de tout à l’heure, j’en suis certain.
À ce mot, l’inconnu fit un brusque mouvement pour échapper à ses deux gardes. Dans ce moment son chapeau tomba, et à l’instant partit un cri d’étonnement et de terreur poussé à la fois par Aïxa, par Yézid et par Fernand.
C’était le duc de Santarem ?
C’étaient du moins la taille, les traits, la physionomie de Santarem.
Pour quelqu’un moins préoccupé ou moins ému, il était facile de voir que le duc actuel était plus âgé, plus fort, plus carré que l’ancien ; que dans les traits du nouveau venu il y avait quelque chose d’ignoble et de commun, au lieu de l’afféterie et de la fatuité que l’on remarquait dans l’autre, et qui donnaient à sa physionomie un air de distinction et d’homme comme il faut.
Toutes ces remarques, qui avaient échappé au greffier Pacheco, don Fernand les avait faites en un instant. Il fit signe aux deux alguazils de s’éloigner, s’approcha rapidement de l’inconnu, et lui mettant dans la main une bourse pleine d’or, il lui dit vivement :
— Ce soir et jusqu’à demain soutenez hardiment au corrégidor que vous êtes le duc de Santarem, et votre fortune est faite.
Avant que l’inconnu eût pu répondre, la porte du petit salon s’ouvrit. Le corrégidor, rayonnant de joie, sortit, suivi de son neveu et de ses trois affidés…
— Pacheco ne m’a-t-il pas trompé ? s’écria-t-il ; est-il vrai que M. le duc de Santarem nous soit rendu ?
— Oui, monsieur le corrégidor, dit l’inconnu, sans se déconcerter. Et il tendit avec une certaine dignité sa main au magistrat, qui s’empressa de la serrer dans les siennes, comme pour s’assurer encore mieux de la présence réelle de monseigneur.
— Vous seul aviez raison, monsieur le corrégidor, dit Fernand en souriant, et je prie monsieur le duc de vouloir bien, ainsi que vous, me pardonner mon erreur.
— Erreur d’autant plus fatale, s’écria le corrégidor, qu’elle pouvait causer à madame la duchesse le saisissement le plus dangereux.
— Je n’en suis pas encore remise, dit Aïxa, pâle et tremblante.
— Et, continua le magistrat, il n’a pas fallu moins que la présence de votre mari pour vous rassurer entièrement.
— Comme vous dites, monsieur le corrégidor.
— Et maintenant, s’écria celui-ci, que la reconnaissance a eu lieu, que M. le duc est réellement vivant et bien vivant, et que nous voilà tous revenus de nos terreurs, à commencer par moi, expliquons-nous, car la justice veut des explications ; elle ne vit que de cela, et je suis obligé, pour monseigneur le duc de Lerma, de consigner la vérité sur mon procès-verbal.
Et le digne magistrat, qui avait déjà repris toute sa belle humeur, et qui rêvait de nouveau la place de conseiller et l’ordre d’Alcantara, ajouta en riant :
— Si la vérité était exilée de la terre, c’est dans les procès-verbaux qu’il faudrait l’aller chercher. Vous d’abord, seigneur don Fernand, comment avez-vous pu croire que M. le duc de Santarem était mort ? et comment le seigneur Yézid d’Albérique, qui est blessé…
Au nom de Yézid d’Albériqué, l’inconnu leva la tête et regarda le jeune homme avec attention. Le corrégider, qui avait remarqué ce geste, se mit à rire, et s’adressant à l’étranger :
— Oui, monseigneur, on accusait ce jeune homme de vous avoir tué, et il se trouve au contraire que, grâce au ciel, vous vous portez à merveille, et que c’est lui qui est blessé… Comment m’expliquera-t-on tout cela ?
— Très-aisément, monsieur le corrégider, dit Fernand avec un aplomb qui effraya Yézid et Aïxa et qui intrigua beaucoup l’inconnu.
Chacun redoubla d’attention.
— Ce soir, monsieur le corrégider, je suis arrivé assez tard de Madrid pour parler à M. de Santarem de la part du duc de Lerma…
— Je comprends, dit le corrégider.
— En essayant de rejoindre dans le parc le maître du château, qui faisait, m’a-t-on dit, sa promenade du soir, j’ai heurté la nuit sous mes pas un homme étendu à terre et sans connaissance ; j’ai cru tout naturellement que c’était le duc de Santarem que je cherchais… vous l’auriez cru comme moi.
— C’est très-juste, dit le corrégider.
— J’ai essayé vainement de le rappeler à la vie. Et alors, je l’ai cru mort.
— C’est tout simple, dit le corrégider.
— En voulant appeler et chercher du secours, je me suis égaré dans le parc, et c’est après deux heures : de marche que je suis enfin arrivé à l’hôtellerie, où vous dormiez…
— Je me le rappelle parfaitement.
— Pendant ce temps, qu’avaient fait les deux combattants ? car c’était un duel, monsieur le corrégidor, nous sommes obligés de vous l’avouer… Des deux adversaires, l’un… M. le duc de Santarem, qui était vainqueur, rentrait tranquillement chez lui, dans son château, l’autre, le seigneur Yézid, qui enfin était revenu à lui, s’était traîné, quoique dangereusement blessé, chez le charron Antonio, où vos gens l’ont saisi. Voilà toute la vérité.
— La vérité tout entière, répéta l’inconnu avec noblesse.
— C’est en effet bien simple, dit le corrégider, et je ne l’aurais jamais deviné.
— Je dois cependant, continua le faux Santarem, ajouter un mot au récit de Fernand d’Albayda, mon ami : c’est que j’étais rentré chez moi pour envoyer des secours à mon noble et vaillant adversaire, et ne pas le compromettre, je m’étais décidé à les lui porter moi-même. C’est un devoir que j’allais remplir… quand vos gens m’ont empêché de sortir de chez moi…
— Ah ! monseigneur ! fit Pacheco en s’inclinant.
— Insolence que je comptais châtier, et dont maintenant je rends grâce au ciel ! Quant au sujet de notre combat, ajouta-t-il en regardant le corrégidor, j’espère que personne ne m’en demandera compte. Il est des secrets qu’il n’est pas permis de trahir, même quand on le voudrait ; celui-ci est de ce nombre…
— Je ne demande rien de plus, s’écria le corrégidor avec respect.
— Le plus important dans ce moment, dit Aïxa en montrant Yézid, est de donner des soins à ce jeune gentilhomme.
— J’espère, répliqua l’inconnu avec un accent chevaleresque, qu’il daignera accepter un appartement dans mon château. Ce serait m’offenser que de loger ailleurs.
Yézid s’inclina en signe d’assentiment. Fernand proposa de lui donner le bras.
— Et moi, Messeigneurs, dit Aïxa, si M. le duc daigne me le permettre, et elle regarda l’inconnu, je vais vous indiquer l’appartement qui vous est destiné.
L’inconnu approuva de la main et du regard, adressa un salut gracieux à don Fernand et à Yézid, puis se jetant dans un excellent fauteuil près de la cheminée, il contempla, d’un air d’aisance et de protection, Josué Calzado.
— Eh bien ! corrégidor, que je ne vous gêne pas ; achevez votre procès-verbal.
Pendant ce temps, le cœur oppressé par la joie et respirant à peine, les trois amis sortaient de l’appartement ; mais au lieu de monter le grand escalier qui conduisait aux chambres d’honneur, ils se dirigèrent vers la cour.
— Es-tu en état de marcher quelques minutes ? demanda Fernand à Yézid.
— Je ne souffre plus, dit celui-ci.
— Eh bien ! la voiture qui m’a amené de Madrid doit m’attendre depuis longtemps à cinquante pas sur la route. Elle est douce, excellente et faite exprès pour un blessé. Nous roulerons toute la nuit sur la route de Valence.
— Maintenant, ma sœur, dit Yézid, nous avons devant nous les vingt-quatre heures que tu demandais.
— Oui, tu seras en sûreté quand la vérité se découvrira ; et grâce à l’audace et à l’esprit de cet aventurier, elle ne se découvrira pas de longtemps.
— Qu’il soit Santarem jusqu’à demain, c’est tout ce qu’on exige de lui, dit Fernand.
— Et demain, reprit Aïxa, fidèle à vos promesses, je lui paierai généreusement l’imposture qui nous sauve… Adieu, frère ! adieu ! que le ciel et l’amitié te conduisent !
Elle se jeta dans les bras d’Yézid, et, avec un regard de reconnaissance, elle tendit la main à Fernand.
Celui-ci se crut payé de toutes ses peines. Quelques minutes après, les deux amis roulaient sur la grande route, Aïxa rentrait au château, et au moment où elle arrivait au haut du grand escalier, elle rencontra Pacheco le greffier, qui lui dit :
— M. le duc de Santarem fait demander madame la duchesse.
Aïxa tressaillit, son frère n’était pas encore en sûreté, et, craignant que quelque incident fâcheux ne fût survenu de la part du corrégidor, elle se hâta de se rendre dans sa chambre à coucher.
Le duc de Sautarem avait jeté sur un meuble son manteau et son feutre ; il s’était, comme nous l’avons vu, étendu dans un bon fauteuil, les pieds au feu, à son aise, et comme chez lui, Le corrégidor, assis devant une petite table, terminait son procès-verbal.
— Par saint Jacques, mon cher Calzado, vous faites là un état que je n’aimerais guère.
— Vous avez raison, monseigneur, il vaut mieux être duc que corrégidor… surtout quand on a, comme vous, une femme charmante.
— Oui… elle n’est pas mal, n’est-ce pas ? Vous n’êtes pas marié, monsieur le corrégidor ?
— Heureusement ! toujours absent de chez moi, le jour et souvent la nuit, vous le voyez…
— Vous êtes donc bien occupé ?
— C’est inouï !… À Pampelune, où j’exerçais, il y a quelques années, ce n’était rien, c’était un métier de chanoine ; mais depuis que j’ai été nommé à Tolède, je n’ai pas un moment à moi. Je suis accablé d’honneurs et de fatigues. D’abord voici le premier ministre qui m’ordonne… de veiller sur vous, monsieur le duc, j’ignore pourquoi, mais vous le savez sans doute ?
— Pas plus que vous, corrégidor.
— C’est étonnant car il m’a expressément recommandé de ne point vous quitter et de vous protéger envers et contre tous.
— Mission que vous avez remplie d’une manière extraordinaire, j’en suis témoin.
— N’est-ce pas ? Et au moment où il me prescrit de ne pas vous perdre de vue, monseigneur de Ribeira, archevêque de Tolède, m’ordonne de poursuivre jour et nuit, et à outrance, un infâme bandit nommé Juan-Baptista.
— En vérité ? dit le duc en riant.
— Qui n’a pas craint d’emprunter l’habit honorable de l’un des miens pour porter une main sacrilége sur le saint prélat.
— Parbleu, dit le duc avec impatience, voilà ce que je ne comprends pas… expliquez-moi cette affaire.
— Elle est inexplicable… et l’on n’en parle qu’à voix basse. Il paraîtrait que l’archevêque aurait reçu lui-même quelques coups de discipline sur les épaules…
— C’est original, dit le duc.
— De la main de ce Juan-Baptista, déguisé en alguazil, et qui voulait convertir monseigneur.
— C’est absurde ! s’écria le duc avec colère.
— Voilà du moins ce que m’ont appris les rapports les plus véridiques et les plus détaillés qui m’aient été faits sur cette affaire. Il y a aussi un Maure, un nommé Piquillo, qui est mêlé à tout cela. Il s’est enfui, le misérable, au moment où il allait être converti, et j’ai ordre de le poursuivre.
— Vous ferez bien, dit le duc, je vous le recommande spécialement.
— Il me suffirait de votre recommandation, monseigneur, pour redoubler de zèle, mais il m’est déjà ordonné de l’arrêter, partout où je le trouverai, et de le renvoyer à monseigneur l’archevêque Ribeira, car il faut qu’il soit chrétien, mort ou vif ; ce sont les expressions du saint prélat.
— Ce n’est pas moi qui m’y opposerai !… au contraire ! mais dites-moi, corrégidor, est-ce que vous n’auriez pas une idée que j’ai ?
— Laquelle, monseigneur ?
— Celle de souper !
— C’est trop d’honneur pour moi, monseigneur.
Aïxa rentra dans ce moment, et le duc s’écria :
— Voici, madame la duchesse, ce pauvre corrégidor qui meurt de faim, et moi aussi ; n’y aurait-il pas moyen de souper ici au coin du feu ?… si toutefois il n’y a pas d’indiscrétion ? dit-il en se levant.
— Restez, monsieur, restez, de grâce, répondit-elle vivement en le retenant, car il lui semblait entendre encore le bruit des roues de la voiture.
— Je resterai certainement, et tant que vous le voudrez, madame la duchesse… mais daignez alors vous occuper de ces détails… car moi je ne peux pas.
— C’est juste, dit Aïxa, qui aimait autant que les gens de la maison ne vissent point le nouveau duc.
— Je prie monseigneur, dit le corrégidor, de ne point se gêner pour moi… il reste là en uniforme… et en bottes, quand j’ai vu dans la chambre à côté où j’étais tout à l’heure, sa robe de chambre de brocart brodée en or et ses pantoufles fourrées en bon cuir de Cordoue…
— Je n’oserai jamais, dit le duc en s’inclinant.
— Devant votre femme et chez vous, ce serait trop extraordinaire, s’écria en riant le corrégidor.
Et Aïxa effrayée se hâta de répondre :
— Il me semble, en effet, que monsieur le duc est le maître.

Celui-ci ne se le fit pas dire deux fois. Il prit une bougie et passa dans la pièce voisine, qu’il examina soigneusement et en détail. Aïxa profita de son absence pour faire servir quelques viandes froides, et renvoya les domestiques. Le corrégidor, à qui l’exercice et l’heure avancée de la nuit avaient donné un vif appétit, attendit cependant avec respect la rentrée de M. le duc ; il ne tarda pas à paraître… en pantoufles, en robe de chambre élégante, et le défunt lui-même serait revenu en personne dans ce moment qu’il l’aurait pris pour le vrai duc, à plus forte raison le corrégidor.
Le véritable amphitryon,
Est l’amphitryon où l’on soupe !
dit Plaute, et depuis lui Molière ; et Josué Calzado soupait d’un si bon appétit qu’il en aurait donné à quelqu’un qui n’en aurait pas eu. Grâce au ciel, ce n’était pas là ce qui manquait au noble châtelain. Tous deux à l’envi sablaient le porto et l’alicante. Le temps s’écoulait vite pour eux, et Aïxa, se promenant dans la chambre, les yeux fixés sur la pendule, comptait les minutes, et se disait :
— Une heure ! une heure d’avance ! Voilà une heure qu’ils sont partis !
Elle était tellement-préoccupée de l’idée unique qui dans ce moment l’absorbait tout entière, qu’elle fit à peine attention au corrégidor, Celui-ci se levait et disait au duc :
— Je crains, monseigneur, d’être indiscret… mais à cette heure-ci il me sera bien difficile de retourner à l’hôtellerie du village…
— Aussi j’espère bien que vous logerez au château.
Le duc prit un flambeau qu’il mit dans la main de Josué Calzado, et s’approchant de la porte, il cria au dehors :
— Conduisez M. le corrégidor à son appartement.
— Qu’est-ce ? dit Aïxa en sortant de la rêverie où elle était plongée.

— Rien, madame, ne faites pas attention, dit le duc en fermant la porte principale, dont il retira la clé, c’est M. le corrégidor qui se rend chez lui.
Aïxa jeta autour d’elle un regard d’effroi. Elle se trouvait seule, la nuit, avec cet homme qu’elle ne connaissait pas. Elle n’avait, il est vrai, aucune raison de se défier de lui ; au contraire, il venait de la servir avec zèle, dévouement et surtout intelligence.
Et cependant Aïxa tremblait.
Elle se rassura peu à peu en le voyant revenir près de la cheminée et s’asseoir tranquillement. D’ailleurs on entendait encore dans le château le bruit des domestiques qui montaient, descendaient et traversaient les corridors, le bruit des portes qui se fermaient, enfin tout le mouvement qui, même après l’heure du repos, règne longtemps encore dans une vaste et nombreuse maison. Aïxa se hasarda à adresser la parole à l’étranger :
— Vous venez, monsieur, de nous aider bien généreusement.
— Oui, la scène a été chaude,
— Et difficile.
— Surtout quand on n’est pas prévenu et qu’on est obligé d’improviser…
— Je ne vous demanderai pas, monsieur, comment vous vous êtes trouvé là… si à propos pour nous rendre ce service…
— Franchement, madame, je l’aime autant.
— Et pourquoi ?
— Parce que je vous demanderais comment il s’est trouvé que vous ayez besoin qu’on vous rendît service… et ce serait peut-être indiscret.
— Non pas… mais trop long à vous raconter.
— Vous avez raison, madame. Il est tard… vous avez sans doute besoin de dormir… et moi aussi !… surtout quand on a bien soupé.
— Oui, monsieur… mais permettez-moi de vous dire…
— Ne faites pas attention à moi… je suis très-bien dans ce fauteuil.
— Vous seriez encore mieux dans cette pièce, dit Aïxa en lui montrant la chambre à côté.
Mais déjà l’inconnu paraissait ne plus l’entendre. Il s’était enfoncé dans le fauteuil, sa tête était tombée sur sa poitrine, et un ronflement d’abord léger, puis plus fortement accentué, prouva qu’il serait sourd aux observations et explications d’Aïxa, et qu’il n’était nullement disposé à y faire droit.
La jeune femme se serait bien retirée elle-même dans l’appartement qu’elle désignait au faux duc de Santarem, mais le fauteuil occupé par lui était devant la porte et fermait le passage. Elle s’arrêta. Elle n’osait l’éveiller. D’ailleurs, tant qu’il dormirait ainsi, elle n’aurait rien à craindre. Elle alla donc s’asseoir à l’extrémité de la chambre, le plus loin de lui possible, et ne le quittant point des yeux. Il lui sembla que de temps en temps l’inconnu entr’ouvrait les siens.
Il ne dormait donc pas !… elle commença a avoir peur.
Une heure et plus se passa ainsi ; le bruit qui régnait dans le château avait peu à peu diminué, puis il s’était entièrement éteint. Partout le plus profond silence ; chacun dormait. Il était probable que l’inconnu avait attendu ce moment pour s’éveiller, car il leva la tête, ouvrit les yeux et aperçut en face de lui ceux d’Aïxa, qui, brillants et flamboyants, ne perdaient pas un seul de ses gestes.
— Eh quoi, madame, vous ne dormez pas !
— Non, seigneur cavalier, j’attendais votre réveil pour vous prier de vouloir bien passer dans l’appartement voisin et me laisser celui-ci, qui est le mien.
— Ah ! dit l’inconnu avec un sourire moqueur, vous oubliez que, ce soir, quand je voulais sortir de ce château, on m’a retenu, que vous-même tout à l’heure encore m’avez dit : « Restez… restez, de grâce. » Je l’aï promis, et je tiens ma parole.
— Je ne vous empêche pas de la tenir, dit Aïxa, pourvu que ce soit, non pas ici… mais là-bas.
Et du doigt elle lui montrait la porte de l’autre chambre.
— À merveille ! on n’a plus besoin de moi et l’on me renvoie. Voilà la reconnaissance des grands seigneurs et des grandes dames !
— Je ne suis point ingrate, dit Aïxa. Le noble cavalier Fernand d’Albayda vous a promis de faire votre fortune. Je me chargerai d’acquitter sa promesse. Que voulez-vous ?
— Ce que je veux ! dit-il en la regardant.
Et il fit un pas vers elle.
Dès le premier moment où l’inconnu était entré dans cette chambre, il était resté comme ébloui et fasciné devant cette belle jeune fille dont les yeux noirs lançaient des éclairs. Par un triomphe dont elle eût été peu flattée, sa vue avait produit sur le bandit le même effet que sur les nobles seigneurs. Ce n’était pas de l’amour, c’était plus, car il l’eût préférée à l’argent, à l’or, aux diamants, ses seules amours à lui. Et quand il se trouva tout à coup être son mari, quand tout le monde lui donna ce titre, qu’elle-même acceptait et ne repoussait point ; quand il se vit seul, dans sa chambre à elle, et avec elle, il éprouva un frisson de joie qui parcourut tout son être et effleura presque son cœur, mouvement inconnu et involontaire qui fit bientôt place à une frénésie passionnée et furieuse.
Il s’était donc approché d’elle et répéta :
— Ce que je veux ! je veux ce qui m’est dû, ce qui m’appartient !
— Rien ici ne vous appartient.
— Ne suis-je pas le duc de Santarem, votre mari !… Je suis ici chez moi, et tout est à moi, à commencer par vous !
Aïxa voulut s’élancer vers la sonnette. Il l’arrêta et lui dit :
— Qu’allez-vous faire ? appeler vos gens ! ils ne viendront pas ! mais ils viendraient, qu’ils s’arrêteraient à cette porte. Vos cris mêmes ne leur donneraient pas le droit de la franchir. Je suis votre mari, vous-même l’avez reconnu ; ils le savent, et ils s’éloigneront à ma voix, car vous êtes ma femme… vous l’avez dit !
— Plutôt la mort ! répondit Aïxa en regardant avec angoisse autour d’elle. Elle ne vit aucune arme, aucun moyen de se défendre, ni même de mourir.
— À moi !… à mon aide ! seigneur Josué ! seigneur corrégidor ! cria-t-elle en réunissant toutes ses forces.
— Et si ce corrégidor venait, vous perdriez celui que vous aimez… ce Yézid, ce Maure qui est votre amant et que j’ai sauvé ! On irait le saisir là-haut dans sa chambre, le traîner blessé et sanglant…
— Plût au ciel qu’il fût là pour me défendre et pour te châtier, toi qui n’es qu’un infâme !
— Un infâme ! soit ! un infâme qui t’aime ! qui bravera pour toi la mort et les bourreaux !
Il voulut l’envelopper dans ses bras. Elle lui échappa, et, plus rapide qu’une flèche, elle s’élança à l’autre extrémité de la chambre, ouvrit une fenêtre et se précipita. Le brigand poussa un cri d’effroi, il l’avait suivie. Il était près d’elle. D’une main vigoureuse il la saisit à moitié penchée au-dessus de l’abîme où elle allait rouler ; comme un rival furieux et jaloux, il l’enleva au trépas qu’elle lui préférait, et serra contre son cœur sa victime pâle, brisée, à moitié évanouie.
— Dieu de mes pères, secourez-moi ! dit-elle.
— Dieu n’est pas ici, dit le bandit en riant, il demeure trop haut pour nous entendre.
En ce moment, et comme pour répondre à son blasphème, une explosion terrible retentit. Le brigand poussa un cri de rage et de douleur. Son bras gauche était fracassé. Il se retourna, et, à la lueur des flambeaux qui brûlaient encore dans l’appartement, il vit Piquillo, pâle et les cheveux hérissés, lui présentant à la poitrine un second pistolet. Il recula, épouvanté à la fois, et de l’apparition, et de l’arme qui le menaçaient.
— Dieu, que tu défiais, m’envoie à toi, capitaine Juan-Baptista ! car j’avais d’anciennes dettes à te payer.
Aïxa, cependant, s’était jetée au cordon de la sonnette. Au coup de feu qui avait retenti dans le château, au bruit de cette sonnette d’alarme, les domestiques, le corrégidor et ses gens avaient été réveillés et descendaient en tumulte le grand escalier. Aïxa, prenant la clef que le capitaine avait placée sur la cheminée, avait couru ouvrir la porte. Le corrégidor s’était précipité le premier dans l’appartement, et apercevant Juan-Baptista dont le sang coulait, il s’écria avec désespoir :
— M. le duc de Santarem blessé ! et moi qui devais le protéger !
— Épargnez-vous ce soin, lui dit froidement Aïxa ; ce n’est point le duc de Santarem.
— À d’autres, senora ! où serait donc alors le véritable duc ?
— Dans le parc, dit Piquillo. Envoyez vos gens près le troisième massif de la grande allée ; vous le trouverez mort… mort depuis hier soir !
— Ce n’est pas possible ! dit le corrégidor en pâlissant. Allez, Pacheco, allez voir. Que serait donc alors celui-ci (et il montrait Juan-Baptista), celui-ci que mon neveu, que madame la duchesse, que tout le monde a reconnu ?
— Celui-ci, poursuivit Piquillo, est un fourbe, un imposteur, le capitaine Juan-Baptista.
— Juan-Baptista ! cria le corrégidor en le regardant avec étonnement ; lui que l’archevêque de Valence m’a ordonné d’arrêter !
— Lui-même, continua Piquillo ; lui qui, sachant qu’il y avait ici une noce, une fête, ne s’est introduit dans ce château qu’avec des idées de vol ou d’assassinat ! lui, dans ce moment, capitaine d’infanterie et dernièrement alguazil.
— Alguazil ! s’écria le corrégidor, ainsi que tous les alguazils véritables qui l’environnaient. C’est bien cela ! c’est lui qui a osé se jouer de ce qu’il y a de plus respectable au monde, des archevêques !
— Et des alguazils ! s’écrièrent ses compagnons.
Juan-Baptista vit qu’il était perdu, que ce dernier crime-là surtout serait sans rémission. Mais il n’était pas homme à abandonner la partie sans vengeance.
— Eh bien oui, s’écria-t-il, puisqu’il ne me reste qu’un bras disponible et que je ne peux vous étrangler tous, damné corrégidor, vous et vos acolytes, c’est moi, Baptista ! qui suis encore assez généreux pour rendre un service, car si je ne prenais pas de temps en temps la peine de faire votre état, vous ne pourriez jamais vous en tirer. Celui qui est mort et bien mort est le duc de Santarem ; son meurtrier, qui dort là-haut tranquillement, est Yézid d’Albérique, et celui-ci (il montrait Piquillo), je vais vous apprendre qui il est. Nous jouons dans ce moment une partie ensemble une partie dont il a gagné la première manche, dit-il en regardant celle de son habit qui était ensanglantée, mais je le retrouverai et je compte bien gagner la seconde. Pour commencer, apprenez, corrégidor stupide, que c’est le Maure Piquillo.
— Lui, dit Calzado, dont l’étonnement redoublait à chaque instant.
— Lui ! qui s’est enfui au moment d’être converti, reprit en riant le capitaine, lui, dont votre incompréhensible archevêque veut faire un chrétien, mort ou vif.
— Ce n’est pas vrai ! dit Aïxa, effrayée du danger auquel Piquillo s’était exposé pour elle… ce n’est pas vrai, monsieur le corrégidor, cet homme vous trompe encore ; c’est un imposteur qui veut vous compromettre par de fausses démarches.
— C’est ce que nous verrons, dit le corrégidor, qui dans ce moment ne savait plus ce qu’il devait croire. Son trouble redoubla encore, quand il vit entrer son neveu en désordre et les traits bouleversés,
— Eh bien ! qu’y a-t-il encore !… parle, parle donc !
— Cette fois ce n’est que trop vrai, dit le jeune greffier avec une horreur indéfinissable ; j’ai constaté moi-même le fait. Ils étaient deux… deux ducs de Santarem existants, dont un est mort…
— Qu’est-ce que je vous disais ? s’écria Juan-Baptista. Par saint Thomas, votre patron, me croirez-vous enfin, incrédule corrégidor ?
— Je ne croirai plus rien que mes yeux et mes oreilles, et encore !… Venez avec moi, dit-il aux alguazils et à son neveu. Allons d’abord voir et interroger ce jeune homme d’hier, ce Yézid… Mais avant tout… je ne laisserai point ces deux hommes ensemble. Celui-ci, qui est blessé (et il montrait Juan-Baptista), conduisez-le dans la pièce voisine de celle-ci… Bien. Fermez la porte à double tour, et donnez-moi la clé… à moi… elle ne me quittera pas. Quant à vous, senora, daignez me conduire vous-même à l’appartement occupé par le seigneur Yézid d’Albérique.
— Je suis à vos ordres, monsieur le corrégidor, dit Aïxa en cherchant à cacher son inquiétude et ses craintes, non pour Yézid, qui ne risquait plus rien, mais pour Piquillo ; je suis prête a vous conduire, mais j’espère qu’avant tout vous allez rendre à la liberté ce jeune homme, qui est un ami, un protégé de don Fernand d’Albayda.
— Madame la duchesse, dit le corrégidor, nous allons d’abord en causer avec le seigneur don Fernand, puis j’en écrirai au duc de Lerma en lui envoyant dès ce matin ce jeune prisonnier.
Aïxa tressaillit. Piquillo était perdu.
— D’ici là, poursuivit le magistrat, je prierai le jeune cavalier de vouloir bien, avec votre permission, madame la duchesse, nous attendre dans cette chambre, dont nous allons, par précaution, fermer la porte sur lui.
Aïxa respira, Piquillo était sauvé.
— Je n’ai rien à répondre, dit la jeune fille ; partons, monsieur le corrégidor.
Avant de sortir, elle tourna les yeux vers Piquillo, et ensuite vers la boiserie à l’endroit ou était la porte secrète, puis elle adressa à son frère, à celui qui venait de la sauver, un regard d’éternelle amitié. C’était le seul remercîment qui lui fût possible.
Piquillo entendit se fermer la porte principale.
Tout le monde était parti. Il était seul. Il regarda autour de lui et contempla quelques instants la chambre d’Aïxa, ce lieu où il avait éprouvé un bonheur si grand et une si horrible douleur. Le bonheur avait passé comme un éclair, et la douleur devait durer toute sa vie. Mais il ne se plaignait plus de son sort ; il bénissait le ciel, qui lui avait permis, dans ce lieu même, de sauver de la honte et du déshonneur son amie, sa sœur… oh ! plus encore peut-être !… Mais il ne voulut point s’arrêter à cette idée, et se rappelant le dernier regard, le dernier ordre d’Aïxa, il fit glisser le panneau de la boiserie, descendit l’escalier, ouvrit la porte qui donnait sur le parc, et s’élança à grands pas dans la campagne aux premiers rayons du jour qui commençait à paraître.
Nous dirons plus tard ce qui l’avait forcé à revenir sur ses pas et l’avait ramené ainsi au secours d’Aïxa. Nous ne pouvons quitter le château de Santarem sans avoir le résultat des recherches du corrégidor.
Il était monté avec Aïxa à un des appartements d’honneur du second étage ; il entra dans la chambre où devait reposer le seigneur Yézid. Il ne l’y trouva pas ; l’appartement de don Fernand était également désert, et au grand étonnement du corrégidor, il fut impossible de trouver dans tout le château la moindre trace de leur séjour ou de leur passage. Privé ainsi d’un prisonnier sur lequel il comptait, le désappointé Josué Calzado redescendit à la chambre à coucher d’Aïxa pour s’emparer au moins de Piquillo et l’appréhender au corps ; mais celui-ci avait également disparu. Alors, et dans le dernier degré de la fureur, le magistrat ordonna à son neveu Pacheco, le greffier, et à ses gens de traîner devant lui sa seule capture, son seul dédommagement, le capitaine Juan-Baptista, sur lequel allait retomber tout le poids de sa colère et de sa justice. Au bout de quelques minutes, le jeune greffier rentra avec l’air hébété et étonné qui lui était habituel.
— Eh bien, mon neveu ? dit le corrégidor en se dressant devant lui comme un point d’interrogation.
— Eh bien, mon oncle, personne !
— Personne répéta le magistrat anéanti et comme frappé d’un coup au-dessus de ses forces. Soudain il regarda son neveu. Un rayon d’espoir brilla dans ses yeux. On l’entendit murmurer le mot : Imbécile ! puis s’écrier : Si on ne voyait pas tout par soi-même ! et il s’élança dans l’appartement voisin.
La chambre où l’on avait emprisonné momentanément le capitaine avait deux croisées donnant sur le parc. Malgré la douleur horrible que devait lui causer sa blessure, il avait arraché les longs et solides rideaux de damas qui décoraient cet appartement ; avec son bras droit et avec ses dents, il les avait attachés au balcon de fer, qui n’était pas très-éloigné du sol, et s’était ainsi laissé glisser jusqu’à terre, en s’aidant d’un seul bras ; mais auparavant, et pour établir sans doute un lest convenable, il avait eu soin de décrocher la montre, les bagues, les bijoux, tout ce qui se trouvait dans l’appartement qu’il abandonnait. Il y a une comédie de Calderon intitulée : De trois choses en ferez-vous une ? Josué Calzado, qui vivait de son temps, la lui a peut-être inspirée. Des trois prisonniers qu’il espérait (Juan-Baptista, Piquillo et Yézid), le corrégidor n’avait pu en réaliser aucun ; en revanche, le jeune duc, le nouveau marié sur lequel il devait veiller, était bien décidément mort. C’est ainsi que le corrégidor mayor de Tolède exécuta la mission extraordinaire et importante pour laquelle le ministre l’avait envoyé exprès au château de Santarem.
XLI.
le couvent.
On a vu, dans le chapitre précédent, que la nuit était déjà avancée quand don Fernand et le corrégidor, frappant à l’appartement d’Aïxa, avaient forcé Piquillo à s’éloigner. Celui-ci, muni de la eté que sa sœur lui avait remise, s’était trouvé au milieu du parc, et avait naturellement suivi l’allée principale qui s’offrait à lui. Elle était fort longue et il s’avançait en regardant avec précaution autour de lui, quand il découvrit près d’un massif l’horrible spectacle qui avait déjà frappé les yeux de don Fernand d’Albayda.
C’était un homme baigné dans son sang, et les rayons de la lune lui montrèrent des traits qu’il connaissait trop bien.
D’abord, le matin, à l’église, au moment de ce fatal mariage, il avait vu le duc, et puis sa ressemblance si grande et si frappante avec Juan-Baptista ne pouvait lui laisser aucun doute. Sans s’expliquer les causes d’un pareil événement, il comprenait de quelle importance il était d’en informer d’abord et avant tout sa sœur Aïxa. Et malgré les dangers qui le menaçaient lui-même, il revint sur ses pas. Une des fenêtres de l’appartement de la nouvelle duchesse donnait sur le parc ; il vit cet appartement éclairé et distingua à travers les rideaux les ombres de plusieurs personnes. Il n’osa pas alors se servir de la eté qu’il avait gardée ni pénétrer par le petit escalier de la chambre d’Aïxa. Il attendit, errant dans le parc, se cachant dans les massifs épais, revenant de temps en temps regarder à la fenêtre si les lumières étaient éteintes, si Aïxa était seule, s’il pouvait sans bruit arriver jusqu’à elle.
Tout à coup il vit cette fenêtre s’ouvrir, et une femme, pâle et échevelée, s’élancer pour se précipiter. C’était Aïxa ! Et derrière elle il vit Juan-Baptista ! Piquillo gravit le petit escalier, ouvrit le panneau dans la boiserie, et se trouva en un instant près de sa sœur pour la défendre, pour la sauver. On sait le reste.
Maintenant il se trouvait seul, rêvant aux événements de la nuit, se demandant ce qu’il allait devenir. Quels seraient désormais son but et sa vie ? Son but jusqu’alors avait été l’amour d’Aïxa. Son existence, c’était elle ! il ne lui restait rien, pas même l’espoir ! Le même jour avait vu la jeune fille esclave et libre ; ce mariage, formé par la contrainte, était brisé. Elle était de nouveau maîtresse d’elle-même !
— Mais qu’importe ! s’écriait Piquillo en sanglotant… perdue à jamais… perdue pour moi ! Et alors il voulait de lui-même se livrer à ses ennemis et aux bourreaux qui le poursuivaient. Il voulait mourir ! et puis il rougissait de sa lâcheté et de sa faiblesse, il se disait que ses jours, inutiles à lui-même, pouvaient être utiles à Aïxa, à Yézid, à d’Albérique, à tous les siens. En ce moment même Yézid n’était-il pas en danger ?… Si, comme l’avait dit devant lui Juan-Baptista (et tout lui prouvait que c’était la vérité), si Yézid s’était battu avec le duc de Santarem et l’avait tué, il n’y avait point pour lui de grâce à espérer, il y allait de sa vie, et Piquillo jurait de la défendre, oubliant que ses jours à lui-même et sa liberté étaient menacés. — Oui, se disait-il, c’est pour Yézid, c’est pour mon frère que je dois me dévouer.… c’est pour le sauver qu’il faut vivre. Et il rêvait qu’il lui serait facile d’arriver à Madrid, de s’y cacher… où ?… dans quel lieu ? dans quel asile ?
Cet asile, il pensa qu’il pourrait pendant quelques jours le trouver chez la senora Urraca, sa grand-mère ; qu’il attendrait là, en secret et en sûreté, le retour d’Aïxa ou de Fernand d’Albayda, et qu’il irait leur demander alors : Quel péril faut-il braver pour sauver Yézid ?… me voici ! envoyez-moi !
Tout entier à ces idées, il marcha d’un bon pas une partie de la journée. Il ne craignait plus de rencontrer Juan-Baptista, qu’il savait prisonnier du corrégidor et dont il se croyait délivré. Il s’était cependant prudemment défait de sa robe de pèlerin qu’il avait jetée dans un fossé, car il était probable que Josué Calzado, en exécution des ordres rigoureux de l’implacable archevêque, lancerait à sa poursuite toute son armée d’alguazils. Pour cette raison il évita d’entrer dans Tolède, ce qui l’aurait conduit plus directement à Madrid. Il préféra faire un détour, prit sur la droite par Ocana et Aranjuez, qu’il traversa le lendemain, puis se dirigea sur un gros bourg nommé Pérolès.
Il lui avait semblé que depuis quelque temps on l’épiait. Deux ou trois voyageurs, des espèces de marchands forains qui avaient cherché à entrer avec lui en conversation, suivaient la même route et s’arrêtaient aux mêmes endroits que lui. Ces compagnons de voyage lui paraissaient suspects. Il s’était établi dans une hôtellerie à Pérolès et avait commandé son diner, quand, dans la salle à côté de la sienne, il entendit arriver des voyageurs. Il regarda par une fente de la cloison. C’étaient les trois marchands, fatigués de la chaleur du jour et de la marche qu’ils venaient de faire ; ils déposèrent les ballots qu’ils portaient sur leurs épaules, ouvrirent les surtouts de camelot jaune qui recouvraient leurs poitrines, et Piquillo vit briller l’uniforme noir qu’il connaissait si bien, celui d’alguazil. Il sut alors à quoi s’en tenir, et, pour qu’il ne lui restât pas le moindre doute :
— Es-tu sûr que ce soit lui ? dit l’un d’eux.
— Ma foi, non.
— On disait qu’il avait un habit de pèlerin, il ne l’a plus.
— L’habit ne fait pas le moine, dit le troisième. Le reste du signalement est conforme.
— C’est juste… aussi mon avis est de l’arrêter.
— Arrêtons toujours.
— Et si ce n’est pas ce lui que nous cherchons ?
— C’est sa faute ! pourquoi lui ressemble-t-il ?… ça lui apprendra !
— Est-il ici ?
— Il vient d’arriver et de commander son repas.
— Très-bien… Pendant qu’il dînera… c’est le bon moment. On ne se défie de rien quand on dîne.
Piquillo n’en entendit point davantage. Il n’attendit point son dîner, descendit doucement l’escalier, ne sortit point par la grande porte de l’hôtellerie, mais par un petit jardin dont il franchit la haie, disparut derrière un bouquet de bois, gagna la campagne, et après avoir longtemps marché à travers champs, aperçut enfin le clocher d’une ville importante. On lui dit que c’était Alcala de Hénarès.
Il était encore à quatre ou cinq lieues de Madrid, mais la nuit était venue, il était harassé de fatigue, et de plus il n’avait pas dîné. Il s’arrêta à l’hôtellerie de Saint-Pacôme, se fit servir un bon souper, puis demanda une chambre, un lit, et s’endormit, après avoir, par précaution, fermé sa porte en dedans aux verrous.
Il se réveilla en pensant que l’oncle de Juanita, le barbier Gongarello, qu’il avait sauvé du bûcher de l’inquisition, avait été relégué à Alcala de Hénarès, qu’il y avait transporté ses pénates et ses rasoirs, et que c’était lui qui faisait la barbe à la population de cette ville. Je suis sauvé ! se dit-il ; me voici un ami, une protection ! Je serai mieux chez lui que dans une hôtellerie, où l’on est exposé à toutes sortes de rencontres, et puis il me donnera les moyens de me rendre sûrement et directement à Madrid. Il se leva, ouvrit sa fenêtre, qui donnait sur la grande place, huma quelques instants l’air du matin, puis se retira vivement. Un café était voisin de l’hôtellerie, et devant la porte de ce café, au milieu d’un groupe de bourgeois qui parlaient des variations de l’atmosphère et de la politique, Piquillo avait vu deux yeux se lever sur lui. Ces yeux étaient ceux d’un militaire qui avait le bras gauche en écharpe et qui s’appuyait de la main droite sur une canne. Toujours préoccupé du souvenir de Juan-Baptista, Piquillo avait cru voir encore ses traits dans ceux du vieux militaire, supposition qu’avait fait naître sans doute le rapprochement de ce bras en écharpe avec la blessure que lui-même avait faite l’avant-veille au bandit. Mais il lui paraissait impossible que Juan-Baptista, qui avait été saisi par le corrégidor et jeté probablement par lui dans les prisons de Tolède, fût, deux jours après, à fumer tranquillement sa pipe sur la grande place d’Alcala de Hénarès. Pour mieux s’en assurer, et tout en riant de sa vaine frayeur, il s’avança de nouveau à son balcon et regarda. Le groupe avait disparu. Il fit appeler son hôte et lui demanda s’il connaissait dans la ville le barbier Gongarello.
— Tout le monde le connaît… tous ceux du moins qui ont de la barbe au menton. Votre Seigneurie veut-elle qu’on le fasse avertir ? ce n’est pas loin…
— J’irai chez lui. Voulez-vous m’indiquer sa boutique ?
— Je vais vous donner un de mes garçons pour vous conduire.
— Très-bien.
Piquillo paya son hôte, acheva de s’habiller et vit entrer un petit marmiton qui, sous son bonnet de coton, portait un air sournois qui lui déplut.
— Qui es-tu ?
— Troisième marmiton de l’hôtellerie Saint-Pâcome.
— Tu veux pour boire ?
— Je ne venais pas pour cela, mais c’est égal.
Il tendit la main, Piquillo y jeta quelques maravédis ; l’enfant remercia en disant :
— Le patron donne si peu ! jamais de bénéfices ; ce qui fait qu’on en trouve où l’on peut. Je suis prêt à vous conduire, seigneur cavalier.
Piquillo suivit l’enfant, qui marchait devant lui en s’accompagnant d’un air de fandango avec deux castagnettes faites aux dépens de la vaisselle de l’hôtellerie. Ils traversèrent plusieurs rues tortueuses, et Piquillo s’arrêta en disant :
— On prétendait que ce n’était pas loin. Est-ce que nous n’arrivons pas ?
— Patience, dit le marmiton avec un sourire mauvais, ça ne peut pas tarder.
Ils s’arrêtèrent enfin devant une maison de sombre apparence.
— C’est ici, dit l’enfant, montez.
— Je ne vois ni l’enseigne du barbier, ni ses palettes, ni sa boutique, qui est toujours peinte en bleu.
— La couleur n’y fait rien… ça ne vous empêchera pas d’être rasé. Montez toujours.
— Gongarello n’est donc plus en boutique… il est en chambre ?
— Vous l’avez dit… Montez donc.
Au haut d’un petit escalier, l’enfant s’arrêta comme par respect et laissa passer Piquillo devant lui. Celui-ci entra dans une chambre nue et sans meuble ; mais à peine y eut-il mis le pied qu’il entendit la porte et la serrure se fermer sur lui.
— Il est pris, s’écria le marmiton au dehors, et il ne se doute pas que je l’ai conduit dans un corps-de-garde d’alguazils ! Donnez-moi, monsieur le militaire, le réal que vous m’avez promis.
— En voici deux, reprit joyeusement une voix que Piquillo reconnut pour celle du capitaine Juan-Baptista, et la même voix cria du haut de l’escalier :
— Seigneur Garambo della Spada, vous commandez le poste, prenez quatre de vos plus braves, montez saisir le prisonnier, et n’oubliez pas de partager avec moi les cent ducats que monseigneur l’archevêque a promis à qui s’emparerait du Maure Piquillo.
— Me voici, cria du rez-de-chaussée le seigneur Garambo della Spada ; au lieu de quatre hommes, j’en prends huit.
— Très-bien, dit Juan-Baptista, je me joindrais à vous, si ce n’était la blessure que j’ai reçue à l’armée des Pays-Bas, et qui n’est pas encore cicatrisée ; mais hâtez-vous, je garde la porte.
— Nous montons.
En entendant ces paroles et les pas des alguazils qui retentissaient sur les marches de l’escalier de buis, Piquillo regarda autour de lui avec effroi. Une chambre nue et sans meubles, les quatre murailles crayonnées au charbon par les pensées en vers ou en prose et surtout par les noms de tous les prisonniers qui y avaient précédé Piquillo. C’était une salle d’attente où l’on déposait provisoirement ceux que ramassaient les patrouilles de jour et de nuit, jusqu’au moment où on les transportait dans les prisons de la ville ou de l’inquisition. Une seule porte, celle par laquelle on allait entrer. Une seule fenêtre, donnant sur une rue populeuse et marchande, dont presque tous les bourgeois étaient assis dans leur boutique ou debout sur le pas de leur porte. Aucun espoir de salut, de tous côtés il serait immanquablement arrêté, et cependant, par un instinct de conservation qui nous porte à nous défendre jusqu’au dernier moment, en entendant la clé tourner dans la serrure, Piquillo s’élança par la fenêtre, qui était à une quinzaine de pieds du sol, et tomba sans se faire de mal au beau milieu de la rue. Il avait déjà pris sa course, et Le seigneur Garambo della Spada criait de la fenêtre :
— Arrêtez ! arrêtez !
À ce cri, les marchands sortirent de leur boutique, et ceux qui étaient sur le pas de leur porte, montrant du doigt Piquillo qui s’enfuyait, répétaient de loin :
— Arrêtez ! arrêtez !
Mais Piquillo venait brusquement de tourner par une petite rue à droite, puis par une autre à gauche, et il avait déjà gagné une avance d’une cinquantaine : de pas lorsque les bourgeois et les alguazils se décidèrent à le poursuivre. Jeune, alerte et animé par la crainte, qui donne des ailes, il leur eût peut-être échappé ; par malheur il ne connaissait pas la ville, et après quelques minutes d’une course rapide, il s’était dirigé vers une vaste rue, la plus belle sans doute de la ville d’Alcala ; poursuivi alors seulement par les bourgeois, il se croyait sauvé, lorsque du bout de cette rue il vit arriver l’escouade des alguazils, qui, mieux au fait des localités, avaient pris une rue de traverse pour lui fermer la retraite. Alors, et comme le cerf aux abois que des chasseurs impitoyables et une meute furieuse viennent de forcer et d’acculer dans ses derniers retranchements, le pauvre Piquillo regarda avec désespoir autour de lui. Aucune rue transversale par laquelle il pût échapper. Seulement en face de lui, une vaste cour dont la grille en fer était entr’ouverte, au fond de cette cour un long et magnifique bâtiment qui ressemblait à un palais ; au fronton étaient écrits en lettres d’or sur une tablette de marbre noir ces mots :
Sans réfléchir, sans se demander s’il n’allait pas de lui-même se livrer à ses ennemis et tomber peut-être de Charybde en Scylla, Piquillo se précipita dans la cour du couvent, dont il referma sur lui la grille à moitié ouverte, et cria à plusieurs moines qui sortaient du réfectoire :
— Asile ! asile !.. Sauvez-moi !
— Ne craignez rien, dit l’un d’eux, qui, sous un air de bonhomie, cachait un œil fin et un sourire narquois ; ce couvent a droit d’asile, et le frère Escobar ne laissera point violer les priviléges de son ordre. Dans ce moment, les bourgeois et les alguazils arrivaient essoufflés et s’arrêtèrent de l’autre côté de la grille.
— Livrez-nous le prisonnier ! s’écria-t-on de toutes parts.
— Qu’a-t-il fait, mes frères ? dit Escobar aux bourgeois.
Ceux-ci se regardèrent et répondirent :
— Nous n’en savons rien, mais ce doit être un voleur ou un meurtrier !
— C’est mieux que cela, mes pères, dit le chef des alguazils, c’est un hérétique ! c’est un Maure !
— Qui invoque le droit d’asile, dit Escobar.
— Mais il est réclamé par monseigneur Ribeira, patriarche d’Antioche, archevêque de Valence, qui a promis cent ducats à celui qui le livrerait mort ou vif.
— Et qu’en veut faire monseigneur de Valence ? dit Escobar.
— Le convertir à la foi catholique.
— Et nous aussi, dit Escobar avec une orgueilleuse humilité, nous pouvons, grâce au ciel, nous vanter de quelques conversions, et celle-ci peut-être ne serait pas au-dessus de nos forces.
— Non pas, dit vivement l’alguazil, comme un homme qui craint qu’on ne lui dérobe son bien, celui-ci appartient à monseigneur ! c’est une conversion à lui… Il l’a commencée !
— Dans ce cas-là, mon frère, commencer n’est rien, le tout est de finir, et il parait que monseigneur n’en est pas venu à ses fins.
— Parce que cet hérétique et ce mécréant s’est enfui.
— Pour me soustraire à la torture et aux mauvais traitements qu’on me faisait subir ! s’écria Piquillo.
— Vous l’entendez, mes frères, dit Escohar d’une voix paterne ; je ne m’étonne plus du nombre des conversions qu’on enregistre tous les ans à Valence, si pour les obtenir on emploie des moyens pareils. Ce n’est point par la violence, s’écria-t-il à voix haute et regardant le peuple, que nous forçons les brebis d’entrer au bercail. L’enfant égaré est venu à nous de lui-même, et nous lui ouvrons nos bras et nos portes, mais nous ne prétendons pas le retenir malgré lui. Nous le laissons libre de retourner à Valence ou de rester parmi nous.
Piquillo, à qui aucun des deux partis ne convenait, hésitait, en proie à de mortelles angoisses, et il gardait le silence.
— Frère, dit Escobar au portier du couvent, ouvrez les grilles et que le captif choisisse.
— Je reste, mes pères ! je reste ! s’écria Piquillo.
Un murmure d’étonnement circula dans la foule.
— Vous le voyez, s’écria le moine triomphant… Nous ne le forçons point, nous ne forçons personne de venir à nous….. Emmenez-le, mes frères, dit-il aux autres moines, en leur montrant Piquillo.
— Un instant, reprit Garambo della Spada, vous allez me donner acte de la remise de mon prisonnier et comme quoi vous en répondez, car il ne peut sortir de votre couvent que pour être livré à monseigneur l’archevêque de Valence ou à la sainte inquisition.
— C’est trop juste, seigneur alguazil, répondit Escobar en regardant Piquillo, nous nous y engageons. Veuillez entrer au parloir, où je vais vous donner un reçu en bonne forme d’un hérétique appartenant à monseigneur de Valence, et que vous nous laissez en vertu de notre droit d’asile, déclarant de notre côté que nous en répondons, et nous nous portons forts de le représenter en temps et lieu à qui de droit.
— C’est cela même, dit l’alguazil, et nous allons dresser du tout un petit procès-verbal que nous signerons, vous et moi, mon père.
— Et le révérend frère Jérôme, supérieur de couvent, dit Escobar.
L’alguazil entra au parloir, les bourgeois retournèrent à leurs boutiques, le marmiton à ses fourneaux, et Piquillo fut conduit par les bons pères dans une cellule propre, riante, bien éclairée et approvisionnée de tout ce qui peut rendre la vie commode et agréable.
— C’est bien, se dit-il en regardant autour de lui avec inquiétude, mais avec tout cela me voilà encore prisonnier, et même, si je l’ai bien entendu, je ne pourrai sortir d’ici que pour être livré à l’archevêque ou à l’inquisition. Je ne me soucie pourtant pas de rester éternellement dans ce couvent, encore moins de me laisser convertir et baptiser, car c’est leur espoir, je le vois. Mais moi, qui ai résisté à Ribeira et à ses bourreaux, je saurai bien déjouer les projets des révérends pères ; moi, qui me suis échappé des tourelles d’Aïgador, je saurai bien franchir les grilles et les murailles de ce couvent.
Et il oublia sa position, ses peines, ses dangers, pour penser à ceux de Yézid, pour rèver à sa sœur Aïxa et aux moyens de lui faire connaitre ce que lui, Piquillo, était devenu.
Escobar, cependant, avait rendu compte de tout ce qui venait d’arriver à son supérieur, le père Jérôme. Celui-ci était enchanté d’engager cette lutte avec l’archevêque de Valence, et s’ils triomphaient où Ribeira avait échoué, quel échec pour la réputation du saint prélat ! quelle gloire pour les bons pères ! mais il fallait réussir !
— Nous réussirons, dit Escobar en souriant.
— Cela ne parait pas facile ; il a résisté aux menaces, aux tortures ; c’est un hérétique obstiné et inattaquable.
— Bah ! il a bien quelque côté faible.
— Lequel ?
— Je n’en sais rien encore… nous verrons ! je l’étudierai. Tous les hommes ont au fond du cœur une pensée dominante qui finit par devenir une passion, à commencer par vous et par moi.
— Et quelle est la mienne ? dit le père Jérôme.
— D’être cardinal !
— C’est vrai, dit le supérieur.
— Voyez-vous, mon révérend, continua Escobar, la raison et la foi peuvent être impuissantes, les passions ne le sont jamais… les mauvaises surtout, et c’est pour nous livrer les hommes que Dieu, dans sa prévoyance infinie, a inventé les péchés capitaux ; ce sont nos plus utiles auxiliaires !
— Par malheur, murmura le père Jérôme avec un soupir, il n’y en a que sept.
— C’est bien peu, dit Escobar, mais l’adresse peut suppléer au nombre.
Dès les premiers mots qu’Escobar avait échangés avec Piquillo, avec ce jeune homme qu’il croyait sans expérience, ce Maure qu’il supposait sans instruction, il avait été étonné du nombre et de la variété de ses connaissances.
— Ce n’est pas un homme ordinaire, se dit-il ; et désormais il le traita en conséquence.
Piquillo, placé sous sa surveillance, occupait une cellule qui communiquait avec la sienne. Comme il ne pouvait rester dans l’intérieur du couvent avec l’habit laïque, on exigea de lui qu’il prit l’habit de novice et qu’il fit couper ses cheveux.
Piquillo accepta la première proposition et refusa la seconde. On n’insista pas, on ne le contraignit point. Au contraire, toutes les attentions, tous les égards lui étaient prodigués, tous les livres du couvent étaient mis à sa disposition ; il passait des matinées entières dans la bibliothèque des bons pères, bibliothèque riche et curieuse. C’était pour le jeune homme la plus agréable et la plus douce des prisons, mais c’était une prison ! Ce mot seul le rendait insensible à toutes les prévenances d’Escobar et sourd à toutes ses insinuations. Quand le moine hasardait quelques attaques détournées, Piquillo souriait, le regardait d’un air railleur et gardait le silence.
— Il a de l’esprit, se dit Escobar, il se défiera de toutes nos ruses : il a du cœur, on ne le trompera que par la franchise.
— Vous n’avez qu’une pensée, lui dit-il un jour, c’est d’échapper à notre surveillance et de vous évader.
— C’est vrai, dit le jeune homme.
— Et moi, répondit Escobar, je vous l’avouerai, je n’ai qu’un but, c’est de vous convertir à la foi catholique. Je le désire ardemment, autant pour vous sauver que pour humilier l’archevêque de Valence.
— Je le sais, dit Piquillo ; je l’ai bien vu.
— Oui, nous voulons vous convaincre, non pas, comme lui, par la violence ou les tortures, mais par la seule force de la raison, et je ne consentirais à vous donner le baptême qu’autant que vous viendriez vous-même me supplier de vous l’accorder… Voilà où je veux vous amener… et vous y viendrez.
— Jamais, mon père !
— Vous y viendrez, je vous le jure !
— Qui peut vous le faire croire ?
— La rectitude de votre esprit et la justesse de votre intelligence, qui vous empêcheront d’imiter ce que vous blâmiez dans Ribeira.
— Comment cela ! dit Piquillo étonné.
— S’il était absurde en voulant vous imposer une religion que vous ignoriez, ne le seriez-vous pas autant que lui en repoussant une vérité que vous ne connaissez pas ?
— Que voulez-vous dire, mon père ?
— Que nous vous demandons non point de suivre nos préceptes, mais de les discuter ; non pas d’embrasser notre sainte loi, mais de l’écouter. Si vous me parliez ainsi, mon fils, si vous me vantiez votre croyance…
— Vous m’écouteriez, mon père ?
— J’examinerais, du moins, et j’accepterais si elle me paraissait la meilleure. Juger sans voir est d’un insensé, condamner après avoir vu est d’un sage. Je ne vous demande pas autre chose.
Piquillo, obligé de reconnaitre qu’Escobar n’était pas si déraisonnable, répondit :
— Eh bien ! soit, je verrai.
C’était un premier pas.
Les ouvrages d’Escobar attestent un profond savoir, une érudition immense et surtout de prodigieuses ressources dans l’esprit. Ces ressources, qu’il n’a presque jamais déployées que pour la défense de l’erreur ou du sophisme, il les employa alors pour faire luire aux yeux de Piquillo d’éternelles et sublimes vérités que, mieux que personne, il devait connaitre, car il avait passé sa vie à les combattre.
Quant à Piquillo, qui n’était ni chrétien ni musulman, il n’avait jamais lu l’Évangile ni le Coran, à peine en savait-il quelques versets de routine et par cœur. Jamais ses études ne s’étaient tournées de ce côté. Ce fut Escobar qui lui fit connaître les deux textes. Il les lisait, les analysait, les discutait avec lui. Le jeune Maure, qui à un sens droit joignait une vive et rare intelligence, luttait vainement contre l’habile théologien et surtout contre la cause qu’il défendait. Pour convaincre Piquillo, les pensées qui venaient du cœur étaient les meilleurs arguments. Malgré lui, il se sentait ému aux saintes croyances du christianisme, et quand il comparait les prescriptions puériles et minutieuses du Coran à la morale de l’Évangile, l’amour du prochain, le pardon des injures, comment nier des vérités qu’il sentait innées en lui ? Comment ne pas croire à des préceptes qu’il pratiquait déjà ?
— Oui, oui, se disait-il tout bas, leur croyance peut être la véritable, mais l’autre est celle d’Aïxa, l’autre est celle de mes pères, et plus que mon jugement, mon cœur m’ordonne d’y rester fidèle.
— Eh bien, répétait Escobar en le voyant hésiter, qu’avez-vous à répondre ?
— Que toutes ces vertus sont trop grandes pour être renfermées dans une cellule ou dans une prison ; que c’est en plein air et sous la voûte des cieux qu’elles doivent éclater, et si j’étais libre, maître de mon corps et de mon âme, peut-être finirais-je par les adopter, mais tant que je serai prisonnier, je ne puis que les repousser.
— Et tant que vous les repousserez vous serez prisonnier… à moins que cette prison où vous êtes si libre, ne vous semble intolérable, et que vous ne vouliez absolument voir ces portes s’ouvrir. Vous n’avez qu’à parler, je vous l’ai dit. Mais alors, nous l’avons signé, nous nous y sommes engagés, nous sommes obligés ; de vous livrer à l’archevêque de Valence et à l’inquisition !…
— Jamais ! jamais ! s’écriait Piquillo.
Et Escobar, qui le voyait ébranlé, saisissait ce moment avec adresse pour lui montrer le sort brillant qui l’attendait dans le monde avec ses talents, son esprit, son instruction…
Mais Piquillo était inaccessible à la vanité.
Son tentateur avait beau lui parler de la fortune qu’il pouvait faire, des honneurs et des dignités auxquels lui, chrétien, aurait droit d’aspirer, Piquillo n’était ni avide ni ambitieux. Escobar déployait alors à ses yeux les jouissances légitimes, permises, et cependant si douces, qui pouvaient embellir sa vie… un heureux intérieur… une compagne jeune et charmante ; Piquillo restait impassible, nul amour ne pouvait plus lui sourire… il avait perdu Aïxa !
— Quoi ! si jeune encore et pas une seule passion ! s’écriait Escobar, dont le système se trouvait en défaut ; pas une mauvaise pensée, disait-il au père Jérôme, dont on puisse tirer parti pour achever sa défaite !
— S’il en est ainsi, lui demandait le révérend, que ferez-vous ?
— Eh bien ! nous agirons en sens contraire, nous nous adresserons, pour nous en servir contre lui, à quelque vertu, à quelques généreux instincts ; cette fois, du moins, nous n’aurons que l’embarras du choix, et nous sommes sûrs de réussir.
— Vous espérez donc encore réussir ?
— Toujours, mon révérend. Il ne me faut pour cela que deux choses.
— Lesquelles ?
— Du temps et une occasion, et le Maure converti viendra se jeter dans nos bras.
— De lui-même ?
— De lui-même ! pour le triomphe de la foi, et pour la confusion de l’orgueilleux archevêque de Valence !
— Si vous faites cela, Escobar, vous serez le flambeau et la gloire de notre ordre.

— C’est ma pensée à moi, mon révérend, comme la vôtre d’être cardinal !
Convaincu, mais non persuadé, Piquillo reprit ses lectures. Comme il ne suivait aucun des offices, et qu’il n’était astreint à aucune des règles du couvent, il avait du temps à lui pour étudier et pour rêver. C’était son unique occupation durant les longues promenades qu’on lui permettait de faire dans le cloitre du couvent. Ce cloitre était ombragé d’arbres et environné de hautes murailles. Il y rêvait à la liberté et à Aïxa, sa pensée errante s’élançait au delà du possible, et pour être heureux, pour être réuni à elle, il se créait des miracles.
Un jour, tout à coup, il s’arrêta en pâlissant et en portant la main à son cœur. Si Escobar eût pu le deviner, il aurait été content, car une mauvaise pensée venait presque de s’y glisser. — Si cependant, se disait-il, si Albérique Delascar n’était point mon père, si j’étais fils du duc d’Uzède ! Aïxa ne serait pas ma sœur ; or, c’est au duc d’Uzède que d’abord ma mère m’avait adressé. Qui peut savoir, excepté Dieu ; quel sang coule dans mes veines ? Parce que le duc m’a repoussé et chassé de son hôtel, ce n’est pas une raison pour que je ne lui appartienne pas. Moi, qui me rappelle ses traits, je sais bien qu’à la première vue, j’ai été frappé de la ressemblance qui existait entre nous… et dans le doute, cette ressemblance est beaucoup… c’est une présomption… c’est une preuve ! Oui, oui, se disait-il avec chaleur et en cherchant à rassembler ses souvenirs, il me semble le voir encore.
Et levant en ce moment ses yeux qu’il tenait baissés vers la terre, il aperçut, appuyé contre un des piliers du cloitre, un seigneur richement vêtu qui, depuis quelques instants, le contemplait avec attention.
Il jeta un cri, et fit un pas vers lui en étendant les bras. Mais le cavalier le repoussa d’un geste de dédain, détourna la tête et s’éloigna.
C’était le duc d’Uzède qui se rendait chez le révérend père Jérôme ; dans quel but ? c’est ce dont nous parlerons plus tard.
Cependant Piquillo était resté immobile, le front couvert de rougeur, et de la main qu’il tenait cachée dans sa poitrine, il froissait son cœur en proie au remords :
— Ingrat, se disait-il en comparant le duc d’Uzède à Albérique, tu allais renier celui qui t’a reconnu et adopté ! Quand tu avais besoin de lui, quand il t’accablait de sa tendresse et de son or… tu le nommais ton père, tu étais heureux et fier de lui appartenir ! et lorsque ton intérêt… l’intérêt de ton amour et de ton bonheur exige que tu l’abandonnes, tu te persuades qu’il ne t’est plus rien, que vos liens sont rompus ! tu n’es plus son fils !… tu lui préfères un infâme qui te méprise et qui te repousse !.. Ah ! s’écria-t-il en se jetant à genoux, Albérique, mon père, Yézid, mon généreux frère, pardonnez-moi ! Aïxa est ma sœur ! elle doit l’être ; c’est comme telle qu’elle s’est jetée dans mes bras ! et vous tous, mes seuls amis, ma vraie famille, que je sois à vous par le sang ou par la reconnaissance, il ne m’est plus permis de vous abjurer.
Piquillo rentra lentement dans sa cellule, s’y enferma, et, regardant autour de lui, s’aperçut alors avec désespoir qu’il était seul. Il était si accablé, si malheureux, qu’il avait besoin d’épancher son cœur et de dire ses peines. Si Escobar eût été là, il lui eût tout avoué, tout raconté ; car chaque jour le moine gagnait peu à peu dans son estime et dans sa confiance. Piquillo était donc assis près de son prie-Dieu. Un livre était là sous sa main, c’était l’Évangile, ce livre qu’Escobar lui avait dit être le livre de l’éternelle vérité. Le jeune novice l’ouvrit, et sur un morceau de papier il lut ces mots, écrits d’une main tremblante, et presque illisibles : « Défiez-vous des bons pères et surtout d’Escobar ! »
Qui donc lui envoyait ce conseil salutaire et mystérieux ? On était donc, en son absence, entré dans sa cellule ? mais on ne pouvait y pénétrer que par celle d’Escobar… C’était donc quelqu’un de la maison, et dans tout le couvent il ne connaissait personne qui lui voulût du bien, excepté Escobar, dont on lui disait de se méfier. Il rêva toute la journée à cet incident, et ses soupçons s’arrêtèrent sur un frère coupe-choux, Ambrosio, espèce d’hébété qui nettoyait les réfectoires et les cellules, et qui parfois sortait pour la quête ou pour les provisions. Il n’était pas impossible que Pedralvi, averti par Aïxa ou par Juanita, n’eût suivi ses traces et découvert sa retraite. Piquillo connaissait le courage, le zèle, l’activité du jeune Maure. Celui-ci avait peut-être abordé et questionné le frère Ambrosio dans ses sorties du couvent, peut-être même l’avait-il déjà gagné, et c’était par là que lui était parvenu ce bon avis, dont il ne risquait rien de profiter. Il se tint sur la réserve avec Escobar et chercha à rencontrer le frère coupe-choux ; mais celui-ci ne se trouvait pas sur le chemin de la bibliothèque, il n’y mettait jamais les pieds.
Piquillo se disait cependant que celui qui avait pénétré dans sa cellule y pouvait pénétrer encore, et qu’il irait d’abord visiter le livre qui avait servi déjà de messager ; il mit alors au même endroit, à la même place, en guise de signet, un petit papier sur lequel il écrivit ces mots ;
« Qui que vous soyez, donnez-moi des nouvelles de Yézid et d’Aïxa. »
Il sortit, se rendit à la bibliothèque, y resta quelques instants, puis, comme à l’ordinaire, se promena dans le cloitre, excepté que ce jour-là il trouva l’horloge du couvent d’une lenteur désespérante. Enfin, au bout d’une heure, il se glissa, le cœur plein d’espoir et de crainte, dans la cellule d’Escobar, qu’il fallait traverser pour entrer dans la sienne ! Personne ! le révérend venait de s’habiller, il était à vêpres. Rien dans la cellule de Piquillo n’avait été dérangé, mais on avait touché au livre saint. Il l’ouvrit et trouva ces mots :
« Yézid est arrêté et condamné, Aïxa est dans les prisons de l’inquisition. Ne songez qu’à vous. Silence, et attendez ! »
Ce billet était écrit d’une main plus ferme que le premier. On voyait que celui qui l’avait tracé avait eu ou moins peur, ou plus de temps à lui, ce qui s’expliquait par l’absence d’Escobar.
— Attendre ! dit Piquillo avec rage. Attendre ! rester sous les verrous d’une prison, quand tout ce que j’aime est en danger ; ce n’est pas possible… Je m’évaderai à tout prix ; ce qui peut m’arriver de plus terrible c’est d’être pris et de partager leur sort, et c’est tout ce que je demande.
Il descendit dans la cour du couvent. Plusieurs frères se promenaient. Il ne les regarda pas ; il regardait les murs, et de l’œil calculait leur hauteur. Vingt-cinq à trente pieds pour le moins et aucun moyen d’arriver au chaperon. Il y avait bien d’un côté de la cour une fenêtre au troisième étage qui donnait sur un petit toit, et ce toit arrivait au bord du mur. Il y avait de quoi se briser les os, et puis, arrivé au haut de ce mur, il fallait redescendre les trente pieds du côté de la rue.
Piquillo pensa à l’hôtellerie du Soleil-d’Or, à Pampelune ; et se rappelant cette première aventure de son enfance, il se disait :
— Si Pedralvi pouvait, comme alors, arriver cette nuit à mon aide avec une échelle !…
Vaine espérance ! ses yeux se reportèrent vers la terre avec découragement, et il aperçut dans un coin frey Ambrosio qui balayait la cour.
— Est-ce le ciel qui me l’envoie ?
Il s’approcha de lui, et dit à voix basse :
— Voyez-vous, frey Ambrosio, l’endroit du mur sur lequel le toit s’appuie ?
— Oui, je le vois, seigneur novice.
— Dites à Pedralvi que c’est le seul endroit praticable.
— Praticable, à quoi ? demanda frey Ambrosio.
— Il vous comprendra, dit Piquillo ; ne connaissez-vous pas Pedralvi ?
Frey Ambrosio le regarda d’un air tellement hébété qu’il devait être vrai.
— Me serais-je donc trompé ? dit Piquillo avec inquiétude.
En ce moment un homme traversait la cour, sortait de chez le révérend père Jérôme, et se dirigeait vers la loge du frère portier. Une petite veste de velours vert, ornée d’une profusion de boutons d’argent, serrait sa taille, et de chacune de ses poches sortait le coin d’un mouchoir blanc ; ses culottes, de la même étoffe que sa veste, avaient deux rangées de boutons depuis la hanche jusqu’aux genoux. Ses cheveux grisonnants étaient enveloppés dans une résille ; il portait à la même main un plat à barbe, où étaient couchés une serviette, une savonnette et une paire de rasoirs, et quoique seul, il parlait en marchant.
— C’est Gongarello ! se dit Piquillo, muet de joie et de surprise, et sans songer à ce qu’il faisait, il courut à lui. Gongarello venait de franchir la grille, mais en se retournant, il aperçut de l’autre côté des barreaux le novice qui lui tendait les bras. Le barbier effrayé lui fit un geste qui voulait dire : Silence ! vous nous perdez !
Et il s’enfuit.
— C’était lui ! plus de doute ! s’écria Piquillo. Comment ne l’avais-je pas deviné !
Il apprit, en effet, du premier frère qu’il interrogea, que Gongarello, autrefois persécuté par les dominicains et par l’inquisition, avait eu pour cela même la pratique du couvent ; que, pour distinguer les révérends pères de la foi des Dominicains et des autres ordres religieux, le père Jérôme, par une innovation hardie, avait décidé qu’ils auraient le menton uni et rasé. Et chaque frère se conformait par lui-même à la règle établie, excepté le supérieur et le prieur, qui, vu leurs nombreuses occupations, avaient le privilège de se faire faire la barbe. Aussi, tous les deux jours, le seigneur Gongarello, dont les matinées étaient consacrées aux pratiques de la ville, se rendait avant ou après vêpres dans la cellule d’Escobar et du père Jérôme. Tout était expliqué pour Piquillo. Il n’avait pas encore vu Gongarello, parce que l’heure de sa visite était celle où lui, Piquillo, travaillait dans la bibliothèque ; mais le barbier l’avait aperçu, ou avait appris son aventure, laquelle devait s’être répandue dans la ville d’Alcala de Hénarès. Le barbier, avant d’accommoder Escobar ou après l’avoir rasé, s’était probablement trouvé seul un instant et en avait profité pour entrer dans la cellule de Piquillo et lui écrire à la hâte le peu de mots qu’il avait trouvés dans ce livre de prières. Il était désolé de n’avoir pu parler à Gongarello, qui, vu ses habitudes et son dévouement, n’aurait pas demandé mieux, mais peut-être était-ce un bonheur ; cet entretien en plein air et dans la cour du couvent eût fait naître des soupçons. D’un autre côté, et puisque le barbier ne venait que tous les deux jours, il devait encore attendre quarante-huit heures, lui qui n’avait pas de temps à perdre ; force lui fut de prendre patience.
Le surlendemain il se garda bien d’aller à la bibliothèque, et, en effet, il entendit le barbier entrer en fredonnant un alleluia dans la cellule d’Escobar ; mais celui-ci, soit par défiance de voir Piquillo rester chez lui, on soit seulement par décence et sentiment de pudeur, ferma la porte de communication pendant tout le temps que dura sa toilette, et congédia le barbier sans que ce dernier, malgré tous ses efforts, pût trouver un prétexte pour pénétrer dans la cellule du novice. Il voulait, avant de sortir, y serrer les affaires de barbe du révérend père ; mais Escobar l’arrêta, lui défendant de déranger le jeune frère, qui sans doute était resté pour travailler, puisqu’il en avait oublié sa visite ordinaire à la bibliothèque.
Piquillo, qui avait entendu cette conversation, en conclut que s’il restait encore le surlendemain dans sa cellule, il exciterait infailliblement les soupçons du prieur, et cependant il ne pouvait attendre plus longtemps. Il fallait qu’il vît Gongarello et qu’il s’entendit avec lui par mots, par regards ou par gestes. Il prit alors un grand parti.
— Mon frère, dit-il à Escobar, j’ai refusé, il y a une quinzaine de jours, de me laisser couper les cheveux… Je crois que j’ai eu tort et je change d’idée.
— À merveille, s’écria Escobar avec joie. Le bon grain commence donc enfin à germer… Vous avez là une bonne pensée pour nous !
— Vous pourriez vous tromper…
— Non ! je vois ce que cela veut dire.
— Cela veut dire que ces cheveux sont d’une longueur démesurée et me tiennent trop chaud en tombant sur mes épaules.
— Ah ! dit Escobar d’un air triomphant, vous ne voulez point céder encore, et vous cherchez des prétextes. Très-bien… très-bien ! Nous admettons les restrictions et les capitulations…… Peu nous importe ! pourvu que vous vous rendiez, et vous vous rendrez, mon cher fils.
— Je ne le crois pas, mon révérend.
— Vous viendrez à nous, et comme je le désire… de vous-même !
— Ce ne sera pas de sitôt, du moins, et en attendant, je vous prie, veuillez avertir pour demain le barbier du couvent.
— Votre volonté sera faite, mon fils.
Piquillo ne dormit pas de la nuit, et la matinée du lendemain lui parut bien longue. Enfin deux heures sonnèrent, et pour comble de bonheur, Escobar avait quitté sa cellule. Piquillo se trouvait seul dans la sienne, il pourrait donc entretenir le barbier à loisir et sans témoin. Des pas retentirent dans le corridor. Il entendit ouvrir la porte de la chambre d’Escobar ; dans son impatience, il courut ouvrir la sienne, et sa physionomie joyeuse s’allongea singulièrement, en voyant entrer Escobar, qui lui dit d’un air grave :
— Le révérend père Jérôme vous attend à deux heures et demie dans son oratoire, il désire vous parler.
— Sur quel sujet, mon père ?
— Nous avons encore une demi-heure d’ici là, et dans votre intérêt, je vais vous prévenir en confidence de ce dont il s’agit.
Piquillo tressaillit d’impatience et de rage. Le révérend prit tranquillement un fauteuil en bois, et il allait s’asseoir quand Gongarello entra. À la vue du prieur, il parut aussi contrarié que Piquillo.
— Ah ! dit Escobar en apercevant le barbier. Je l’avais oublié… Mais que je ne vous dérange pas, faites comme si je n’étais pas là.
Il s’assit et prit un livre, qu’il se mit à lire attentivement, s’interrompant seulement de temps en temps pour voir si l’ouvrage du barbier avançait.
Gongarello, qui s’était muni de tout ce qui était nécessaire, avait enveloppé le corps et les bras du novice dans un peignoir, et tout en s’occupant de cette opération, il tournait le dos au prieur et regardait avec désolation Piquillo, dont les yeux lui disaient :
— Quel malheur qu’il soit là !
— Est-ce qu’il ne s’en ira pas ? disaient les yeux du barbier.
— Non, répondaient ceux de Piquillo.
Le barbier, désolé, et toujours tournant le dos au prieur, montra lestement une petite lettre qu’il cachait dans sa main. Mais comment la prendre ? Piquillo, embarrassé dans son peignoir, n’était plus maitre de ses mouvements, et ses mains surtout n’étaient pas libres.
— Eh bien, dit Escobar en levant les yeux, nous hâtons-nous ? le révérend père Jérôme va nous attendre.
— Nous voici à l’œuvre, répondit le barbier.
Les boucles de cheveux commencèrent à tomber sous ses ciseaux ; elles roulaient sur les épaules de Piquillo et de là jusqu’à terre ; mais la lettre restait toujours entre les mains de Gongarello, qui, placé derrière le novice, avait juste en face de lui Escobar. Celui-ci lisait, il est vrai, mais à chaque instant il levait les yeux, et il eût pu surprendre le moindre geste, ce qui déconcertait horriblement le barbier, lequel était peureux, comme on sait, et quand il avait peur, il était maladroit. Il comprit son insuffisance, il sentit qu’il n’aurait jamais la présence d’esprit, le sang-froid et l’agilité nécessaires pour glisser cette lettre en présence même et sous les yeux du prieur ; et comme les généraux qui désespèrent d’enlever une position, il prit le parti de la tourner.
Il quitta brusquement Piquillo, qu’il tenait par les cheveux, et courut à une petite table placée dans un coin de la cellule, pour prendre son peigne qu’il y avait laissé. Sur cette table était une écritoire, des papiers épars et un large sablier qui marquait les heures. En feignant de bouleverser les papiers pour trouver l’arme qu’il cherchait, il leva d’une main le sablier, et de l’autre glissa dessous le billet qu’il tenait.
Piquillo, qui le suivait des yeux, ne perdit pas un seul de ses mouvements.
Escobar, enfoncé dans son fauteuil, lisait toujours.
Le barbier ravi revint à son ouvrage. Il avait retrouvé son peigne, qu’il tenait fièrement à la main et qu’il affectait de montrer.
Escobar leva les yeux, et les rebaissa tranquillement sur son livre.
Au bout de quelques minutes de silence, le barbier s’écria :
— C’est fini !
— Tant mieux, dit le prieur à Piquillo, venez vite, car le révérend père Jérôme nous attend.
— Vous croyez ? dit Piquillo avec anxiété.
— J’en suis sûr. La demi-heure est écoulée… voyez plutôt à ce sablier.
— Vous avez raison, s’écria Piquillo avec effroi, en voyant le prieur avancer la main vers l’horloge de sable qui cachait son secret ; et se levant vivement :
— Je suis prêt à vous suivre !
— Le prieur et le novice sortirent les premiers ; le barbier les suivit et descendit avec eux l’escalier. Tous les trois traversèrent la cour : Piquillo et son guide pour se rendre chez le supérieur, Gongarello pour retourner à sa boutique ; mais avant de franchir la grille, il jeta sur son jeune ami un dernier coup d’œil qui lui recommandait de nouveau la prudence et la discrétion.
Le père Jérôme, renfermé dans son oratoire, fit attendre assez longtemps Piquillo, dont rien n’égalait l’impatience ; enfin on donna ordre de le faire entrer.
Le père Jérôme était de médiocre stature, de la même taille à peu près que Piquillo, mais l’habitude du commandement le grandissait. Son front grave et sévère était ridé par la méditation. Il y avait dans ses yeux baissés une humilité orgueilleuse ; dès qu’il les levait, l’orgueil dominait.
Il regarda quelque temps avec satisfaction la robe que portait Piquillo et surtout ses cheveux nouvellement coupés.
— C’est bien, mon frère, dit-il lentement, très-bien ! Pourquoi faut-il qu’à ces éloges je sois forcé d’ajouter un reproche… ou plutôt un conseil ?
— Lequel, mon père ? dit vivement Piquillo, qui avait hâte d’en finir et de retourner chez lui.
— Vous avez hier tenté de détourner de son devoir un de nos frères qui, grâce au ciel, est incorruptible. Dieu, dans sa bonté, ne l’a doué d’imbécillité que pour le mettre à l’abri de toute captation.
— Frey Ambrosio, je vous le jure, m’a mal compris !
— Il n’a rien compris, mon fils. Il est venu seulement me raconter ce que vous lui avez dit. J’ai cru y voir de votre part un projet d’évasion… je désire me tromper. Mais si telle est votre pensée, j’ai à vous prévenir des dangers auxquels elle vous exposait.
— Je vous écoute, mon père, dit Piquillo, désolé de l’onction paternelle ou plutôt de la lenteur avec laquelle le révérend lui parlait. Celui-ci continua :
— Les membres du saint-office, les dominicains, nos frères et nos ennemis en Dieu, ne se contentent point de la promesse que nous leur avons faite en vous donnant asile ; ils ont tellement peur que nous ne vous laissions échapper, que ce couvent est constamment entouré par leurs affidés. Et tenez, dit-il en le menant à une fenêtre de son oratoire qui donnait sur la rue, ne voyez-vous pas cette escouade d’alguazils qui, même en plein jour, fait sa ronde autour de nos murs, à plus forte raison la nuit ?
Piquillo frémit, car le révérend disait vrai. Le révérend poursuivit :
— J’espère que le frère Escohar a rempli mes intentions ; il a dû vous dire, et je m’empresse de le répéter, que vous n’avez besoin de chercher à gagner ni frey Ambrosio, ni aucun de nos frères ; si la captivité où nous vous tenons vous paraît intolérable, si à la règle paisible et studieuse de notre couvent, si à nos soins paternels, vous préférez les tortures de l’inquisition, vous êtes libre, vous n’avez qu’un mot à dire, ces grilles vont s’ouvrir devant vous.
— Mon père, dit Piquillo, qui avait hâte de terminer l’entretien, je n’hésite point… je n’ai jamais hésité entre vous et mes persécuteurs, entre ceux qui voulaient me donner la mort et ceux qui m’ont donné asile. J’aurais trouvé peut-être plus généreux, plus digne de vous, que cette hospitalité ne fût pas achetée au prix de ma liberté et de ma croyance.
— Et telle n’est pas notre volonté, s’écria vivement le père Jérôme ; nous avons dû, dans les intérêts du ciel et dans les vôtres, chercher à vous attacher à nous ; l’archevêque de Valence avait employé deux mois à vous torturer, nous avons demandé le même espace de temps pour vous éclairer et vous instruire. Nous voici à la moitié de ce terme ; dès qu’il sera écoulé, si nous n’avons pas su par la persuasion vous amener à nous, aucune tentative, je vous le jure, ne sera faite pour ébranler votre foi et vous en faire changer ; si alors vous restez encore ici, ce sera comme notre hôte, notre ami, et autant que le soin de votre liberté vous rendra cet asile nécessaire.
En achevant ces mots, il tendit la main au jeune homme, qui la saisit avec reconnaissance, la porta à ses lèvres, et lui dit avec émotion :
— Pardon, mon père, de vous avoir méconnu. Je vous remercie de vos généreuses promesses, et j’y compte.
Il s’empressa de regagner sa cellule, où par bonheur Escobar n’était pas. Il s’enferma, souleva le sablier, y vit la lettre que Gongarello avait cachée, la prit d’une main tremblante, et respirant à peine, lut ce qui suit :
« mon fils ! »
Ému et attendri, il se hâta de regarder la signature ; c’était celle de Delascar d’Albérique.
« Mon fils, voici la première fois que je vous écris, et c’est pour vous associer à mes douleurs ! Tout m’accable à la fois. J’ai appris par Gongarello, qui vous remettra cette lettre, votre captivité au couvent d’Alcala. Pour avoir tué en duel un chrétien, pour avoir défendu sa sœur, Yézid, votre frère, est condamné ; et Aïxa, plongée dans les prisons de l’inquisition comme complice de la mort du duc de Santarem, suivra peut-être son frère au bûcher. Je ne vous parle pas de moi, le sort de mes enfants sera le mien ; mais pendant que je pleurais sur eux, est venu à moi un prêtre des chrétiens, celui qui commande dans notre province et qu’ils nomment l’archevêque de Valence, ce Ribeira que vous avez mortellement offensé. « Je suis membre du saint-office, m’a-t-il dit, je sauverai vos deux enfants, si en expiation vous me livrez le troisième, c’est à lui de vous racheter tous. Et voici à quelles conditions : Non seulement il recevra le baptême qu’il a repoussé, mais il se consacrera au Seigneur par des vœux éternels. »
Voilà ce qu’il a osé dire, mon fils, et je ne voulais pas d’abord vous l’apprendre, mais j’ai pensé que plus tard vous me maudiriez peut-être de vous l’avoir caché. On vous demande plus que vos jours ; on demande votre culte et votre foi ; on veut que vous soyez coupable et parjure. Fidèle aux lois de ses ancêtres, votre père n’a rien à vous dire !… il pleure et il attend ! Mais dans le désespoir de son cœur, il demande au Dieu de ses pères, comme au Dieu des chrétiens, si celui dont le crime est de sauver tous les siens n’est pas béni sur terre et pardonné dans le ciel !
« Delascar D’Albérique. »
Que devint Piquillo en lisant cette lettre ! Pâle et inanimé, il tomba sur une chaise et y resta longtemps sans pouvoir même réfléchir ; il ne voyait rien.. tout était nuage et confusion à ses yeux et dans son cœur… Il n’avait plus d’idées… il ne pensait plus ! il ne souffrait même pas encore… car il ne vivait pas. Enfin avec le sentiment de la vie il retrouva celui de la douleur, il relut cette lettre et commença à comprendre toute l’étendue de son malheur. Puis, peu à peu, toute sa raison lui revint, il sonda alors d’un coup d’œil effrayé la profondeur de l’abime qu’il n’osait pas même contempler d’abord.
Lui qui, au prix de sa vie voulait délivrer Aïxa et Yézid, avait leur salut dans ses mains. Il n’avait qu’un mot à dire… mais ce mot qui les sauvait le perdait à jamais ! Il voulait bien donner ses jours, mais donner son âme et sa conscience à ses persécuteurs… partager leurs principes, marcher dans leurs rangs, prononcer des vœux éternels, devenir le ministre du Dieu des chrétiens, de ce Dieu qui avait ordonné le massacre de ses frères, et qui dans ce moment le condamnait au malheur ! Mais Yézid, à qui il devait tant ! mais Aïxa qui était sa sœur !… Ah ! bien plus encore… Aïxa allait donc marcher au bûcher ?..
Succombant à ses douleurs, il cacha sa tête dans ses mains et se mit à sangloter. Puis, repassant dans sa pensée tous les maux qui l’avaient assailli depuis son enfance ; la honte et la misère auxquelles il avait été voué en naissant ; les brigands qui l’avaient adopté et élevé dans le crime ; la fatalité qui partout semblait le poursuivre :
— Je suis donc maudit ! s’écria-t-il, maudit et abandonné de Dieu !
À peine avait-il prononcé ce blasphème qu’il lui sembla entendre une voix qui murmurait ce mot : Ingrat !
Il tressaillit, et soit dans le trouble de ses sens, soit dans le délire que lui donnait la fièvre à laquelle il était en proie, il lui sembla voir sa cellule s’éclairer d’une lumière ardente et soudaine. Il entendait le craquement du bois, le bruissement de la flamme ; il sentait sa poitrine oppressée par la fumée ; il voyait le feu s’élever en tourbillonnant et envelopper un chêne immense, et sur ce chêne, sur ce bûcher un enfant éploré levant les bras et les yeux vers le ciel, et il entendait distinctement ces paroles qui retentissaient à son oreille : « Mon Dieu ! mon Dieu ! si vous me permettiez d’échapper à ce danger qui m’environne, si vous veniez m’arracher à ces flammes qui déjà m’atteignent, je croirais en vous, ô mon Dieu, et je vous servirais ! Et ces jours que vous m’auriez conservés, je les emploierais non pour moi, mais pour mes amis et mes frères. Je ferais pour eux ce que vous auriez fait pour moi. Je ne vivrais que pour les sauver, je le jure ! »
— Oui, oui, s’écria Piquillo, ces paroles, je les ai dites ; ce serment, je l’ai fait… et Dieu, qui alors m’a entendu, me trace aujourd’hui mon devoir. Ma vie n’est rien, elle ne m’appartient pas, elle appartient aux miens ! Yézid et Aïxa, vous vivrez !
À une secousse aussi forte, à une agitation aussi violente succédèrent le calme et l’accablement, et Piquillo considéra avec plus de sang-froid et sa situation actuelle et le sacrifice qu’il acceptait. Aïxa ne pouvait plus être à lui ; les liens du sang s’y opposaient. Que lui importaient alors les nouveaux obstacles que Dieu et les hommes élevaient entre eux ! Par lui Aïxa vivrait ; par lui Yézid serait la gloire et la consolation de son père ; il s’acquittait envers le vieillard qui lui avait ouvert les bras et l’avait adopté. Il donnait plus qu’il n’avait reçu, et puis cette religion qu’on lui imposait, il l’avait appréciée ; son cœur et sa raison lui disaient qu’elle était sublime, charitable et consolante, qu’elle secourait le pauvre et protégeait l’opprimé. Si on persécutait, si on torturait en son nom, le crime était non pas à elle, mais à ses ministres, et il y avait pour lui encore un noble rôle à remplir, celui de lutter contre ses bourreaux et de leur arracher leurs victimes. Dieu même l’envoyait peut-être dans les rangs ennemis pour y porter des paroles de paix et de clémence et pour servir ses frères plus utilement encore que s’il fût resté parmi eux.
Soutenu par ces pensées et surtout par l’idée d’avoir fait son devoir, Piquillo s’endormit, et dans ses rêves, il crut entendre la voix du vieillard qui le bénissait et lui disait : Merci, mon fils ! Il crut voir Aïxa et Yézid se pencher vers lui et lui dire : Tu as racheté nos jours au prix de ton bonheur… et ce bonheur, notre affection te le rendra.
Le lendemain pâle, et défait, mais le cœur plein de courage et décidé à son sacrifice, il se rendit chez le père Jérôme, où Escobar se trouvait, et d’une voix ferme, il leur dit :
— Je veux être chrétien.
Les deux prêtres tressaillirent de joie.
— Ah ! je vous le disais bien, s’écria le prieur, la grâce vous a touché plus encore que mes soins, et vous voilà comme je le désirais, venant de vous-même vers nous pour nous demander le baptême !
— Je veux plus, je veux me consacrer au service des autels.
Escobar poussa un cri de joie, et lui sauta au cou en lui disant :
— Mon fils ! mon fils ! vous faites bien, et Dieu, qui vous inspire, vous en récompensera. La route qui s’ouvre devant vous est la seule par laquelle on arrive, et tous ceux chez qui brille l’intelligence ou l’esprit se hâtent de la prendre. On verra peut-être luire un siècle privilégié qui est bien loin encore, où l’instruction et le mérite permettront d’aspirer à tous les emplois et de parvenir à toutes les sommités ; mais, de nos jours, le moine peut seul jouir de cet avantage, le moine est le seul qui n’ait pas besoin de naissance et puisse se passer d’aïeux. Le moine, fils du laboureur ou du muletier, voit tous les grands de la terre se prosterner à ses pieds. Le moine qui se distingue dans son couvent, devient prieur, devient abbé, devient général de son ordre. Dès lors, il est admis au conseil de Castille, il peut aspirer à tout. Ce sont les rois qui s’inclinent devant lui et qui le consultent. Cette carrière, cette destinée sera la vôtre ! je vous le prédis, et vous verrez qu’Escobar ne se trompe point !
Piquillo, qui l’avait à peine écouté, continua froidement :
— Je veux prononcer des vœux… à une condition, c’est qu’aujourd’hui même et devant moi, vous allez annoncer cette résolution à monseigneur Ribeira, archevêque de Valence.
— À l’instant, s’écria le père Jérôme, qui voyait se réaliser ainsi ses rêves les plus ardents, l’élévation de l’ordre, l’humiliation de l’archevêque, et une autre promesse encore qu’il avait à cœur de remplir.
En ce moment on annonça le duc d’Uzède ; il lança sur le pauvre novice un regard de courroux et d’indignation : « Encore lui ! » murmura-t-il. Piquillo répondit à cette nouvelle insulte par un regard d’indifférence et d’oubli, et rentré dans sa cellule, il y resta plusieurs jours sans voir personne, seul avec lui-même ou plutôt avec Dieu, lui demandant maintenant la force d’accomplir son sacrifice.
Le duc d’Uzède, en le voyant sortir, se tourna vers les deux prêtres avec un air d’impatience et de dédain.
— Eh bien, mes pères, où en sommes-nous ? en finissons-nous ?
— Tout est fini, monseigneur, lui dit le supérieur en se frottant les mains d’un air de triomphe. Nous vous l’avions promis.
— Vous raillez, mon père… ce n’est pas possible !
— C’est réel, monsieur le duc, vous voilà délivré d’une paternité douteuse ! Ce prétendu fils ne viendra plus par sa présence rappeler à Votre Seigneurie un passé pénible, et ne pourrait plus, même quand il le voudrait, faire le scandale que vous redoutiez. Il ne sortira plus de ce couvent où il va s’engager. Il prononce ses vœux.
— Allons donc ! dit le duc d’un air d’incrédulité ; lui qui avait résisté à toutes les séductions de l’archevêque de Valence !
— Il cède à notre éloquence persuasive, et je m’empresse d’en prévenir le saint prélat, dit le père Jérôme en lui montrant la lettre qu’il venait de commencer pour Ribeira.
— Et qui a pu produire une pareille conversion… je veux dire un pareil prodige ?
Le père Jérôme se retourna et désigna du doigt Escobar.
— Vous, mon père ? s’écria le duc avec étonnement et respect.
Escobar s’inclina avec humilité, et aux questions multipliées du duc il fallut bien répondre en déroulant le plan tracé, exécuté et suivi par le révérend père Escobar pour la plus grande gloire du ciel et surtout celle de l’ordre. Humilier Ribeira, l’emporter sur lui, amener ce Maure, cet hérétique, à se faire chrétien, c’était bien ; mais l’amener à se faire moine ! cela tenait du miracle. Voilà pourquoi l’habile prieur l’avait tenté. Outre le mérite de la difficulté vaincue, c’était gagner à leur ordre un sujet distingué, un homme d’instruction et de talent qui pourrait leur faire honneur (et dès ce temps-là déjà, ils cherchaient à attirer à eux tous les genres de mérite) ; et puis cela rendait service, par occasion, au duc d’Uzède, leur allié, qui, par fatuité, ne doutait point de sa paternité, mais qui, pour mille raisons de rang et de convenances, aimait mieux placer un bâtard à lui dans un couvent que dans le monde.
Un instant Escobar avait cru échouer dans ses projets. Piquillo ne lui offrait aucune prise et il ne savait plus par quel côté l’attaquer. Le hasard, père des succès, lui était venu en aide. Un jour que le barbier Gongarello traversait la cour du couvent pour aller raser les bons pères, il aperçut un jeune novice, la tête baissée, les bras croisés, qui passait sans voir personne, et se dirigeait vers la bibliothèque. Dans sa surprise, Gongarello manqua de laisser tomber à terre son plat à barbe en faïence, car dans ce novice si mélancolique et si rêveur, il avait cru reconnaître Piquillo. Il s’était empressé de faire part de cette découverte à sa nièce Juanita, celle-ci à Pedralvi, et Pedralvi à son bon maître Delascar d’Albérique.
En attendant leur réponse, Gongarello cherchait, sans en venir à bout, le moyen de prévenir Piquillo, qu’il n’apercevait jamais, et dont la cellule touchait cependant celle du prieur.
Un matin que le barbier était occupé à raser Escobar, celui-ci s’absenta un instant et revint, mais en rentrant, il crut voir que le rasoir et la main du barbier tremblaient. Il remarqua que la porte qui conduisait chez Piquillo était entr’ouverte. Or, un moment avant, elle était fermée. Le barbier était donc entré chez le novice.
En effet, Gongarello se voyant seul, n’avait pu résister au désir de jeter un coup d’œil dans la chambre de son jeune ami, il espérait l’y trouver et n’avait trouvé personne. Mais il avait voulu du moins, et sans se compromettre, tenir Piquillo en défiance contre les pièges du révérend père Escobar. Celui-ci, après avoir renvoyé le barbier, était entré dans la cellule du novice, avait tout examiné et n’avait pas eu de peine à trouver dans le livre de prières ces mots tracés en tremblant par Gongarello :
« Défiez-vous des bons pères et surtout d’Escobar. »
Le premier mouvement du prieur avait été de déchirer cet écrit. Puis il avait pensé avec raison qu’en le laissant où il était, ce premier message, qui ne lui apprenait rien, en amènerait peut-être d’autres qui lui apprendraient beaucoup.
Il avait raisonné juste. Piquillo, plein de confiance, avait répondu par ces mots remis au même messager :
« Qui que vous soyez, donnez-moi des nouvelles d’Yézid et d’Aïxa. »
Escobar s’était emparé du message. Quel était donc ce Yézid, cette Aïxa auxquels Piquillo portait tant d’intérêt, et auxquels il pensait plus qu’à lui-même, plus qu’à sa liberté ? Il avait questionné à ce sujet le duc d’Uzède. Celui-ci, instruit par le ministre, son père, lui avait raconté que Yézid, fils du Maure Albérique, était poursuivi en ce moment par l’inquisition pour avoir tué en duel le duc de Santarem, mais qu’il s’était soustrait à toutes les recherches et qu’on n’avait pu le découvrir. Quant à Aïxa, le duc savait par la comtesse d’Altamira tout le dévouement que Piquillo lui portait ; on ignorait, il est vrai, à quel titre. Mais n’importe ! on ne risquait rien d’effrayer le prisonnier et de le faire trembler pour les objets de son affection. C’est ce qu’avait fait Escobar, attendant les événements et de plus amples renseignements, que Gongarello n’avait pas manqué de lui fournir.
Le jour où le digne barbier était venu couper les cheveux du novice, on se rappelle qu’Escobar était présent à cette cérémonie. Ses yeux, en apparence fixés sur un livre de prières, suivaient tous les mouvements du barbier ; il lui avait vu montrer vivement une lettre, puis plus tard la placer sous un sablier. On se souvient qu’à l’instant même il avait emmené Piquillo chez le père Jérôme, où il l’avait laissé ; il était revenu précipitamment à la cellule, avait soulevé le sablier, et telle était la lettre qu’il y avait trouvée :
« mon fils ! »
« Voici la première fois que je vous écris, et c’est, grâce au ciel, pour vous envoyer de bonnes nouvelles, pour vous apporter espoir et consolation. Nous avons appris par Gongarello, qui vous remettra cette lettre, et votre captivité au couvent d’Alcala, et les pièges qui vous environnent. Résistez et ne craignez rien. Votre frère Yézid est toujours poursuivi, il est vrai, mais il est en lieu sûr, on ne peut le découvrir, et j’ose espérer pour lui de puissantes protections qui obtiendront sa grâce. Aïxa, votre sœur, veuve et libre, est retournée à Madrid. Ce n’est plus la fille du Maure ni l’enfant adoptif de don Juan d’Aguilar, c’est la duchesse de Santarem qui emploie ses amis et son crédit à votre délivrance. Vous avez, m’écrit-elle, de redoutables adversaires, l’archevêque de Valence, Ribeira que vous avez mortellement offensé ; mais elle ne désespère point du succès, le zèle ne lui manquera pas, ni l’or non plus, je vous l’atteste. Prenez donc courage, votre nouvelle famille ne vous abandonnera jamais. Résistez aux embûches que l’on veut vous tendre, restez fidèle à notre croyance, au Dieu de nos ancêtres, et pensez à votre père, qui vous aime et vous bénit.
« Delascar D’Albérique. »
Cette lettre, qui eût désespéré tout autre qu’Escobar et lui eût démontré l’inutilité de ses efforts, lui avait fait entrevoir au contraire la possibilité du succès. Elle lui apprenait d’abord des liens de parenté qui lui semblaient en contradiction avec ceux que redoutait le duc d’Uzède, mais il n’était point chargé de débrouiller un mystère dans lequel la Giralda elle-même n’avait osé se prononcer ; il lui suffisait que cette parenté, fausse ou véritable, eût créé dans le cœur de Piquillo une affection tendre et profonde, un dévouement de frère et de fils ; c’est là-dessus qu’il fallait calculer. Cet écrit lui apprenait ensuite que, récemment admis dans la famille du Maure, Piquillo n’avait encore reçu de lui aucun message, aucune lettre… c’était la première ! Il ne connaissait donc point l’écriture de d’Albérique. C’était un grand point. S’appuyant alors de toutes ces circonstances et surtout de la haine que Ribeira portait au jeune novice et qui déjà lui était connue, Escobar s’était hâté de composer et de transcrire une autre lettre, celle que Piquillo avait lue. Pour quiconque connaissait, comme Escobar, le cœur du jeune homme, son âme ardente et généreuse, son abnégation de lui-même et son dévouement au devoir, cette lettre était un chef-d’œuvre, c’était la plus adroite, la plus infernale et la plus rare des combinaisons ! combinaison douteuse ailleurs et qui, ici, était immanquable ; on avait spéculé sur l’honneur et la vertu ! Piquillo devait en être dupe.

Tout s’apprêta pour la cérémonie ; mais pour des raisons que l’on devine aisément, au lieu de donner un grand éclat à leur triomphe, au lieu de compléter par la publicité la défaite de l’archevêque de Valence, les bons pères, par une affectation de modestie et d’humilité chrétienne, dont ils comptaient bien se dédommager plus tard, voulurent que tout se passât sans bruit et sans faste, entre eux, dans l’intérieur du couvent, et sans appeler à cette solennité les fidèles du dehors.
Pour Piquillo, nous l’avons dit, il avait demandé à ne voir personne.
Il pleurait et il priait !
Le frère Escobar vint frapper doucement à la porte de sa cellule. Piquillo n’ouvrit pas.
— Mon frère, dit le prieur, le révérend père Jérôme m’envoie vous demander si vous consentez à ce que la cérémonie ait lieu d’aujourd’hui en quinze ?
— Le plus tôt possible, mon frère, répondit Piquillo d’une voix tremblante.
— La volonté de Dieu soit faite et la vôtre aussi, mon frère ! dit Escobar ; ce sera donc pour dans huit jours, le jour de la Saint-Louis.
Piquillo ne répondit point.
— Qui ne dit mot consent, pensa Escobar, et il descendit annoncer au révérend père Jérôme que le novice avait lui-même choisi le jour de la Saint-Louis pour recevoir le baptême et prononcer des vœux éternels !
XLII.
intrigues de cour.
Le duc de Lerma, en apprenant du corrégidor de Tolède la mort du duc de Santarem, avait été furieux et désolé. Cette mort renversait tous ses projets. En faisant épouser Aïxa au duc, il avait un mari à sa dévotion, à ses ordres, qui, dès le lendemain du mariage, eût présenté sa femme à la cour ; mari d’autant plus commode que, docile, on le comblait de faveurs, et que, rebelle ou récalcitrant, on l’éloignait à l’instant même sans pouvoir être taxé d’arbitraire et sans tyrannie ; car, après la part active et prouvée qu’il avait prise à la conspiration de Lisbonne, l’exil était encore de la clémence.

Mais lui mort, Aïxa devenait bien plus libre encore qu’auparavant. Jeune fille, elle dépendait de la comtesse d’Altamira ; veuve, elle ne dépendait plus que d’elle-même.
Le duc, fidèle à ses promesses, lui avait fait remettre, le matin de son mariage, par frey Gaspard de Cordova, la lettre d’elle qu’il avait interceptée et qui pouvait compromettre tous les siens. Il n’avait donc plus aucun moyen de l’amener à la cour, comme il l’avait juré au roi son maître ; et le roi plus impatient et plus amoureux que jamais, lui répétait à chaque instant : Quel jour madame la duchesse de Santarem me sera-t-elle présentée ? Je ne veux que sa vue, sa présence… mais je la veux… vous me l’avez promise…
Il fallut bien alors annoncer au monarque que ce bonheur devait être encore différé, Aïxa ne pouvant être présentée à la cour par son mari, et apprendre à Sa Majesté le léger obstacle qui s’y opposait… la mort du duc de Santarem !
À cette nouvelle, à l’idée qu’il fallait attendre encore, le roi éprouva un tel dépit et se montra d’une telle humeur contre son ministre, que celui-ci comprit aisément que désormais sa faveur allait dépendre de l’exécution de sa promesse, et que toutes les questions se résumaient en une seule : Amener à tout prix Aïxa à la cour ; la décider, n’importe à quel titre, à y paraître ; sinon c’en était fait pour le duc de Lerma de son influence et de son pouvoir.
Il promit donc tout ce que désirait le monarque, et celui-ci retrouva sur-le-champ sa belle humeur et son sourire ; le beau temps était revenu. Mais pour qu’il fût durable, il s’agissait de contenter le roi, qui était pressé, et d’employer des mesures promptes et énergiques.
Le ministre commença par destituer le corrégidor mayor Josué Calzado ; c’était bien. Mais en le renvoyant, cela ne faisait pas venir Aïxa à la cour. Il ordonna les poursuites les plus sévères contre celui qu’on soupçonnait être le meurtrier du duc de Santarem. Mais aucun alguazil n’avait pu encore découvrir ni ses traces ni le lieu de sa retraite ; et cependant il n’y avait pas de temps à perdre pour satisfaire l’impatience du roi.
Dans le champ de l’intrigue, il faut tout cultiver ; car tout peut rapporter et produire. Le duc de Lerma se rappela la part que don Fernand d’Albayda avait prise à cette affaire. Quoiqu’il ignorât complètement dans quel but et dans quel sens, il savait que Fernand d’Albayda était le fiancé et serait bientôt l’époux de Carmen d’Aguilar ; que Carmen d’Aguilar était l’intime amie, la sœur d’Aïxa. On pouvait effrayer la jeune fille sur son fiancé, qui avait quitté son poste sans permission, qui s’était mêlé à une ténébreuse affaire et qui avait ainsi encouru la colère du monarque, c’est-à-dire du ministre. On pouvait ensuite montrer en perspective à Carmen le pardon de cette faute ; bien plus, la faveur du roi, de nouvelles grâces, de nouvelles dignités venant accabler son mari, Fernand d’Albayda. Et pour tout cela, on ne lui demandait qu’une chose, déterminer son amie, sa sœur Aïxa, la duchesse de Santarem, à se laisser présenter à la cour avec elle, Carmen. C’était un moyen à tenter, et il y avisa.
Cependant les deux jeunes filles s’étaient hâtées de quitter le château de Santarem et de revenir à Madrid. Aïxa avait tout raconté à sa compagne, et n’ayant aucune nouvelle des fugitifs, elles tremblaient pour Yézid souffrant et blessé, et puis pour ce pauvre Piquillo, à qui elles devaient tant !
— Et Fernand, s’écriait Carmen avec inquiétude, ce pauvre Fernand qui n’était pas ton frère et qui pourtant s’exposait pour toi, qui venait se battre pour toi ! tu ne le plains pas… tu n’y penses pas ?
Carmen peut-être se trompait.
— Pourvu, se disait-elle, qu’il ne lui arrive pas malheur et qu’on n’aille pas l’accuser.
— Sois tranquille, dit Aïxa ; en arrivant à Madrid, nous parlerons pour eux… nous les défendrons.
— Et comment, répondait la jeune fille, que rien ne rassurait ; quelle protection avons-nous ?
— Eh ! mais… la comtesse d’Altamira, ta tante… et puis qui sait ?.. d’autres encore !
Aïxa pensait à la reine, son seul espoir. Elle avait chargé en secret Juanita de tout lui raconter et d’implorer sa bonté.
En effet, au premier moment où la jeune cameriera se trouva seule avec sa souveraine, elle dit à demi-voix :
— Votre Majesté me permettra-t-elle de lui parler de la fille du Maure Alberique… de la pauvre Aïxa ?
— De la duchesse de Santarem ?
— Elle est bien malheureuse…
— Que lui est-il donc arrivé ?
— Elle est dans la douleur ! Le duc de Lerma l’avait unie à ce duc de Santarem contre son gré, contre celui de sa famille, et son frère, le noble, le généreux Yézid, averti… je ne sais comment, de ce mariage…
— Ah ! il avait été averti, dit la reine en cherchant à cacher son trouble.
— Oui, madame, une main inconnue l’avait prévenu de ce mariage. Et pour défendre sa sœur, pour l’arracher à un joug odieux, il est accouru, mais trop tard… ce mariage était fait. Alors il a défié ce duc… un duel, la nuit, dans le parc… un événement affreux…
— Mort ! dit la reine, mort !
— Qui, madame… Ah ! mon Dieu ! s’écria la jeune fille en voyant la reine pâlir ; qu’a donc Votre Majesté ?
— Rien, dit la reine, dont les lèvres étaient blanches et les mains tremblantes. Je conçois la douleur d’Aïxa… Yézid n’est plus !
— Eh non, madame ! dit vivement Juanita ; ce n’est pas lui… c’est l’autre !
— Ah ! dit la reine, dont les joues venaient de reprendre leurs couleurs, c’est l’autre !… c’est bien.
— Comment, madame, c’est bien ! s’écria Juanita étonnée.
— Non, reprit vivement la reine ! je veux dire… c’est différent.
— Cela n’empêche pas que le duc de Santarem n’ait été tué en duel, et par qui ? par Yézid. Il est permis aux chrétiens de tuer des Maures, cela paraît tout simple ; mais quand c’est un de nos frères qui tue un chrétien, il y a des lois qui les condamnent, et voilà ce qui désole cette pauvre Aïxa.
— Est-ce que son frère est entre les mains de ses ennemis ?
— Non, madame… il leur est échappé ; il paraît même qu’il est caché dans un endroit où on ne saurait l’atteindre, et que personne ne connaît…
— Je comprends, dit la reine…
Elle pensa alors au souterrain que Yézid lui avait montré dans la maison de son père ; secret qu’elle seule possédait et qu’elle lui avait promis de ne jamais trahir. Plongée dans ces souvenirs, elle garda quelque temps un silence que Juanita n’osait troubler, mais la jeune fille se disait en elle-même :
— C’est étonnant ! notre reine, qui était tout à l’heure si pâle, est maintenant toute rouge et tout émue… qu’a-t-elle donc ? Si bien, madame, reprit-elle à voix haute…
La reine se réveilla à ces mots et parut sortir d’un songe.
— Si bien, continua Juanita, que ce pauvre jeune homme va être obligé de se cacher toujours et de passer sa vie en prison, sans voir ni sa sœur, ni ses amis, ni personne ! C’est terrible, c’est ce qui désole Aïxa, et elle m’envoie implorer Votre Majesté.
— Moi ? dit la reine.
— Et la supplier de demander la grâce de son frère…
— À qui donc ?
— Eh mais… au roi… ou au ministre.
— Jamais ! jamais ! dit la reine effrayée.
— Quoi ! ce n’est pas possible à Votre Majesté, qui est si bonne, si généreuse !.. qui m’a sauvée du bûcher, moi et mon oncle Gongarello, et qui chaque jour encore demande la grâce de tant de monde !
— Oui, tu as raison, mais pour lui c’est impossible !
— Et pourquoi, madame ?
— Je n’oserais pas, dit la reine avec une expression que Juanita ne put comprendre.
— Ce pauvre jeune homme va donc mourir ?
— Mourir ! reprit la reine avec terreur ; ne m’as-tu pas dit qu’il était en sûreté ?
— N’est-ce pas mourir, que de ne plus voir un rayon de soleil, que de passer sa vie dans quelque cachot ! Allez, allez, je sais ça ; autant être rayé du nombre des vivants ! et s’il n’y peut pas tenir, s’il veut absolument entrevoir la lumière du jour, et mieux encore, revoir ceux qu’il aime…
La reine tressaillit.
— S’il se hasarde à sortir et qu’il soit pris, il faudra donc qu’il meure, et je dirai donc à sa sœur que Votre Majesté a refusé de le sauver, qu’elle l’a abandonné à ses bourreaux !
— Non, non, dit la reine, cherchant vainement à cacher son trouble ; mais comment faire ? On annonça le duc de Lerma.
— Ah ! dit Juanita à voix basse, vous voyez bien que le ciel vous envoie la grâce de Yézid. Le ministre ne pourra la refuser à Votre Majesté.
Juanita ne comprenait pas que le difficile était de la demander.
Le duc entra. Il venait prendre les ordres et les invitations de la reine, pour le spectacle de la cour. On devait donner pour la dernière fois un ouvrage nouveau de Calderon, monté avec la plus grande magnificence, car le duc ne savait quel moyen employer pour amuser le roi, le distraire de sa passion et lui faire pendant quelques instants oublier Aïxa.
Jamais la reine, qui du reste était assez froide avec le ministre, n’avait été pour lui plus prévenante, plus affable et plus gracieuse ; mais, à la grande surprise de Juanita, qui était restée debout à l’écart dans un coin, elle n’abordait point la question principale et ne parlait point d’Yézid !
— Je sais, monsieur le duc, combien vous protégez la littérature et les arts. Je me plais à reconnaitre qu’ils vous doivent beaucoup… et que jamais ils n’ont brillé de plus d’éclat que sous votre administration.
— Votre Majesté est trop bonne, dit le ministre en s’inclinant.
— Je voulais vous demander, monsieur le duc…
— Enfin, se dit Juanita, nous arrivons à Yézid.
— Je voulais vous demander… continua la reine avec embarras… si ce n’est pas à vous… à vos encouragements que nous devons Calderon de la Barca.
— Oui, madame… j’ose me flatter de l’avoir attiré à la cour, où il a passé les plus belles années de sa jeunesse et composé ses plus beaux ouvrages. Nos grands seigneurs et nos grandes dames lui ont fourni non-seulement des spectateurs, mais encore les personnages et souvent même le sujet de ses pièces.
— Et quelle est celle qu’on donne demain… quel en est le titre ?
— Le Feu caché sous la cendre ou l’Amour secret, dit le ministre.
— Je vous remercie, monsieur le duc, dit la reine, qui paraissait plus embarrassée que jamais… je voulais vous demander aussi…
— Quoi donc, madame ?
— Enfin nous y voici, dit Juanita, qui aurait voulu pousser la reine et lui donner du courage.
— On prétend, continua la reine, que si ce pauvre Cerventes a joui de quelques loisirs, c’est à vous qu’il en est redevable ?
— Oui, madame, et c’est même au comte de Lémos, mon beau-frère, qu’il a dédié son Don Quichotte.
— En vérité, dit la reine, voilà ce que je ne savais pas !… Mais c’est très-beau, très-noble…
— Votre Majesté a-t-elle autre chose encore à me demander ?
— Moi, monsieur le duc… mais non, je ne crois pas !
— Et Yézid ? se disait Juanita étonnée.
Le duc, charmé des gracieusetés de la reine, ne savait à quelle cause attribuer cette faveur inusitée, et se promettait bien de l’entretenir de son mieux.
— En cas de disgrâce ou de froideur de la part du roi, se disait-il, c’est une alliée à ménager, et un point d’appui pour attendre et regagner une position perdue.
Il vit dans ce moment entrer la comtesse d’Altamira. Elle salua le ministre avec un air de plaisir et de contentement qui lui parut suspect. La comtesse n’était jamais plus joyeuse que lorsqu’elle apportait quelque fâcheuse nouvelle.
— Je dérange monsieur le duc, dit la comtesse, il faisait sans doute sa cour à la reine.
— Oui, madame la comtesse, heureux d’exprimer à Sa Majesté mon respectueux et éternel dévouement.
— Respectueux, c’est possible ! éternel, dit la comtesse en riant, c’est différent !
— Qu’est-ce à dire ? madame ! s’écria le ministre.
— Tout dépend des définitions. Qu’entendez-vous par éternel ?
— Celui qui dure et durera toujours, dit le duc en s’inclinant.
— Toujours… vous entendez par là… matin et soir.
— À coup sûr.
— Et si on avait le matin un dévouement et le soir un autre, comment cela s’arrangerait-il, je ne dis pas avec votre conscience, monsieur le duc, mais avec votre définition ?
— Je ne vous comprends pas, madame la comtesse.
— Je vous parle cependant, monseigneur, d’une anecdote récente, sujet très-piquant que j’aurais déjà donné à Calderon, s’il avait pu le traiter.
— Et qui l’en empêcherait ? dit la reine.
— C’est, répondit la comtesse, que le héros de l’ouvrage est justement celui qui lui fait une pension de mille ducats.
— Eh mais, dit la reine en se tournant vers le ministre, ne me disiez-vous pas tout à l’heure, monsieur le duc, que vous accordiez à Calderon de la Barca votre protection…
— Protection bien fatale en ce moment, s’écria la comtesse, et qui nous privera d’une comédie charmante en trois journées !… Votre Majesté peut en juger elle-mème, je lui en donnerai l’analyse en quelques lignes…
Et voyant le duc qui commençait à la regarder avec inquiétude, elle continua gaiement :
— Première journée !… le théâtre représente un palais. Dans ce palais est un roi qui s’ennuie, quoiqu’il ait une femme charmante, adorable ; il cherche des distractions et s’adresse à son premier ministre.
— Madame ! s’écria le duc avec colère.
Mais la comtesse, sans y faire attention, continua froidement :
— Il y a un ministre… c’est fâcheux, on ne peut pas s’en passer, il faut qu’il joue un rôle ; celui-ci, donc, propose à son auguste maître ; comme objet de distraction… une de ses sujettes… roturière qu’on anoblit et dont on fait une duchesse, en attendant mieux… tout cela pour avoir le droit de la présenter à la cour ; mais, et voilà où l’intrigue se noue, par caprice ou par spéculation de coquetterie, la nouvelle duchesse ne veut pas être présentée…
— Vous me permettrez de vous dire, madame la comtesse, s’écria le duc en s’efforçant de rire, que voilà une donnée bien invraisemblable.
— Ici… à la cour… c’est vrai, dit la reine.
— Et voilà justement ce qui en fait le charme et le piquant, reprit la comtesse ; et elle continua sur le même ton :
Deuxième journée : Que fait alors Son Excellence désolée ? La nouvelle duchesse qui ne voulait pas être favorite, avait une amie intime, une jeune fille charmante et de bonne maison, comme qui dirait, par exemple, Carmen d’Aguilar, ma nièce…
À ce nom, le ministre pâlit.
— Cette jeune fille avait, un fiancé qu’elle allait épouser… bien mieux encore, qu’elle aimait !… Et un matin, le ministre lui propose d’élever le futur époux en honneurs et en dignités, ou de le disgracier complétement ; selon que la pauvre jeune fille sera favorable ou contraire aux projets de Son Excellence…
— Ce n’est pas possible, dit la reine.
— Je pense comme Sa Majesté, dit le duc froidement ; la jeune fille aura sans doute mal compris, ou peut-être avait-elle auprès d’elle quelque grand parent, une tante, par exemple, qui l’aura aidée à mal interpréter…
— Vous croyez ! dit amèrement la comtesse.
— Ou qui, familiarisée avec ces sortes d’intrigues, aura cru en voir où il n’y en avait pas.
— Non, non, monsieur le duc, la proposition était bien formelle et bien précise ; il fallait que cette jeune fille engageât, exhortât son amie à se laisser présenter à la cour, en d’autres termes, à devenir la maîtresse du roi, à prendre la place de la reine !.. Et, attendez donc, monsieur le duc, continua la comtesse, ne vous récriez pas, ne vous indignez pas, nous ne sommes qu’au second acte.
Troisième journée !
— Tout cela est absurde ! s’écria le duc, tout cela est faux !
— C’est juste, dit la comtesse en souriant et en s’adressant à la reine… Je me trompais ! Ce n’est pas une autre journée, c’est la même ! Oui, vraiment, le ministre venait le même jour, presqu’au même instant, faire sa cour à la reine et protester d’un dévouement éternel… Je demanderai maintenant à Votre Majesté ce qu’elle pense de la définition de ce mot, si elle l’entend comme M. le duc.
La comtesse fit une grande révérence, et se retira, laissant le duc accablé sous le coup imprévu que venait de lui porter sa redoutable ennemie. Il voyait fondre sur lui l’orage du côté par où il l’attendait le moins. Il voyait tous ses projets renversés, et la promesse qu’il avait faite à son maître impossible désormais à réaliser. Sous quelque prétexte qu’il voulût maintenant présenter Aïxa à la cour, la reine s’y opposerait. La reine, prévenue par la comtesse, refuserait de recevoir sa rivale ; bien plus, le faible monarque, accablé de justes reproches, et ne sachant que répondre, se vengerait de la colère de sa femme et de la perte de sa maitresse, sur le ministre qui n’avait su ni garder son secret, ni faire réussir ses amours.
Tout cela était infaillible, immanquable. C’était une disgrâce certaine ; et le duc, tenant ses yeux baissés vers le tapis de la chambre, semblait y lire l’arrêt de sa chute. Enfin, décidé à soutenir de son mieux l’orage qu’il ne pouvait éviter, il composa son maintien, chercha à se donner un air d’assurance, et avec un sourire de cour, sourire intraduisible, qui dit tout et qui ne dit rien, il se hasarda à jeter un regard sur Sa Majesté.
Ce qu’il vit dérangea de nouveau toutes ses prévisions et déconcerta totalement sa perspicacité. Au lieu du courroux et de l’indignation qu’il s’attendait à trouver sur les traits d’une femme et d’une reine irritée, il lui sembla voir briller un air de satisfaction et de triomphe ; un sourire à moitié joyeux, à moitié railleur, errait sur les lèvres de Marguerite ; elle regardait le ministre en silence, mais de manière à l’encourager ; elle semblait presque attendre qu’il parlât le premier.
Il se hâta de profiter des avantages qu’on lui offrait.
— J’espère, dit-il en balbutiant, que Votre Majesté ne me jugera pas sans m’entendre… si je suis coupable en cette occasion… si du moins j’en ai l’apparence… c’est par l’interprétation que l’on donne à l’action la plus simple.
— En vérité, dit la reine avec enjouement, expliquez-moi cela, de grâce.
— Le cercle de la reine, poursuivit le duc, est très-respectable… Il est composé de femmes charmantes… qui sont reconnues telles depuis longtemps… depuis trop longtemps peut-être… et je voulais, imprudent que j’étais, et sans penser aux haines que j’allais amasser sur moi, je voulais… embellir cette guirlande toujours fraiche, de quelques fleurs… plus fraiches encore.
— Je comprends, dit la reine avec le même ton de dignité, rajeunir le personnel de ma maison… Vous avez raison… Cela ne fera pas de mal… Et ces dames, à commencer par la comtesse, vous accusent de faire, dans l’intérêt de mon mari, ce que vous faites dans le mien.
— J’espère, s’écria vivement le duc, que Votre Majesté n’ajoute pas foi à toutes ces calomnies.
— Je n’en crois pas un mot, dit gravement la reine… vous, monsieur le duc, à votre âge !.. un personnage sérieux et le frère du grand inquisiteur ! et puis vous avez tant d’autres occupations… tant de choses à faire !
Le ministre avait trop d’esprit pour ne pas voir que la reine n’était pas sa dupe, et en même temps trop de tact pour ne pas comprendre qu’elle ne demandait pas mieux que de lui pardonner ; dans quelle intention ? c’est ce qu’il ne pouvait s’expliquer ; mais dans ce moment, peu lui importait, et il poursuivit avec chaleur :
— Voilà pourquoi, madame, j’ai voulu que la fille de don Juan d’Aguilar fût dernièrement présentée ; voilà pourquoi j’insistais auprès de cette jeune fille pour que son amie la duchesse de Santarem le fût également.
— Elle est donc bien jolie ! demanda la reine avec un sourire malin.
— Mais oui… madame, dit le duc avec embarras… elle n’est pas mal.
— Cela ne suffit pas pour nos jeunes recrues, et d’après le système que vous me développiez tout à l’heure… il faut qu’elle soit tout à fait bien.
— Elle est bien, dit le duc froidement.
— Je voudrais mieux encore !… Je voudrais qu’elle fût très-jolie, très-remarquable.
— Eh mais, dit le duc, qui craignait quelque piège, beaucoup de gens la trouvent telle… mais moi…
— Oh ! vous, monsieur le duc, vous ne pouvez vous y connaître. Nous, c’est différent ; et je veux en juger.
— En vérité ! dit le ministre effrayé.
— On prétend qu’elle est veuve ? continua la reine sans faire attention à l’inquiétude du duc.
— Oui, madame.
— Je ne vois pas alors comment elle pourrait m’être présentée et faire partie de ma cour sans un titre quelconque et sans être attachée à ma personne, ce ne serait pas convenable. Vous lui direz, monsieur le duc, que je l’admets au nombre de mes dames d’honneur, si toutefois elle veut bien accepter ce titre.
À ce nouveau coup de théâtre plus inattendu, plus surprenant que tous les autres, le duc restait muet de surprise et de joie… joie mêlée de doute et d’incertitude ; car il osait croire à peine à ce qu’il venait d’entendre.
Après s’être cru abattu, le ministre se voyait tout à coup relevé, et replacé au pinacle par celle qui devait le perdre.
Tout ce qu’il avait promis au roi, tout ce qu’il cherchait à obtenir, sans en venir à bout, tout ce qu’il pouvait espérer, en un mot, par ses machinations et ses intrigues, l’entrée d’Aïxa à la cour, la reine venait elle-même le lui offrir d’une façon décente et honorable qui imposait silence à toutes les calomnies !.. mais quelle était l’idée de la reine ? car elle en avait une pour agir ainsi… et le ministre, ni Juanita, ni personne au monde ne pouvait la deviner.
C’était peut-être ce que voulait Marguerite.
Le ministre s’inclina et dit :
— Je préviendrai dès aujourd’hui madame de Santarem de l’honneur que Votre Majesté daigne lui faire.
— Si elle y consent, dit la reine… car il faut qu’elle y consente ne l’oubliez pas : je ne prétends forcer personne.
Le duc sortit, au comble de la joie, et la reine dit à Juanita, qui pendant ce temps était toujours restée à l’écart :
— Toi, petite, cours à l’instant chez Aïxa, et dis-lui de refuser !
— Comment, madame ! dit la jeune fille étonnée. M. le duc va lui proposer de vivre près de vous, de ne plus vous quitter, faveur qui comblerait tous ses vœux…
— Et surtout ceux du ministre.
— Et il faudra qu’elle refuse, qu’elle dise non !
— Obstinément… à moins que le duc ne lui accorde et ne lui signe la grâce de son frère Yézid.
— Je comprends, je comprends maintenant ! dit Juanita. Et vous croyez que le ministre l’accordera ?
— À l’instant même… sur-le-champ !…
— C’est bien, c’est bien, reprit Juanita en baisant les mains de Marguerite.
Elle sortit, et la reine, restée seule, regarda autour d’elle et se dit à voix basse :
— Il sera libre, il sera sauvé… et ce n’est pas moi qui l’aurai demandé !
Impossible de décrire la rage et l’étonnement de la comtesse lorsqu’elle apprit, quelques jours après, le dénoûment de la scène qu’elle avait si bien préparée ; mais malgré sa haine, elle ne pouvait se défendre d’un sentiment d’admiration pour l’ennemi qu’elle détestait. Comment avait-il pu sortir d’une pareille situation et en sortir victorieux ? Par quelle ruse, quelle infamie, quel trait de génie avait-il d’abord prouvé à la reine son innocence, et ensuite comment avait-il obtenu qu’elle devint la protectrice de sa rivale ? c’était à confondre, et pour la première fois la comtesse fut forcée de s’avouer que le duc de Lerma était un grand ministre ! aveu qui redoublait sa colère et son désir de le renverser ; aussi dès ce moment elle chercha plus haut et plus loin les moyens d’y parvenir.
Le duc cependant était triomphant ; et, comme bien des généraux vainqueurs par hasard, enivré d’un succès qu’il ne comprenait pas, il avait couru fièrement près du roi, et lui avait annoncé la réussite de leurs projets ; Aïxa venait à la cour, elle y serait présentée, et ne la quitterait plus ; il lui raconta qu’elle avait hésité un instant à accepter, et qu’elle y avait mis pour condition une grâce…
— Qu’il fallait lui accorder, dit le roi.
— Et c’est-ce que j’ai fait, sire, en votre nom : c’était un Maure, un nommé Yézid, qui s’était battu en duel, et à qui nous expédierons des lettres de grâce le plus tôt possible, c’est-à-dire dans huit jours… elle tient à les avoir avant de paraître devant vous.
— Et pourquoi ?
— Pour vous en remercier, sire, le premier jour qu’elle vous rencontrera chez la reine… car la voilà attachée à la personne de Sa Majesté.
Et le ministre s’étendit alors complaisamment sur l’adresse profonde et sur la diplomatie ingénieuse qu’il avait déployées pour amener la reine à choisir, à demander elle-même Aïxa pour dame d’honneur ; ce qui donnait à la duchesse de Santarem une position, ce qui détournait tous les soupçons, et ce que le roi regardait comme le coup d’État le plus habile et l’évènement le plus important de son règne.
Aussi, enchanté de voir cette grande affaire heureusement terminée, le roi, retiré dans son cabinet et assis dans son grand fauteuil, se frottait les mains. Il partageait en ce moment l’opinion de la comtesse d’Altamira et se disait à lui-même : en vérité, j’ai un grand ministre !
On lui annonça le grand inquisiteur Royas de Sandoval et l’archevêque de Valence, les deux principaux membres du saint-office.
Le grand inquisiteur et l’archevêque de Valence ne pouvaient arriver dans un moment plus favorable, s’ils avaient quelque chose à demander ; et en effet le grand inquisiteur se hâta de raconter à Sa Majesté que tous les droits et priviléges de l’inquisition avaient été scandaleusement violés dans la personne du saint prélat ; qu’un néophyte qu’il avait daigné prêcher et enseigner lui-même, lui avait été enlevé par les intrigues des pères de Jésus, et qu’on le gardait illégalement au couvent d’Alcala de Hénarès sous prétexte de donner asile à un prétendu fugitif ; que la sainte inquisition reconnaissait la première le droit d’asile dans les églises et dans les couvents, mais que ce droit ne pouvant pas être illimité, il convenait d’en borner la durée ; que le conseil du saint-office, présidé par lui, venait, sur la proposition de l’archevêque de Valence, de décider que ce temps ne pourrait excéder une ou deux semaines tout au plus ; qu’en conséquence le couvent d’Alcala de Hénarès eût à renvoyer de l’enceinte de ses murs ou à livrer à qui de droit le néophyte retenu par lui depuis plus d’un mois, lequel serait sur-le-champ remis aux officiers du saint-office, etc.
C’étaient ces deux actes que l’inquisiteur et l’archevêque apportaient à la signature du roi, et ils s’apprêtaient à les soutenir par tous les arguments que pourraient leur suggérer l’intérêt de la foi et le ressentiment de Ribeira ; mais le roi ne leur permit pas de donner de plus longs développements à leur éloquence.
— Donnez, mes pères, dit-il, donnez ! dès que cela vous semble juste et de votre devoir, le mien est de signer sans discussion tout ce que vous voudrez, tout ce qui vous plaira, seigneur archevêque.
Et il chercha une plume sur son bureau.
— C’est toujours le même, le saint roi Catholique ! dit Ribeira.
— Le bouclier et l’épée de l’Église ! ajouta le grand inquisiteur.
Telles étaient les paroles qu’ils prononçaient à voix haute ; mais en même temps ils se regardaient, et leurs yeux se disaient :
— C’est toujours ce roi sans caractère et sans énergie qui décide sans voir, signe sans lire, et dont nous ferons toujours tout ce que nous voudrons.
Le roi, qui signait rarement et qui n’écrivait jamais, avait peu de plumes sur son bureau ; aussi, pendant qu’il en cherchait une de la main, ses yeux parcouraient, presque sans le vouloir, les papiers qu’on venait de lui remettre, et il vit à un alinéa que ce fugitif destiné aux cachots et aux tortures de l’inquisition, se nommait Piquillo Alliaga…
— Piquillo… Alliaga… dit-il en répétant ce nom qui ne lui était pas inconnu et qui lui rappelait de doux souvenirs ; eh oui ! c’est celui que don Augustin de Villa-Flor avait promis de découvrir…
— Nous l’avons découvert, dit Ribeira, il est au couvent d’Alcala.
— C’est lui que nous voulons saisir, reprit Sandoval.
— Que nous voulons châtier, ajouta l’archevêque avec rage.
— Et moi, je ne le veux pas ! s’écria le roi avec chaleur.
— Eh, mon Dieu ! sire, se dirent les deux prélats étonnés, qu’est-ce que cela signifie ?..
— Que je ne le veux pas ! s’écria le roi avec force.
— Mais Votre Majesté n’y pense pas !
— J’y pense si bien qu’il n’entrera point dans les prisons de l’inquisition ! je l’ai promis ! et s’il y était, je l’en ferais sortir sur-le-champ, je l’ai promis !
— Et à qui donc, sire ?
— À qui ?..
Il hésita et dit :
— À moi-même ! et il me semble que les promesses faites au roi sont aussi sacrées que les autres.
— Sans contredit, sire ! mais Votre Majesté connaît donc ce Piquillo Alliaga ?
— Du tout !
— Elle l’a vu au moins ?
— Jamais !
— Et pour quelle raison, sire, le protéger contre nous ?
— Parce que je le veux !
Ces mots, prononcés d’une voix nette et ferme, retentirent sous les voûtes du cabinet qui semblaient presque étonnées de les entendre. Les deux prélats effrayés se regardèrent cette fois avec un sentiment bien différent, et dans ce nouveau dialogue leurs yeux se disaient :
— Je n’y comprends rien !
— Ni moi non plus.
— Qu’est-ce qu’il a donc ?
— Est-ce qu’il aurait de l’énergie ?
— Du caractère ?
— Et une volonté ?
— Et s’il s’avise d’être toujours ainsi…
— Où allons-nous ?
— Qu’allons-nous devenir ?
Le roi, durant cette conversation muette, avait écrit : un ordre de lui-même, de sa main, et, sans le montrer : aux deux prélats, sans les consulter, il dit :
— Non-seulement il n’ira pas en prison, mais j’ordonne qu’on le fasse sortir à l’instant même du couvent d’Alcala de Hénarès, où vous dites qu’il est prisonnier. Il sonna. Un huissier de la chambre parut.
— Y a-t-il quelque officier dans le premier salon ?
— Un seul, sire, don Fernand d’Albayda, qui a reçu du ministre l’ordre de quitter Lisbonne pour venir rendre compte de sa conduite.
— Il répondra au ministre plus tard ; il faut d’abord qu’il m’obéisse, à moi.
Sandoval regarda de nouveau le roi pour s’assurer qu’il n’était point malade et qu’il était bien réellement dans son bon sens.
Pendant ce temps, Fernand d’Albayda était entré.
— Monsieur, lui dit le roi, vous allez vous rendre ; sur-le-champ à Alcala de Hénarès, à cinq lieues d’ici ; vous irez au couvent des révérends pères de la Foi, et vous leur ordonnerez, en vertu de cet acte signé de moi, de remettre à l’instant même en liberté le nommé Piquillo Alliaga.
— Piquillo dit Fernand avec étonnement.
— Vous le connaissez ?
— Oui, sire.
— Vous êtes plus avancé que moi.
— C’est un jeune homme plein de cœur, de mérite, de talent, s’écria Fernand.
— Vous l’entendez, mes pères ! dit le roi.
— Et digne en tout point de la protection de Votre Majesté.
— Vous entendez, mes pères ! Partez, monsieur… ah ! attendez, dit-il en se remettant à écrire ; puis il s’arrêta et reprit : Non, non, cette lettre-là, ce n’est pas vous qui la porterez.
Fernand s’inclina et sortit.
Le roi écrivait toujours. Il traçait le billet suivant :
« Le roi s’est empressé de tenir la promesse que don Augustin de Villa-Flor avait faite à la belle Aïxa. Dès ce soir, Piquillo Alliaga sera remis en liberté. »
Puis levant les yeux sur Sandoval et Ribeira qui restaient debout et immobiles devant lui :
— Je ne vous retiens plus, mes pères, leur dit-il.
Les deux grandes dignités ecclésiastiques du royaume, consternées et humiliées, descendaient côte à côte l’escalier du palais ; elles descendaient, et dans ce moment le duc de Lerma montait. Sandoval lui raconta avec effroi ce qui venait d’arriver… Ribeira le lui répéta en faisant le signe de la croix.
— C’est inexplicable… Je ne comprends plus rien au roi.
— Ni moi à la reine, dit le ministre.
— En vérité, dit Sandoval à voix basse, je crois que notre auguste souverain est fou.
— Non, dit le ministre en soupirant, mais il est amoureux.
Fernand, cependant, fidèle aux ordres du roi, galopait sur la route d’Alcala, enchanté d’aller délivrer Piquillo, et ravi d’une mission qui le dispensait de son audience avec le ministre. En recevant l’ordre de se rendre à Madrid, il s’était douté que les événements du château de Santarem allaient lui valoir quelque disgrâce, et la confiance dont le roi l’honorait en ce moment lui semblait une compensation de la mauvaise humeur du ministre.
Il arriva vers le milieu du jour à Hénarès, et sans s’arrêter, sans se reposer, il alla droit au couvent ; il remit son cheval au valet qui le suivait, et demanda au frère portier le supérieur du couvent, le révérend père Jérôme.
— Impossible de le voir en ce moment.
— Dites à lui ou au prieur que j’ai à leur parler de la part du roi, moi, don Fernand d’Albayda.
Le frère portier revint un instant après, et remit un petit billet non cacheté : il était d’Escobar.
« Le père Jérôme me charge de présenter ses respects et ses excuses au seigneur don Fernand d’Albayda, et le prie de vouloir bien l’attendre quelques instants. Une importante cérémonie retient en ce moment à la chapelle le supérieur et ses frères.
« Le prieur, Frère Escobar. »
— C’est donc une grande fête, une grande solennité ? dit Fernand.
— Une ordination !… rien que cela ! dit le frère portier. Écoutez plutôt.
— En effet, toutes les cloches du couvent sonnaient à grande volée ; les orgues se faisaient entendre, ainsi que les voix des frères.
— J’ai ordre, seigneur cavalier, de vous conduire au parloir.
— Je vous suis, mon frère.
Fernand entra au parloir et attendit.
Un silence profond régnait dans les bâtiments et dans les cours du couvent. C’était le repos, mais le repos de la tombe. On eût dit que ces lieux étaient abandonnés, si de temps en temps un chant lointain et monotone n’eût retenti sous les voûtes du cloitre. Fernand se sentit effrayé du calme qui l’environnait ; lui qui dans le monde, parvenait parfois à se distraire et à s’étourdir par le bruit, par l’agitation, par les devoirs de chaque jour, il se trouvait seul, ici, avec lui-même, seul avec l’image d’Aïxa et les pensées qu’il s’efforçait de fuir !… Ah ! que je plains, se disait-il, ceux qui viennent dans la solitude du cloitre pour y chercher la consolation et l’oubli ! on n’y trouve au contraire que la douleur et le souvenir ! Il se félicitait du moins d’arracher Piquillo à ces hautes et sombres murailles, de le ramener au sein du monde, aux plaisirs de son âge, aux douceurs de l’amitié… à Carmen, à Aïxa, qui l’attendaient.
En ce moment de longues files de moines, le capuchon baissé et les mains croisées sur la poitrine, sortirent de la chapelle et rentrèrent dans leur cellule. Fernand se fit conduire à l’appartement du supérieur.
Le père Jérôme avait avec lui le frère Escobar et un jeune moine qui, agenouillé dans un coin, semblait absorbé dans une sainte extase ou dans une profonde douleur, car il ne voyait et n’entendait rien de ce qui se passait autour de lui.
— Mon révérend, dit le jeune militaire au supérieur… Je viens vers vous de la part du roi…
À cette voix d’un ami, à cette voix qu’il avait entendue pour la première fois, auprès d’Aïxa et de Carmen et sous le toit hospitalier de Juan d’Aguilar, le moine leva vivement la tête.
— Piquillo ! s’écria Fernand.
Le moine se jeta dans ses bras, et, comme si toutes ses larmes, depuis si longtemps comprimées, se fussent fait tout à coup un passage, il éclata en sanglots, et n’eut que la force de s’écrier :
— Vous ! vous, Fernand ! ah ! parlez-moi d’elle… de mes amis… de Yézid !…
— Allons ! allons ! calmez-vous, lui dit Fernand en souriant, vous allez bientôt les revoir, je vous emmène. Mon père, dit-il au supérieur, daignez lire cet ordre du roi qui vous enjoint de me remettre Piquillo, votre prisonnier.
— Piquillo n’existe plus, répondit froidement le supérieur, nous n’avons ici que le frère Luis d’Alliaga.
— Que voulez-vous dire ? s’écria Fernand en reculant d’un pas.
— Qu’aujourd’hui, jour de la Saint-Louis, ce jeune frère a prononcé ses vœux.
— Ce n’est pas possible ! il y a ici quelque trahison… et je proteste au nom du roi qui m’envoie.
— Prenez garde à vos paroles, seigneur cavalier, dit le père Jérôme avec calme. C’est d’elle-même que cette âme égarée est venue à nous ; c’est à genoux que l’enfant prodigue est venu nous supplier de le réconcilier avec le ciel !
— Serait-il vrai ? dit Fernand en se retournant vers Alliaga.
— Oui, oui, il l’a fallu, répondit celui-ci, pâle et baissant les yeux… Apprenez-moi du moins, c’est ma seule consolation, que mon sacrifice n’a pas été inutile. Yézid est-il arraché à ses bourreaux ?
— Yézid n’a jamais été en danger, dit Fernand avec étonnement. Sauvé par moi et dérobé à toutes les recherches, il vient d’obtenir sa grâce.
— Aïxa était donc seule menacée ? s’écria Alliaga. Dites-moi qu’elle est sortie de son cachot, qu’elle est rendue à la liberté.
— La duchesse de Santarem a toujours été libre et respectée… elle vient d’être nommée dame d’honneur de la reine…
Le jeune moine se mit à trembler, et avec une agitation convulsive, il chercha sur lui un papier en disant :
— Cette lettre, cependant, cette lettre… tenez, tenez… c’est de Delascar d’Albérique… d’un vieillard… de mon père ! il n’a pu me tromper, celui-là ! lisez ! lisez !…
Fernand, élevé avec Yézid, connaissait trop bien l’écriture du vieillard pour s’y méprendre un instant, et, du premier coup d’œil, il s’écria :
— Ceci n’est point de la main d’Albérique !
— En êtes-vous bien sûr ? dit Piquillo avec la pâleur de la mort.
— Et même, continua Fernand, en comparant cette écriture avec celle du petit billet qu’il venait de recevoir, il ne serait pas impossible d’en connaitre l’auteur. Tenez ; voyez vous-même si ce ne serait pas la main du frère Escobar.
À cette vue, à ce nom, le jeune moine poussa un cri horrible, un cri de malédiction et de vengeance, et tomba sur le plancher roide et sans connaissance. Fernand le crut mort et courut à lui. Escobar voulut l’aider.
— Laissez-le, laissez-le ! dit Fernand en le repoussant. C’est vous qui l’avez tué, et je vous disais bien, mes pères, qu’il y avait ici quelque trahison dont vous répondrez devant Dieu et devant les hommes ; mais Piquillo est libre, et, d’après l’ordre du roi, je l’emmène à l’instant, si toutefois, comme je l’espère, il est en état d’être transporté.
— Il ne sortira point d’ici ! s’écria le père Jerôme en se plaçant entre Fernand et son ami. Le roi avait des droits sur Piquillo, il n’en a aucun sur frey Luis d’Alliaga, moine de ce couvent, et qui ne dépend plus que de moi, son supérieur. Puis, s’adressant à plusieurs frères qui étaient accourus au bruit : Enlevez-le dit-il en leur montrant le pauvre jeune homme toujours sans connaissance, et portez-le dans sa cellule.
— Je ne le souffrirai pas ! s’écria Fernand.
— La violence serait inutile, répondit le supérieur, et vous perdrait vous-même, seigneur cavalier.
Fernand comprenait trop bien que le moine avait raison, et il s’écria :
— Je proteste du moins contre la ruse et la trahison dont il est victime… Je proteste contre des vœux qui sont nuls !
— Qui sont réguliers ! s’écria Escobar pendant qu’on emportait Alliaga ; ces vœux ne lui ont pas été imposés, ils ont été sollicités par lui…
— Tout a été violé à son égard ; il était ici comme prisonnier.
— Comme novice !
— Il y a un mois à peine !
— Un mois et demi, dit Escobar.
— Il faut un an de noviciat.
— Un an au plus ! trois mois au moins ! répondit Escobar ; tel est le texte du règlement.
— Eh bien ! s’écria Fernand avec fureur, vous convenez vous-même qu’il n’a passé qu’un mois et demi…
— Et deux mois dans l’œuvre de la Rédemption, ainsi que l’atteste lui-même l’archevêque de Valence. Cela fait bien, si je ne me trompe, trois mois et demi de noviciat… C’est donc quinze jours de trop !
Fernand, hors de lui, s’élançait pour étrangler le moine.
— Faites, mon frère, s’écria Escobar avec une résignation évangélique. Aussi bien, je le vois, il vous sera plus facile de m’étrangler que de me répondre.
Fernand, suffoqué de rage, se précipita vers la porte, s’élança sur son cheval, et reprit ventre à terre la route de Madrid.
XLIII.
le petit souper.
Alliaga resta longtemps sans connaissance. Quand il revint à lui, quand il aperçut les murs de sa cellule, cette croix, ce prie-Dieu, et surtout le père Jérôme debout près de son lit, il s’écria avec terreur :
— Fernand !.. Fernand, où êtes-vous ? Fernand, ne m’abandonnez pas !
— Il n’est plus ici, dit le moine.
— Ce n’est pas possible !.. Il ne m’aura pas laissé au milieu de mes ennemis.
— De vos frères ! dit pieusement le supérieur.
— Vous, mes frères ; vous que je renie et que je déteste ! Vous !.. vous plus lâches et plus cruels que Ribeira lui-même, car il n’employait que la violence, et vous employez la trahison ; je pouvais par le courage résister à mes bourreaux, mais comment se défendre contre les ruses et les piéges dont vous et Escobar vous m’avez entouré ?
— Mon fils, calmez-vous et écoutez-moi ; il fallait vous faire connaître l’éternelle vérité.
— Et vous avez commencé par le mensonge !
— Qui veut la fin veut les moyens. Le but que l’on se propose sanctifie tout, et nous avons voulu vous, faire arriver au ciel.
— Par le chemin de l’enfer !
— Les bords de la coupe sont amers, mais ils renferment un salutaire breuvage.
— Un poison qui tue !
— Quand ce serait vrai ! nous vous aurions donné en échange la vie éternelle… mais ce courroux tombera. Vous voilà des nôtres.

— Jamais !..
— Et quand vous serez resté quelque temps parmi nous…
— Je n’y resterai pas ! Je suis libre, je veux ma liberté !
— Vous l’avez engagée devant Dieu !
— Devant Dieu, qui lit dans nos cœurs et qui sait à quelle condition je m’engageais, et si, comme vous le prétendez, votre Dieu est un Dieu de justice…
— Sans contredit.
— Il sait que je ne suis pas à lui ; il sait que mes vœux sont nuls, il vous ordonne de les briser, et si vous me retenez ici de force et malgré moi, c’est vous qui outragez ce Dieu dont vous me parlez !
— Permettez, mon frère, dit le jésuite avec sang-froid ; il y a les lois de Dieu, mais il y a aussi celles du couvent, qui sont la loi de Dieu sur la terre. Or, nous sommes sur la terre dans ce moment. C’est donc au couvent qu’il faut obéir d’abord, non pas que cela soit la seule juridiction, mais c’est la première et la plus immédiate ; c’est donc par elle qu’il faut commencer, sous peine de manquer à toutes les autres. Or, que dit la règle du couvent ? Aucun moine ne sortira sans la permission du supérieur ; donc…
— Si l’on me retient de force, j’emploierai la force pour m’arracher de vos mains, je proclamerai en tous lieux comment vous peuplez vos couvents ; j’irai dire à Ribeira quels moyens vous employez pour convaincre les âmes…
— Et moi, mon frère, dit le supérieur avec un peu d’impatience, je n’ai plus qu’un mot à vous répondre. Vous nous opposez sans cesse le saint archevêque de Valence, Ribeira ; vous affectez de l’exalter et de l’élever au-dessus de nous pour nous humilier sans doute ; mais nous aussi, nous reconnaissons avec vous que ses pieuses pratiques ont du bon, que ses moyens de conviction ne sont pas à dédaigner, et pour certaines occasions nous avons adopté son système.
— Que voulez-vous dire ? s’écria Alliaga.
— Système que nous avons perfectionné ; et je vous déclare que nous avons ici, sans que l’on s’en doute, certains cachots modèles, où nous avons soin de reléguer ceux qui, par obstination ou endurcissement, resteraient sourds à la voix du ciel, et surtout qui, par malice ou méchanceté, voudraient décrier notre ordre et le calomnier !
— Le calomnier ! s’écria Alliaga furieux, le calomnier ! est-ce que cela est possible !.. est-ce que votre fourberie et votre méchanceté ne dépassent point tout ce que l’on pourrait inventer ! Et vous avez pu espérer que je resterais dans vos rangs, que je vous appellerais mon frère !.. Écoutez-moi, car je ne vous ressemble pas… je ne veux tromper personne, pas même un ennemi ! À vous et à Escobar, à vous et à tout votre ordre, je déclare dès ce jour une haine mortelle !… Ce serment-là, je le fais bien de moi-même, et je le tiendrai… Et maintenant que vous me connaissez, appelez vos geôliers et ordonnez-leur d’ouvrir vos cachots…
— Plus tard, dit froidement le père Jérôme, je ne dis pas non… c’est possible ! mais dans ce moment vous avez la fièvre. Nous attendrons que vous soyez guéri, et je vais vous envoyer pour cela le frère médecin, en le priant d’employer tous ses soins à hâter votre guérison.
Il sortit, et un quart d’heure après arriva un frère élève de Saint-Pacôme.
Il trouva, en effet, Piquillo en proie à une fièvre chaude que rien ne pouvait calmer, et qui dura plusieurs jours. Pendant quelque temps on surveilla le jeune frère avec soin, puis on s’en occupa moins, puis on le laissait seul des heures entières, luttant contre la maladie, dont les accès, quoique moins fréquents, revenaient encore.
Un soir, en proie à un délire ardent, à moitié fou de rage et de douleur, et conservant cependant assez de raison et de mémoire pour se rappeler toutes les trahisons dont il avait été victime : — Il n’y a donc ici-bas, s’écria-t-il, ni loi, ni justice ! Eh bien, c’est moi qui serai la loi ! c’est moi qui serai la justice ! C’est à moi de châtier les coupables que les hommes laissent impunis !.. Oui… oui, continua-t-il avec exaltation, Dieu me confie cette mission, et je la remplirai ! je commencerai par Escobar… et par le père Jérôme !
Il s’était levé… il s’était habillé complétement.
— Ils m’ont donné cette robe de moine, disait-il… ils ont bien fait. Me voici désormais, comme eux, ministre de Dieu !.. d’un Dieu vengeur. Allons, maintenant à l’œuvre ! et que le ciel me conduise !
Enveloppé dans sa robe, le front caché par son capuchon, il s’élança dans la cellule d’Escobar. Celui-ci était absent, par bonheur pour lui, car nul doute que, dans sa rage, Alliaga, dont les forces étaient doublées par la fièvre, n’eût, de ses propres mains, étranglé le bon père.
— Ah ! il n’est pas là ! dit-il avec égarement, le ciel le protége encore… mais ce ne sera pas toujours ainsi… il reviendra… et en attendant il y en a d’autres encore à punir et à immoler… Allons chez le père Jérôme !
Il descendit l’escalier d’un pas ferme, et traversa la cour. La nuit était venue. On sonnait l’Angelus ; mais au lieu de suivre les autres frères à la chapelle, il continua sa marche jusqu’à la cellule du supérieur. Un moine en sortait un panier vide. C’était Paolo, le frère, ou plutôt le valet de chambre de confiance du père Jérôme. Il fit un geste de surprise en voyant un moine dont il ne pouvait distinguer les traits s’avancer aussi résolument vers l’appartement dont il venait de fermer la porte. Il voulut parler, Alliaga lui saisit brusquement la main, et lui dit d’une voix sourde :
— Silence !
— Ah ! vous êtes de ceux qu’il attend.
— Oui… celui que Dieu envoie.
Il vit la porte fermée, et regardant frey Paolo qui tenait une clé, il ajouta :
— Ouvre !
Il entra dans la cellule, dont la porte se referma sur lui. Il se trouva dans l’obscurité ; et après avoir fait le tour de l’appartement :
— Et lui aussi, se dit-il, n’est pas chez lui ! Oui… oui, j’ai entendu sonner l’Angelus… il y est, je l’attendrai… il espérait se dérober à ma vengeance, mais il ne m’échappera pas ; Dieu va me l’amener… je l’attends !.. je l’attends !…
Il se leva du fauteuil qu’il avait rencontré et sur lequel il s’était jeté. Il se mit à marcher de nouveau à grands pas dans la chambre. Nous avons dit qu’elle n’était point éclairée ; et au milieu de l’obscurité, il vit une faible lueur sortir de dessous un panneau et glisser sur le parquet.
— Ah ! dit le jeune moine… chez eux la lumière ne vient pas d’en haut, mais d’en bas.
Et il s’approcha de ce qu’il croyait une porte. C’était un tableau, un portrait en pied de saint Jérôme, qui ornait la cellule du supérieur. Ce portrait couvrait et masquait tout un panneau ou plutôt une porte secrète qui glissait sous un ressort, et qui, d’ordinaire, était si exactement jointe au reste de la boiserie, qu’on ne pouvait soupçonner aucune solution de continuité. Frey Paolo, qui venait de sortir, n’avait pas probablement rapproché complétement le tableau de la muraille, puisqu’il s’en échappait un rayon de lumière, et si faible que fût cette lueur, elle servit à guider Alliaga. Il porta la main sur le panneau, qui glissa, et le pauvre insensé fut tout à coup ébloui par la masse de bougies qui l’illuminèrent.
Dans un réduit, dans un petit salon simplement orné, était préparée une table couverte de linge bien blanc richement damassé. Sur la table était une collation composée de viandes froides, de pâtisseries, de fruits et de confitures de toutes sortes. Des vins rafraîchissaient dans des vases de glace. Il y avait quatre couverts qui attendaient les convives. Des flambeaux à plusieurs branches garnies de bougies brillaient aux deux bouts. Les chaises et les fauteuils, doux, soyeux et commodes, semblaient inviter à s’asseoir, et on apercevait, au fond de l’appartement, dans un enfoncement, un large canapé saintement rembourré et embelli de coussins d’un pieux édredon. C’était là que le révérend père supérieur venait se reposer et faire sa sieste dans les grandes chaleurs. De chaque côté du canapé était un cabinet ayant une ouverture à hauteur d’homme fermée par un rideau de taffetas vert.
Alliaga s’était arrêté à cette vue, interdit, stupéfait, et regardant autour de lui avec étonnement. Soit que ce passage subit d’une obscurité complète à un jour éclatant eût donné une secousse à son cerveau affaibli, soit que l’accès de fièvre qui avait jusqu’alors surexcité toutes ses facultés diminuât peu à peu et fût arrivé à sa fin, il porta la main à son front, puis interrogea lentement du regard les lieux où il se trouvait. Ses souvenirs, d’abord vagues et confus, se dessinèrent avec plus de netteté, et il se rappela, comme on se rappelle au sortir d’un rêve pénible, le délire auquel il venait d’être en proie. Oui, c’était dans le dessein d’immoler le père Jérôme qu’il avait quitté sa cellule et qu’il était venu dans celle-ci. Pour se venger d’une trahison, il allait commettre un meurtre et punir un crime par un crime plus grand encore. Mais, grâce au ciel, son égarement était passé, la fièvre était tombée, il ne se sentait plus que de la lassitude dans tous les membres et une grande faiblesse. Il voulut alors, avant que personne pût soupçonner son dessein, se hâter de retourner dans sa cellule ; mais celle du père Jérôme était fermée à clé en dehors.
Alliaga était donc prisonnier, et comment justifier sa présence en ces lieux ? quel prétexte donner à sa visite à une pareille heure ? et puis le réduit mystérieux tenant à la cellule du supérieur, ce salon élégant dont Piquillo ne se doutait point et que les autres frères ignoraient sans doute, ce secret enfin dont le hasard l’avait rendu maître, tout cela n’offrait-il pas dans sa position plus d’un danger ? Il calculait toutes ces chances, quand il entendit marcher dans le corridor. Sans réfléchir et dans l’espoir seulement d’échapper aux premiers regards, il se précipita dans le petit salon et referma sur lui le tableau de saint Jérôme au moment même où l’on ouvrait la porte du supérieur. Mais à peine il sortait d’un danger, il comprit qu’il venait de se jeter dans un autre.
Il était impossible cette fois qu’on ne le vît pas, et il y avait plus d’inconvénient pour lui à être trouvé dans ce lieu que dans la cellule du révérend père. Un seul asile lui était offert : dans le renfoncement occupé par le canapé, il y avait, comme nous l’avons dit, deux cabinets ; il se jeta dans le premier qui s’offrit à lui. C’était une espèce de garde-robe où étaient accrochés de chaque côté les soutanes, les surplis, les étoles, les habillements ecclésiastiques du père Jérôme, habillements très-soignés et très-riches ; le révérend y mettait de la coquetterie, et toutes les grandes dames, ses pénitentes, se disputaient l’honneur de travailler pour lui. Un fauteuil se trouvait dans ce cabinet, fort à propos pour les jambes d’Alliaga, que l’émotion et la maladie faisaient chanceler.
On venait d’entrer dans le petit salon. Deux personnes parlaient. Ce n’était point la voix du supérieur. C’étaient d’abord celle d’Escobar… et, à la grande surprise de Piquillo, une voix de femme, une voix qui ne lui était pas inconnue, celle de la comtesse d’Altamira. Craignant de se tromper, le jeune moine entrouvrit à peine le rideau de taffetas qui fermait la petite croisée ronde pratiquée dans la porte, et en face de lui il vit distinctement la comtesse, qu’Escobar venait d’amener et de faire asseoir.
— Quoi ! dit la comtesse, nous sommes les premiers au rendez-vous ?
— Oui, senora, c’est le révérend qui se fait attendre.
— Le supérieur du couvent ! lui qui doit le bon exemple, lui qui doit être pour la règle et l’exactitude ! Puis, regardant autour d’elle, elle s’écria :
— En vérité, mes frères, c’est trop de recherche, c’est trop de frais ! je viens pour causer d’affaires, et vous me donnez une collation.
— Nous avons pensé que la senora, arrivant de Madrid et venant de faire cinq lieues, aurait besoin de prendre quelques rafraichissements.
— Oui, vraiment… un fruit… un biscuit… un repas de couvent… mais un souper complet… un petit souper… c’est trop mondain ! Et puis tout est ici d’une élégance… on dirait d’un boudoir.
— Celui de madame la comtesse est bien autre chose.
— C’est possible… mais on n’y parle pas d’affaires… d’affaires à trois… Il est vrai que, grâce au père Jérôme, qui se fait attendre, nous voilà seuls.
— C’est juste, dit frère Escobar en rougissant un peu.
— C’est presque un tête-à-tête ! s’écria la comtesse.
— Presque ! reprit Escobar étonné ; il me semble cependant que nous ne sommes que deux.
— Et votre vertu qui est en tiers ! ajouta gaiement la comtesse ; votre vertu que vous ne comptez pas, mon père, et qui cependant, je l’espère, doit compter pour quelque chose.
— Certainement, dit avec embarras Escobar, qui n’avait pas l’habitude de conversations pareilles.
— Et quand j’y pense, continua la comtesse, il est heureux que vous ayez eu l’idée de vous faire moine ; vous auriez été trop redoutable dans le monde, vous qui avez le talent de persuader et de convaincre.
— Le danger n’eût pas été si grand que vous voulez bien le dire. Ma vue eût détruit, grâce au ciel, l’effet de mes paroles.
— Peut-être ! dit la comtesse avec coquetterie ; il y a des gens qui écoutent et qui ne regardent pas.
— Je suis de ceux-là, senora, et bien m’en prend en ce moment, dit Escobar en abaissant ses regards vers la terre.
— C’est juste, mon père !.. je suis sûre que vous n’avez jamais jeté les yeux que sur vos livres.
— Jamais, répondit gravement le moine.
— C’est original ! et il eût été piquant de vous faire oublier vos in-folio et votre bréviaire.
— C’est difficile, il est toujours là devant moi… ouvert sur ma table… et j’ai juré de ne jamais le fermer.
— Et cependant, dit la comtesse en riant, si, moi, par exemple, je vous en priais… que deviendrait votre serment ? le tiendriez-vous ?
— Oui, senora.
— Vous me refuseriez ? dit la comtesse d’un air railleur.
— Non, senora.
— Comment alors arrangeriez-vous cela ? car enfin il faut qu’un livre soit ouvert ou fermé.
— Je mettrais un signet, dit le moine en souriant.
— Ah ! s’écria la comtesse en riant aux éclats, le terme moyen est admirable, et il n’y a que vous, mon père, pour concilier ainsi, à la fois, vos serments et les convenances.
En ce moment, le père Jérôme entra, surpris de la gaieté de la comtesse.
— Qu’est-ce donc ? s’écria-t-il en fronçant le sourcil.
— Je vous le dirai, mon père… ou plutôt, non… je ne vous le dirai pas ! Cela vous apprendra à arriver si tard ! Qui vous a donc retenu ?
— Des papiers importants… des nouvelles que je viens de recevoir de France, et dont je vous parlerai tout à l’heure, dit gravement le moine.
Il regarda autour de lui et il ajouta :
— Je ne vois pas monseigneur le duc d’Uzède.
— Il n’a pu m’accompagner, comme je l’espérais, répondit la comtesse ; il y avait ce soir réception à la cour, et il y est resté pour des raisons que je vous raconterai aussi tout à l’heure.
— J’ai cru qu’il était arrivé, reprit le supérieur. Frey Paolo m’avait dit tout bas, en passant près de moi à l’Angelus, que quelqu’un était déjà ici et m’attendait.
— C’était moi, répondit Escobar.
— Alors, reprit le père Jérôme, mettons-nous à table, et causons en soupant, si madame la comtesse le veut bien.
— Il y a sûreté au moins ? dit celle-ci en riant.
— Le couvre-feu vient de sonner, répondit le supérieur, et tout le monde dort déjà dans le couvent, dont toutes les portes sont fermées.
— J’espère qu’on les rouvrira pour moi cette nuit, s’écria gaiement la comtesse ; je ne pourrais pas la passer dans ce saint lieu sans me compromettre !
— Ne craignez rien, madame, dit Escobar, je vous reconduirai par où vous êtes venue, par le petit corridor souterrain qui conduit à la petite porte du cloître.
— Mon cocher m’y attendra.
— C’est un garçon sûr ? demanda le prieur avec inquiétude.
— Discret comme ses mules.
— Causons donc, dit Escobar.
— Causons, dit la comtesse, car les circonstances sont graves.
— Très-graves, reprit le supérieur en versant à la comtesse du vin d’Alicante.
Alliaga écouta de toutes ses oreilles, ce qui était facile : du cabinet où il était assis, on ne perdait pas une parole, même celles dites à demi-voix, et quand il entr’ouvrait le léger rideau de taffetas, il voyail en face de lui la comtesse en grande parure, brillante et belle encore, placée entre le supérieur et le prieur, qui la regardaient tous deux d’un air béat, et déployaient pour elle toutes les prévenances de la galanterie monastique.
— L’important, dit le père Jérôme, est d’assurer avant tout…
— La chute du duc de Lerma ! s’écria la comtesse.
— L’existence et l’influence de notre ordre, répondit le jésuite.
— Je remarque, dit la comtesse, que quand il s’agit de mes affaires, vous commencez toujours par les vôtres.
— Pour y revenir plus sûrement ! s’écria le père Jérôme… Elles se tiennent étroitement, et c’est un détour qui nous avance.
— La ligne droite, dit Escobar, est rarement la plus courte. C’est un préjugé dont on commence à revenir.
— Il s’agit donc, reprit le père Jérôme, de nous établir complétement, franchement et ostensiblement en Espagne.
— En fraude, c’est permis, dit Escobar ; mais ostensiblement, est-ce possible ?
— Je l’espère bien ! s’écria le supérieur.
— Moi, je ne le pense pas, dit gravement Escobar, et je crains même que nous ne puissions jamais y réussir. L’Espagne n’est pas un pays qui nous convienne et nous ne lui convenons pas. L’inquisition va mieux aux Espagnols, qui, sombres et graves, ne demandent qu’à croire et ne tiennent pas à raisonner. Avec ses formes absolues, et qui n’admettent pas de doute, le saint-office est justement ce qu’il leur faut. Le saint-office leur cause une frayeur mêlée d’intérêt, et ils courent à ses auto-da-fé et à ses processions comme aux combats de taureaux. Pour nous autres, qui régnons non par la violence, mais par l’adresse, ils ne nous comprennent pas. Il nous faut à nous un peuple : qui ait de l’esprit, de la finesse, ou qui croie en avoir ! La France nous convient mieux. Il n’y a là ni bûcher ni force brutale ; on nous y attaque par des plaisanteries ingénieuses et de piquantes épigrammes, mais on nous laisse faire, et pendant qu’ils se félicitent et se réjouissent de leur esprit, nous nous servons du nôtre.
— Aussi, dit le père Jérôme, c’est toujours de l’autre côté des Pyrénées qu’est établie pour nous la métropole ; la mère patrie ; mais cela n’empêche pas, dans l’intérêt même de l’ordre, de travailler à la propagation de nos doctrines, à l’agrandissement de nos ressources, et de chercher, en un mot, à étendre nos conquêtes. La France nous y aidera ; elle nous y aide dès ce moment. Je viens de recevoir des dépêches en chiffres du plus puissant et du plus habile de nos frères, car, pour avoir conquis l’estime et la faveur d’un roi tel que Henri IV, il faut bien de l’adresse.
— Il faut mieux que cela, dit Escobar.
— Et quoi donc ?
— Un talent et une vertu réels… Un roi tel que Henri ne se laisse pas prendre aux apparences, et s’il a donné sa confiance au père Cotton, c’est qu’il la mérite.
— Et vous avez raison, Escobar ; le père Cotton est tout dévoué au Béarnais, j’en ai la preuve ; car toutes ses lettres, ses dépêches, ont pour but de l’éclairer et de le servir.
— En vérité ? dit la comtesse.
— Le roi Henri avait des traîtres jusque dans son conseil. Villeroi, vieux ligueur, donnait avis de tout ce qui s’y passait à Nicolas l’Hoste, son commis principal, qui le transmettait au duc de Lerma. C’est le père Cotton qui à tout découvert et tout dit à son maitre.
La reine de France, Marie de Médicis, et ses confidents, Éléonore Galigaï et Concini, étaient en correspondance secrète avec l’Espagne. Bien plus, la maîtresse du roi, la marquise de Verneuil, le trahissait et était vendue à don Balthazar de Zuniga, ambassadeur d’Espagne, créature du duc de Lerma ; c’est le père Cotton qui a tout deviné, tout déjoué et mis en garde le Béarnais.
— Et contre l’ordinaire des princes, dit Escobar, celui-ci n’a pas été ingrat. L’édit de Rouen a rappelé nos frères de l’exil.
— Enfin, continua le supérieur, pour en venir à ce qui nous regarde, l’année dernière, j’ai eu le bonheur et le talent d’apprendre, par une de mes pénitentes, une intrigue où était mêlé un amant à elle, intrigue qui n’allait rien moins qu’à livrer la ville de Marseille aux Espagnols. Louis de Meyraigues, premier magistrat de la ville, s’entendait pour cela avec le duc de Lerma, par le moyen d’un secrétaire de la légation espagnole. J’en ai informé le père Cotton, qui en a instruit le roi. Celui-ci, qui n’est pas comme le nôtre et qui sait agir, s’est assuré par lui-même de la réalité du complot, et sur-le-champ il a donné ordre d’arrêter le secrétaire de légation et de trancher la tête au comte de Meyraigues, comme coupable de haute trahison[19].
Mais toutes ces intrigues secrètes, tous ces complots tramés dans l’ombre, car c’est là la seule politique du duc de Lerma et surtout de l’inquisiteur Sandoval, son frère, toutes ces tentatives, qui démontraient clairement au roi Henri le mauvais vouloir de l’Espagne, l’ont enfin lassé et irrité, et ne prenant conseil que de lui-même, il a résolu d’en finir et d’abattre d’un seul coup l’Espagne et son ministre.
— Ah ! dit la comtesse, voilà qui nous intéresse.
— Je vous disais bien que nous allions y venir.
— Et cela devient sérieux ?
— Très-sérieux, reprit le révérend en lui servant une aile de volaille froide.
Puis il continua son récit.
— Le roi Henri IV n’entreprend rien à l’étourdie, à la légère. Il prépare ses entreprises d’avance, de longue main, sans rien donner au hasard ; et d’après les dépêches que je viens de recevoir du père Cotton, son plan est admirable, immense, immanquable, et même en ce moment le duc de Lerma en serait instruit, il ne pourrait plus s’y opposer… il est trop tard.
— Qu’est-ce donc ? dit Escobar.
— Longtemps Philippe II et les provinces qui lui étaient soumises, c’est-à-dire presque toute l’Europe, ont formé une grande croisade catholique contre les protestants ; aujourd’hui le Béarnais se met à la tête de tous les peuples protestants contre l’Espagne. La Hollande, la Suède, tous les princes luthériens d’Allemagne, Venise, la Suisse et la Savoie le reconnaissent pour chef et marchent sous ses drapeaux.
— C’est une guerre formidable ! dit la comtesse.
— Bien plus, reprit Escobar, c’est une révolution qui va changer toute la face de l’Europe, et je ne vois pas, en effet, comment le duc de Lerma pourra y résister.
— Rien n’est préparé pour la défense : pas une place forte en état, pas une armée sur pied et pas un maravédis dans le trésor royal. Le roi Henri, au contraire, d’après ce que m’annonce le père Cotton, a une armée de cinquante mille hommes de pied et huit mille de cavalerie, tous vieux soldats, commandés par des officiers habitués aux combats et formés par le Béarnais pendant les guerres de la Ligue. Il a en outre un train d’artillerie supérieur à tous ceux qu’aucun souverain a jamais fait paraître en campagne, et des munitions de guerre pour cent mille coups de canon. De plus, et par l’économie et la sage administration du duc de Sully, son ministre, qui n’est point un duc de Lerma, il a amassé des trésors tels qu’il pourrait tenir sur pied, pendant dix ans, des forces militaires aussi redoutables, sans rien demander à ses sujets et sans créer aucun impôt extraordinaire. Jamais l’Europe n’aura vu de si grands préparatifs ni de si vaste entreprise.
— C’est admirable ! s’écria la comtesse.
— Quel roi que ce Henri IV ! dit Escobar.
— Homme de tête et de cœur, ajouta le père Jérôme, il réunit toutes les qualités qui font les grands princes ; il les a toutes !
— Il aime les femmes, dit la comtesse.
— Il protège les jésuites, dit le supérieur.
— C’est-à-dire, il s’en sert, reprit Escobar, ce qui est bien différent ; mais n’importe, imitons-le ! servons-nous de lui, et si ce que le révérend nous apprend est authentique…
— Je tiens tous ces détails du père Cotton, qui, à son tour, m’en demande quelques autres sur la situation intérieure de l’Espagne, et c’est à vous que je m’adresse, madame la comtesse.
— Vous les aurez, s’écria celle-ci.
— Par qui ? demanda Escobar.
— Par le duc d’Uzède, répondit froidement le supérieur.
— Qui les obtiendra de son père le duc de Lerma, dit la comtesse, c’est plus sûr.
— C’est juste, dit Escobar ; cela devient une affaire de famille et d’intérieur.
— Et le jour où le roi de France entrera en campagne, ce qui ne peut tarder, continua le supérieur, le duc de Lerma, qui n’a rien prévu et qui ne peut s’opposer à rien, le duc de Lerma, qui n’aura su défendre ni son roi ni le royaume qui lui était confié, ne pourra plus rester au pouvoir ni conserver les rênes de l’État. C’est un homme perdu, renversé de fait et de droit sans que nous ayons besoin de nous en mêler. Avec lui tombe Sandoval, son frère.
— Avec Sandoval l’influence de l’inquisition, dit Escobar.
— À la place du saint-office, la Compagnie de Jésus.
— Et à la place de Gaspar de Cordova, qui n’est rien, frère Jérôme, qui sera tout ; frère Jérôme, confesseur du roi, aussi puissant en Espagne que le père Cotton l’est en France ; n’est-ce pas, mon révérend ?
— Eh mais, dit Jérôme en souriant, cela est possible.
— Et qui, un beau matin, continua Escobar, nous saluera de son chapeau de cardinal.
— Si toutefois il salue personne, dit la comtesse, quand il portera ce chapeau-là. Mais il y a un seul obstacle à tous ces projets, à tous ces rêves.
— Lequel ?
— Ils sont impossibles.
— Comment cela, s’il vous plaît ? dit le supérieur en posant sur la table un verre de xérès qu’il allait porter à ses lèvres.
— C’est que vous allez travailler pour d’autres, c’est que, le duc de Lerma renversé, ce n’est pas vous qui hériterez de son pouvoir et de son influence.
— Et qui donc ?
— Je vais vous le dire : le roi est amoureux.
— Nous le savons.
— Mais non pas de celle que nous voulions lui donner pour maîtresse, non pas de Carmen, ma nièce…
— Hélas ! oui, dit Escobar, et c’est dommage.
— Le duc d’Uzède nous a tout raconté, reprit le père Jérôme.
Piquillo redoubla d’attention.
— Le roi, continua la comtesse, le roi, qui n’aimait rien, et que je croyais incapable d’aimer, est en proie en ce moment à un amour ou plutôt à une passion… à un délire inouï… et cela sans raison, sans motif.
— C’est bien singulier, dit le père Jérôme.
— Vous qui vous y connaissez, madame la comtesse, ajouta Escobar, expliquez-nous cela.
— Ce n’est pas possible ! si cela s’expliquait, ce ne serait plus de l’amour.
— Je ne comprends pas, dit froidement Escobar ; mais puisque vous le dites, ce doit être.
— Et, ajouta Jérôme, si cet amour est en effet aussi violent, il y a au moins un espoir, c’est qu’il ne durera pas longtemps.
— Vous auriez raison si cette femme était sa maîtresse, si elle était à lui, et plût au ciel que cela fût ainsi !
— Le ciel nous en fera la grâce, dit Escobar.
— Eh non ! c’est un amour pur, chaste, platonique. Le roi n’avait osé jusqu’ici jeter les yeux sur aucune femme. Il serait comme vous, Escobar… s’il aimait les livres. Tout ce que voulait Sa Majesté, c’était que cette beauté fût présentée à la cour, pour qu’il eût le bonheur de la voir et de l’admirer tous les soirs. Ses vœux n’allaient pas plus loin. Le duc de Lerma s’était chargé de les satisfaire, et moi d’y mettre obstacle.
— C’était bien.
— J’ai couru prévenir la reine et tout lui dire.
— Encore mieux !
— Je lui ai prouvé que le duc de Lerma avait le dessein d’amener à la cour une maîtresse, une favorite du roi, une rivale, en un mot…
— Eh bien, dit vivement Jérôme, qu’a fait la reine ?
— La reine… dit la comtesse avec dépit, la reine, qui ne se mêle de rien, a, je crois, plus d’esprit que nous tous ! loin de se fâcher, loin d’accabler le ministre que je lui livrais, loin de faire une scène de ménage à son auguste époux, la reine a choisi elle-même et demandé pour dame d’honneur la belle Aïxa !
— Ce n’est pas possible ! s’écrièrent à la fois Escobar et le prieur.
Leurs exclamations bruyantes empêchèrent d’entendre un profond et douloureux soupir qui partait du cabinet à droite. Alliaga avait réuni toutes ses forces pour commander à son trouble et à son émotion. De ses deux mains, il comprimait les battements de son cœur, et avançait sa tête vers la porte pour ne rien perdre de ce qui se disait.
— Oui, vraiment, continuait la comtesse, la reine a attaché Aïxa à sa personne. Depuis ce moment qu’est-il arrivé ? Le roi, qui, presque jamais, n’apparaissait chez la reine, y vient maintenant tous les soirs. De son côté, Marguerite a déjoué les projets de son mari en les devançant ; elle a fait de la jeune fille sa favorite, sa compagne, son amie ; elle lui témoigne tant d’affection que celle-ci désormais ne peut plus la trahir ; cela paraîtrait ingrat et odieux… même à la cour. Le roi, sans se douter des obstacles que cette facilité apparente apporte à ses desseins, en paraît ravi, enchanté, et semble le plus heureux des hommes ; il voit tous les jours Aïxa, il cause avec elle, et quoiqu’il soit facile de voir à quel point il en est épris, il n’exige rien de plus. J’ignore combien de temps cela durera ; mais en attendant, Aïxa, aimée de la reine, adorée du roi, jouit dans ce moment d’un crédit immense, d’un pouvoir dont elle ne se doute pas, et dont elle ne pense pas encore à se servir. Cependant, si elle le voulait, et elle le voudra, tout fléchirait devant elle. Le duc de Lerma lui-même serait brisé comme un roseau. Ce n’est donc plus lui qui est à craindre, c’est elle. Lui renversé, le ministre qui arrivera au pouvoir, le confesseur qui obtiendra la confiance du roi, sera celui qu’elle protégera et qu’elle désignera.
— Eh ! mais alors, dit le père Jérôme avec un peu d’embarras, rien n’est désespéré. Cette jeune fille, après tout, paraît jusqu’ici fort estimable…
— On pourrait, continua Escobar, savoir qui dirige sa conscience, et peut-être arriver par là…
— Oui, vraiment, répliqua la comtesse, qui avait déjà deviné les desseins des bons pères, prêts tous deux à l’abandonner pour se tourner vers la nouvelle favorite ; oui, vraiment, rien n’est plus facile.
— Eh bien ! reprit Escobar, s’il est facile de la gagner, s’il y a moyen de réussir…
— Pour tout le monde, reprit froidement la comtesse, excepté pour moi et pour vous !
— Comment cela ! s’écrièrent les deux jésuites.
— Moi… parce que je suis son ennemie mortelle et déclarée, parce qu’il s’est passé entre nous des choses qu’on n’oublie pas.
— Vous, comtesse, c’est possible ; mais nous… dit Escobar.
— Vous, mon père, c’est différent ; vous et le révérend père Jérôme l’avez offensée dans ce qu’elle a de plus cher.
— Allons donc !
— Et vous n’avez d’elle ni merci ni clémence à attendre.
— Expliquez-vous, de grâce, dit Escobar en attachant sur elle un regard qui semblait chercher la vérité, non dans ses paroles, mais dans ses yeux et jusqu’au fond de son âme.
— M’y voici, mes pères. Vous connaissez un jeune moine nommé autrefois Piquillo ?
— Oui, dit le supérieur, aujourd’hui frère Luis d’Alliaga, en mémoire de saint Louis, son patron, sous l’invocation duquel il a été baptisé.
— C’est le dernier novice reçu dans ce couvent, dit Escobar.
— Reçu ! reprit la comtesse ; il paraît que vous l’avez un peu forcé d’entrer.
— Que la volonté de Dieu soit faite ! s’écria Escobar ; et n’importe comment, pourvu qu’elle se fasse !
On se doute que depuis quelques instants l’attention de Luis d’Alliaga avait redoublé.
— Eh bien, continua la comtesse, le jeune Fernand d’Albayda, mon neveu, un très-joli cavalier…
— Nous le connaissons, dit le supérieur en commençant à regarder Escobar d’un œil inquiet ; un charmant gentilhomme qui a un peu trop de vivacité, un peu trop de franchise.
— Il ne vous fait pas le même reproche, mon père ; car il est arrivé, il y a quelques jours… furieux… hors de lui, raconter chez moi… dans mon hôtel, à ma nièce Carmen et à son amie Aïxa, que, par une trahison indigne… infâme… au moyen d’une lettre interceptée… ou contrefaite… que sais-je !
— Passons, dit Escobar. Nous connaissons l’anecdote.
— Je m’en doute, reprit la comtesse, Il parait donc que cet Alliaga, entraîné dans le piége, a prononcé des vœux indissolubles, et que depuis ce temps, et de peur du scandale qu’il pourrait faire, vous le retenez prisonnier dans ce couvent.
— Quand ce serait vrai ? dit le père Jérôme.
— Vous en êtes bien le maître, reprit la comtesse ; ce Piquillo était un sot que je n’ai jamais pu souffrir, un censeur hautain et sévère, un amateur d’in-folio, un savant qui lisait du matin au soir sans s’arrêter, et sans avoir même jamais l’idée de mettre un signet, dit-elle en jetant sur Escobar un regard railleur.
— Eh bien ! murmura le père Jérôme avec impatience, quel rapport entre Piquillo et la favorite, et qu’y a-t-il de commun entre eux ?
— Quel rapport ? répondit la comtesse… c’est son frère !
— Son frère ! s’écria le supérieur effrayé… ça n’est pas possible !
— Si vraiment, dit Escobar à demi-voix….. Un Yézid… une Aïxa, il y Avait de tout cela dans la lettre…
— Qu’il a lue ?
— Non !.. qu’il aurait dû lire ! mais je ne croyais pas que cette Aïxa dont on parlait fût celle pour qui Sa Majesté perdait la tête.
— Et ce Piquillo est son frère ! répéta le père Jérôme d’un air consterné.
— Oui, vraiment, ce n’est plus un secret ; le jeune moine Luis d’Alliaga est un Maure, un bâtard, un roman tout entier, mais Aïxa porte à ce frère naturel l’affection la plus vive et la plus tendre… à la nouvelle de ce guet-apens monastique dans lequel il était tombé, je n’ai jamais vu de douleur plus profonde ; elle a d’abord éclaté en menaces et en imprécations contre vous, mes pères ; puis, fondant en larmes, elle s’est jetée à genoux et s’est écriée en étendant les bras : Mon frère !… mon sauveur, toi qui t’es perdu pour nous, je te vengerai… je te le jure !
Ici la comtesse s’arrêta en regardant les moines interdits et confondus.
— Maintenant, mes pères, continua-t-elle, croyez-vous encore pouvoir la gagner ?
— Peut-être, dit Escobar.
— Et comment ?
— Par Luis d’Alliaga ; on peut combiner telle ruse… (Dieu nous l’inspirera sans doute) qui le touche et qui le désarme !
— Ne l’espérez pas, dit le père Jérôme… je l’ai vu… je l’ai entendu ; il nous à juré une haine mortelle, à vous, Escobar, et à moi…
— Juste comme sa sœur ! dit la comtesse.
— Cela n’empêche pas, reprit Escobar en rêvant, et je trouverai bien moyen de le décider à prendre la défense et les intérêts de la Compagnie de Jésus, quand on devrait l’élever aux premières dignités de notre ordre, et lui montrer en perspective sa sœur Aïxa reine un jour d’Espagne. Mais pour cela il faudrait qu’il fût des nôtres…
— N’est-il pas engagé dans votre ordre, dit la comtesse étonnée, n’est-il pas jésuite comme vous ?
— Eh non, dit Escobar avec colère, pas encore ! d’après la dernière bulle du pape Paul V, trois mois de noviciat suffisent pour être prêtre, et les vœux de Piquillo sont valides et inattaquables. Mais on peut être prêtre sans être jésuite, et jésuite sans être prêtre ; cela n’a aucun rapport. Or, les règlements de la Compagnie de Jésus exigent rigoureusement deux ans de noviciat, donc ce d’Alliaga n’est pas encore des nôtres.
— Et n’en sera jamais, dit le supérieur. D’après ce que je sais de lui, il n’y consentira pas !… et la rigueur seule… le cachot peut-être… et les fers.
— La rigueur ! dit la comtesse en souriant.
— Oui… c’est le seul moyen !
— Et sa sœur ! reprit la comtesse ; sa sœur qui, si vous le faites disparaitre, vous demandera compte de ses jours et de sa liberté ! sa sœur, qui réclamera du roi vengeance contre vous…..
— C’est vrai, dit Jérôme.
— Et le roi ne lui refuserait rien, je vous le jure ! rien ! pas même une injustice… à plus forte raison…
— C’est vrai, dit Escobar.
— Et elle sera secondée dans sa haine par le duc de Lerma, qui tient à conserver sa position, par Sandoval et Ribeira, qui tiennent à vous faire perdre la vôtre. Ce sera une ennemie constante, implacable, qui travaillera à chaque instant du jour… Dieu est bien haut, les Français sont encore loin, la favorite est bien près, et avant que le ciel ou la France vous soit en aide, la belle Aïxa aura fait fermer votre couvent et exiler de l’Espagne la Compagnie de Jésus… Que vous en semble, mes pères, et qu’en dites-vous ?
Les deux révérends pères se regardaient et semblaient se consulter du regard.
— La comtesse a raison, murmura le père Jérôme après un instant de silence.
— Parfaitement raison, répondit Escobar.
— Il n’y a pas moyen, je le reconnais, de désarmer une ennemie pareille.
— Ni de la gagner.
— Oui, dit le supérieur avec fierté ; ce serait s’avilir.
— Et pour rien ! ajouta Escobar… C’est là que serait l’humiliation ! Il faut donc chercher un autre moyen.
— Je n’en connais qu’un seul, s’écria la comtesse, c’est de la renverser.
— De la perdre ! dit le père Jérôme.
— Et je suis prête à vous servir, continua la comtesse avec rage, à vous seconder de toutes les manières.
— De toutes ? dit froidement le supérieur.
— Oui, mes pères.
— Et quand viendra le moment, madame la comtesse, vous ne tremblerez point ? vous n’hésiterez point ?

— Hésiter à perdre une rivale… une ennemie !… vous ne me connaissez pas ! Parlez, parlez, mes pères !…
Et le cœur de la comtesse battait d’émotion et de colère, et ses yeux semblaient lancer des éclairs.
— Ah ! elle est belle ainsi ! s’écria le père Jérôme.
— Très-belle, dit froidement Escobar ; mais vous disiez, mon révérend ?
— Je disais…
Et le supérieur, regardant toujours la comtesse, parlait lentement, s’arrêtait presque à chaque mot, et semblait vouloir moins fixer l’attention qu’irriter l’impatience de celle qui l’écoutait.
— Je disais… que, pour se défaire d’un ennemi… redoutable… et qu’on ne peut vaincre… il y a peu de moyens… À vrai dire… il n’y en a même qu’un seul.
— Lequel ? demanda la comtesse.
— Les saintes Écritures nous en offrent de nombreux exemples, répondit Escobar.
— Nous y voyons, continua le supérieur, des femmes pieusement intrépides, et que l’on traite d’héroïnes, tout braver pour perdre l’ennemi commun.
— Quelles sont ces femmes, ces héroïnes ? demanda la comtesse.
— Eh mais, dit le père Jérôme en ayant l’air de chercher dans sa mémoire, sans aller plus loin… Judith !
La comtesse se tut et regarda tour à tour les deux moines comme pour sonder toute l’étendue de leur pensée. Les deux pères baissèrent les yeux, et pendant quelques instants un silence profond régna dans la salle.
Ce silence, la comtesse le rompit en répétant d’une voix brève et incisive.
— Judith ? mes pères !
— L’exemple est mal choisi, s’écria le supérieur, car des armées ne sont point en bataille, et il ne s’agit point de tirer le glaive… j’ai voulu dire seulement…
— Je comprends… je comprends, dit la comtesse. Et vous pensez, mes pères, continua-t-elle en parlant

lentement, vous pensez donc que cela est permis ?…
— Distinguons ! s’écria vivement Escobar. Se défaire d’un ennemi… méchamment, par haine, et seulement pour lui nuire, le ciel le défend. Mais quand c’est pour repousser ses attaques, quand c’est pour se préserver soi-même, quand c’est dans le cas de légitime défense, le ciel le permet et l’autorise. J’ai fait un livre sur cette matière, mon livre des Cas de conscience, je le donnerai à lire à madame la comtesse.
— Je vous remercie, dit celle-ci. Le père Jérôme partage-t-il vos doctrines à ce sujet ?
Le révérend s’inclina en signe d’approbation.
— Ainsi, mon père, ce que vous conseillez… vous le feriez… vous en partageriez toutes les chances ? dit-elle lentement.
Le révérend fit de nouveau un geste affirmatif.
— Et moi, je ferais plus encore, dit Escobar.
— Quoi donc ?
— Je vous donnerais à tous les deux, et sans crainte, l’absolution !
— C’est quelque chose, dit la comtesse.
— C’est le principal ! s’écria Escobar, car je vous dégage ainsi de toute responsabilité je l’assume tout entière sur moi, et m’en charge à tout jamais dans le ciel.
— Si ce n’était que le ciel, dit la comtesse, je serais tranquille. Dès qu’il sera désarmé par vous, je n’aurais plus à craindre son courroux ni sa justice… mais il en est une autre… moins redoutable, il est vrai, mais qui cependant existe.
Le père Jérôme la regarda en souriant, et jeta un coup d’œil à Escobar, qui, en ce moment, haussait les épaules d’un air de dédain et de pitié.
— Croyez-vous donc, madame la comtesse, s’écria le révérend, croyez-vous donc qu’on aille niaisement s’exposer aux dangers que vous avez la bonté de redouter ?
— Comme les hommes sont presque tous sujets à l’erreur, dit Escobar, comme ils ne peuvent, la plupart du temps, apprécier les intentions ni comprendre les motifs, cela fait qu’ils s’égarent et se trompent souvent dans leurs jugements ; aussi, il ne faut pas s’y fier.
— Ni s’y soumettre, dit le révérend.
— Ni même s’y exposer, ajouta Escobar, et c’est facile.
— Comment cela ? demanda vivement la comtesse.
— Dieu seul, dit Escobar, peut lire dans le fond des cœurs. Les hommes ne vont point si avant… ils ne voient que l’apparence.
— Et en n’en laissant aucune, continua le supérieur, en ne laissant aucune trace, leur pouvoir ou leur malice est forcé de s’arrêter, et ne peut aller plus loin.
— Et le moyen, dit la comtesse, de parvenir à ce que vous me dites là, et d’effacer aux regards terrestres jusqu’à la moindre trace de ces projets que le ciel approuve et que les hommes pourraient blâmer ?
— Le moyen !.. dit le révérend en souriant ; je croyais que vous, comtesse, qui êtes une femme supérieure, vous en aviez au moins quelque idée…
— Aucune, mon père.
— Ah ! c’est que nos travaux assidus ont fait luire pour nous des lumières qui ne brillent pas à tous les yeux.
— Oui, dit Escobar, nos études scientifiques nous ont donné des connaissances qui ne sont jusqu’à présent que le partage du petit nombre. Nous avons entre autres une science qu’on eût autrefois appelée la magie ou la sorcellerie, et que maintenant l’inquisition ne serait pas éloignée de traiter comme telle !.. Nous autres savants nous l’appelons tout uniment la chimie… Nous lui devons des résultats étonnants et des secrets merveilleux !
— Vous allez en juger, dit le supérieur. Frère Escobar, prenez dans mon nécessaire ce petit flacon rose… vous savez… celui en cristal de roche, qui se referme avec un couvercle en or surmonté d’une émeraude.
— Oui, mon révérend, répondit Escobar en se dirigeant vers le cabinet où était Piquillo.
Celui-ci tressaillit, et sentit une sueur froide inonder son visage.
— Non, non, s’écria le révérend en se retournant. Où va-t-il ? où va-t-il ? pas dans celui-ci… dans l’autre !
— C’est juste, dit Escobar ; je ne sais plus où j’ai la tête.
Et il entra dans le cabinet, où il resta quelques instants.
— C’est la vérité, dit le supérieur, le frère Escobar a ce soir des distractions, des préoccupations, que du reste j’explique aisément.
— Comment cela, mon père ?
— Eh mais… par le tête-à-tête où je l’ai trouvé ici avec madame la comtesse… Je ne l’y exposerai plus… dans l’intérêt de son âme… Le voici, ce bon frère.
Escobar rentrait en ce moment avec un petit flacon de cristal de roche d’une forme charmante, et qui contenait une liqueur d’une teinte rose.
— Tenez, dit le supérieur, en le lui prenant des mains, tenez madame la comtesse, regardez bien et écoutez : On jetterait quelques gouttes de cette liqueur dans un verre d’eau, dans une boisson quelconque, que l’on ne s’en apercevrait point au goût, car elle n’en a aucun.
Bien plus elle ne produirait d’abord aucun effet… Des semaines, un mois entier s’écoulerait sans apporter aucun changement ; mais peu à peu, jour par jour, heure par heure, une sourde et lente décomposition se ferait sentir dans tous les organes. Sans souffrance, sans secousse, au bout de trois ou quatre mois, peut-être moins, suivant la dose, on arriverait par une maladie de consomption et de langueur, au terme de ses jours, sans que l’œil même le plus exercé en pût soupçonner la cause.
— En vérité, dit la comtesse en saisissant le flacon, qu’elle regardait avec curiosité, cela produit de pareils effets… vous en êtes sûr ?
— À n’en pouvoir douter… trop d’exemples l’attestent.
— Et lesquels ? s’écria la comtesse.
— Philippe II connaissait le secret que je viens de découvrir, dit le supérieur à demi-voix. C’est ce qui fait que don Juan d’Autriche, le vainqueur de Lépante et des Pays-Bas, don Juan dont l’ardente ambition et surtout les exploits, importunaient et inquiétaient son royal frère, don Juan d’Autriche est mort à trente ans, au milieu de ses projets et de sa gloire… d’une maladie de langueur dont vous tenez la cause dans vos mains. Madame la comtesse ; comprenez-vous maintenant ?
— Très-bien ! mon père ; me voilà rassurée d’un côté. Mais vous me répondez que de l’autre… que du côté du ciel…
— Cela nous regarde, ma sœur.
— Je vous garantis le ciel, dit Escobar, et ne craignez rien. Dieu qui vous guide et vous inspire saura bien se manifester à vous.
— Comment cela ?
— Oui sans doute, s’écria le révérend ; si Dieu condamne notre dessein et ne veut pas qu’il s’exécute, il aura soin que l’occasion ne s’en présente pas. Mais si telle est sa volonté, soyez sûre qu’elle viendra d’elle-même et par son ordre s’offrir à vos yeux.
En ce moment l’horloge du couvent sonna minuit.
Frère_Escobar tenait à la main un biscuit qu’il allait porter à sa bouche. Minuit venait de sonner. Une nouvelle journée commençait ; il fallait qu’il fût à jeun pour dire la messe et chanter matines dans deux heures.
— Comme le temps passe ! dit le supérieur.
— Quand on parle de Dieu, reprit Escobar, et qu’on s’occupe de lui.
— Je pars, dit la comtesse ; je retourne à Madrid, et personne n’aura pu se douter de ma visite au couvent.
— Je vais vous reconduire, dit Escobar, et de là me coucher.
— Moi de même, dit le supérieur… car il y a peu de temps d’ici à matines. Aidez-moi auparavant à éteindre toutes ces bougies, car en ce moment frey Paolo doit dormir et viendra demain soir, à la nuit, desservir et serrer tout cela.
En un instant toutes les bougies furent éteintes. L’appartement rentra dans l’obscurité. Piquillo entendit le tableau de saint Jérôme glisser dans le panneau, et l’ouverture qui conduisait à la cellule du supérieur fut hermétiquement fermée. Seulement alors le jeune moine se hasarda à sortir de sa cachette, en craignant de heurter dans l’ombre quelque meuble ou quelques débris du festin, car frère Jérôme venait de rentrer dans sa cellule, probablement pour s’y coucher, et, soit réalité, soit imagination, Alliaga crut au bout d’un quart d’heure l’entendre ronfler.
— Il dort ! se dit-il… il peut dormir après les projets qu’il vient de former !.. et moi, je tremble encore seulement de les avoir entendus !
Toutes ses craintes alors se renouvelèrent plus vives que jamais ; les jours d’Aïxa étaient menacés par des ennemis implacables, sans conscience et sans remords ! Et non-seulement il était prisonnier de ces mêmes ennemis, mais, à supposer qu’il pût s’échapper de leurs mains, sa liberté désormais engagée ne lui permettrait plus d’être, comme autrefois, à toute heure auprès de sa sœur, pour la défendre et veiller sur elle.
Avant tout, comment sortir de cette chambre où lui-même était venu s’enfermer ? Il en avait d’abord remercié le ciel, qui lui avait donné ainsi le moyen de connaître les projets de ses persécuteurs ; mais maintenant il s’agissait de les déjouer et de prévenir leurs tentatives, et comment y réussir, s’il devait, ainsi que le révérend père Jérôme l’en avait menacé, être jeté dans un cachot ?
— Non, non, s’écria-t-il, il faut reconquérir ma liberté, il faut être libre… Je le serai… je le veux… Je ne suis pas obligé de rester dans leur ordre… je le sais maintenant… je l’ai entendu de leur bouche… et pour me venger d’eux, pour les combattre, pour leur rendre le mal qu’ils m’ont fait, pour défendre Aïxa, j’irai plutôt me jeter dans un autre couvent…
Oui, mais, ajoutait-il en regardant autour de lui et en sentant la réflexion succéder à la colère, il faudrait d’abord sortir de celui-ci.
Il se rappela que les matines devaient sonner, que le supérieur devait s’y rendre, et que pendant ce temps il pourrait sortir de l’appartement où il se trouvait et de la cellule du père Jérôme. Il fallait encore attendre. Il se résigna. Tout à coup un grand bruit se fit entendre dans la pièce à côté. On ouvrait brusquement la porte.
— Qu’est-ce ? qui vient là ? cria le supérieur d’une voix haute.
— Moi, encore moi, mon révérend.
— Et qui vous amène, Escobar, quand il y a à peine une heure que je dors ?
— Un incident extraordinaire et terrible !
Alliaga colla son oreille contre le tableau de saint Jérôme.
— En revenant de conduire la comtesse, qui est partie, bien partie, et qui roule sur la route de Madrid, j’ai voulu, avant de me coucher, voir comment allait notre jeune frère, notre malade. J’ai entr’ouvert doucement la porte qui conduit dans la cellule de frère Luis d’Alliaga.
— Eh bien ?
— Eh bien… il n’y était plus ! mon révérend. Enfui ! disparu !
— Miséricorde ! s’écria le supérieur en se levant sur son séant. Seraient-ce déjà la vengeance de sa sœur et les persécutions qui commencent ? Aurait-on, par ordre du roi, osé violer les droits de notre couvent et pénétré par force dans nos murs ?
— C’était ma peur ! je craignais que ce scandale-là ne fût arrivé pendant que nous étions à souper. Rassurez-vous, de ce côté du moins. Je viens de réveiller le frère portier : personne n’est entré ; mais il parait qu’on est sorti, et il n’y a rien de bouleversé dans le couvent, il n’y a qu’un frère de moins.
— C’est important ! celui-là surtout ! Mais il ne peut être dehors ; nos murailles sont trop hautes, nos portes et nos grilles ferment trop bien. Il ne peut être que caché pendant la nuit dans quelque coin du cloître.
— Pourvu qu’il ne m’ait pas vu reconduire la comtesse !
— Il ne manquerait plus que cela… une femme dans notre couvent… s’il le savait !
— La favorite le saurait bien vite. C’est pour le coup qu’il faudrait, et pour sa vie, le tenir dans un cachot.
— Certainement ! mais pour cela il faut d’abord découvrir le coupable et nous en emparer.
— C’est bien. Nous ordonnerons au point du jour une recherche générale.
En ce moment, on entendit sonner la cloche qui annonçait les matines. Les deux religieux sortirent.
Les angoisses d’Alliaga étaient devenues plus grandes encore. Devait-il maintenant essayer de quitter sa retraite ? S’il en sortait, s’il était rencontré, les frères s’empareraient de lui, et leur intention, qu’il connaissait, était de le jeter dans un cachot. D’un autre côté, en restant où il était, il ne pouvait manquer d’être découvert un peu plus tard. Auquel des deux dangers donner la préférence ? Il vit bientôt qu’il n’avait même plus l’embarras du choix ; il s’était approché du tableau de saint Jérôme et avait essayé de l’ouvrir. Le panneau était fermé de l’autre côté par un verrou. Impossible de s’éloigner ; il fallait donc demeurer dans sa prison actuelle, qui, après tout, valait mieux, et il se mit de nouveau à réfléchir.
D’après ce qu’avait dit le prieur, il était probable qu’il n’avait rien à craindre de la journée. Frey Paolo viendrait seulement à la nuit enlever les débris du festin ; d’ici là tous les frères parcourraient le couvent du haut en bas, et tout serait soigneusement visité, excepté la cachette où il se trouvait ; c’était donc encore pour lui l’asile le plus sûr.
Il était exténué de faim et de sommeil, et dans l’état d’accablement où il se trouvait, il ne pouvait prendre. aucun parti ; une occasion de fuir lui aurait été offerte, qu’il n’aurait pu en profiter : il se soutenait à peine. Il commença par manger un peu, puis s’étendit sur l’excellent canapé du père Jérôme, et malgré les dangers qui le menaçaient, lui et ce qu’il avait de plus cher, malgré les inquiétudes et les tourments auxquels il était en proie, la fatigue l’emporta, il s’endormit profondément ; un long sommeil lui fit oublier ses maux et répara ses forces.
Quand il se réveilla, il se sentit tout autre que quelques heures auparavant. La fièvre l’avait quitté, et toutes ses facultés lui étaient revenues. Il ignorait, par malheur, combien de temps il avait dormi et ne savait pas à quelle heure de la journée il se trouvait. Le salon qu’il occupait était toujours dans l’obscurité. Il y avait bien une fenêtre dont les volets et les persiennes étaient fermés. Il n’osait les ouvrir, d’abord parce qu’on pouvait l’entendre, et puis parce qu’il ignorait sur quel endroit du couvent donnait cette croisée. Le peu de rayons qui se glissaient à travers les fentes des persiennes semblaient si pâles et si faibles, qu’il fallait ou que le jour vint à peine de paraître ou qu’il fût déjà sur son déclin. Or, Piquillo sentait au bien-être qu’il éprouvait, à ses forces et à son appétit revenus qu’il avait dû dormir depuis bien longtemps : donc il devait se trouver au soir du second jour, donc la nuit allait bientôt arriver et avec elle frey Paolo.
Il se mit à examiner attentivement ce petit salon, obscur pour tout autre et non pour lui, dont les yeux étaient déjà façonnés et habitués à cette obscurité. Il en distingua parfaitement l’ameublement et toutes les parties. Des couteaux brillaient sur la table, il en saisit un vivement. C’était une arme ; mais pouvait-il s’en servir contre ceux qui viendraient l’arrêter, pauvres moines obéissant passivement aux ordres de leur supérieur ? Meurtre inutile d’ailleurs, puisqu’il serait toujours accablé par le nombre.
Un instant il eut la pensée de tourner cette arme contre lui-même : c’était échapper à une prison éternelle peut-être et à bien d’autres douleurs encore. Mais qui donc sauverait Aïxa ? qui veillerait sur elle ? qui détournerait de ses lèvres le poison qui lui était destiné ? Déjà même il était bien tard, peut-être ! Non, il ne lui était pas permis d’attenter à des jours qui ne lui appartenaient plus et qu’il avait voués à tous les siens. Une idée alors lui vint, idée hardie, périlleuse, et dont la réussite était presque impossible ; mais il n’avait pas la liberté de choisir.
Que risquait-il, d’ailleurs, et quelle crainte pouvait l’arrêter ? Rien ne donne plus d’audace et de sang-froid qu’un péril certain et inévitable. Il avait aperçu la veille, dans le cabinet où il s’était réfugié, les robes, les ornements et les insignes remarquables que portait d’ordinaire le père Jérôme, abbé du couvent. Alliaga, nous l’avons dit, était à peu près de la taille du supérieur, et la robe et le froc vont à tout le monde. Il revêtit les habits du jésuite, passa autour de son cou le large ruban bleu des abbés d’Alcala de Hénarès, au bout duquel pendait une croix en bois de cèdre, en mémoire du morceau de la vraie croix dont la chapelle avait été dotée par Ferdinand le Catholique, et qui brille parmi les nombreuses reliques dont jouit le monastère. Il attacha au cordon de sa robe un chapelet bénit par le pape, et que souvent le supérieur laissait pendre à sa ceinture ; il prit à la main un missel que le bon père ne lisait jamais, mais qu’il portait presque toujours ; il croisa sa robe, abaissa son froc et attendit. Le faible rayon de jour qui éclairait à peine la chambre avait totalement disparu, il était nuit, et l’Angelus, qu’Alliaga entendit sonner, l’avertit que frey Paolo ne tarderait pas à venir.
En effet, on ouvrit la porte de la cellule. Piquillo s’élança à côté du panneau mobile, et, respirant à peine, il resta debout, appuyé contre la boiserie ; on eût dit d’une figure de moine appliquée sur la muraille dans le cadre d’un tableau ou d’une tapisserie. Le panneau glissa sans bruit, et frey Paolo parut, portant d’une main un grand panier vide, et de l’autre une lanterne, laquelle lui permettait de distinguer les objets qui étaient en face de lui, et l’empêchait d’apercevoir ceux qui étaient à sa droite et à sa gauche.
À peine avait-il fait quelques pas dans la chambre que Piquillo se glissa doucement derrière lui, et une fois dans la cellule, poussa le panneau et tira le verrou. Peu lui importait alors que le moine l’entendit ; mais celui-ci, au milieu du bruit des assiettes et des couverts qu’il desservait et mettait dans son panier, ne tourna seulement pas la tête, et lorsque, quelques minutes après, il voulut sortir, il crut, en se voyant prisonnier, que le supérieur lui-même venait de refermer le tableau, et il n’osa ni crier ni appeler, de peur de compromettre le père Jérôme, qu’il supposait n’être pas seul.
Piquillo cependant n’avait fait que traverser la cellule ; une fois dans le corridor, il n’hésita point sur le parti à prendre. Il n’y en avait qu’un qui pût le sauver. Il descendit rapidement l’escalier et traversa la cour espérant que l’Angelus ne serait pas encore chanté, et que les frères seraient encore à la chapelle.
Ils en sortaient dans ce moment. N’importe, il n’y avait pas à reculer. Alliaga se dirigea hardiment vers la cellule du frère portier. Deux ou trois frères qui se trouvaient près de là se rangèrent avec respect pour le laisser passer et le saluèrent profondément.
Alliaga leur rendit leur salut, et non sans que le cœur lui battit avec violence, il s’élança dans la cellule où demeurait le gardien du couvent. Celui-ci, à la lueur de sa lampe, qu’il venait d’allumer, était occupé à coller sur un livre de prières des images découpées de saints et de saintes, travail qui absorbait toute son attention.
À la vue du supérieur, il se leva brusquement et murmurant entre ses dents :
— C’est singulier ! je ne l’avais pas vu rentr…
Un geste impérieux ne lui permit pas d’achever cette phrase. Sans le regarder, sans lui adresser la parole, Alliaga lui avait fait un signe du bras dans la direction de la porte, et comme par un mouvement mécanique, comme par un seul ressort, on avait vu en même temps la tête du frère portier s’incliner, et son bras droit tirer le cordon.
Ah ! quand Alliaga vit s’ouvrir cette porte, et tomber la dernière barrière qui le retenait captif, quand il sentit l’air du dehors, l’air de la liberté qui venait déjà dilater sa poitrine et rafraichir ses poumons, il éprouva dans tout son être, une de ces sensations qu’on ne peut rendre, un frisson de bonheur indicible ; et, avide de saisir la liberté qui lui était offerte, tremblant encore qu’elle ne lui fût ravie, il se hâta de poser le pied sur le seuil. Il en avait encore un dans le couvent dont il allait sortir, quand se présenta pour entrer un homme vêtu d’une robe de moine et portant en sautoir le ruban bleu des abbés d’Alcala. Que devint Piquillo ! C’était le père Jérôme !
À la vue d’un second abbé qui lui était si pareil de taille et d’habit, à l’aspect d’un autre lui-même, le père Jérôme était resté stupéfait et la bouche béante. De surprise, il fit un pas en arrière. Piquillo en avait fait un en avant. Il avait compris du premier coup d’œil le danger de sa position. La porte du couvent n’était pas encore refermée ; le véritable abbé pouvait appeler ; ou allait accourir à sa voix, et il lui était facile de se faire connaitre, de réclamer son nom, son titre et ses droits, sans compter sa robe et ses insignes ; déjà il s’était écrié :
— Qui êtes-vous ?
— Silence ! lui avait dit Piquillo en rabattant son capuchon sur ses yeux.
— D’où venez-vous ?
— De la part de la comtesse d’Altamira, avait-il murmuré tout bas à l’oreille du supérieur, ce qui lui permettait d’abord de déguiser sa voix, et ensuite d’arrêter celle du supérieur, qui, surpris et effrayé de cette communication mystérieuse, lui répondit sur le même diapason :
— Parlez.
Et il voulait le faire rentrer dans le couvent.
— Pas ici ! s’écria le faux abbé avec une terreur qui n’était pas feinte, et qui redoubla celle du père Jerôme.
À l’instant et sans lui donner le temps de lui répondre, Alliaga passa son bras sous celui du révérend, et l’entraîna vivement et à grands pas loin des murs du couvent.
XLIV.
la boutique du barbier.
Le supérieur le suivit pendant quelque temps, aussi ému qu’essoufflé et sans prononcer un seul mot, persuadé que le message qu’on lui apportait était d’une importance telle que les murs du couvent ne devaient pas l’entendre ; mais quand il s’en vit à une cinquantaine de pas, par la nuit qui déjà était sombre, et prêt à entrer dans une rue de la ville :
— Parlez, dit-il, maintenant.
Piquillo lui fit signe de la main qu’il y avait encore trop de danger, et ils se remirent en marche. Quelques minutes après, le supérieur s’écria :
— Mais parlez donc !.. pourquoi venir à cette heure ?.. pourquoi sortir du couvent vêtu de ce costume et de ces insignes qui sont les miens ?
Piquillo renouvela le même geste qui voulait dire :
— Pas encore !… Attendez.
Enfin, et au bout de quelques minutes de marche, le supérieur s’arrêta. Les deux moines, ou plutôt les deux pèlerins étaient alors dans un carrefour où aboutissaient plusieurs rues ; la ville d’Alcala, à cette époque, n’était point éclairée de nuit, et le supérieur s’écria :
— Ici, monsieur, personne ne peut nous voir ni même nous entendre. Apprenez-moi enfin le message dont la comtesse vous a chargé pour moi.
Alliaga se trouvait alors assez loin du couvent pour qu’il fût impossible au supérieur d’appeler ses frères. Alliaga saisit avec force la main du moine, et s’approchant de son oreille :
— La comtesse m’a dit de vous dire, mon père, que vous étiez un infâme !
Et laissant le supérieur stupéfait, atterré, foudroyé, Alliaga s’élança dans la première rue qui s’offrit à lui, se doutant bien, ou que l’abbé n’oserait le poursuivre, ou que ses jambes de soixante ans ne pourraient lutter avec celles du jeune homme.
Alliaga courut ainsi jusqu’à l’extrémité de la rue, en prit une autre à sa droite, et alors seulement il ralentit sa marche pour ne point donner de soupçons. Il écouta. Aucun cri, aucun pas ne se faisait entendre, il n’était point poursuivi. Il réfléchit alors sur ce qu’il avait à faire : courir à Madrid au plus vite pour avertir et protéger Aïxa. Mais il ne pouvait faire, cette nuit, à pied, les cinq lieues qui le séparaient de Madrid ; il sortait de maladie, et les émotions qu’il venait d’éprouver avaient épuisé cette force factice que lui avait donnée le danger. Il le sentait bien ; et s’il allait en route se trouver mal, rester sur le grand chemin, et au point du jour être reconnu… être repris ! Mais à qui demander protection et secours ? à qui s’adresser ? Il pensa au barbier Gongarello ; il s’agissait de retrouver sa boutique, qui, ainsi que la ville d’Alcala, lui était totalement inconnue. Les rues étaient presque désertes, et il fut quelque temps sans rencontrer personne ; enfin, au détour d’une rue, il se trouva nez à nez avec un homme d’assez bonne mine vêtu d’un manteau noir.
— Pourriez-vous, seigneur cavalier, m’enseigner la boutique du barbier Gongarello ?
— Rien de plus facile, mon frère, la seconde rue à gauche, la dernière boutique à votre main droite.
Alliaga remercia et s’éloigna, enchanté d’avoir si peu de chemin à faire ; car il sentait les forces lui manquer.
Il compta la première rue, puis la seconde à sa gauche, et en entrant dans celle-ci, il lui sembla qu’il était suivi. Il se retourna vivement et ne vit personne. Il s’était trompé sans doute ; il arriva, ou plutôt il se traîna jusqu’à la boutique du barbier. Elle était fermée. Il frappa. On ne répondit point. Il frappa fort ; une petite fenêtre s’ouvrit.
— Qui va là ?
— Un ami.
Gongarello hésitait, car il venait de voir une robe de moine.
— J’ai beaucoup d’amis, répondit-il, autant que de pratiques ; mais je ne rase pas à cette heure-ci, par mesure de prudence : on risque de couper ses clients.
Et il se retirait de la croisée.
— Gongarello ! s’écria de nouveau le pauvre jeune homme.
— Eh ! que voulez-vous ? répéta avec impatience le prudent barbier.
— Asile.
— À vous ?
— À moi ! ne me reconnais-tu pas… moi, Piquillo !
À ce nom, le barbier referma vivement sa fenêtre, mais ce fut pour ouvrir sa porte.
— Entrez, entrez !
Et au moment où enfin Alliaga mettait le pied dans la boutique du barbier, il crut entendre distinctement marcher dans la rue près de la porte ; mais peu lui importait alors, il était en sûreté.
Gongarello lui avait sauté au cou. Il l’accablait de caresses et de questions.
— Vous voilà donc ! c’est donc vous, mon sauveur, mon libérateur, que je peux sauver à mon tour ! que s’est-il donc passé ?
Alliaga le lui raconta.
— Vous ! moine ! moine à tout jamais ! s’écria Gongarello avec désespoir ; vous si bon, si généreux, si honnête !… ah ! vous ne méritiez pas cela ! Et c’est moi qui en suis cause… c’est ma maladresse ; cet Escobar m’aura vu au moment où je glissais la lettre sous le sablier… il l’aura prise ! il l’aura changée, et c’est par ma faute !… et c’est moi qui aurai contribué à faire un moine !.. Notre Dieu ne me le pardonnera pas !
— Allons… allons, dit Alliaga en essuyant lui-même une larme, console-toi, je suis hors de leurs mains, grâce à Dieu et grâce à toi ! Maintenant il faudrait, et le plus tôt possible, me rendre à Madrid.
— Nous partirons au point du jour. J’ai une carriole et une mule que j’ai appelée Juanita, pour me consoler de l’absence de ma nièce, qui autrefois me tenait compagnie et qui surtout me tenait tête… la pauvre enfant ! et dès que vous aurez dormi quelques heures…
— Oui, si tu veux me donner un lit…
— Le mien ! le mien ! s’écria le digne barbier ; mais auparavant vous souperez, je vous tiendrai compagnie.
— Mais ton souper, peut-être, était fini ?
— Je recommencerai !… dès qu’il s’agit d’un ami ! Vous avez fait bien autre chose pour moi.
Gongarello se mit sur-le-champ à l’ouvrage ; le couvert fut dressé, le repas fut servi, et le barbier paraissait si heureux de l’hospitalité qu’il exerçait, que Piquillo en était ému.
— À votre santé ! à votre bonheur ! à votre heureux voyage ! s’écria Gongarello en lui versant de son meilleur vin, une bouteille de valdepenas.
— Tu veux donc bien encore trinquer avec moi, lui dit Piquillo, moi qui vous ai abandonnés, moi qui suis un moine !
— Moine par l’habit, mais non par le cœur ! Vous êtes toujours un Maure, un de nos frères…
— Tu l’as dit ! s’écria Piquillo.
— Et vous l’avez prouvé ! C’est pour sauver d’Albérique et les siens que vous vous êtes immolé ! Nos frères le sauront tous, je m’en charge ! Dès qu’il ne faut que parler, vous pouvez compter sur moi.
Le barbier prouvait en même temps qu’il savait agir pour ses amis ; car rien ne fut oublié pour soigner son hôte : bon repas et bon lit, et pendant qu’Alliaga dormait, il veillait ; il s’occupait de tous les préparatifs du départ. Avant le jour, la carriole était en état, la mule pansée et attelée, et il alla réveiller son jeune ami.
— En route, en route ! lui dit-il.
— Il n’est pas encore jour.
— Nous voyagerons de nuit… comme dans la sierra de Moncayo, vous rappelez-vous ? cette nuit où j’ai fait tant de chemin en dormant, sans pourtant être somnambule. Allons, allons ! sur pied !
— Me voici, dit Alliaga, qui en un instant fut habillé.
Ils montèrent dans la carriole, dont le barbier prit les rênes.
— Sauras-tu bien me conduire jusqu’à Madrid ?
— Je vous le jure ! s’écria le barbier.
Mais, par malheur, il ne devait pas tenir son serment.
À peine la modeste voiture avait-elle fait un tour de roue, que trois ou quatre hommes à cheval l’arrêtèrent et l’entourèrent.
— Descendez ! dirent-ils au barbier.
— Et pourquoi, seigneurs cavaliers, voulez-vous que nous descendions ?
— Vous seulement… le révérend père voudra bien rester : nous nous chargeons de lui servir d’escorte.
Celui qui parlait ainsi monta dans la carriole à côté de Piquillo, et fit partir la mule au grand trot ; les trois autres cavaliers le suivirent au galop et eurent bientôt disparu.
Le barbier, encore tout étourdi de l’aventure, n’eut pas la force de jeter un cri. Il se dit seulement en lui-même et avec désespoir :
— Ah ! le pauvre jeune homme !.. c’est décidément moi qui lui porte malheur !
— C’est fait de moi !… je suis perdu ! se dit Piquillo ; j’aurais dû penser que le père Jérôme et Escobar, connaissant mes relations avec Gongarello, feraient cerner et surveiller sa maison ; la maison d’un ami était le dernier endroit où j’aurais dû chercher un asile. Et maintenant… surtout après ce qui s’est passé je n’ai plus ni pitié ni miséricorde à attendre… Je sais leur secret… Ils doivent s’en douter… Ce n’est plus un cachot… une prison éternelle qu’ils me destinent… c’est la mort. Soit ! je suis prêt et ne me plaindrais pas si j’avais pu seulement sauver Aïxa.
La voiture cependant roulait toujours, et le frère Luis d’Alliaga commençait à s’étonner de n’être pas encore arrivé, car, après tout, la ville d’Alcala n’était pas si grande, ni le couvent si éloigné. Son compagnon de voyage ne lui disait pas un mot. D’une main il tenait les guides, de l’autre il fouettait toujours. La pauvre mule ne reconnaissait point la touche de son maître, et jamais n’avait couru si vite ni si longtemps. Le jour, qui commençait à paraître, permit d’apercevoir une grande route, des arbres et de vastes plaines tant bien que mal cultivées. On était loin d’Alcala de Hénarès, et bientôt on vit les premières maisons des faubourgs de Madrid. Six heures sonnaient à toutes les paroisses quand la carriole s’arrêta devant un palais de sombre apparence que Piquillo reconnut sans peine. C’était celui de l’inquisition, qu’il avait eu le temps de contempler le jour où, monté sur une borne, il avait vu défiler le cortège dans lequel figuraient, bien malgré eux, Juanita et Gongarello. Frey Alliaga, stupéfait, ne comprenait rien à ce mystère que nos lecteurs s’expliqueront aisément.
L’archevêque de Valence et le grand inquisiteur, en quittant le cabinet du roi, dont ils étaient sortis fort mécontents, n’avaient pas pensé à communiquer à leurs agents l’ordre de Sa Majesté, par lequel la liberté était rendue à Piquillo. Une mauvaise nouvelle arrive toujours assez tôt. D’ailleurs, à quoi bon, puisque Fernand d’Albayda partait lui-même pour le délivrer ? Ribeira et Sandoval avaient à s’occuper de tant d’autres choses plus importantes, l’une à Valence, l’autre à la cour, que l’affaire de Piquillo fut tout à fait oubliée, et que le corrégidor et la police d’Alcala continuèrent à rester sur pied et à observer, aux frais du gouvernement. L’homme au manteau noir à qui Piquillo s’était adressé pour demander la boutique du barbier, était un alguazil, par la raison qu’à cette heure-là tous les bourgeois étaient rentrés chez eux, et que les alguazils seuls rôdaient et faisaient le guet. Celui-ci s’était étonné de voir, la nuit, un révérend père s’informer de la demeure du barbier…
Il l’avait alors suivi de loin, machinalement et par habitude, plutôt que par dessein arrêté. L’alguazil ne raisonne pas, il observe ou écoute, et en se glissant le long de la muraille, celui dont nous parlons avait entendu Piquillo décliner son nom pour obtenir l’hospitalité.
L’alguazil avait prévenu trois de ses compagnons, qui, ravis de gagner la récompense promise par l’archevêque, n’avaient point fait part à d’autres de la découverte, mais avaient surveillé la maison du barbier et fait toutes leurs dispositions pour que, le lendemain de grand matin, leur capture fût remise entre les mains de Manuelo Escovedo, sous-officier de la sainte inquisition, préposé à la réception et à l’écrou des prisonniers.
Acte en bonne forme fut donné aux quatre alguazils du dépôt qu’ils venaient de faire, et Escovedo procéda aussitôt après leur départ à un petit interrogatoire sommaire.
— Vous êtes Piquillo, Piquillo Alliaga ?
— Oui, mon père.
— Et je dois vous incarcérer à la demande de monseigneur l’archevêque de Valence pour refus de baptême.
— J’ai été baptisé.
— Ah ! ah ! dit le greffier étonné, voilà qui est singulier… Alors je dois vous incarcérer pour avoir, vous laïque, porté l’habit religieux, l’habit de moine, sous lequel vous avez été pris.
— Mais j’ai prononcé des vœux, je suis religieux, je suis moine, dit Alliaga.
— Ah ! ah ! c’est encore plus singulier, dit le greffier ; alors je dois vous incarcérer comme vous étant échappé du couvent des jésuites dont vous faites partie.
— Mais je ne suis point jésuite et ne veux point m’engager dans leur ordre.
— Par saint Jacques ! dit le greffier impatienté, il faut pourtant bien que je vous incarcère pour quelque chose… et il écrivit : Incarcéré comme n’étant pas des nôtres.
— Au contraire, s’écria Piquillo, je viens vous demander à en être. Je serai, si vous le voulez, de l’ordre des dominicains.
— Est-il possible !
— Celui-là ou un autre, peu importe, pourvu que je sois libre à l’instant même.
— Je vais inscrire votre demande, dit le greffier, et vous serez dominicain ; mais libre… je ne peux pas vous en répondre. Vous avez été amené ici pour être incarcéré ; bien plus, je viens d’écrire que vous l’étiez : voyez vous-même… Il ne peut y avoir de ratures sur mes registres. Il faut que j’en réfère à l’autorité supérieure.
— Et moi, il faut que je sois libre ! s’écria Piquillo avec désespoir.
— Cela finira par là, mais je dois soumettre l’affaire au conseil suprême du saint-office, qui la soumettra au grand inquisiteur.
— Et combien cela durera-t-il ?
— Un mois au plus, vu que nous avons peu d’affaires courantes. C’étaient les auto-da-fé qui nous en donnaient le plus, et ils sont eu souffrance en ce moment ; il faut espérer que cela reprendra.
— Un mois ! s’écria Alliaga sans écouter la fin de la phrase du greffier, un mois !.. Et pendant ce temps, se disait-il en lui-même, la comtesse… et Aïxa… Il serait trop tard… je ne pourrais plus les sauver !
— Mon frère, dit-il à voix haute, il faut que je sorte à l’instant même ; il y va d’une affaire de la dernière importance… de la vie de quelqu’un !
— L’inquisition ne se mêle pas de cela.
— Eh bien ! reprit Alliaga, frappé d’une idée soudaine, faites dire au grand inquisiteur que je demande à voir le duc de Lerma. J’ai une révélation à lui faire… à lui, à lui-même ! révélation qui intéressa le salut de l’État et le sort du ministre.
— Ah bah ! dit le greffier étonné, racontez-moi | donc cela.
— Je vous ai déclaré que je ne pouvais le confier qu’à lui-même… vous voyez donc bien qu’il faut que je sorte, ou que du moins on me conduise vers lui… dans le palais, et si vous ne le faites pas, c’est vous, seigneur greffier, qui serez responsable de tous les malheurs qui arriveront.
— C’est différent, s’écria Manuelo Escavedo… vous m’annoncez là une chose qui mérite considération. Emmenez le prisonnier, dit-il aux familiers du saint-office… pour la forme seulement et pour la régularité de mes écritures… car dès qu’il aura signé sa demande, ce jeune frère peut se considérer comme de l’ordre de Saint-Dominique. Je vais référer de tout cela à nos bons pères… Adieu, mon frère, dit-il en saluant Alliaga de la main… à bientôt !
Mais toute une semaine se passa avant que le greffier eût parlé aux assesseurs, qui en parlèrent aux juges, lesquels en firent un rapport au conseil suprême, et Piquillo attendait dans les murs du saint-office, et les jours d’Aïxa étaient menacés !
XLV.
la favorite.
Aïxa, à son retour de Tolède, n’avait plus voulu demeurer chez la comtesse d’Altamira. Veuve, maîtresse d’elle-même, et duchesse de Santarem, c’est elle qui à son tour avait offert à Carmen asile et protection dans son hôtel. Carmen devait demeurer avec sa sœur et amie jusqu’à son mariage avec Fernand d’Albayda, qui, ainsi que nous l’avons vu, avait été rappelé de Lisbonne par le duc de Lerma, et ce mariage, c’était Aïxa qui l’avait fixé elle-même à la fin du mois dans lequel on venait d’entrer. Nous avons vu comment, dès le premier jour de son arrivée, Aïxa avait été nommée dame d’honneur de la reine, et comment son acceptation avait eu pour condition la liberté d’Yézid.
Le premier usage qu’en avait fait celui-ci avait été de se rendre à Madrid près de cette sœur dont il avait été si longtemps éloigné, et qu’à présent enfin il lui était permis de voir ; c’était à lui, d’ailleurs, dans ce moment plus que jamais, à veiller sur elle et à la protéger. Aixa, que sa nouvelle dignité appelait à la cour, se rendait presque tous les soirs au cercle de la reine, et jamais Marguerite n’avait vu son royal époux aussi assidu et aussi empressé auprès d’elle. Le plaisir que le roi éprouvait à causer avec Aïxa était si pur, et l’estime qu’elle lui inspirait était si vraie, qu’il ne craignait pas de les avouer hautement. La vertu la plus craintive n’aurait pu s’offenser d’une passion muette et profonde que tout semblait attester, mais que rien ne trahissait. Si Aïxa avait pu se laisser séduire, c’est ainsi, à coup sûr, qu’on aurait réussi près d’elle, et sans artifice comme sans calcul, le roi avait pris le meilleur moyen de gagner son amitié. Placée entre le roi qui l’aimait, et la reine, sa bienfaitrice, Aïxa n’avait pas éprouvé un instant d’embarras. N’ayant ni ambition, ni arrière-pensée, sa conduite loyale et franche avait détourné sur-le-champ toute idée de coquetterie et de trahison, et jamais favorite ne s’était élevée par de semblables moyens à une double faveur, aussi prompte et aussi haute. Le roi ne pouvait vivre sans la voir, et la reine ne pouvait se passer d’elle.
Le cercle du soir se ressentait de la rigoureuse étiquette de la cour d’Espagne ; mais le matin la reine recevait chez elle dans l’intimité et la simplicité allemande Aïxa et Carmen, qui étaient inséparables. Yézid, qui amenait sa sœur au palais ou qui venait l’y chercher, était presque toujours admis dans ce petit cercle, ainsi que Fernand d’Albayda, le fiancé de Carmen. Parmi les gens du palais, Juanita, la femme de confiance de la reine, veillait seule pendant ces réunions, pour en éloigner les importuns ou les profanes. Jamais la pauvre reine n’avait vu autour d’elle autant d’amis ; maintenant seulement elle se sentait vivre, et, avare de ces jours heureux qui s’écoulaient si vite, elle aurait voulu les arrêter.
Carmen ne rêvait, ne songeait qu’à Fernand ; son bonheur l’embellissait, son bonheur était sa vie, son bonheur était si grand que le pouvoir même et l’affection de la reine n’y pouvaient rien ajouter ; aussi Marguerite se disait : « Elle n’a pas besoin de moi ; » et une sympathie secrète l’attirait vers Aïxa. Il y a des souffrances qui s’entendent et se comprennent.
Il était souvent question du mariage de Carmen, qui devait avoir lieu dans une quinzaine de jours, et dont la reine s’occupait beaucoup.
— Et toi, duchesse de Santarem, lui dit-elle, un matin qu’elles étaient seules, ne songes-tu point à te remarier ?
— Non, madame.
— Tu n’aimes donc personne ?
— Non, madame.
Mais Aïxa, surprise par cette question imprévue, rougit tellement que la reine détourna les yeux pour ne pas l’embarrasser, et examina un tableau de Murillo qui ornait son oratoire. Aïxa se remit de son trouble et dit :
— J’ai deux frères, madame, deux frères qui m’ont sauvé l’honneur et la vie, deux frères qui seront mes seules amours, et comme ni l’un ni l’autre ne se mariera, je ferai comme eux, pour ne pas les quitter, et pour leur donner ma vie entière.
— Deux frères ? dit la veine, je ne t’en connaissais qu’un…
La reine ne prononça pas son nom.
— Oui, madame… Yézid, mon vrai frère… mon frère légitime, et l’autre…
— Qui ne l’est pas…
— Mais avec lequel j’ai été élevée… le cœur le plus noble, le plus généreux, et qui m’est dévoué.
— Et pourquoi ne se marie-t-il pas ? dit la reine. Il me semble qu’avec ma protection, et surtout la tienne, ajouta-t-elle en souriant, nous effacerions bientôt cette tache de naissance.
— Hélas ! madame, dit Aïxa, qui le jour même avait appris par Fernand ce qui venait de se passer au couvent d’Alcala, pour sauver mes jours et ceux d’Yézid, qu’il a crus menacés, il s’est fait chrétien, il a prononcé des vœux. Son bonheur, son avenir, il a tout donné pour moi….. Ne lui dois-je pas mon amitié et ma vie en dédommagement !
— Je comprends, dit la reine… je comprends, en effet, que celui-là ne puisse pas se marier… Mais ton autre frère ?..
— Yézid, madame ?
— Oui.
— Oh ! celui-là, madame, c’est autre chose !… Il y a dans sa vie un mystère que nous ne comprenons pas.
— En vérité !.. Dis-moi cela, duchesse, à moi qui suis curieuse.
— Mon père l’a souvent pressé de se marier, et moi aussi. Il a toujours répondu à mon père : Plus tard ! plus tard ! mais à moi, il m’a dit : jamais !
— Et pourquoi ?
— C’est la seule chose qu’il ne m’ait jamais confiée….. malgré toutes mes instances. Alors je ne lui en parle plus… je crois avoir deviné.
— Et qu’est-ce donc ? dit la reine, dont la curiosité redoublait.
— Je crois, madame, qu’il a au fond du cœur un amour malheureux et sans espoir, auquel il veut rester fidèle.
— En vérité ? reprit la reine avec émotion… Sans espoir ! tant mieux, il finira par l’oublier.
— Yézid n’oublie pas, madame…
— Mais toi et ses amis devriez essayer de le guérir.
— Il y a des amours dont on ne guérit pas, dit Aïxa en baissant les yeux.
— C’est vrai, murmura la reine… Mais il y a du moins une chance.
— Et laquelle ? dit vivement Aïxa.

— On en meurt.
— Et Marguerite, laissant tomber sa tête sur sa poitrine, resta livrée à de sombres réflexions.
— Pauvre reine ! dit la jeune fille ; le malheur aussi a passé par là. Et contemplant avec respect, presque avec reconnaissance, le silence et la douleur de Marguerite :
— Quelle confiance pour une reine ! se dit-elle, elle ose penser et souffrir devant moi !
Le cœur d’Aïxa était aussi déchiré par bien des souffrances ; mais la plus vive en ce moment provenait du sort de Piquillo. Elle connaissait l’Espagne et savait que ni pouvoir ni protection, quelque grande qu’elle fût, ne pouvaient briser des vœux religieux ; que si, parfois, le pape avait accordé une faveur pareille (à l’archiduc Albert, par exemple, beau-frère du roi), ce n’avait été jusqu’alors que pour des princes, et pour des raisons de haute politique. Mais pour un simple particulier, pour Piquillo, pour un Maure surtout… il n’y avait pas à y penser.
Ce qu’elle cherchait du moins, c’était un moyen de l’arracher au père Jérôme et à Escobar, dont elle redoutait les intrigues et les mauvais desseins ; elle ne voulait pas le laisser livré à ceux qui l’avaient déjà si indignement trompé. Une existence pareille était intolérable. Le père Jérôme avait répondu à Fernand d’Albayda que, comme supérieur de la Compagnie de Jésus, il avait désormais tout pouvoir sur Piquillo. Mais déjà, dans son zèle, Aïxa s’était informée… elle avait consulté, interrogé, et elle avait appris, à n’en pouvoir douter, ce que nous savons déjà : c’est que, pour être jésuite, il ne suffisait pas d’être prêtre, et que, pour entrer dans la Société de Jésus, il fallait deux années consécutives d’un rigoureux noviciat. Telle était la règle expresse de son fondateur, Ignace de Loyola.
Fort de ces nouvelles données, muni des instructions d’Aïxa, et furieux d’avoir été lui-même joué par les bons pères, Fernand d’Albayda était retourné, quelques jours après, à Alcala de Hénarès, et sonnait à la grille du couvent, qui bientôt lui fut ouverte.
Jérôme et Escobar pâlirent à sa vue.
Fernand s’expliqua en peu de mots et d’un ton sévère : on n’avait pas craint de faire outrage à lui, porteur des ordres du roi ; on avait avec lui, comme avec Piquillo, employé la ruse et l’imposture, qui paraissaient être la règle du couvent ; mais il connaissait enfin la vérité, il avait le droit d’emmener Piquillo, et il venait le réclamer.
Les deux moines se regardèrent avec inquiétude.
— Je vous jure, mon frère… s’écria Escobar.
— Un serment ! dit Fernand, vous allez me tromper.
— Non, je vais vous dire la vérité. Notre frère Luis Alliaga n’est plus ici.
— Je m’y attendais ! s’écria Fernand, et pour ne pas me le rendre, vous allez me soutenir qu’il s’est évadé… échappé !
— C’est justement cela, dit Escobar.
— À d’autres, mes pères ! la ruse est trop grossière, et je ne m’y laisserai pas prendre… Ou Alliaga languit dans vos cachots, ou vous avez employé, pour vous assurer son silence, des moyens encore plus odieux.
Le père Jérôme poussa un cri d’indignation et fit le signe de la croix. Escobar se contenta de lever les yeux au ciel.
— Ces suppositions, je puis les faire. Votre conduite passée m’en donne le droit, Mais si Alliaga ne m’est pas rendu, elles deviendront des certitudes pour moi et pour tous ceux qui s’intéressent à lui ; alors c’est au roi et à la sainte inquisition que nous nous adresserons pour avoir justice de vous, mes pères, et de votre ordre ; et vous ne pourrez accuser que vous-mêmes des maux que vous aurez attirés sur lui.
— Il n’a que trop raison ! s’écria le père Jérôme après son départ.
— Impossible de le persuader, ne pas vouloir nous croire !…
— Même quand nous lui disons la vérité.
— Il y a de quoi en dégoûter, dit froidement Escobar.
— Maudit soit ce Piquillo !
— Et le jour où il est venu nous demander asile !
— C’est l’enfer qui est entré avec lui dans notre couvent !
— Il y était déjà, mon père, dit Escobar, le jour où ce duc d’Uzède est venu nous parler de ses intérêts, qui n’étaient pas ceux de notre ordre. C’est en partie pour lui complaire que nous nous sommes chargés de la conversion de ce Piquillo.
— C’est vous qui l’avez voulu, Escobar.
— C’est vous, mon père… ou plutôt lui, d’Uzède. Il faut donc qu’il nous vienne en aide, et qu’il se hâte.
— Qu’il se concerte avec la comtesse pour nous délivrer de la favorite ! c’est d’elle que nous viennent déjà ces persécutions, et si elle veut venger ce frère qui s’est évadé…
— Qui s’est peut-être tué… exprès… pour nous nuire…
— Il en est bien capable.
— Elle fera fermer notre couvent.
— Elle nous fera exiler d’Espagne !
— Allons, il n’y a pas de temps à perdre.
Le duc d’Uzède et la comtesse, qui étaient désormais dans la dépendance des bons pères, reçurent donc leurs instructions, pour ne pas dire leurs ordres. Le supérieur demandait que l’on en finit au plus vite avec la favorite, et, en dédommagement de toutes les peines qu’il s’était données et des désagréments sans nombre qu’il avait éprouvés dans cette affaire, Escobar, déjà prieur du couvent et recteur de l’Université d’Alcala, Escobar demandait une place d’aumônier de la reine, qui venait d’être vacante, place à laquelle il tenait, moins pour lui que pour les services qu’elle lui permettrait de rendre à tous ses amis.
Tout fut promis par le duc d’Uzède et par la comtesse ; il ne s’agissait que d’exécuter ces promesses.
Don Fernand avait fait part de ses nouvelles craintes à Aïxa, et celle-ci, tourmentée par l’idée que Piquillo était prisonnier ou mourant, n’avait pu fermer l’œil de la nuit. En proie à une insomnie horrible, elle n’avait pensé qu’aux moyens de le délivrer. Dans tout autre pays que l’Espagne, on se serait adressé aux lois et aux magistrats, on eût ordonné de visiter le couvent même de force ; mais ici les monastères avaient leurs priviléges, que l’inquisition elle-même eût respectés pour qu’on respectât les siens. Dans son trouble, dans son inquiétude, la jeune fille résolut de se confier à la reine, sa protectrice, et de lui demander, sinon son appui, du moins ses conseils. Le jour parut ; mais il fallait attendre l’heure de se présenter chez la reine. Ça ne pouvait être que vers midi, et Aïxa entendit enfin sonner l’heure qu’elle attendait avec tant d’impatience.
Il faisait ce jour-là une chaleur accablante, et le soleil d’Espagne dardait ses rayons les plus ardents. N’importe ! Aïxa sortit, seule, à pied, et se dirigea vers Buen-Retiro. Elle entra, comme d’habitude, par les jardins et par une petite porte qui donnait sur les appartements particuliers de la reine.
— Sa Majesté n’y est pas, lui dit Juanita.
— Ah ! mon Dieu, s’écria Aïxa avec douleur, moi qui tenais tant à lui parler !
Et elle lui raconta toutes ses craintes.
— Rassurez-vous, dit Juanita, la reine, qui vient de perdre son aumônier, ne s’est point, comme à l’ordinaire, fait dire la messe dans son oratoire ; elle s’est rendue ce matin à la chapelle du roi… elle va revenir.
— Alors, dit Aïxa en s’asseyant sur un long et large canapé, je l’attendrai. Aussi bien, il fait ici une fraicheur délicieuse.
Les deux jeunes filles étaient alors dans une salle basse communiquant avec les appartements de la reine, mais donnant aussi sur les jardins. C’était par là que Marguerite descendait, quand elle voulait se promener dans le parc réservé pour elle. Une brise légère, venant des allées ombragées, se jouait dans les cheveux d’Aïxa et rafraichissait son front.
— Qu’il fait chaud, Juanita ! disait elle en s’éventant avec un mouchoir de fine toile de Hollande.
— La senora veut-elle que je lui donne un verre d’orangeade excellente ? c’est moi qui l’ai faite, et la reine n’en boit jamais d’autre !
— Volontiers, ma bonne Juanita !… dit la jeune fille en la remerciant, va vite.
Juanita sortit et ne fut pas longtemps. Quelques minutes après, elle revint, portant sur une assiette d’argent un verre de cristal plein d’orangeade glacée. Elle s’arrêta en voyant Aïxa qui, gracieusement couchée sur le canapé, venait de fermer les yeux.
— Pauvre fille ! dit Juanita ; elle qui n’a pas dormi de la nuit, à ce qu’elle vient de me dire, ne la dérangeons pas, respectons son sommeil.
Elle plaça doucement, sur un petit guéridon qui était à côté du canapé, l’assiette et le verre, pour qu’Aïxa les aperçût à son réveil ; puis elle se retira sur la pointe du pied.
Aïxa dormait ; un doux rêve lui montrait Piquillo, son frère, étendant les mains vers elle, pour la défendre et la protéger.
Des pas légers se firent entendre sur le sable, l’étoffe d’une robe froissa le feuillage d’un massif… Aïxa ne se réveilla pas… Une femme parut à la porte qui donnait sur le jardin : c’était la comtesse d’Altamira. Elle s’arrêta à la vue d’Aïxa, la regarda plusieurs instants, puis tout à coup pâlit et devint tremblante, agitée qu’elle était par une idée horrible.
— Si Dieu le veut… et elle répétait tout bas les dernières paroles du père Jérôme, il ne manquera pas de vous offrir une occasion !
— En voici une, se dit-elle, et jamais elle ne pouvait se présenter plus favorable et plus sûre.
On n’avait point vu la comtesse entrer dans les jardins. Aïxa dormait, elle était seule… et ce verre… auprès d’elle !..
La comtesse regarda bien attentivement. Personne !… elle écouta : aucun bruit, pas même celui de la brise… tout se taisait, excepté son cœur, dont elle croyait entendre les battements… il lui semblait qu’eux seuls pouvaient la trahir. Elle se hâta… elle saisit le flacon qu’elle portait toujours sur elle… l’ouvrit… et de nouveau la main lui trembla…… Mais elle regarda Aïxa ; elle était si admirablement belle dans son sommeil, que cette vue, qui aurait désarmé toute autre, rendit à la comtesse sa colère et tout son courage.
Elle versa dans le verre une goutte, et puis plusieurs… plusieurs encore. Elle erra à l’autre bout du parc, s’y promena quelque temps, rencontra des personnes de la cour, des dames d’honneur qui attendaient comme elle que la reine revint de la chapelle, et ramenée malgré elle du côté des massifs où était la salle basse, elle s’approcha… regarda à travers le feuillage. Aïxa dormait toujours… et le verre, plein jusqu’au bord, était toujours près d’elle.
— Elle ne se réveillera donc pas ! dit la comtesse avec rage ; et elle était tentée d’agiter les branches qu’elle serrait d’une main convulsive ; mais la prudence la retenait, et craignant d’être ainsi surprise à observer son ennemie, elle s’éloigna de nouveau, monta dans les appartements du palais, soutint avec le comte de Lémos une conversation qui lui parut éternelle, et fut tout étonnée, en regardant la pendule, de voir que cinq minutes à peine s’étaient écoulées. Tout ce que ses forces lui permirent fut de prolonger encore son supplice pendant un quart d’heure ; mais enfin, n’y tenant plus, elle descendit de nouveau dans le parc ; et le cœur serré par une horrible étreinte, elle s’approcha de la salle basse… y jeta un regard furtif…
Aïxa n’y était plus… et le verre était vide !
XLVI.
l’inconnu.
Quelques jours après cette scène, le greffier Manuelo Escovedo reçut une lettre ainsi conçue :
« Vous ferez signer sur les registres de l’ordre le jeune frère qui a, dites-vous, des révélations à faire au premier ministre ; vous le conduirez ensuite et le laisserez au palais, chez M. le duc de Lerma, que j’ai prévenu et qui l’attendra.
« Le grand inquisiteur,
Alliaga, à l’arrivée de cette lettre, vit donc enfin s’ouvrir devant lui les portes de l’inquisition. Tous les tourments qu’il avait jusqu’alors soufferts dans sa vie n’étaient rien à côté des angoisses qu’il avait éprouvées depuis huit jours.
Il était près d’Aïxa et ne pouvait la secourir !.. La mort était suspendue sur sa tête et il ne pouvait la détourner !.. Mais enfin il était libre !.. il allait veiller sur elle !
Il signa tout ce qu’on lui présenta, et le nouveau frère de Saint-Dominique arriva avec le greffier du saint-office au palais du roi ; car c’était là que demeurait le duc de Lerma, non par orgueil, mais par prudence, et pour tenir toujours sous sa main son esclave couronné.
On n’entrait pas facilement dans la demeure royale, et il fallut montrer la signature du grand inquisiteur aux gardes de la porte ainsi qu’aux officiers de l’escalier. Un huissier du palais reçut la lettre d’audience que lui présenta frey Alliaga, et fit entrer celui-ci dans un vaste vestibule qui servait de salle d’attente.
Piquillo, qui croyait avoir un long entretien particulier avec le duc de Lerma, fut étrangement désappointé en voyant la foule de solliciteurs qui l’avait précédé et qui attendait comme lui.
Des gens de robe, des gens d’église, des militaires et des grands seigneurs encombraient cette vaste antichambre. Des dames mêmes s’y montraient en grand nombre, et n’étaient ni les moins intrépides ni les moins opiniâtres.
La foule était considérable surtout vers la porte du cabinet du duc de Lerma ; chacun s’y pressait dans l’espoir de passer des premiers. Quelques vieux solliciteurs plus expérimentés se tenaient à l’autre extrémité de la salle, à la porte en face, par laquelle devait entrer le ministre pour se rendre dans son cabinet.
On pouvait lui glisser ainsi au passage quelques flatteries, quelques pétitions, ou quelques mots adroits desservant d’avance un concurrent.
L’audience devait commencer à dix heures, et midi venait de sonner à la grande horloge du palais. L’impatience était grande, la chaleur encore plus.
On avait ouvert de grandes portes vitrées qui donnaient de la salle d’attente sur les jardins du roi.
Quoique l’air fût doux et pur, les arbres en fleur et les gazons verdoyants, personne n’était tenté d’en profiter et de se promener dans ce parc magnifique, qui déroulait vainement à tous les yeux ses vastes allées et ses épais ombrages.
La cupidité ou l’ambition les retenait tous entassés dans le même endroit, à la même place, tant ils avaient peur de perdre un mot, un regard, une minute, de l’idole qu’ils attendaient et qui tardait bien à paraître. Enfin la porte s’ouvrit.
À un brouhaha de satisfaction générale succéda un léger murmure de désappointement sur-le-champ réprimé.
Piquillo vit paraître un homme richement habillé, d’une taille noble et élégante ; l’intelligence et l’esprit brillaient dans son regard autant que la fierté et l’impertinence. Il portait la tête haute, et même, quand il s’inclinait, avait l’air de recevoir plutôt que de donner un salut.
Ce qui étonna surtout Piquillo, c’était son air de jeunesse : il paraissait avoir tout au plus trente-six ans.
— Quoi ! demanda-t-il tout bas à l’un de ses voisins, un vieux chevalier de Calatrava, quoi ! c’est là le duc de Lerma ?
— Vous ne le connaissez donc pas ?
— Je ne l’ai jamais vu.
— Eh bien ! ce n’est pas lui, mais un autre lui-même ; celui qui fait tout dans sa maison, son majordome politique.
— Qui donc ?
— Son secrétaire intime, don Rodrigue de Calderon, comte d’Oliva. Le duc n’aura pas pu donner audience, ce qui lui arrive souvent. Dans ce cas-là, c’est Rodrigue de Calderon qui s’en charge.
— Ce n’est pas la même chose, s’écria Piquillo interdit.
— Exactement, répondit le chevalier. En fait de pétitions pour emplois, titres et honneurs, le secrétaire écoute, accorde ou refuse selon son bon plaisir, certain d’avance d’être approuvé par son maitre le duc de Lerma, lequel l’est toujours par le roi Philippe III notre auguste souverain.
Le sous-favori s’avançait lentement, se dirigeant vers son cabinet et saluant de la main la foule qui l’entourait.
— Pardon, messeigneurs, de vous avoir fait attendre.
— En effet, dit avec hauteur un fier hidalgo qui avait peine à cacher son impatience, voilà près de deux heures de retard, et je prierai monsieur le secrétaire du duc de Lerma de me recevoir avant tout ce monde, car on m’attend chez le roi.
— Qui êtes-vous ?
— Le comte de Bivar ! s’écria l’hidalgo avec un orgueil qui lui sortait par tous les pores.
— Je ne connais pas, répondit Calderon avec le flegme le plus impertinent.
— Si monsieur Calderon avait lu l’histoire, il aurait vu qu’un de mes aïeux, Rodrigue de Bivar, surnommé le Cid, avait été autrefois à la tête des armées du roi, et moi, je suis dans son antichambre.
— J’ai lu l’histoire, monsieur le comte, répondit Calderon en s’inclinant d’un air moitié respectueux, moitié railleur, et j’y ai vu que les Bivar avaient été mis à leur place.
Un sourire d’approbation circula dans l’assemblée ; le descendant du Cid se mordit les lèvres, et le secrétaire d’État continua sa marche.
Au milieu de la foule qui se pressait à la porte de son cabinet, Calderon aperçut un simple soldat, un invalide, qui de loin et de la main semblait lui faire quelques signes de reproche ou de colère.
— Permettez-moi, messeigneurs, dit-il, d’écouter d’abord ce soldat qui désire me parler. Vous me pardonnerez ce passe-droit, c’est mon père.
Et il entra avec le vieillard dans son cabinet en lui disant :
— Eh bien ! seigneur mon père, qu’avez-vous à m’annoncer ?
— Tu n’y prends pas garde, mon fils, si tu savais tout ce que l’on dit de toi, ce que je viens d’entendre tout à l’heure encore dans cette salle d’attente.
— Eh bien ! mon père…
— Ça ne peut pas durer ; ça finira mal ; il t’arrivera malheur.
— Bien, bien, mon père !
— Tu es trop audacieux, tu es trop insolent : tu parles en maître à des gens qui ont des aïeux, toi qui es fils d’un soldat et d’une servante flamande, la pauvre Marie Sandelen, ma défunte !
— Oui, oui, mon père, mes parents n’étaient rien, et moi je suis beaucoup. C’est le contraire chez le comte de Bivar et bien d’autres grands seigneurs.
— Qui pourront bien te renverser, mon fils.
— Soit ! Mais non pas m’abattre. Ne craignez rien, mon père, rentrez à l’hôtel, buvez, mangez et tenez-vous en joie.
Puis, se retournant vers l’officier de service :
— Guzman, lui dit-il, où est la liste de ceux qui attendent ? Quel est le premier ?
— Le seigneur Bernardo, un riche épicier de Madrid, pour un chargement qui lui arrive de la Vera-Cruz. La seconde personne, dona Antonia, veuve d’un officier…
— Bien… bien… Et le comte Bivar ?
— Le dixième sur la liste, mais on peut commencer par lui.
— Non ! À son rang, c’est-à-dire à son tour.
Et l’audience commença.
Je n’oserais pas, après l’immortel auteur de Gil Blas, esquisser une des audiences de Rodrigue de Calderon, ce favori d’un favori, ce fier parvenu qui, fils d’un soldat, avait eu la faiblesse de renier son père et le courage de s’en repentir ; qui l’avait placé près de lui, à la cour, comme expiation de sa faute, et comme souvenir continuel de son origine ; ce Calderon, un des plus curieux caractères que puisse étudier le moraliste ou l’historien.
Lesage ne pouvait et ne devait l’envisager qu’au point de vue de l’auteur comique.
Ce qu’il n’a pas dit et ce que l’histoire ajoute, c’est que Rodrigue de Calderon soutint l’adversité plus fièrement encore qu’il n’avait supporté la fortune ; c’est qu’il se montra réellement digne de sa grandeur et de ses titres le jour où il lui fallut les perdre ; c’est que, chrétien et philosophe, sa longue captivité fut plus héroïque et sa mort plus sublime que sa prospérité n’avait été insolente.
Mais alors il était au plus haut point de cette prospérité, et Piquillo, contemplant avec effroi la masse de solliciteurs qui devaient passer avant lui, calculait déjà que Calderon, en accordant seulement cinq minutes à chacun d’eux, ne pourrait jamais donner audience à tout le monde.
D’ailleurs, ce n’était pas à Calderon, c’était au duc de Lerma qu’il voulait parler. On avait beau lui dire que c’était exactement la même chose, il ne pouvait confier à Calderon, à un favori en sous-ordre, le secret de l’État, et surtout un autre secret bien plus important pour lui, celui qui concernait Aïxa.
Préoccupé de cette idée, frey Alliaga était sorti, sans s’en apercevoir, de la salle d’attente. Dans l’agitation où il était en proie, il marchait toujours devant lui, et se trouva, sans s’en douter, au milieu des jardins du palais.
Une caisse d’oranger contre laquelle il se heurta le fit revenir à lui. Il était à l’entrée d’une grande allée, près d’un parterre où croissaient les fleurs les plus rares.
Un homme d’une taille moyenne et d’un air distingué cueillait en rêvant ces fleurs et en faisait un bouquet ; sa préoccupation égalait au moins celle de Piquillo, car il ne l’avait pas même entendu venir.
Sur l’exclamation du jeune moine, il se releva et s’écria vivement :
— Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ?
Et voyant la robe de Saint-Dominique, il s’arrêta et s’inclina profondément.
— Pardon, seigneur cavalier, dit Alliaga ; je viens, je crois, de me perdre dans ce parc, et si vous êtes, comme je le pense, du château…
— Oui, oui, j’en suis, dit l’inconnu en souriant.
— Daignez alors m’indiquer mon chemin pour retourner à la salle d’audience.
— Ah ! vous avez audience au palais… aujourd’hui ?
— C’est-à-dire j’aurais voulu au prix de tout mon sang en obtenir une, et je ne le puis pas.
— Et pourquoi donc ?
— Il y a tant de monde, c’est si difficile !
— Si je pouvais vous aider… répondit l’inconnu.
— Quoi ! seigneur cavalier, vous auriez ici quelque crédit ?
— Pas beaucoup ! mais enfin ce que j’ai est à votre service.
— Merci ! merci mille fois !.. Eh bien ! pourriez-vous me faire parler en ce moment, non pas à Rodrigue de Calderon, mais au duc de Lerma… au duc lui-même ?
— En ce moment, c’est difficile, mais je puis, si vous le voulez, vous faire parler au roi.
— Ah ! dit Alliaga, ce n’est pas la même chose !
L’inconnu rougit et dit :
— Pardon, mon père, c’est tout ce que je peux faire.
— C’est égal ! c’est égal ! s’écria vivement Piquillo, j’accepte ! Et même, maintenant que j’y pense, je l’aime mieux.
— Cela se trouve bien, répondit l’inconnu en souriant.
— Oui ! oui ! s’écria-t-il, il y a une chose que le roi seul doit savoir.
— Venez alors, dit l’inconnu, suivez-moi.
Et ils se dirigèrent du côté des appartements du roi.
XLVII.
l’aumônier de la reine.
— Quel est votre nom, mon père ? dit l’inconnu pendant qu’ils marchaient côte à côte dans une longue allée ombragée par de vieux arbres.
— Luis Alliaga.
— Alliaga… reprit l’inconnu en s’arrêtant ; seriez-vous parent d’un Piquillo Alliaga auquel je porte le plus vif intérêt ?
— C’est moi-même, seigneur cavalier !
— Vous !..
L’inconnu regarda alors Piquillo avec une attention qui déconcerta le jeune frère. Il n’aurait jamais cru qu’un nom aussi obscur que le sien pût produire autant d’effet.
— C’est vous que les révérends pères de Jésus ont fait moine malgré lui, à ce que m’a raconté Fernand d’Albayda ?
— Oui, seigneur cavalier, dit Piquillo interdit ; mais je ne me rappelle pas avoir jamais vu Votre Seigneurie.
— Jamais, c’est la première fois.
— D’où vient donc l’intérêt dont vous daignez m’honorer ?
— Eh mais ! dit l’inconnu en souriant, Fernand d’Albayda, en qui j’ai toute confiance, est votre ami… et puis vous connaissez la duchesse de Santarem.
— C’est d’elle que je veux entretenir le roi.
— Est-il possible ! Parlez, parlez ! dit vivement l’inconnu ; de quoi s’agit-il ?
— De la protéger, de la défendre ! on en veut à ses jours !
— Et qui aurait cette audace ! s’écria l’inconnu, dont le visage devint pourpre et dont les yeux étincelèrent de colère. Malheur à qui l’oserait tenter !
— Ah ! se dit Piquillo enchanté, je ne pouvais pas mieux m’adresser qu’à ce digne cavalier… Oui, continua-t-il, ce sont des personnes puissantes, dangereuses… les plus élevées de la cour…
— Silence, mon père ! dit l’inconnu en lui serrant la main.
Il venait d’apercevoir dans une des allées latérales un groupe d’officiers et de jeunes seigneurs qui s’inclinèrent respectueusement.
— Fernand d’Albayda, dit l’inconnu à l’un d’eux, en lui faisant signe de la main, venez ici.
À ce nom, Alliaga avait frémi de surprise, et Fernand tressaillit de joie en retrouvant dans le palais de Buen-Retiro l’ami dont il déplorait la perte.
— Piquillo ! s’écria-t-il, Piquillo auprès de Votre Majesté !
— Le roi ! dit Alliaga stupéfait.
— Lui-même ! répondit Philippe en rentrant dans l’allée couverte, où l’on ne pouvait plus les entendre. Je vous ai promis de vous faire parler au roi, et je tiens ma parole. Parlez donc ; mais rappelez-vous que personne, pas même le duc de Lerma, ne doit connaître ce que vous allez m’apprendre. C’est vous et Fernand d’Albayda qui seuls exécuterez mes ordres.
— Qu’y a-t-il donc, sire ? demanda Fernand avec émotion.
— Il y a, monsieur, qu’un indigne complot a été ourdi contre nous !
— Contre vous, sire !
— C’est la même chose ! contre une amie intime de la reine, contre une personne que j’estime, que j’honore ! la duchesse de Santarem ; on veut la tuer !
— Aïxa ! s’écria Fernand pâle de terreur.
— Oui, dit Piquillo, ses jours sont en danger.
— Qui donc ose les menacer ? dit Fernand en portant la main à son épée. Parlez, sire, ordonnez ; où faut-il courir ?… tout mon sang, s’il le faut…
— Bien, Fernand, bien ! je te remercie, dit le roi en lui prenant la main ; mais calme-toi ; voilà tes traits bouleversés et ta main est glacée. Toi, du moins, tu es de ceux sur qui je puis compter, et que rien n’effraiera, car il s’agit, à ce que m’a dit ce jeune moine, de s’attaquer à des personnes des plus haut placées.
— Qu’importe ! nous les démasquerons ! s’écria Fernand.
— Nous arracherons Aïxa à ses ennemis ! continua Piquillo.
— Oui… oui, nous la sauverons ! dit le roi avec chaleur.
Pour quelqu’un qui aurait pu lire au fond des cœurs, c’était une étrange et curieuse situation que celle de ces trois hommes, de positions et de rangs si différents, qu’animaient en ce moment la même pensée, les mêmes craintes et le même amour ; ces trois hommes qu’une seule idée rapprochait, qu’un seul nom venait de rendre alliés, et qu’un mot de plus peut-être eût désunis et rendus ennemis.
— Parlez, parlez, répétaient le roi et Fernand à Alliaga, nommez-nous le coupable.
— Quel que soit son rang ou sa famille, ajouta le roi, je signe à l’instant l’ordre de l’arrêter.
— Et moi, disait Fernand, je l’exécuterai, cet ordre, au milieu même de la cour ; et quand vingt épées devraient briller pour défendre le coupable, parlez ! parlez ! nommez-le !
Et Piquillo se taisait.
En entendant Fernand s’exprimer ainsi, une foule d’idées auxquelles il n’avait pas pensé d’abord étaient venues l’assaillir. Ces coupables qu’on le pressait de nommer, ce n’étaient pas seulement le père Jérôme et Escobar, qui avaient conseillé le crime, c’étaient encore la comtesse d’Altamira et le duc d’Uzède, qui s’étaient chargés de le commettre. La comtesse était la tante de Fernand d’Albayda et de Carmen ; c’était la sœur de don Juan d’Aguilar.
L’accuser, c’était livrer à la honte et au déshonneur la famille à laquelle, lui, Piquillo, devait tout ! Et quant au duc d’Uzède, complice de la comtesse, quelque coupable qu’il fût, Dieu seul pouvait savoir si Piquillo, en le faisant condamner, ne devenait pas plus criminel que lui.
— Sire, dit-il, et vous, Fernand, daignez m’écouter. J’espère que vous ne douterez point de la vérité de mes paroles. J’atteste, comme homme, et comme prêtre, ajouta-t-il en tressaillant, puisque les vœux que j’ai prononcés m’en imposent les devoirs, j’atteste devant Dieu et devant vous que je connais tous ceux qui ont tramé ce complot, et que je ne puis les nommer.
— Eh ! qui donc vous en empêcherait ? s’écria Fernand avec colère.
Alliaga regarda son ami et lui répondit :
— Mon devoir… des raisons sacrées !…
— Auriez-vous appris ce secret par la confession ? dit le roi.
— Oui….. oui, sire, s’écria Piquillo en saisissant cette idée ; c’est ainsi que j’ai connu ces projets.
— Comment alors protéger Aïxa ? reprit Fernand.
— Qui veillera sur la duchesse ? s’écria le roi.
— Moi !.. moi seul ! répondit Piquillo, si vous daignez le permettre. Je jure de la sauver ou de mourir !
— Et qui donc êtes-vous pour elle ? demanda le roi d’un air inquiet.
Fernand alors expliqua à Philippe les liens de parenté qui existaient entre Aïxa et le jeune moine ; l’affection du roi en redoubla pour celui-ci, et il s’écria :
— Je vous donnerai un acte signé de moi approuvant d’avance les mesures que vous prendrez pour déjouer et combattre les ennemis de la duchesse.
— L’essentiel, répondit Piquillo, c’est que je sois sans cesse près d’elle, afin de veiller à tous les instants, et cette surveillance devient impossible si les vœux que j’ai prononcés m’obligent à rentrer dans un couvent, si de nouveau je suis enfermé sous les grilles d’un cloitre…
— J’entends qu’il soit libre ! dit le roi.
— Qu’il réside ici, à la cour, ajouta Fernand.
— Pour cela, continua le monarque, il faudrait un titre qui ne le rendit dépendant que de moi…
— Qui l’attachât à la chapelle de Votre Majesté… à votre aumônerie.
— Il n’y a point de place vacante, et en créer une nouvelle, ce serait exciter les réclamations du grand inquisiteur, ce serait toute une guerre à soutenir… sans compter que cela éveillerait les soupçons.
— Il y a une place dans la maison de la reine, dit vivement Fernand ; son premier aumônier est mort.
— C’est vrai, c’est vrai ! répéta le roi avec joie… Mais, poursuivit-il d’un air découragé, cela dépend toujours du grand inquisiteur, et surtout du duc de Lerma, qui nomme à tous ces emplois-là… Or, je sais qu’il a déjà promis formellement cette place au duc d’Uzède, son fils, pour je ne sais quel protégé.
— Si ce n’est que cela, reprit timidement le jeune moine, je me fais fort de l’obtenir.
— Vous, Piquillo ! s’écria Fernand.
— Vous ! dit le roi ; forcer le duc de Lerma à manquer de parole à son fils, et surtout lui faire faire ce qu’il ne veut pas ! je n’oserais le tenter, moi… le roi !
— Et moi, continua Piquillo toujours d’un air timide et modeste, si Votre Majesté le permet, j’espère réussir. Le roi et don Fernand le regardèrent avec étonnement.
— Soit, dit Philippe, vous pouvez sur-le-champ vous mettre à l’œuvre… Voyez-vous au bout de cette longue allée ce grave personnage qui vient à nous ?.. c’est le duc de Lerma qui sort de son appartement.
— Où il s’est reposé, se dit Piquillo en lui-même, pendant que son secrétaire Rodrigue de Calderon donnait pour lui ses audiences.
Le duc avançait lentement et cherchait à deviner quelles étaient les deux personnes qui s’entretenaient aussi intimement avec le roi. Il avait déjà reconnu de loin don Fernand d’Albayda et fronça le sourcil. Tout porte ombrage à un favori. À l’égard du jeune moine, la perspicacité du ministre fut en défaut, et son front se rembrunit encore en voyant un nouveau visage.
— Mon cher duc, lui dit le roi en s’avançant vers lui, voici un jeune religieux qui a une demande à vous faire, demande que nous vous recommandons.
Il salua de la main le duc, qui s’inclina d’un air gracieux, et le roi continua sa promenade en causant avec Fernand. Ils suivirent l’immense allée qui s’étendait au loin, et ne revinrent sur leurs pas que quand ils en eurent atteint l’extrémité.
Le duc, resté avec Piquillo, le contemplait en silence d’un œil sombre et inquiet, qui eût déconcerté tout autre solliciteur. Aucun de ceux qui connaissaient les manières habituelles du duc de Lerma ne se fût hasardé, en pareil cas, à présenter sa supplique. Piquillo aussi regardait le duc, mais d’autres pensées le préoccupaient : ce Ministre si puissant, ce souverain de fait de la monarchie espagnole, qu’il voyait pour la première fois, n’était peut-être pas un étranger pour lui. Le même sang peut-être coulait dans leurs veines. Et pendant que le duc, impatienté de son silence, lançait sur lui un regard où respiraient la colère et le dédain, Piquillo, le contemplant d’un air ému et indécis, se disait :
— Si c’était mon aïeul !
— Eh bien ! fit le duc, voyant que Piquillo ne parlait pas.
— Eh bien ! monseigneur, puisque sa Majesté vous l’a dit, je venais demander à Votre Excellence…
— Cela ne se peut pas ! grommela brusquement Le duc, qui ne l’avait pas même écouté.
— Je n’ai pas dit ce que je demandais, monseigneur.
— C’est une place ?
— Oui, monseigneur.
— Elles sont toutes données.
— Alors, monseigneur, je vous demanderai…
— Quoi encore ?
— La permission de vous rendre un immense service.
— À moi ?
— À vous-même.
— Qui êtes-vous ? dit le duc étonné.
— Le frère Luis Alliaga.
— Piquillo Alliaga ! reprit le-duc en l’examinant lentement de la tête aux pieds.
— Encore ce nom, pensa en lui-même le moine, qui produit son effet.
— C’est vous qui m’aviez fait demander une audience pour une révélation importante ?
— D’où dépend votre salut, monseigneur.
— Eh bien ! Calderon ne vous a-t-il pas reçu ? Cela suffit, il me dira ce dont il s’agit.
— Il ne pourra rien dire à Votre Excellence, car je ne lui ai pas parlé, je ne l’ai pas vu.
— Et pourquoi ?
— Je suis venu, j’ai attendu plus de deux heures dans son antichambre, c’est-à-dire dans la vôtre, et je me suis en allé.
— Vous voulez parvenir, et vous ne savez pas attendre !
— Je ne veux pas parvenir.
— Que voulez-vous donc ?
— Je vous l’ai dit : vous rendre service.
— Et ce que vous vouliez me révéler, reprit le duc avec dédain, vous venez de le raconter au roi.
— À personne, monseigneur ; cela ne regardait que vous.
Le duc s’adoucit tout à coup. Un éclair de bienveillance brilla sur son front assombri. Il fit signe à Piquillo de marcher à côté de lui, et tous deux continuèrent à causer en se promenant, mais du côté de la grande allée opposé à celui où était le roi.
— Parlez, mon frère, je vous écoute.
— Depuis longtemps, monseigneur, un complot se trame contre vous. On veut vous renverser, on veut se mettre à votre place ; il n’y a là rien de nouveau ni d’extraordinaire ; ce qui l’est peut-être, ce qui vous semblera inouï… épouvantable… inexplicable, c’est le nom de celui qui dirige ce complot.
— Quel est-il ? demanda le duc avec émotion.
Piquillo baissa la voix, et dit :
— Votre fils, le duc d’Uzède !
Le malheureux père poussa un cri, et s’arrêta en cachant sa tête dans ses mains.
— Je vous avais prévenu, monseigneur, que cela vous paraitrait impossible.
— Tout est possible… ici ! murmura le duc d’une voix sourde.
Le père avait poussé le premier cri, un cri de douleur ; mais ce fut le ministre qui, levant vers Piquillo un œil où brillait la rage, lui dit en lui serrant la main avec force :
— Je m’en suis toujours douté !
— Vous, grand Dieu ! s’écria Piquillo interdit.
— Oui… oui ! Achevez, mon père, reprit le duc d’un air affectueux.
— C’est le duc d’Uzède et la comtesse d’Altamira qui conspirent contre vous, d’accord avec le père Jérôme et Escobar, prieur du couvent et recteur de l’université d’Alcala.
— C’est cela même, c’est évident ; cette comtesse, mon ennemie mortelle, à laquelle il faisait la cour pour me servir, disait-il ; ce voyage qu’il a fait avant-hier à Hénarès, près de ce frère Escobar, son confesseur… Je voyais tout cela… je ne voulais pas le croire. Quand on est ministre, quand on a le pouvoir, on ne devrait avoir ni famille ni parents ; c’est autant d’ennemis donnés par la nature. Je verrai, je m’informerai… Nous reparlerons de cela, mon père. Je vous en remercie toujours. Adieu… Ah ! à propos, quelle place me demandiez-vous ?
— Il n’y en a plus, c’est vous-même, monseigneur, qui me l’avez dit.
— Peut-être. Ce que vous venez de me confier peut en rendre vacantes plusieurs.
— Peu m’importe à moi, qui n’en veux qu’une, et pas d’autre.
— Laquelle ?

— Celle d’aumônier de la reine.
Le duc, cherchant à cacher son embarras, répondit avec hésitation :
— Certainement, je le voudrais… mais cela ne dépend pas de moi… cela dépend du grand inquisiteur. Vous êtes de son ordre, à ce qu’on m’a dit : l’ordre de Saint-Dominique ; mais c’est depuis si peu de temps ! depuis quelques jours, je crois ?…
— De ce matin seulement.
— Et vous demandez une des premières places de la cour… Il faudrait, pour cela, avoir rendu des services…
— Je n’ai pas achevé, monseigneur !
— Quoi ! ce que vous venez de m’apprendre…
— Était de peu d’importance, dit froidement Piquillo, et n’avait rien d’extraordinaire. Il s’agissait seulement d’un ministre à renverser et d’un fils ingrat ! Des ministres, on peut en trouver… et des ingrats, il y en a partout, ajouta-t-il en regardant le duc, qui baissa les yeux. Ce qui me reste à vous faire connaître est-bien autrement important, car il s’agit du salut de l’Espagne.
— Que voulez-vous dire ?
— Que l’Espagne est perdue si vous ne vous hâtez, et peut-être déjà est-il trop tard.
Piquillo déroula alors au ministre, en détail et avec une clarté parfaite, tous les dessins de Henri IV, desseins dont le duc ne se doutait même pas ! Sécurité tellement incroyable (si l’histoire n’était pas là pour l’attester) qu’il n’y avait pas un seul préparatif de défense pour repousser la ligue formidable qui menaçait l’Espagne ; pas un vaisseau en état, pas une armée sur pied, pas même un corps de troupe pour protéger la frontière. Et le plan de Henri IV commençait déjà à s’exécuter : toute la Savoie était en armes ; Lesdiguières, avec douze mille hommes, avait déjà envahi le Milanais. Henri IV n’attendait plus, pour entrer en campagne, que les contingents des princes allemands.
Le duc, pâle et respirant à peine, cherchait vainement
à cacher son trouble à Piquillo. Jamais 
En face de lui, il vit distinctement la comtesse qu’Escobar venait d’amener et de faire asseoir.
imprévoyance et incapacité plus grandes ne s’étaient révélées.
Le ministre comprenait trop bien en ce moment
qu’il avait amené l’Espagne au bord de l’abîme, et il
ne voyait aucun moyen de l’en retirer.
— D’où tenez-vous ces renseignements, mon frère ? dit-il enfin d’une voix tremblante.
— C’est mon secret, monseigneur ; mais peu importe d’où ils viennent, pourvu qu’ils soient exacts. C’est à vous de vous en assurer.
— C’est ce que je ferai… Vous n’en avez pas parlé au roi ?
— Pas un mot, monseigneur ; je vous l’ai dit. Sa Majesté s’occupe peu des affaires d’État…
— Oui, oui, reprit le ministre en baissant les yeux, elle s’en repose sur moi.
Le même silence avec tout le monde ! ajouta-t-il vivement ; vous me le promettez ?
— Je vous le jure.
— Vous serez aumônier de la reine, dit le ministre d’une voix haute et ferme, quels que soient vos concurrents ! et ce matin cependant j’avais signé le brevet ; je l’ai là.
Il le tira de sa poche, le froissa et le déchira.
— Je l’avais promis au duc d’Uzède, qui devait venir le prendre chez moi, ce matin même !
Tout à coup le ministre tressaillit.
— Qu’est-ce ? dit vivement Piquillo.
— Rien, répondit le duc en se remettant sur-le-champ ; ne le voyez-vous pas ? C’est lui qui s’avance.
En effet, le duc d’Uzède sortait en ce moment des appartements, et se dirigeait vers son père et vers le roi, qui se promenaient, lui avait-on dit, dans la grande allée du parc. Piquillo crut qu’une scène terrible allait avoir lieu ; à sa grande surprise, le duc accueillit son fils le sourire sur les lèvres.
— Vous venez, je le vois, mon cher duc, pour ce brevet d’aumônier de la reine, et vous me voyez dans un véritable chagrin… Je ne puis vous l’accorder.
— Vous me l’avez promis, mon père, dit Uzède en changeant de couleur.
— C’est vrai, répondit froidement le ministre, mais qui peut répondre de tenir ses promesses !
— Me manquer de parole, monseigneur, à moi ! votre fils !
— Justement. Il vaut mieux que cela tombe sur lui que sur un autre… Je trouverai plus d’indulgence pour ma position. J’ai eu la-main forcée. Vous vouliez donner cette place à Escobar ?
— Un homme de talent, mon confesseur.
— Je le sais bien ! celui qui dirige votre conscience, dit le duc avec un accent que Piquillo seul put comprendre ; mais le roi a préféré ce jeune religieux et m’a contraint de nommer le frère Luis Alliaga.
Piquillo, qui jusque-là avait baissé la tête, leva en ce moment un œil fier et menaçant sur le duc d’Uzède, qui, à son aspect, demeura atterré de surprise et de rage. Le ministre salua de la main le jeune moine et s’élança vers les appartements.
En apercevant le roi et Fernand d’Albayda, qui, revenus du bout de l’allée, s’avançaient pour le rejoindre, d’Uzède, humilié et furieux, courut au-devant du roi, près duquel il avait toujours été en grande faveur, et, certain de l’emporter sur un aventurier, sur un inconnu, il se plaignit avec amertume de l’injustice et de l’affront dont il était victime.
Le roi regarda Fernand avec un étonnement impossible à décrire, et dit gaiement à d’Uzède :
— Quoi ! votre père vous retire cette place qu’il vous avait promise ?
— Oui, sire. C’est indigne, n’est-ce pas ?
— Et il la donne au jeune frère Luis Alliaga ?
— Il vient de me le dire à l’instant même.
— C’est à confondre ! dit le roi.
— N’est-il pas vrai, sire ? et il prétend que c’est vous qui lui avez forcé la main, que c’est par votre volonté qu’un homme sans naissance, un homme de rien m’est préféré.
— Vous ne le croyez pas ? dit le roi, vous savez que le duc et votre oncle Sandoval nomment à toutes les places vacantes dans notre maison et dans celle de la reine, quitte à nous à ratifier leur choix.
— C’est ce que Votre Majesté ne fera pas ! s’écria d’Uzède.
— Pourquoi donc, moi qui n’ai pas l’habitude de contrarier votre père, commencerais-je aujourd’hui à l’égard d’un jeune homme de talent et de mérite, ami de don Fernand d’Albayda ?
En parlant ainsi, tous les trois arrivèrent à l’endroit de l’allée où Piquillo était resté.
— Je veux qu’on sache, dit le roi en posant sa main sur l’épaule du jeune religieux, que nous approuvons le choix de notre ministre, que nous tenons en haute estime le frère Luis Alliaga, et que nous le nommons dès aujourd’hui premier aumônier de la reine, sauf l’approbation de ma femme, ajouta-t-il gravement.
Le roi s’appuya sur le bras de Fernand et rentra dans ses appartements.
Le duc d’Uzède, confondu de tout ce qu’il venait d’entendre, resta seul avec Piquillo, qui fit un pas vers lui, et le regardant bien en face :
— Vous avez voulu que je fusse moine, monseigneur, lui dit-il ; n’accusez donc que vous-même de ma nomination, et rappelez-vous surtout que vous avez eu tort de me chasser, il y a un an, de votre hôtel ; on a souvent besoin d’un plus petit que soi !
Pendant ce temps, tout pâle, tout effrayé encore de ce qu’il venait d’apprendre, le duc de Lerma courut chez son frère Sandoval. Il trouva celui-ci dans le ravissement. Depuis plusieurs mois il s’était livré de nouveau et sans relâche à son rêve politique et religieux. Il avait repris, d’accord avec Ribeira, son projet favori, ce projet si utile, si glorieux pour l’Espagne et l’inquisition, l’expulsion des Maures. Forcé d’ajourner cette mesure, il ne l’avait jamais abandonnée. La volonté bien ferme de la reine, la protection évidente qu’elle accordait aux Maures, la crainte, si on se mettait en hostilité ouverte avec elle, de la voir se réconcilier avec le roi, s’emparer du pouvoir et favoriser le père Jérôme et la Compagnie de Jésus ; toutes ces considérations avaient, comme nous l’avons vu, suspendu la volonté opiniâtre de Sandoval, et arrêté le zèle fougueux de l’archevêque de Valence ; mais les torrents que l’on retient ne deviennent que plus furieux et finissent par briser toutes les digues.
Les deux prélats n’avaient pas renoncé à leur proie. Ils n’attendaient que l’occasion de la saisir, et, pensait Sandoval, cette occasion venait de nouveau se présenter. Selon lui, l’amour du roi pour Aïxa rendait nulle l’influence de la reine. Celle-ci aurait beau se réconcilier avec son royal époux, elle ne pouvait plus reprendre désormais aucun empire ni saisir comme autrefois le pouvoir. La protection qu’elle accordait aux Maures était donc nulle ; c’était donc le moment d’agir : il fallait faire signer au roi l’ordonnance de bannissement, ordonnance qu’il se chargeait d’exécuter, et pour cela il avait déjà dirigé vers Valence les deux ou trois régiments composant toute la force militaire dont l’Espagne pouvait alors disposer. Tel était l’admirable plan qu’il se complaisait à dérouler au duc de Lerma. Mais celui-ci l’interrompit en lui prouvant que jamais, au contraire, les circonstances n’avaient été plus défavorables pour l’exécution d’un tel projet ; que l’amour du roi pour Aïxa le rendait impossible.
— Et pourquoi ? s’écria Sandoval.
— Parce que Aïxa est Maure ! parce qu’elle est la fille d’Albéric Delascar !
— Est-il possible ! s’écria l’inquisiteur consterné… Et le roi le sait-il ?
— Le roi l’ignore.
— Il faut le lui apprendre… il faut tirer de là un moyen de succès, les perdre tous et elle-même la première ; nous aurons pour nous les foudres du Vatican, le pape, les cardinaux et l’excommunication.
— Eh ! s’écria le ministre avec impatience, ce n’est pas là le danger le plus grand ! Ministre et inquisiteur, nous songeons à anéantir quelques ennemis inoffensifs, et la monarchie, prête à s’écrouler, va nous écraser sous ses ruines.
Il lui raconta alors la ligue des protestants, dont le roi de France était l’âme et le chef. Il lui rappela tous les complots secrets que, depuis dix ans, l’Espagne tramait contre la France ; il était évident que Henni IV voulait rendre son éternelle ennemie incapable désormais de lui nuire ; que lui seul avait soulevé cet orage, que des préparatifs aussi immenses n’annonçaient point une entreprise ordinaire ; qu’un roi tel que Henri IV, le premier général de son siècle, à la tête d’une armée aussi formidable, devait et pouvait tout oser ; que la ruine et le démembrement de l’Espagne était son but ; que lui et ses alliés se la partageraient ou s’enrichiraient de ses dépouilles. Le ministre terminait en avouant que, dans l’état où étaient l’armée et le trésor, il n’avait aucun moyen d’empêcher le roi de France d’arriver jusqu’à Madrid.
Le grand inquisiteur était confondu.
— Mais pourtant, disait-il, Marie de Médicis et tous ses amis sont pour nous. D’Épernon nous est dévoué ; Éléonore Galigaï et Concini, Italiens devenus Français, sont Espagnols dans l’âme. Tous les galions arrivés du Mexique ont été employés à nous les gagner.
— Oui, s’écriait le ministre ; mais au Louvre, ce n’est pas comme à l’Escurial. Il y a autant d’intrigues, et plus peut-être ; mais les intrigues de cour n’influent en rien sur la marche des affaires, avec un homme aussi dur, aussi peu maniable que Sully, et un roi comme Henri, qui voit tout par lui-même.
— Mais cependant, grâce au ciel, il a des maitresses.
— Et beaucoup ; mais elles ne règnent pas le jour, et ne décident pas de la paix et de la guerre. Je ne vois donc, pour parer l’orage et l’empêcher d’éclater, aucune ressource possible, aucun moyen humain.
— Le ciel alors peut encore nous en fournir ! s’écria l’inquisiteur.
— Le pape et l’inquisition, foudres usées, armes émoussées, avec un ennemi comme le Béarnais ! Ne s’est-il pas fait catholique ! ne va-t-il pas à la messe… quand il a le temps ! Et cela ne l’empêche pas d’être à la tête du protestantisme contre le royaume le plus catholique du monde, contre l’Espagne, que nous avons inondée de moines et d’eau bénite ! Non, non, ne comptons point sur le ciel !
— Peut-être, dit l’inquisiteur, Mais enfin, s’il arrêtait le torrent qui nous menace, s’il détournait ou dissipait l’orage avant même qu’il eût le temps d’éclater, hésiteriez-vous encore à suivre nos avis à Ribeira et à moi ? Ne consentiriez-vous pas à nous accorder ce que nous vous demandons dans l’intérêt du ciel et de la foi ?
— Oui, oui, sans doute ! s’écria le duc, qui dans ce moment-là eût tout donné, tout accordé.
— Vous nous jurez donc, si la guerre n’a pas lieu, si tout s’arrange avec la France, de vous unir à nous pour l’expulsion des Maures ?
— Je vous le jure.
— De consacrer à cette grande œuvre tous vos soins et toutes les ressources du royaume ?
— Je vous le jure.
— Bien, bien, mon frère ; il y a encore de l’espoir ! Dieu combattra pour nous !
Le grand inquisiteur alla prier, et le ministre, qui n’avait qu’une médiocre confiance dans l’intervention céleste, songea, s’il ne pouvait sauver l’Espagne, à se sauver lui-même. S’il avait peu de prévoyance pour les intérêts du royaume, il en avait beaucoup pour les siens ; il avait perdu depuis deux ans sa femme, Félicité Henriquez de Cabrera, et dans sa douleur, il s’était fait ecclésiastique pour la forme. On n’avait vu là qu’un acte de piété ; c’en était un de haute prévision : il avait songé, si les dignités de la terre l’abandonnaient, à se réfugier dans celles de l’Église. On peut cesser d’être ministre, on ne cesse point d’être cardinal ni pape. Il ne pensait donc en ce moment qu’au cardinalat. Il avait déjà fait dans ce but quelques démarches qu’il fallait en ce moment rendre plus pressantes et plus actives, et pendant que son frère priait, il alla écrire à la cour de Rome.
Piquillo cependant était sorti, libre, puissant et protégé, de ce palais où il était entré presque comme prisonnier. Tout autre que lui eût été ébloui de sa fortune et de la perspective qui s’offrait à ses yeux… Aumônier de la reine, et bientôt sans doute en faveur près d’elle par le crédit d’Aïxa, protégé par le roi, qui lui accordait sa confiance intime, et tout-puissant déjà sur le duc de Lerma, dont il se trouvait posséder tous les secrets, le fils de la Giralda, le Maure, l’aventurier, le bohémien, l’obscur Piquillo préludait déjà, sans le vouloir et sans s’en douter, à la haute fortune où, quelques années plus tard, l’histoire nous montre le frère Luis Alliaga ; mais loin de lui alors toute idée d’ambition ; une seule pensée l’occupait, sauver Aïxa. Et peut-être, se disait-il, peut-être déjà est-il trop tard !
Aussi, et même avant de courir à l’hôtel de Santarem pour embrasser cette sœur chérie, Piquillo, en sortant du palais, dirigea ses pas vers la demeure de la comtesse d’Altamira.
La comtesse était souffrante et ne recevait pas.
— Il faut qu’elle me reçoive, répondit le moine d’une voix menaçante ; dites-lui que je suis Luis Alliaga.
Ce nom produisit sans doute son effet accoutumé. La comtesse, effrayée autant qu’étonnée d’une pareille visite, ordonna de faire entrer le jeune moine.
XLVIII.
le flacon.
La comtesse avait fait annoncer qu’elle était souffrante, et cette fois, elle avait dit vrai. Ses yeux plombés, son teint livide, annonçaient des nuits d’insomnie. Elle qui, depuis tant d’années, soutenait contre le temps une lutte victorieuse, semblait enfin cette fois avoir perdu la partie : elle n’était plus belle. Un mouvement nerveux et convulsif agitait ses traits, et sa parole brève et saccadée annonçait le dépit et l’impatience.
— Vous ici ! dit-elle à Piquillo. Qui vous amène ?
— Nous n’avons pas de temps à perdre, et je vais vous apprendre l’objet de ma visite. Renvoyez d’abord cette femme de chambre.
— Pour vous, mon jeune frère ? reprit la comtesse en essayant de sourire.
— Non, madame la comtesse, pour vous !
La femme de chambre sortit. Dès qu’ils furent seuls, dès que les portes furent bien fermées :
— Madame la comtesse, vous avez juré de perdre une jeune fille que moi j’ai juré de défendre. C’est Aïxa, ma sœur.
— Quelle idée ! répondit la comtesse en souriant avec ironie ; moi perdre la duchesse de Santarem ! elle n’a pas besoin de moi pour cela… et la favorite du roi…
— Saura défendre son honneur et sa réputation, vous pouvez vous en rapporter à elle, madame la comtesse, et comme vous dites très-bien, elle n’a pas besoin de personne pour cela. Mais il ne lui sera pas aussi facile de défendre ses jours contre de lâches complots.
— Qu’entendez-vous par là ? s’écria la comtesse en tressaillant.
Et elle regarda Piquillo d’un œil inquiet et menaçant.
— Ce que je veux dire, répondit tranquillement Piquillo, votre trouble suffirait pour me l’expliquer, si j’avais besoin d’explications. Mais nous ne sommes pas ici chez les révérends pères de la Compagnie de Jésus.
— En effet, dit la comtesse en cherchant à se remettre, vous n’y êtes plus ; on prétend que vous vous en êtes évadé.
— Oui, madame, chacun son goût ; je ne me plaisais pas à ce couvent ; il y a de grandes dames qui ne sont pas comme moi et qui s’y plaisent… Mais, contre l’ordinaire de ces bons pères, laissons de côté les détours, et parlons franchement.
Vous avez juré de vous défaire d’Aïxa, qui vous gène.
— Moi ! monsieur ! dit la comtesse avec hauteur et indignation.
— Vous voulez la tuer…
— Une pareille calomnie…
— Par le poison !
— Votre nouvel habit ne vous donnera point l’impunité, et je me vengerai de pareils outrages.
Elle voulut se lever pour sonner et pour appeler. Piquillo la prit par la main, et la forçant de se rasseoir :
— Vous n’appellerez pas et vous m’écouterez ! S’il n’avait fallu que vous perdre, je ne serais pas ici, j’aurais porté ma plainte au tribunal de l’inquisition, dont je suis membre aujourd’hui, et vous et vos complices, vous seriez déjà sous sa main redoutable ; mais vous êtes la tante de don Fernand d’Albayda et de Carmen, vous êtes la sœur de don Juan d’Aguilar, mon protecteur et mon père. C’est ce souvenir qui vous a sauvée… Je garderai le silence, mais à une condition, c’est que vous renoncerez à vos desseins, si déjà il n’est pas trop tard, si déjà, continua-t-il en voyant le trouble de la comtesse, ils ne sont pas exécutés…
— Moi ! dit la comtesse en tremblant de tous ses membres ; quels desseins ?
— Vous les connaissez mieux que moi ; mais Dieu les connait aussi.
Et, d’une voix grave et solennelle comme celle d’un juge qui prononce un arrêt, Piquillo ajouta :
— Vous avez reçu du père Jérôme un flacon en cristal.
La comtesse poussa un cri d’effroi.
— Fermé par un couvercle en or et orné d’une émeraude.
La comtesse cacha sa tête dans ses mains, et Piquillo continua :
— Ce flacon renferme un poison… poison lent et mortel.
La comtesse tomba à genoux en étendant les bras.
— Bien, vous voilà à votre place ; mais vous n’avez pas besoin de me prier : ce n’est pas à moi, je vous l’ai dit, c’est à votre noble frère don Juan d’Aguilar que vous devez votre grâce. Il nous contemple tous deux en ce moment, et en son nom, madame, vous allez me remettre ce flacon.
— Moi ! dit la comtesse en jetant sur Piquillo un regard épouvanté.
— À l’instant même. Je ne puis laisser entre vos mains une arme pareille, dont vous comptiez vous servir contre ma sœur… et peut-être… contre moi. Vous allez donc me le rendre.
— Mais, mon père…
— Je le veux ! dit Piquillo d’une voix menaçante, ou don Juan d’Aguilar ne pardonnera pas, ni moi non plus.
La comtesse se leva en chancelant, ouvrit un petit meuble fermé à clé et prit le flacon.
— Au moins, monsieur, dit-elle en s’avançant vers Piquillo, vous m’apprendrez comment ce secret a pu être découvert par vous.
— C’est ce que vous ne saurez jamais ! s’écria Piquillo en observant le regard faux de la comtesse.
Et il ajouta avec intention :
— Je me réserve ce moyen pour connaître ainsi à l’avenir et sur-le-champ tous les complots que vous pourriez tramer encore.
La comtesse ne put retenir un mouvement de dépit et de rage qu’elle se hâta de réprimer, et elle remit le flacon à Piquillo.
Il le regarda et poussa un cri de terreur On s’était servi du flacon ! C’était évident, car il n’était plein qu’aux trois quarts, Piquillo pâlit, une sueur froide inonda son visage, et, près de tomber, il s’appuya contre un meuble. La comtesse s’élança vers lui ; Piquillo reprit toute sa colère, et n’ayant plus désormais qu’à venger sa sœur, il s’écria :
— Le crime est consommé !… Je ne vous dois plus rien, ni pardon, ni pitié !
Il fit un pas pour sortir. Elle se jeta à ses pieds.
— Je vous jure, lui dit-elle, que je ne me suis point servie de ce flacon. Il m’a été remis tel que vous le voyez par le père Jérôme… Je vous le jure ! monsieur… je vous le jure !
Et voyant Piquillo qui, saisissant avidement cet espoir, s’arrêtait et paraissait hésiter, elle lui cria avec un accent de franchise qui semblait partir du cœur :
— Vous le savez bien, monsieur, puisque vous connaissiez ce flacon, puisque vous l’avez vu et tenu dans vos mains avant qu’il me l’eût remis.
— Ainsi donc, les jours d’Aïxa ont été respectés ?
— Elle n’a rien à craindre, répondit la comtesse avec un trouble visible.
— Vous me le jurez ?
— À quoi bon mon serment ?.. vous verrez bien par vous-même que j’ai dit la vérité… Et le regardant d’un air curieux, elle ajouta : puisque vous connaissiez les effets de cette liqueur.
— Oui, dit Piquillo, c’est dans un mois… un mois seulement, qu’elle doit commencer à donner la mort, et depuis dix jours ce flacon est entre vos mains.
— Eh bien ? si je vous avais trompé, si le moindre danger menaçait… ou semblait menacer la personne que vous protégez, vous seriez toujours comme aujourd’hui, à même de me perdre !
— Et rien alors n’arrêterait ma vengeance, dit Piquillo, vous pouvez en être sûre. Quant au père Jérôme et à Escobar, que je ne pourrais frapper sans vous atteindre, dites-leur à quelle condition je pardonne ; qu’ils aient soin, comme vous, de respecter Aïxa. À ce prix, trêve entre nous, je le veux bien ; sinon la guerre ! Adieu, madame la comtesse.
Le soir même, la terreur régnait au couvent de Hénarès et parmi les révérends pères de la Société de Jésus.
Comment Piquillo s’était-il emparé de leur secret ? C’était inexplicable, magique, diabolique ! ni la comtesse, ni les moines ne pouvaient le deviner… Mais quand Escobar apprit plus tard qu’il fallait renoncer à ses espérances, qu’il n’était point aumônier de la reine, que cette place qui lui avait été promise et même accordée, venait de lui être enlevée par Piquillo :
— L’ingrat ! s’écria-t-il, moi qui l’ai éclairé, baptisé et ordonné !
Les bons pères étaient contre leur ancien frère et disciple dans un tel état d’exaspération, qu’une guerre à mort lui fut jurée. En conséquence, on proposa d’abord de lui faire des offres de paix, d’alliance et d’amitié.
— Il ne s’y laissera pas prendre, dit Escobar, il est notre élève.
— Il l’a été si peu ! répondit le supérieur.
— C’est égal. Ce qu’on apprend chez nous ne s’oublie pas. Les premiers principes restent toujours.
— D’ailleurs, poursuivit le révérend père Jérôme, cet homme qui prétend connaître nos secrets, ne se doute pas du plus important ; sans cela il aurait parlé !
— C’est vrai, dit la comtesse.
— Ou il aurait pris des mesures en conséquence, surtout maintenant.
— C’est juste, dit la comtesse avec joie.
Dès ce moment elle respira plus à l’aise et commença à se rassurer. Il y avait, en effet, un événement récent bien autrement grave, un terrible secret qu’ignorait Alliaga, et c’est là-dessus que le père Jérôme et ses amis fondèrent dès ce moment leurs espérances et le succès de leurs nouveaux complots.
Depuis quelques jours cependant Piquillo avait revu Aïxa, dont la joie à son aspect avait été si vive et si tendre, qu’une telle amitié devait, selon lui, suffire au bonheur de toute une existence. Demeurant à l’hôtel de Santarem, où sa sœur l’avait retenu, il voyait ses plus doux rêves réalisés. Du matin au soir, ses jours s’écoulaient près d’Aïxa. C’est à lui maintenant qu’elle confiait ses joies, ses peines, ses plus secrètes pensées, non pas toutes peut-être ; mais celles qu’elle lui cachait, elle eût voulu se les cacher à elle-même. Occupée sans cesse de ce frère chéri, elle cherchait, par les soins les plus empressés et les plus assidus, à embellir la vie d’épreuves et de sacrifices qu’il avait acceptée pour elle. C’est elle-même qui avait veillé à l’arrangement de son appartement et surtout de sa bibliothèque ; tout ce que le luxe et l’opulence peuvent ajouter de bien-être et de charmes à nos jours, elle ne se lassait pas de le lui prodiguer, bien qu’il n’y fit pas attention. Les instants qu’elle ne passait pas à la cour, c’est à lui qu’elle les consacrait. Entre sa sœur et Carmen, Piquillo avait retrouvé le temps le plus heureux de sa vie, les longs entretiens et les douces soirées de l’hôtel d’Aguilar. Des trois amis, Carmen était la plus gaie, la plus heureuse. Déjà la moitié du mois était écoulée, et elle voyait approcher le moment objet de tous ses vœux, celui où elle allait être unie à Fernand.
— Oui, disait Aïxa en s’efforçant de sourire, Carmen va se marier ; dans quinze jours, elle épousera celui qu’elle aime et dont elle est aimée, et dans ta nouvelle situation, frère, une consolation du moins te sera réservée, c’est toi qui les béniras.
— Je l’espère bien, disait Carmen, et mon bonheur sera plus grand encore, puisqu’il me viendra de notre meilleur ami.
— Hélas ! s’écria celui-ci, craignez plutôt que je ne vous porte le malheur qui partout m’accompagne.
— Pas ici du moins, disait Aïxa, car vois-tu bien, frère, notre vie se passera ainsi : toi, Yézid et moi nous ne nous quitterons plus !
Et elle lui répétait le projet qu’elle avait formé et qu’elle avait déjà dit à la reine, celui de ne jamais se marier.
Cette idée seule comblait tous les vœux du pauvre moine, elle lui faisait oublier ses souffrances et ses sacrifices, et il se serait cru heureux, sans une inquiétude de tous les instants qui troublait le repos de ses nuits et le charme de ses jours : malgré les serments de la comtesse, il n’était qu’à moitié rassuré. Elle avait pu le tromper, pour gagner du temps et pour échapper à sa vengeance. Chaque jour il interrogeait les traits d’Aïxa, avec doute d’abord, puis avec crainte, et enfin avec angoisse, car il ne pouvait se dissimuler le changement qu’il remarquait en elle : plus le mois avançait, plus Aïxa paraissait pâle et souffrante. Carmen et même Yézid ne s’apercevaient de rien. Quant à Fernand, il ne levait presque jamais les yeux sur elle et ne venait guère qu’aux heures où elle était à la cour ; mais rien n’échappait à l’œil clairvoyant de Piquillo. Cette sœur sur laquelle étaient concentrées toutes ses affections lui semblait en proie à un abattement et à une faiblesse extrêmes : elle voulait marcher, et s’arrêtait épuisée ; elle cherchait vainement à s’égayer avec Carmen et à prendre part à sa joie, le rire expirait sur ses lèvres glacées.
Un jour, Piquillo la regardait, pâle lui-même, et tremblant d’effroi.
— Qu’as-tu donc, frère, à me regarder ainsi ? lui dit-elle.
— Tu me sembles changée.
— Moi ! dit Aïxa en rougissant, je ne le crois pas.
— Quoi ! tu ne ressens pas une souffrance secrète, intérieure ?
— Qui te le fait croire ?
— Je le vois, je le devine.
Et Aïxa, qui tout à l’heure avait rougi, devint pâle comme la mort.
— Tu le vois bien ! s’écria Piquillo, Tu veux vainement me le cacher… Avoue-moi ce que tu éprouves ; apprends-moi tout.
— Tais-toi… ne me demande rien, dit Aïxa presqu’à genoux.
— Je sais le danger qui te menace.
— Il n’y en a pas.
— Plus que tu ne crois, et pour t’en préserver, s’il en est temps encore, j’aime mieux te faire connaître la vérité.
— Quelle qu’elle soit, je puis l’entendre ! parle donc, frère, parle ?
Et rassemblant tout son courage, Aïxa écouta, froide et immobile comme une statue.
Piquillo lui raconta alors l’horrible projet de la comtesse, la manière dont il l’avait découvert, et la visite que dernièrement il avait faite à l’hôtel d’Altamira.
À mesure qu’il parlait, Aïxa revenait à elle : ses joues et ses lèvres si pâles reprenaient leur couleur ; son front, sa sérénité, et son cœur, tout son calme.
— Quoi ! lui dit-elle, quand il lui eut raconté le complot formé contre sa vie, ce n’est que cela !
— Que cela ! dit Piquillo étonné de sa tranquillité ; quoi ! tu n’es pas plus émue ! Tu ne m’as donc pas entendu quand je t’ai parlé de ce flacon de cristal… de ce poison qui donnait la mort ?
— Eh bien ? dit Aïxa.
— Eh bien, si tu en étais victime ?
— Plût au ciel, frère ! s’écria-t-elle avec égarement.
— Que veux-tu dire ?
— Qu’au lieu d’arrêter la comtesse, il fallait la laisser faire.
— Et pourquoi ?.. Réponds-moi.
— Pourquoi, pourquoi ? dit-elle en revenant à elle… Je suis folle… J’ai là, vois-tu bien, et elle porta la main à son cœur et à sa tête… une douleur aiguë qui ne me quitte pas, et c’est une souffrance telle que je me dis parfois qu’il vaudrait mieux mourir… Mais cela se passera, je te le jure. Rassure-toi, frère !
— Non, non, je ne me rassure pas. Te rappelles-tu, depuis l’époque dont je t’ai parlé, t’être trouvée avec la comtesse ?
— Une ou deux fois à la cour… Mais je ne lui ai pas parlé.
— Tu n’as rien reçu de sa main ?
— Non, frère… J’ai beau chercher, non.
— Aucun aliment, aucun breuvage ?
— Aucun, je te jure !
— Et cependant, s’écria Piquillo, ce flacon dont on s’était servi !..
— Ce flacon, dit Aïxa ; montre-le-moi.
— À quoi bon ?
— Pour le voir ! il ne m’est pas défendu d’être curieuse.
— Tiens, sœur, le voici.
Elle l’examina avec attention.
— C’est singulier ! dit-elle.
— Qu’en veux-tu faire ?
— Le briser…
— Non pas !… Pour effrayer la comtesse, il faut qu’elle le sache toujours entre nos mains, ne fût-ce que comme preuve de son crime !
— Eh bien ! je le garderai.
— Soit ; mais prends bien garde !
— Sois tranquille, et ne crains rien, dit-elle en lui serrant la main.
Malgré cette promesse, Piquillo continua à observer, et plus le mois avançait, plus les souffrances intérieures d’Aïxa semblaient augmenter ; mais, hormis son frère, personne ne le remarquait. Il est vrai que la jeune fille, habile à les cacher, épuisait son courage devant les autres et ne craignait pas de se trahir devant ce frère bien-aimé, qui la regardait sans rien dire et souffrait de sa douleur : c’était presque la calmer !
L’époque du mariage approchait. C’était dans deux : jours. La reine y prenait le plus vif intérêt. Elle avait déclaré qu’elle voulait l’honorer de sa présence, et désirait qu’il fût célébré avec pompe dans la chapelle même du palais. Elle s’était entretenue à ce sujet : avec son premier aumônier, qu’elle avait tout d’abord accueilli avec une grande faveur. C’était le frère d’Aïxa et de Yézid, et d’ailleurs, le jeune Luis Alliaga avait assez de mérite pour se faire remarquer, même sans protection. Il était donc aumônier de fait, mais il n’avait pas encore son brevet ; ce brevet l’attendait au palais de la saint inquisition, et il résolut de l’aller prendre avant la célébration du mariage de Carmen. En même temps il avait à commander des messes pour le repos de l’âme de la senora Urraca. En effet (et nous avons oublié de faire part de sa perte au lecteur) Piquillo, dès qu’il avait été libre, avait couru à Madrid à l’hôtel de Vendas-Nuevas, où il avait laissé sa grand’mère. L’excellente femme, qui s’était convertie à la fin de ses jours, était morte depuis plusieurs mois dans les sentiments les plus chrétiens, tout en parlant toujours des succès de la Giralda, sa fille, des cabales de Lazarilla, et en priant Piquillo, son petit-fils, de faire dire à son retour des messes à son intention.
C’est ce devoir dont il allait s’acquitter. Il s’adressa pour cela à son ami, le greffier, Manuelo Escovedo, qui enregistra sa commande, et passa au secrétariat pour chercher le brevet de l’aumônier de la reine ; pendant que celui-ci se promenait dans la pièce d’attente où se pressaient plusieurs solliciteurs, arriva un homme d’une tournure étrange ; il était vêtu de noir et portait un manteau des plus râpés, il pouvait avoir de vingt-neuf à trente ans : le front jaune, le teint bilieux, les lèvres pâles et minces ; il s’avançait d’un air sombre et les yeux baissés.
— Pauvre solliciteur ! se dit Piquillo, le voilà tel que j’étais il y a trois semaines ! Arrivé des derniers, il ne risque rien d’attendre.
Il se trompait. L’inconnu, en apercevant la foule qui obstruait le passage, leva un œil hagard ; ses traits s’animèrent, et avec l’air et l’accent d’un inspiré, il s’écria :
— Place ! place ! Cœli, aperite portas !
La foule étonnée s’écarta pour voir d’où partait cette voix singulière, et l’huissier qui gardait la porte s’avança vers l’inconnu. Chacun crut que c’était pour le renvoyer ; au contraire, l’huissier du saint-office lui dit d’un air de déférence :
— Suivez-moi.
L’inconnu avait repris son air sombre : il baissa les yeux, et croisant ses mains sur sa poitrine, entra dans le cabinet du grand inquisiteur. Un sourd murmure de mécontentement circula dans la foule des solliciteurs désappointés qui attendaient depuis le matin. Ce qui redoubla leur mauvaise humeur, c’est que le nouveau venu, abusant de ses avantages, prolongea son audience d’une manière démesurée.
Pendant ce temps revint le greffier Manuelo.
— Pardon, mon frère, dit-il à Piquillo, de vous avoir fait attendre si longtemps. Votre brevet était signé ; mais pour que tout fût en règle, il a fallu y faire apposer le sceau du saint-office. C’est ce qui m’a retardé.
En ce moment la porte du grand inquisiteur s’ouvrit, et l’inconnu sortit aussi gravement qu’il était entré.
— Connaissez-vous cet homme ? dit Piquillo au greffier.
— Non ; tout ce que je sais, c’est qu’il n’est pas Espagnol, il est Français ; d’après ses papiers, que j’ai lus, il est né à Angoulème, où il était maître d’école.
— Et son nom ?
— Son nom ? dit le greffier. On le nomme Ravaillac, et il retourne en France.
XLIX.
le mariage.
Aïxa n’était pas le seul sujet de crainte pour Piquillo. Yézid excitait aussi ses inquiétudes. Il n’était plus le même ni pour son frère ni pour ses amis. Fernand d’Albayda, qui l’aimait tendrement, ne pouvait revenir d’un changement pareil.
— Qui aurait jamais cru cela de lui ? disait Fernand à Carmen. Yézid est ambitieux.
— Ambitieux ! disait la jeune fille.
— Oui, matin et soir il est à la cour, il n’en sort pas. J’ai cru d’abord que c’était pour veiller sur sa sœur Aïxa et la protéger.
— C’était tout naturel, dit Carmen.
— Certainement, s’écria vivement Fernand ; c’était bien ! il avait raison, je l’approuvais ; mais, même en l’absence d’Aïxa, il ne quitte pas les salons de réception. Il n’y a pas de courtisan plus fidèle et plus assidu. Ce spectacle, auquel ses yeux n’étaient pas habitués, ces titres, ces honneurs, ces cordons, l’ont ébloui et séduit… Lui aussi veut parvenir !
— À quoi ! demanda ingénument Carmen.
— Je l’ignore… car d’après les lois de Philippe II, lui qui est Maure et qui n’a pas été baptisé, ne peut occuper aucune place, aucun emploi…
— Ne peut-on pas le servir et l’aider ?
— C’est fort difficile. D’abord il ne demande rien jusqu’à présent, et l’on ne sait pas encore ce qu’il veut ; mais quel que soit l’objet de ses désirs, il aura grand’peine à réussir, malgré l’influence d’Aïxa et malgré même le crédit de Piquillo, qui commence à en avoir beaucoup. En attendant, ce pauvre Yézid n’est pas reconnaissable ; lui, le type de la beauté et de l’élégance ; lui, le plus charmant cavalier d’Espagne, a perdu toute sa fraicheur ! il dessèche, il maigrit, et ce caractère si bon, si ouvert, si enjoué, s’est changé en une humeur taciturne, sombre et mélancolique.
— Ah ! s’écria Carmen en soupirant, ce que c’est que l’ambition !
Ce que disait Fernand était vrai. Yézid dépérissait chaque jour, et Piquillo était désolé. Il suivait, il voyait les ravages d’un mal secret. Yézid était en proie à une fièvre ardente ; parfois des larmes roulaient dans ses yeux ; son cœur, plein de sanglots, paraissait prêt à éclater, et quand Piquillo le serrait dans ses bras, s’écriant :
— Ne suis-je pas là pour te plaindre, pour te consoler, pour pleurer avec toi ! parle, mon frère, dis-moi tout.
— Je ne le puis ! je ne le puis ! répondait Yézid. Mais reste là, près de moi, ta vue me fait du bien.
Aïxa lui en disait presque autant, et Alliaga, plus malheureux peut-être qu’eux tous, était leur appui et leur consolation. Sa vie se passait à alléger des peines qu’il ne connaissait pas et qu’il partageait. Oubliant ses maux pour ne penser qu’aux leurs, il accomplissait noblement sa tâche et le vœu qu’il avait fait de se dévouer pour les siens. Sur lui seul retombait leurs douleurs, et loin de succomber sous le poids, il puisait chaque jour de nouvelles forces dans l’ardent et sublime amour qui remplissait son cœur, dans l’abnégation de lui-même, et, s’il faut le dire aussi, dans cette religion qu’il avait embrassée par contrainte et qu’il commençait à aimer, car c’est l’amie du pauvre et du faible, c’est la religion des cœurs souffrants et blessés.
Yézid avait été réveillé de son accablement par un mot de son père.
— Viens, mon fils, j’ai besoin de toi, viens sur-le-champ.
Et quelque grand que fût sur lui, comme le disait Carmen, le pouvoir de l’ambition, quels que fussent les liens qui le retenaient à la cour, Yézid pouvait tout leur sacrifier, excepté le devoir, et son premier devoir était d’obéir à son père ; un seul mot du vieillard était un ordre pour lui. Il courut donc chez Aïxa pour lui annoncer son départ. Les deux enfants du Maure se regardèrent tous les deux en silence, avec effroi, et les yeux pleins de larmes.
— Mon frère ! mon frère ! dit Aïxa, tu as donc bien souffert ?
— Et toi donc, ma sœur ?..
— Oui, lui dit-elle à demi-voix, en lui montrant son cœur, le mal est là, je le sens !
— Et moi aussi, dit Yézid.
Et il s’enfuit ; il s’éloigna de Madrid et de la cour, dont l’air était mortel pour lui.
Cependant le grand jour approchait, il allait arriver. C’était la veille du mariage de Fernand et de Carmen. Celle-ci, tout entière à son bonheur, ne pouvait s’occuper de rien ; Aïxa s’était chargée de tous les ordres et de tous les détails. Elle avait surveillé jusqu’aux bijoux, jusqu’à la parure de la mariée ; son courage avait doublé ses forces, et puis une idée la soutenait, cette idée qui fait que l’ouvrier ou le voyageur épuisé se ranime en apercevant la fin de sa tâche.
Le soir, elle avait défendu sa porte. Elle était dans un petit salon avec Carmen, qui lui parlait de son bonheur. Aïxa accomplissait son dévouement jusqu’au bout : elle avait le courage de l’écouter et de lui sourire. On vint annoncer à Carmen sa robe de mariée à essayer pour le lendemain. Elle poussa un cri de joie et donna à son amie le baiser d’adieu comme ne devant plus la revoir, car c’était une longue et importante affaire qui devait probablement la retenir le reste de la soirée.
Aïxa, soulagée par ce départ qui l’affranchissait de toute contrainte, respira plus librement, et laissant tomber sa tête sur sa poitrine, elle goûta le seul instant de bonheur qui lui était donné dans cette journée, celui d’être malheureuse à son aise.
Un bruit de voiture l’interrompit dans sa rêverie, Qui donc, lorsqu’elle avait annoncé qu’elle voulait être seule, pouvait ainsi pénétrer chez elle ? À l’une des deux extrémités du salon, le double rideau de tapisserie qui formait la portière s’entr’ouvrit, et elle vit paraître don Fernand d’Albayda.
— Pardon, senora, lui dit-il d’un air troublé, on m’avait annoncé que Carmen était avec vous dans ce salon.
— Elle y était tout à l’heure encore, et je crains que vous ne puissiez la voir en ce moment, elle essaie sa robe de noce.
— Ah ! en effet, dit Fernand, dont l’embarras redoublait. Je crois qu’il ne serait pas convenable… d’ailleurs… cette robe… demain je la verrai… et ce soir peut-être… ce serait contrarier Carmen.
— Et vous ôter à vous le plaisir de la surprise, ajouta Aïxa en souriant.
— Comme vous dites, senora, répondit Fernand.
Pendant quelques instants ils gardèrent tous les deux le silence, silence que le trouble de Fernand rendait surtout embarrassant et pénible, car Aïxa avait déjà retrouvé son calme apparent. Aussi elle s’empressa de prendre la parole et d’entretenir Fernand avec une aisance gracieuse de la cérémonie du lendemain, de l’honneur que la reine lui faisait en daignant y assister.
Fernand ne répondait rien.
Aïxa lui parla alors de Carmen, de sa beauté, de ses vertus, et surtout de l’amour immense, dévoué et sans borne qu’elle portait à son amant, à son mari.
Fernand, pâle, les yeux baissés et le cœur oppressé, ne l’écoutait pas. Enfin Aïxa lui montra du doigt l’aiguille de la pendule.
— Il est tout naturel, lui dit-elle en souriant, qu’un prétendu s’oublie chez sa fiancée. Mais cependant il est tard, et demain vous devez être ici de bonne heure.
Elle se leva. Fernand se leva aussi, et prêt à partir, il lui dit :
— Écoutez-moi ! Ce que vous avez voulu, je l’ai fait ; je vous ai obéie. Ce sacrifice que je croyais impossible… demain sera accompli.
Aïxa, à son tour, garda le silence.
— Fidèle à l’honneur et au devoir, j’aurai tenu les serments que j’ai faits à don Juan d’Aguilar et à vous !… n’exigez rien de plus.
Aïxa le regarda avec étonnement.
— Oui, si j’ai résisté à tous les tourments que j’endurais, si j’ai eu la force de vivre, c’était pour tenir ma promesse, c’était pour donner ma main et mon nom à la fille de don Juan d’Aguilar. Une fois ce devoir rempli, je suis quitte de tout… maître de mes jours, Je puis en disposer… et demain, Aïxa… demain j’aurai cessé de souffrir, adieu !
— Fernand ! s’écria-t-elle, restez, restez, je vous l’ordonne.
Fernand s’avançait pour ouvrir la portière ; il resta immobile.
— Non, monsieur, continua Aïxa, vous ne serez pas quitte de votre serment. Le tenir ainsi, c’est le parjurer, c’est forfaire à l’honneur ! vous n’avez pas seulement promis à don Juan d’Aguilar de donner votre main et votre nom à sa fille. Que vous a-t-il dit ! j’étais là, je l’ai entendu. Il vous a confié le bonheur de son enfant. Rends-la heureuse ! s’est-il écrié. Et vous, don Fernand d’Albayda, en noble gentilhomme, et levant la main au ciel, vous avez répondu : je le jure ! et ce serment, vous pensez le tenir en privant Carmen de tout son bonheur, en lui enlevant celui qu’elle aime, en la condamnant au veuvage, à des pleurs éternels, à la mort peut-être ! Que don Juan d’Aguilar se lève et juge entre nous !
— Vous pouvez avoir raison, dit Fernand en baissant la tête ; mais autrement elle serait plus malheureuse encore. J’aime mieux qu’elle me pleure mort que de me haïr infidèle. Je n’aurais jamais, je le sens, ni l’adresse, ni la force, ni le courage de lui cacher l’amour qui bat dans mon cœur. Il a triomphé de moi et de ma raison. J’y succombe.
— Eh ! que diriez-vous donc, vous Fernand, homme de cœur et brave militaire ; que diriez-vous d’un de vos soldats qui, jugeant le danger trop grand, ou l’ennemi trop redoutable, fuirait plutôt que de combattre ? quel nom lui donneriez-vous ?
— Ah ! dit Fernand en rougissant de honte, ce serait un lâche !
— Vous ne l’imiterez pas ! quelque difficile que soit votre tâche, vous la remplirez. Vous saurez vous vaincre vous-même ; vous commanderez à votre cœur, à vos regards ; vous aurez le courage enfin d’être malheureux pour qu’elle soit heureuse !
— C’est impossible !
— Impossible ? dit Aïxa avec mépris, impossible d’avoir ce courage !.. Je l’ai bien, moi ! qui ne suis qu’une femme !
À ce mot, Fernand poussa un cri d’ivresse et étendit les bras vers Aïxa.
— Taisez-vous !… taisez-vous ! lui dit-elle ; ce mot qui est échappé à mon trouble ; ce mot qui devrait me couvrir de honte, je ne le regretterai pas, s’il vous donne le courage de m’obéir.
— Tout m’est possible maintenant ! parlez, commandez !
— Eh bien ! comme don Juan d’Aguilar, moi aussi, je vous confie le bonheur de Carmen, ma sœur et mon amie. Que tous vos instants soient consacrés à la rendre heureuse, tous vos efforts à oublier un autre amour, et tous vos soins à le cacher. Vous partirez dès demain avec elle ; la reine, que j’implorerai, vous fera nommer gouverneur, ou de Valence ou de Grenade. Vos services et votre naissance vous donnent le droit d’aspirer à tout.
— Et vous, Aïxa ! vous !..

— Moi, je vous dirai : En agissant ainsi, vous me réhabiliterez à mes propres yeux. Ce sentiment dont je rougissais tout à l’heure, j’en serai presque fière, en pensant qu’il était si dignement placé. Partez donc, Fernand, partez avec mon estime, avec mon amitié ! Quant à moi, ne vous en inquiétez pas. Je suis déjà habituée au malheur ; s’il est plus grand que mes forces… si j’y succombe, vous vous direz (et cela vous donnera peut-être consolation et courage), vous vous direz : Je n’étais pas seul à souffrir.
Fernand, hors de lui-même, s’écria :
— J’obéis ! j’obéis ! je serai digne de vous ! mon courage égalera le vôtre, et dussé-je aussi en mourir, je jure devant vous le bonheur de Carmen !
— Taisez-vous, dit Aïxa en écoutant… N’avez-vous pas entendu le froissement d’une étoffe ?
— Non… non, dit Fernand, je n’entends rien, si ce n’est le vent qui agitait cette draperie que tout à l’heure j’ai vue remuer.
Et il montrait une des portières du salon.
— Adieu ! adieu ! dit Aïxa, il est tard ; partez !.. et à demain.
Elle reconduisit Fernand jusqu’à la seconde pièce, rentra dans celle qu’elle venait de quitter, et dit en écoutant encore :
— C’est singulier… J’avais cru entendre marcher tout à l’heure dans la pièce voisine !
Elle y regarda, il n’y avait personne ; elle rentra dans sa chambre en se disant :
— Je m’étais trompée.
Non, elle ne s’était pas trompée.
Pendant que Carmen essayait sa robe de mariée, elle avait entendu un carrosse rouler dans la cour de l’hôtel ; elle connaissait le bruit de cette voiture, et donna ordre à l’une de ses femmes de voir si ce n’était point celle de Fernand d’Albayda.
La femme revint et dit :
— Le seigneur d’Albayda vient d’arriver ; je lui ai annoncé que la senora ne serait point visible ce soir.
Carmen eut d’abord un mouvement d’impatience qu’une autre idée sans doute lui fit bien vite oublier ; car elle répondit en souriant :
— C’est à merveille !
— Et le seigneur Fernand est entré chez madame la duchesse de Santarem.
— Dépêchez-vous alors de m’habiller.
Lorsque enfin, et non sans peine, on eut étudié cette robe qui, par le plus grand des hasards, se trouva aller bien, quoique ce fût la seconde fois seulement qu’on l’essayât, Carmen voulut la garder quelques instants encore, et dit :
— Laissez-moi maintenant.
Son idée était de descendre ainsi habillée dans le salon où était son mari et son amie, pour leur faire une surprise, ou plutôt pour que Fernand vît le premier et avant tous les autres une toilette qui, le lendemain, appartiendrait à tout le monde. Quand ses femmes se furent retirées, elle descendit donc, tout doucement et sans lumière, sur la pointe du pied, se dirigea vers le petit salon, souleva la première portière en tapisserie, et au moment où elle allait écarter la seconde, elle entendit prononcer son nom.
— Ah ! ils s’occupent de moi, se dit-elle avec émotion et reconnaissance. Écoutons.
Elle écouta, en effet, et au bout de quelques secondes, tout son bonheur était détruit, toute son existence était brisée. Elle avait, il est vrai, la plus noble et la plus généreuse des amies… mais cette amie… Fernand l’adorait… il en était aimé… C’était pour obéir à don Juan d’Aguilar, c’était pour tenir un serment que Fernand l’épousait : ce dévouement allait peut-être coûter la vie aux deux seuls êtres qu’elle aimât sur la terre !
— Plus pâle et plus blanche que sa robe de mariée, la pauvre fille, en habits de fête et couverte de fleurs, écoutait son arrêt et se sentait mourir. Elle voulut leur crier : Ingrats, je vous pardonne, soyez heureux… moi, je meurs !
La voix expira sur ses lèvres : prête à se trouver mal, elle fit un pas en arrière et se retint à la première portière, celle qu’elle avait déjà franchie. Ce fut dans ce moment qu’Aïxa avait cru entendre du bruit. Elle s’était empressée de renvoyer Fernand, et Carmen, la tête perdue, égarée, était remontée chez elle, ne demandant plus au ciel qu’une grâce… celle de mourir.
Le lendemain, l’hôtel de Santarem retentissait d’un mouvement inusité. Les domestiques montaient, descendaient les escaliers, transportaient des couronnes de fleurs. La musique du régiment que commandait Fernand d’Albayda faisait retentir la cour de l’hôtel de ses joyeuses aubades. Les pages de la reine arrivaient chargés de présents que Sa Majesté envoyait à la mariée.
Les deux portes de l’hôtel s’ouvraient aux nombreuses voitures des grands d’Espagne et des nobles dames.
On vit d’abord entrer celle de la comtesse. Comme tante de Carmen et de Fernand d’Albayda, elle était invitée de droit. C’était elle qui devait conduire sa nièce à l’autel. Aussi arriva-t-elle la première. Mais au lieu d’entrer dans la salle de réception, elle monta à la chanbre de Carmen, pour surveiller la toilette de la mariée, et aussi pour lui donner sa bénédiction.
Aïxa cependant, debout au milieu de son salon, belle et pâle, le sourire sur les lèvres, la mort dans le cœur et le front étincelant de diamants, recevait les conviés, et faisait les honneurs avec la grâce et la dignité d’une reine. Deux portes s’ouvrirent presque en même temps. Par l’une entra don Fernand d’Albayda, richement habillé et décoré des insignes de grand d’Espagne. À l’autre porte apparut un jeune prêtre, qui s’avançait calme et résigné. Au milieu de cette foule dorée, il ne voyait qu’une personne… Aïxa ! et il s’effraya de sa pâleur. Quant à Fernand, à la vue de celui qui allait consacrer son union, il avait tressailli ; mais ses yeux rencontrèrent en ce moment ceux d’Aïxa, et il retrouva tout son courage. On n’attendait plus que la mariée : elle ne paraissait pas ; chacun s’étonnait de ce retard. Enfin la porte s’ouvrit.
L.
le vœu à la vierge.
Au lieu de la jeune fiancée, au lieu de Carmen, on vit paraître la comtesse d’Altamira dans le plus grand désordre et tout effrayée. Soit que ce trouble fût affecté ou véritable, elle raconta qu’étant montée, en arrivant, chez sa nièce, elle l’avait trouvée en proie à une fièvre ardente, ou plutôt à un délire étrange, à en juger par les phrases entrecoupées et sans suite qu’elle avait entendues ; et que cet accès devenait tellement violent que si on ne parvenait à le calmer, elle prévoyait le danger le plus grave.
Fernand et Aïxa coururent près de Carmen ; Piquillo les suivit, pendant que tous les conviés se dispersaient fort étonnés d’un tel événement, les dames surtout, qui se disaient : c’est la première fois que l’excès du bonheur aura produit un pareil effet.
Le lendemain et les jours suivants la reine, inquiète de ne voir ni Aïxa ni Piquillo, envoya savoir des nouvelles de leur jeune amie, et pendant huit jours on répondit qu’on désespérait de Carmen. Pendant huit jours, ni Aïxa, ni Piquillo, ni Fernand, ne quittèrent la pauvre jeune fille. Fernand, à genoux près de son lit, demandait au ciel la guérison de sa fiancée, à laquelle il jurait un amour éternel, et il disait vrai. Il ne croyait pas autant l’aimer. Piquillo priait pour l’amie de son enfance, pour la fille de don Juan d’Aguilar ; et Aïxa, pressant dans ses mains la main de Carmen, murmurait tout bas à son oreille : Je te suivrai, ma sœur, tu ne mourras pas seule !
Enfin, le neuvième jour, cette fièvre ardente parut diminuer et céder : la jeunesse de Carmen avait triomphé du mal et de la douleur dont elle se mourait.
La pauvre jeune fille était bien faible, mais elle était calme ; elle rencontra les yeux de Fernand et ceux d’Aïxa qui étaient fixés sur les siens ; elle détourna la vue, et apercevant Piquillo, elle lui tendit les bras comme au seul ami qui lui fût resté fidèle, comme au seul cœur qui ne la trahissait pas ! Et comme tous les trois s’empressaient autour d’elle, elle leur fit signe de la main qu’elle ne pouvait encore leur parler, et qu’elle désirait qu’on la laissât seule. Ce fut aussi l’avis du docteur. Pendant deux jours se prolongea cette solitude, et comme le médecin répétait qu’elle était sauvée, qu’il n’y avait plus de danger, qu’il répondait de sa guérison, Aïxa et Fernand s’étonnaient qu’elle ne demandât pas à les voir.
Le troisième jour, Carmen fit appeler Piquillo… lui seulement ! et durant plusieurs heures ils causèrent ensemble. Après cet entretien, elle désira que l’on fit venir sa sœur et son fiancé. Quand ils entrèrent, Carmen était tranquille ; son visage rayonnait d’une angélique bonté et d’une céleste résignation. Elle leur tendit la main, et leur souriant comme autrefois, elle leur fit signe d’approcher. Ils cherchèrent alors des yeux Piquillo, et l’aperçurent dans un coin de l’appartement, à genoux et sanglotant.
— Ce n’est pas bien, Piquillo, lui dit-elle, je t’ai appelé pour me donner du courage, et tu vas me l’ôter ! viens donc, continua-t-elle, viens près de moi, et vous aussi, mes amis, rapprochez-vous, car je ne suis pas encore bien forte, et ne peux pas parler bien haut.
Elle s’arrêta un instant comme pour reprendre des forces, mais en réalité pour cacher son émotion.
— Fernand, et vous, Aïxa, vous qui m’aimez tant, écoutez-moi. J’ai été bien malade, j’ai cru vous perdre, j’ai cru ne jamais vous revoir ! Au moment où je sentais la vie m’abandonner et mon âme prête à s’envoler vers le ciel, où m’attendait mon père, j’ai pensé à la douleur que j’allais vous causer… et j’ai voulu vivre… pour vous, mes amis, pour que vous puissiez me voir encore ! Et je me suis adressée à la Vierge Marie ! je l’ai priée avec ferveur, et je lui ai dit : Si tu intercèdes pour moi auprès du Dieu vivant, si tu sauves mes jours, si tu me rends à mes amis, je te jure, Vierge Marie, de te donner en échange cette existence que je te devrai, et de te la consacrer à jamais !
— Qu’avez-vous fait ! s’écria Fernand.
— Le vœu de me consacrer aux autels, dit Carmen ; et soudain j’ai senti la mort qui s’éloignait de moi, la fièvre s’est apaisée, mes yeux se sont ouverts… Je vous ai aperçus, mes amis !.. La vie et le bonheur m’étaient rendus… et à l’instant même j’ai cru entendre une Voix céleste qui me disait : « Celle qui t’a exaucée compte sur ta promesse. »
— Et vous la tiendrez ! s’écrièrent Aïxa et Fernand.
— Et depuis quand, mes amis, un serment n’est-il pas sacré ? Si vous en aviez fait un, dit-elle en les regardant avec bonté, vous lui seriez fidèles, j’en suis bien sûre ! Dois-je me croire bien dégagée parce que ma promesse n’a été faite qu’à Dieu ?
— Mais avant cette promesse, dit Aïxa, tu en avais fait une à Fernand… tu devais l’épouser… tu l’aimais !
— Eh ! si je ne l’aimais pas, dit vivement Carmen, aurais-je eu la force… de faire ce que j’ai fait ?
— Que dites-vous ! s’écria Fernand.
— Que je ne veux que votre bonheur.
Puis s’arrêtant, et craignant de se trahir, la douce créature poursuivit avec un douloureux sourire :
— Si j’étais morte, Fernand, vous auriez été trop malheureux, n’est-ce pas ? Vous auriez trop regretté une amie si tendre et si dévouée… et comme cela, du moins, vous la verrez toujours. Elle ne sera pas à vous, mais elle ne sera qu’à Dieu ! De celui-là, je l’espère, vous ne serez point jaloux… Cela doit faire tant de mal d’être jaloux !
— Croyez-vous donc, lui dit Fernand avec chaleur, que ce ne soit pas un tourment aussi grand d’être témoin d’un pareil sacrifice ! Non, Carmen, ce n’est pas possible, vous ne renoncerez pas à moi ! vous ne m’abandonnerez pas !
— Moi, vous abandonner ! jamais, jamais ! dit-elle vivement ; je prierai Dieu pour vous… je n’aurai que cela à faire. Je prierai Dieu pour qu’il vous envoie quelqu’un, non pas qui vous aime plus que moi, son pouvoir même n’irait pas jusque-là… mais quelqu’un du moins à qui il soit permis de vous rendre heureux… c’est mon seul vœu, et le ciel permettra qu’il soit exaucé.
— Et moi, dit Fernand, je ne consentirai jamais à une telle résolution.
— Ni moi non plus ! s’écria Aïxa.
— Piquillo, Piquillo ! murmura Carmen, viens à mon secours ; les voilà deux contre moi. C’est à toi de défendre une pauvre malade qui use sa force à les aimer et qui n’en a plus pour les combattre.
— Oui, dit Piquillo en étendant la main, je vous jure que j’ai tout employé pour la faire renoncer à son dessein ; elle m’a répondu constamment : Je le veux, je le veux, je l’ai juré… je n’existe qu’à cette condition, et si on m’empêche de la remplir, j’aurai trompé Dieu lui-même, je lui aurai dérobé cette vie que je lui dois, et je la lui rendrai… je me tuerai…
— As-tu dit cela ? s’écria Aïxa épouvantée.
— Je l’ai dit et je le ferai, répondit froidement Carmen. Oui, mes amis, et ne me regardez pas ainsi d’un air étonné ; j’ai toute ma raison. Laissez-moi donc exécuter un dessein que rien désormais ne pourra changer. Je n’appartiens plus qu’à Dieu. Je ferai comme toi, Piquillo, lui dit-elle en lui tendant la main, je prononcerai des vœux éternels, et nous serons frère et sœur dans le ciel comme nous l’étions sur la terre. Il y a, continua-t-elle, dans cette ville où j’ai été élevée, où j’ai passé des jours si doux près de vous et de mon père, il y a à Pampelune un couvent, celui des Annonciades, où nous allions souvent, tu le sais, Aïxa ? tu te rappelles la vieille abbesse, qui était si bonne pour nous ? Eh bien ! je lui avais écrit avant d’être malade et quand j’étais heureuse, je lui avais écrit pour lui apprendre mon mariage. Les nonnes du couvent m’ont répondu que la pauvre abbesse ne pourrait le bénir, qu’elle était morte.
— Morte ! dit Aïxa.
— Oui. Et toi, ma sœur, qui as du crédit près de la reine ; toi aussi, Piquillo, vous lui demanderez pour moi cette place. La reine est bonne, elle me l’accordera. Je serai abbesse. J’étais votre fiancée, Fernand, je serai celle du Seigneur. Allons, mes amis, continua-t-elle en les voyant fondre en larmes, ne pleurez pas ainsi. Je serai près de mon père ; c’est là qu’il repose et m’attend. Soyez tranquille, Fernand, je lui dirai que, fidèle à l’honneur, vous avez tenu tous vos serments… ou que du moins c’est moi qui ne l’ai pas permis… moi et le ciel, auquel nous devons tous obéir et nous soumettre. N’est-il pas vrai, Piquillo ?
Quoique à cette époque des vocations aussi subites et de pareilles résolutions fussent très-ordinaires, même chez les personnes du plus haut rang (témoin le roi d’Espagne Charles-Quint), Aïxa et Fernand espéraient toujours que Carmen ne regarderait pas comme irrévocable un vœu prononcé dans le délire de la fièvre, ne se doutant point du dévouement sublime de leur amie, ignorant qu’elle, à son tour, s’immolait pour eux ; ils se flattaient encore de la faire renoncer à sa résolution.
Vain espoir !… Carmen resta inébranlable dans son dessein.
LI.
la reine.
Au milieu des intrigues, des complots et des ambitions qui agitaient la cour d’Espagne ; au milieu des événements qui se succédaient avec tant de rapidité et auxquels les courtisans accordaient à peine un instant d’attention, entraînés eux-mêmes par le flot de leurs intérêts ou de leurs passions, il y avait cependant un fait qui préoccupait tous les esprits.
Ce n’était point le danger qui menaçait la monarchie espagnole ; ce n’étaient point les formidables préparatifs du roi de France : chacun partageait à cet égard l’heureuse ignorance du ministre, et celui-ci même, comme on l’a vu, ne s’était inquiété que tout récemment et par hasard. Ce qui effrayait tout le monde et ce que personne ne pouvait s’expliquer, c’était l’état de la reine.
Depuis deux mois, elle dépérissait chaque jour et n’était plus que l’ombre d’elle-même. Les médecins les plus habiles ne concevaient rien à un mal aussi extraordinaire, qui déjouait leur expérience et toutes leurs recherches. La reine se mourait, mais sans souffrance ; c’était une agonie sans maladie, un flambeau qui s’éteint.
Quand ses meilleurs amis, quand Aïxa l’interrogeaient sur ce qu’elle éprouvait :
— Je n’ai rien, leur disait-elle ; jamais je n’ai été mieux… ni plus heureuse… je vous aime !… mais je me meurs !… je tiens à la vie… et je sens qu’elle m’échappe ! hâtons-nous ! hâtons-nous !.. dites-moi ce que je puis faire pour vous rendre riches, puissants ou heureux… car bientôt je ne pourrai rien pour vous, bientôt je ne serai plus !
Déjà, malgré les larmes d’Aïxa, elle avait cédé aux prières de Carmen. Celle-ci avait, à la recommandation de la reine, obtenu la place d’abbesse des Annonciades au couvent de Pampelune ; mais avant de recevoir le titre et les insignes de sa nouvelle dignité, il fallait que la jeune abbesse eût prononcé ses vœux, et pour cela un an de noviciat était nécessaire.
Carmen, qui avait hâte de le commencer, ou plutôt de quitter Madrid, Carmen aurait déjà voulu partir pour la Navarre, mais elle était retenue par la maladie de sa protectrice ; elle ne pouvait abandonner la reine dans un pareil état.
Plus de deux mois s’étaient écoulés depuis l’entrevue de la comtesse d’Altamira et de Piquillo.
— Allons, se disait celui-ci, la comtesse m’avait dit vrai. Ce n’est pas la volonté, mais l’occasion qui lui a manqué Le crime n’était pas consommé, et je suis arrivé à temps pour sauver ma sœur.
En effet, Aïxa, toujours triste et pensive, Aïxa, malheureuse du prochain départ de Carmen et de la situation de la reine, était cependant telle à présent qu’elle était autrefois, belle, séduisante et adorée.
L’amour du roi pour elle redoublait chaque jour. Cet amour, d’abord si pur et si modeste, devenait, comme il avait été facile de le prévoir, plus vif, plus ardent et plus impatient ; peut-être même déjà le roi ne fût-il pas resté dans les limites que d’abord il avait semblé se prescrire ; mais il faut lui rendre justice, la maladie de la reine l’avait rappelé à d’autres idées.
Il avait senti renaître pour Marguerite son ancienne affection. Il allait la voir maintenant pour elle, et non plus seulement pour Aïxa ; il évitait les regards de celle-ci ; son amour était le même, mais le respect et les convenances l’avaient rendu plus silencieux encore qu’auparavant.
Cependant le mal empirait ; la reine ne sortait presque plus de ses appartements. Aïxa, Carmen et Juanita étaient ses compagnes assidues, et Piquillo, surtout, qu’on retrouvait partout où il y avait des douleurs à partager, Piquillo ne quittait point sa royale pénitente.
Dès longtemps il connaissait la souffrance, il vivait avec elle ; courageux à la supporter pour lui-même, habile à la calmer chez les autres, il avait le regard de bonté qui l’apaise, et les expressions qui la consolent.
La reine, habituée à la sécheresse et à la sévérité des prêtres qui avaient précédé Piquillo, avait été surprise et ravie de trouver un ami où jusque-là elle n’avait rencontré qu’un juge intolérant. Ceux-là ne l’entretenaient que des dogmes et des superstitieuses pratiques de notre religion ; Alliaga ne lui en montrait que la morale et les célestes vérités. Les autres l’effrayaient, lui la rassurait ; les premiers parlaient de l’enfer, Alliaga parlait du ciel. Avec les uns elle entendait gronder la foudre, avec lui elle ne voyait que le Dieu de miséricorde qui lui ouvrait les bras !
Aussi, quand la reine n’était point avec ses jeunes amies, elle passait presque toutes ses journées avec Piquillo dans son oratoire.
Piquillo avait toute sa confiance, et cependant il y avait un secret qu’elle n’avait encore osé révéler ni à l’ami ni au ministre du ciel. Ce secret était le seul qui pesât sur son cœur, le seul crime qu’elle se reprochât, bien qu’il fût involontaire. Et plus elle sentait la vie prête à l’abandonner, plus elle comprenait que ce crime il fallait l’avouer, et elle n’en avait pas le courage.
— Oui, disait-elle à Piquillo, qui devinait que quelque douloureuse pensée la préoccupait, oui, c’est vrai, j’ai un pardon à demander au ciel… une faute à vous confier, mon père ; mais pas aujourd’hui… demain… demain… Donnez-moi encore un jour !
Les jours s’écoulaient, et bientôt allait arriver celui qui devait être le dernier !
LII.
l’oratoire.
À mesure que la reine approchait du terme fatal, les bruits les plus étranges, les plus sinistres et les plus contradictoires circulaient à la ville, à la cour, et même dans toute l’Espagne.
L’archevêque de Valence Ribeira, l’inquisiteur Sandoval et tous les membres ou affiliés du saint-office répandaient partout que la vengeance céleste s’était étendue sur la reine ; qu’une maladie si prompte, que personne ne pouvait expliquer ni comprendre, indiquait évidemment le doigt de Dieu. Dieu avait voulu punir Marguerite de la protection que pendant sa vie elle avait accordée aux hérétiques, les Maures d’Espagne.
D’un autre côté, un bruit non moins odieux se répandait, surtout parmi le peuple : chacun assurait que c’était le duc de Lerma lui-même, le premier ministre, qui, de sa propre main, avait empoisonné la reine ; qu’elle seule s’opposait à son projet favori, l’expulsion des Maures, et qu’il aurait toute liberté d’agir une fois qu’elle ne serait plus !
On racontait à ce sujet des circonstances, des détails extraordinaires et positifs.
Ce bruit avait été semé avec tant d’art et d’ensemble, qu’à coup sûr ce n’était pas là une calomnie éclose par hasard, mais une accusation méditée, combinée, et mise en circulation par des gens habiles et qui s’y connaissaient.
Les bons pères de la Société de Jésus n’étaient pas étrangers à ces sourdes menées.
Ils avaient répandu ce bruit dans les basses classes, où il avait été accueilli avec empressement et enthousiasme, vu l’intérêt qu’inspirait la reine, et surtout la haine que l’on portait au ministre.
La comtesse d’Altamira, tout en traitant ces nouvelles d’absurdes et d’infâmes, avait contribué à les propager dans les salons et les premières maisons de Madrid, où on ne les connaissait pas encore.
Ces calomnies avaient déjà pris tant de consistance, que le duc de Lerma, en se rendant au conseil, avait été insulté ; de la boue et des pierres avaient été lancées contre sa voiture ; quoique complètement innocent du crime dont on l’accusait, le ministre en était profondément affligé, mais les embarras dont il était accablé en ce moment, les dangers qui le menaçaient à l’extérieur du royaume et dans l’intérieur même de sa famille, tout l’empêchait de remonter à la source de ces bruits, pour en découvrir et en punir les auteurs.
En attendant, ces calomnies circulaient avec d’autant plus de rapidité, que lui et les siens avaient contribué à les rendre vraisemblables. C’était, en effet, au moment même où la reine commençait à ressentir les atteintes du mal qui la conduisait au tombeau, que Sandoval, revenant à ses anciens projets, avait envoyé à Valence des troupes contre les Maures.
Tout se disposait pour un coup d’État. Le vieux Delascar d’Albérique avait trop d’amis dans sa province pour n’être pas promptement averti de tout ce qui se passait ; aussi, sans les deviner encore, il pressentait les mauvaises intentions de l’inquisiteur et du ministre.
C’est dans ce moment-là qu’il avait écrit à son fils Yézid de revenir près de lui ; tous les deux avaient acquis la preuve qu’on pouvait agir à l’improviste, surprendre la signature du roi et publier l’ordonnance d’exil, sans que personne eût pu s’en douter. Il fallait déjouer promptement le danger, prévenir Piquillo pour qu’il prévînt la reine, et cela sans éveiller les soupçons de Sandoval ou du ministre.
Yézid partit de nuit.
Il devait à peine rester à Madrid, ne voir que le seul Piquillo et la reine, et revenir sur-le-champ, pour que leurs ennemis ne fussent pas même instruits de son voyage et qu’il leur fût impossible de deviner la main qui venait encore une fois de renverser leurs projets.
Yézid arriva de bon matin à Madrid. Admis pendant plus d’un mois au palais et dans les appartements particuliers de la reine, il savait, comme Aïxa, les moyens d’y arriver : c’était par l’escalier secret qui conduisait chez Juanita. Celle-ci fut stupéfaite en le voyant entrer, le matin, dans l’oratoire de la reine, où elle mettait tout en ordre.
— Vous, seigneur Yézid ! Vous à Madrid !
— Silence ! Juanita ! il faut que tout le monde l’ignore, excepté Piquillo et toi.
— Quand êtes-vous arrivé ?
— À l’instant mème, à cheval, avec Pedralvi, que tu trouveras chez Aïxa, ma sœur, à l’hôtel de Santarem.
— Pedralvi est ici ! s’écria-t-elle avec joie. Et pour longtemps ?
— Le temps de t’embrasser… Va vite,
Juanita y courait. Il l’arrêta en lui disant :
— Mais auparavant, il faut que tu me fasses parler à Piquillo.
— Ce n’est pas difficile, dit-elle en lui montrant une porte à droite qui donnait dans l’oratoire, c’est là qu’il demeure à présent.
— En vérité !
— Oui, la reine, qui est bien malade, l’a voulu ainsi.
— Bien malade ! dit Yézid en pâlissant.
— De ce côté, continua Juanita en montrant la porte à gauche, sont les appartements de la reine ; ici, son oratoire… et désignant du doigt un grand meuble en bois d’ébène qui occupait tout le fond de la chambre et qui s’ouvrait par une petite grille en bronze doré, recouverte en dedans d’un rideau violet, — ceci est le confessionnal de Sa Majesté, et Piquillo, dont elle ne peut plus se passer, demeure de ce côté, pour être toujours prêt à accourir au premier appel de la reine.
— Bien… Je vais chez Piquillo.
Mais la porte qui conduisait chez ce dernier était fermée à clé en dedans.
— Il prie peut-être, dit Juanita.
Elle frappa légèrement, on ne répondit pas. Elle frappa plus fort, même silence.
— Il sera sorti, dit Juanita, Quelquefois, le matin, il se promène seul dans le parc… Nous l’y trouverons ; venez.
— Tu oublies, répondit Yézid, que je ne dois pas être vu. Je viens pour parler à Piquillo et à la reine, mais il est nécessaire qu’on l’ignore.
— Eh bien ! restez ici, dans quelques minutes, un quart d’heure au plus, Piquillo sera revenu de sa promenade au parc. Pour en être plus sûre, je cours le chercher et le prévenir… moi, je n’ai pas peur d’être vue !
— Bien ! va vite, je t’attendrai ici.
Juanita allait sortir par la porte qui donnait sur les appartements de la reine, quand on entendit très-distinctement la voix de la comtesse d’Altamira. Elle se dirigeait vers l’oratoire.
— Tout est perdu, dit Yézid… elle va me voir… à une pareille heure… ici, dans l’oratoire de la reine !
Quel parti prendre cependant ? Il n’y avait que deux issues : l’une, la chambre de Piquillo ; elle était fermée… et l’autre porte en face était justement celle par laquelle arrivait la comtesse.
— Il n’y a qu’un moyen, dit vivement Juanita en ouvrant la petite grille en bronze doré ; là, dans le confessionnal.
— Si on me voit ?
— On ne vous verra pas, en tirant ainsi le rideau de taffetas violet ; entrez donc vite ! on approche !
— Mais, dit Yézid en reculant d’un pas, c’est là la place d’un prêtre chrétien !
— Qu’importe, pour un instant !
Yézid hésitait encore ; il lui semblait que lui, Maure, commettait dans sa religion un sacrilége en s’asseyant à cet endroit que les chrétiens appellent le tribunal de la pénitence. En ce moment, la comtesse ouvrait la porte de l’oratoire. Juanita poussa Yézid dans le confessionnal, et referma vivement la grille sur lui… Quelque promptitude qu’elle y eût mise, la comtesse avait vu en entrant, non pas Yézid, mais la grille qui se refermait.
La comtesse avait rencontré Marguerite qui se rendait ou plutôt qui se traînait, tant elle était faible, vers son oratoire. La reine préférait être seule, mais la comtesse avait mis tant d’instances à offrir son bras à Sa Majesté, que celle-ci, qui ne savait ni refuser ni mécontenter personne, avait accepté malgré elle. Elle arrivait donc, appuyée sur le bras de la comtesse, au moment où celle-ci s’écria en regardant Juanita et en désignant du doigt le confessionnal :
— Qu’est-ce ? Qu’y a-t-il ? Qui est là ?
Juanita, prise à l’improviste, n’hésita pas un instant. Avec cette présence d’esprit et ce sang-froid admirables que les femmes seules possèdent, elle répondit :
— Le frère Luis Alliaga, qui venait d’entrer et qui s’est mis en prière.
— Silence ! reprit la reine ; ne le troublons pas. Je l’avais aperçu, en effet, de mes fenêtres, se promenant tout au bout du parc, et j’avais envoyé un de mes pages le prévenir que je l’attendais ici.
— Cela se trouve bien, dit Juanita en elle-même, cela me dispensera d’y aller, et je verrai plus vite Pedralvi.
La reine, sans proférer un mot, fit signe à Juanita et à la comtesse de la laisser. Toutes les deux sortirent en silence par les appartements de la reine.
Marguerite était seule ; mais Yézid l’ignorait, et n’osait ni parler ni faire un geste croyant que la comtesse était restée dans l’oratoire et priait à côté de la reine. Un autre danger aussi l’effrayait. Il venait d’apprendre que la reine avait fait prévenir Piquillo ; celui-ci allait donc arriver, et à sa vue qu’allait devenir le mensonge de Juanita ? Qu’allait dire la comtesse en voyant entrer, par cette porte, à droite, ce frère Luis Alliaga qu’on lui avait dit être déjà installé dans le confessionnal ?
En proie à ses angoisses, il ne savait quel parti prendre, craignant également de parler et de se taire, de rester caché ou de se montrer. Tout à coup, à sa droite, et près de la petite grille intérieure, il entendit quelqu’un tomber à genoux et lui dire à voix basse :
— Mon père !
Cette voix c’était celle de la reine, mais si faible, si étouffée, qu’à peine on pouvait l’entendre, ce qui confirma Yézid dans l’idée que la reine n’était pas seule dans son oratoire et que la comtesse y était restée.
Pâle et interdit, il garda le silence, prêt à s’évanouir aux accents de cette voix si chère qui le faisait frissonner de terreur et d’amour.
— Mon père, disait-elle, je voulais… je ne puis tarder davantage à vous dire le secret qui m’accable… demain il n’en serait plus temps… je n’en aurais pas la force. Je suis bien coupable !… j’aime !.. oui, j’aime, en secret, en silence… et depuis bien longtemps. Mais cet amour involontaire, je l’ai combattu, j’ai résisté… personne ne l’a su, pas même lui !… et je me disais : Dieu me le pardonnera peut-être ! Mais ce qu’il ne me pardonnera pas, murmura-t-elle en baissant la tête, et voilà ce qui me fait trembler, c’est que celui que j’aimais… que j’aime toujours… est un Maure ! un ennemi de notre foi…
En ce moment le bruit d’une porte qui s’ouvrait à : droite interrompit la reine.
Elle leva la tête et poussa un cri d’effroi… Celui qu’elle voyait entrer c’était Piquillo !
Elle se leva hors d’elle-même, comme égarée, comme maudite, et saisie d’une horrible crainte qui lui rendit un instant toute sa force, elle courut se jeter dans les bras de Piquillo.
— Qu’avez-vous, madame, qu’avez-vous, de grâce ! dit celui-ci, effrayé de sa terreur et de la crise convulsive à laquelle il la voyait en proie.
— Vous, Alliaga ! répétait-elle avec égarement, vous ! mais alors, se disait-elle en elle-même en portant la main à son front et en regardant du côté du confessionnal, qui donc… là… tout à l’heure… a entendu…
Alors et à travers les barreaux de la grille de bronze doré, une main tremblante jeta une fleur de grenade desséchée qui tomba aux pieds de la reine.
Une lueur d’espoir se glissa dans son âme ; mais ne pouvant n’osant croire à l’idée qui s’offrait à elle, elle s’écria :
— Non ! non ! c’est impossible !
Pendant la minute, la seconde qu’avait duré cette scène, Piquillo, occupé à soutenir Marguerite, n’avait rien vu. Il la déposa sur un fauteuil et s’élança vers la porte à gauche pour appeler au secours de la reine Juanita et ses femmes.
À peine avait-il disparu, que Marguerite, décidée à connaître son sort, dût-elle mourir de honte de son secret trahi, Marguerite courut à la porte du confessionnal, et malgré elle poussa un cri de joie.
C’était Yézid !
Yézid, qui tomba à genoux en s’écriant, comme autrefois Marguerite dans le souterrain du Val-Paraiso :
— Dieu seul ! Dieu et moi ! ce sera le secret de ma vie !
— Ce sera celui de la tombe ! dit Marguerite.
On entendait revenir Alliaga et les femmes de la reine ; elle montra vivement à Yézid la chambre de Piquillo.
— Là… là… lui dit-elle.
Yézid s’élança et referma sur lui la porte.
En ce moment entraient Alliaga et les femmes qui l’accompagnaient. Trop faible pour résister à tant d’émotions, Marguerite tomba évanouie dans leurs bras.
Elle ne se releva plus !
Le soir même, les cloches funéraires retentissaient dans toutes les paroisses de Madrid, Tout un peuple, prosterné sur la pierre des églises, priait pour sa souveraine.
Étendue sur son lit de mort, la reine d’Espagne avait fait signe de la main d’éloigner toute cette foule de dames et de seigneurs qui se pressaient autour d’elle pour la voir mourir… ils s’étalent tous retirés au fond du vaste appartement… et serrés sur un triple rang, ils la contemplaient de loin, mais ne pouvaient l’entendre.
Penché vers elle, un jeune prêtre dont le figure était inondée de pleurs pouvait à peine parler, tant la douleur le suffoquait ; mais de la main il montrait le ciel.
— Vous croyez donc que Dieu me pardonnera ? disait elle à celui qui venait de l’écouter. Et le prêtre lui répondit :
— Maures et chrétiens sont tous enfants du même Dieu, et Dieu n’a maudit aucun de ses enfants, Celui-là était digne de vous, car il vous révérait, il vous adorait comme on révère la vertu, comme on adore les anges ! Votre amour à tous deux n’a pas été un crime, mais une longue souffrance, une lutte, un combat où vous n’avez point succombé. Dieu pardonne à ceux qui souffrent ! s’écria-t-il avec un accent de conviction et d’espérance ; Dieu récompense ceux qui combattent et qui sont vainqueurs !
La reine le remercia du regard, et lui montrant la turquoise qu’elle portait au doigt, elle lui dit à voix basse :
— Je ne peux pas la garder… prenez-la, et rendez-la… à lui !
Elle fit signe à ses femmes d’approcher. Aïxa, Juanita et Carmen se jetèrent à genoux près de son lit. Ranimant ses forces éteintes pour protéger encore ses amis, elle murmura à l’oreille d’Aïxa ;
— Prends garde… pour toi et les tiens. Moi morte, vous n’aurez plus personne pour vous défendre. Et la persécution, l’exil, vous menacent, je le sais.
Alors, élevant la voix, elle demanda qu’on avertit le roi : elle voulait le voir, lui parler. On s’empressa d’exécuter ses ordres, et elle continua :
— Je veux, à mon lit de mort, et c’est tout ce que je peux maintenant pour vous, mes amis, je veux lui faire jurer, devant Dieu et devant vous, que jamais il ne consentira… que jamais il ne signera l’arrêt de bannissement.
C’était trop d’efforts pour elle, la voix expira sur ses lèvres, une sueur froide couvrit son front, et pendant qu’Aïxa s’efforçait de rappeler un reste de vie prête à à s’éteindre, toutes les portes du palais s’ouvrirent.
Le grand inquisiteur Sandoval, en habits pontificaux, les principaux membres du saint-office et du clergé de Madrid apportaient en grande pompe le saint sacrement : le roi, le jeune prince des Asturies et sa jeune sœur, Anne d’Autriche, marchaient derrière le clergé.
Le cortége s’étendait jusque sur l’escalier et dans les cours du palais. De longues files de moines portant des flambeaux psalmodiaient les prières des agonisants.
Aïxa et ses compagnes se retirèrent à l’écart ; mais pour Piquillo, il se tint debout, à son poste, près du chevet de Marguerite.
La cérémonie funèbre commença.
Le grand inquisiteur s’approcha de la reine, qui n’avait pas repris connaissance. Il récita les prières accoutumées, et répandit sur son front l’huile sainte. En ce moment Marguerite ouvrit un instant les yeux, et n’apercevant autour d’elle que des figures froides et glacées, elle se détournait avec terreur ; mais son regard rencontra celui de Piquillo, et remerciant l’ami qui saluait son départ, son âme consolée quitta la terre et s’éleva vers le ciel.
Un grand cri retentit dans le palais, et se prolongea au dehors.
Les prêtres s’inclinèrent, la foule tomba à genoux, et Alliaga, étendant sa main vers la reine, s’écria d’une voix forte :
— Ange descendu des cieux, remontez vers votre patrie !
LIII.
la révélation.
La mort de la reine se répandit bientôt dans toute l’Espagne. Aïxa et Piquillo l’apprirent à leur père, car Yézid, livré au désespoir, n’était plus capable de rien, pas même d’être consolé.
Delascar d’Albérique et les siens se regardaient tristement et ne prévoyaient que trop les malheurs qui allaient fondre sur eux. La perte de Marguerite était celle de toutes leurs espérances : qui oserait maintenant les protéger ? Ils étaient livrés à leurs ennemis, et les cloches funéraires qu’ils entendaient retentir sonnaient à la fois la mort de la reine et leur destruction totale.
Quelque temps cependant s’écoula sans qu’aucun danger apparût et sans que leur tranquillité fût troublée.
Nous en connaissons la raison.
Le duc de Lerma, tremblant pour l’Espagne et 
Piquillo, s’adressant au chef des alguazils, lui parla d’un ton d’autorité.
surtout pour son pouvoir, ses titres, ses richesses et sa
place de ministre, n’était occupé qu’à conjurer l’orage.
Hélas ! tout ce que lui avait annoncé Piquillo n’était
que trop vrai, trop réel. Le mal était encore plus grand
qu’on ne l’avait fait. Le ministre voyait avancer le péril
sans pouvoir le conjurer, et son unique souci, maintenant,
était de le cacher au roi. Toutes ses précautions
tendaient à empêcher la vérité d’arriver au
monarque. On serait toujours assez à temps de l’en
instruire quand il n’y aurait plus de remède.
Jusque-là, le duc poursuivait avec plus de chaleur que jamais ses projets près de la cour de Rome. Le roi avait demandé lui-même pour son ministre le chapeau de cardinal. Le pape l’avait promis ; mais retardée par quelque intrigue que le duc ne pouvait s’expliquer, la nomination n’arrivait pas, et il tremblait qu’elle n’arrivât trop tard, car d’un jour à l’autre on redoutait l’explosion des nouvelles ou plutôt des désastres dont on était menacé.
Le roi de France allait partir pour se mettre à la tête de son armée. Ce départ était prévu et certain ; lui-même l’avait annoncé en plein parlement ; il avait déclaré vouloir laisser en son absence la régence du royaume à Marie de Médicis, sa femme. Nouvelle preuve qu’il regardait comme longue et importante l’expédition qu’il méditait, et cette expédition n’était plus retardée maintenant que par le couronnement de la reine comme régente, couronnement dont Henri avait ordonné les préparatifs et auquel il désirait assister lui-même.
Tout le monde à présent connaissait en Europe les projets de Henri, tout le monde… excepté le roi d’Espagne ! Mais il était facile de lui cacher les événements, dans ce moment surtout, où deux ou trois préoccupations l’absorbaient à la fois, lui qui n’avait pas l’habitude de se livrer à une seule.
Il avait d’abord été tout entier à sa douleur ! il aimait la reine, et sa perte l’avait profondément affligé. Mais depuis cette mort, une autre idée encore l’inquiétait et l’effrayait.

La comtesse d’Altamira, sous prétexte de faire à son souverain son compliment de condoléance et de prendre part à sa royale douleur, la comtesse avait eu plusieurs fois l’occasion de parler au roi ; et avec ce laisser-aller, ce négligé de conversation qu’elle possédait mieux que personne, elle avait, en multipliant les réticences et les parenthèses, instruit complétement le roi des bruits d’empoisonnement qui couraient au sujet de la reine.
Quant à l’auteur d’un tel crime, quant à celui que désignait la vindicte publique, elle s’était bien gardée de lui en dire un mot. Une telle accusation eût été suspecte dans sa bouche. Le peu qu’elle avait appris au roi suffisait déjà pour le préoccuper au delà de toute expression, et, selon son habitude de tout dire au duc de Lerma, il lui parla de ces bruits.
Le duc parut d’abord surpris et contrarié que le roi en fût instruit ; puis, voyant qu’il ne savait rien ou presque rien, et qu’il ignorait même les accusations portées contre lui, il haussa les épaules, et répondit que Sa Majesté était bien bonne de s’occuper d’absurdités et de calomnies pareilles. Le roi, qui ne demandait qu’à être rassuré et qui redoutait même l’apparence d’une inquiétude, se contenta de cette réponse, et rentra dans son calme habituel.
Sa première douleur était passée, et son amour pour Aïxa avait repris toute sa force ; il n’avait plus maintenant qu’une seule pensée et un seul but, se faire aimer d’Aïxa. Tout ce qui pouvait le distraire de cette occupation lui paraissait odieux et intolérable. On pouvait donc, ainsi que nous l’avons dit, détourner son attention des affaires d’État, et le duc de Lerma croyait plus que jamais pouvoir compter sur l’apathie de son souverain ; mais la tranquillité royale fut soudainement troublée par un petit billet que le monarque trouva sur son bureau.
Ce billet était ainsi conçu :
« Si le roi veut avoir des détails certains sur l’empoisonnement de la reine et sur le véritable auteur de ce crime ; s’il tient à connaître les dangers qui menacent, lui, sa gloire et son royaume, qu’il veuille bien garder avec tous le silence sur cet avis, et donner ordre au premier gentilhomme de la chambre d’introduire ce soir dans le cabinet de Sa Majesté, l’inconnu qui se présentera sur les neuf heures à la porte du palais en prononçant ces mots : Philippe et Espagne. »
En lisant ce billet, le roi pâlit et demeura longtemps pensif. Sa vie était d’une tranquillité et d’une monotonie si régulières que tout ce qui avait l’air d’un événement dérangeait son existence. Malgré la défense qu’on lui faisait de ne parler à personne de cet avis, il se demandait s’il fallait ou non en faire part au duc de Lerma ; c’était là ce qui l’occupait d’abord et avant tout. Ensuite il hésitait, et ne savait s’il devait refuser ou recevoir la dénonciation d’un inconnu.
Le roi, en proie à ces diverses idées, se promenait dans le parc ; il aurait eu grand besoin de conseils ; mais comment en demander dans une affaire où le secret lui était recommandé ?
Au détour d’un massif, il rencontra Aïxa. Elle se promenait, rêveuse et les larmes aux yeux, dans cette allée qu’elle avait si souvent parcourue avec Marguerite. À sa vue toutes les hésitations du roi avaient cessé, il venait de prendre un parti…
— Vous ici, duchesse de Santarem ! s’écria-t-il, c’est le ciel qui vous envoie, car je suis bien malheureux !
Aïxa, qui allait s’éloigner, se rapprocha de lui.
— Je comprends mieux que personne, dit-elle, les regrets et l’affliction de Votre Majesté.
— Oui, duchesse, Marguerite avait pour vous, je le sais, une tendre amitié… Mais moi aussi, je l’espère, vous me regardez comme un ami ?
— Toujours, sire !
— Eh bien ! un ami peut demander des conseils à un ami.
— C’est trop d’honneur pour moi, sire !
— Dans cette occasion, surtout où il s’agit de la reine ! Tenez, ceci est un grand secret, au moins… Je ne le confie qu’à vous seule… Lisez.
Aïxa, dès les premiers mots, poussa un cri d’horreur, et après avoir achevé la lettre :
— Eh bien ? dit-elle au roi avec émotion.
— Eh bien ! je pense comme vous ; c’est horrible ! c’est infâme ! Faut-il recevoir cet homme ?
— S’il le faut !.. s’écria-t-elle vivement ; dans une pareille affaire rien n’est à négliger ! Il faut le voir aujourd’hui même !
— Ah ! c’est votre avis… c’était aussi le mien !
— Il n’y a pas à hésiter.
— Je n’hésitais pas ; mais je me disais : S’il me trompe !
— Vous le verrez bien en l’interrogeant ; vous démêlerez le mensonge dans ses traits, dans son regard, dans ses paroles ; vous examinerez d’ailleurs les preuves qu’il vous donnera.
— C’est juste.
— Et s’il disait la vérité, n’est-ce pas à vous de venger la reine, de poursuivre le coupable, de le faire punir !
— C’est mon devoir ! s’écria le roi avec chaleur ; c’est moi que cela regarde… Et dites-moi, duchesse, ajouta-t-il en baissant un peu la voix, si j’en parlais au duc de Lerma ?
— Celui qui vous demande audience réclame le secret.
— C’est vrai.
— Et si c’était quelqu’un qui fût mal avec le duc de Lerma…
— C’est possible ; il y en a beaucoup.
— Si ce qu’il avait à vous dire devait accuser la négligence ou l’imprévoyance de votre ministre…
— Je n’y avais pas pensé.
— Vous auriez donc puni cet homme du service qu’il veut vous rendre : vous lui feriez un ennemi dangereux et puissant.
— C’est juste, c’est juste ! Je recevrai cet inconnu, je le verrai, je l’interrogerai, je vous le promets. Merci, merci, duchesse.
Dès le soir mème, le roi donna ses ordres au premier gentilhomme de la chambre, qui se trouvait être le duc d’Uzède. Il ne parla de rien à son ministre, et fier d’avoir un secret presque à lui seul, il attendit avec impatience l’heure fixée par l’inconnu.
Il fut exact. À neuf heures précises, le duc d’Uzède introduisait dans le cabinet un homme enveloppé d’un manteau. Le roi fit signe au duc d’Uzède de sortir.
— Parlez, monsieur, dit-il, dès qu’ils furent seuls.
L’inconnu ouvrit son manteau.
— Le père Jérôme ! s’écria le roi étonné.
— Lui-même, sire, qui s’expose aux plus grands dangers peut-être, pour faire arriver la vérité jusqu’à Votre Majesté.
— Protégé par moi, qu’avez-vous à craindre ?
— Des ennemis nombreux, puissants, qui ne me pardonneront pas de les avoir dénoncés à votre justice et à celle du pays.
— Vous pensez donc, dit le roi avec émotion vous croyez donc que la reine a été empoisonnée ?
— J’en suis certain… Je le jure devant Dieu.
Le roi pâlit, car un pareil serment était pour lui la plus forte des preuves.
— Je dirai le nom du poison… poison qui ne laisse pas de traces, il est vrai, mais dont les symptômes sont connus de tous ceux qui s’occupent de sciences… Ces symptômes sont ceux qu’a éprouvés la reine…
— Et qui avait intérêt à commettre un pareil crime ? dit le roi.
Le révérend père garda le silence.
— La reine était aimée de tous.
— Il y avait des gens qui pouvaient la craindre.
— Et qui donc ?
La rumeur publique accuse un homme bien haut placé dans la confiance de Votre Majesté.
— De qui voulez-vous parler ? dit le roi en tremblant.
— Il est impossible que Votre Majesté ne l’ait pas déjà entendu nommer ; il n’y a dans toute l’Espagne en ce moment qu’un cri de vengeance et de réprobation contre lui.
— Je ne sais rien, dit le roi avec autant de bonhomie que d’inquiétude.
— C’est bien étonnant, sire ; il faut alors que quelqu’un ait ici intérêt à empêcher ces bruits d’arriver jusqu’à Votre Majesté.
— Enfin, mon père, dit le roi, dont l’émotion redoublait, son nom !
— Je ne sais cependant si je dois le dire et si l’on pourra me croire, car je vois que son influence est si grande et si terrible !
— Son nom ! répéta le roi en se levant avec un frémissement nerveux.
— Eh bien ! sire, c’est le duc de Lerma !
— Le duc ! s’écria le roi en retombant dans son fauteuil, comme suffoqué de surprise et de terreur.
— C’est lui, sire, que tout le monde accuse ; il vous est facile de le savoir ; mais moi seul je puis vous donner des détails et des preuves.
— Parlez ! parlez ! dit le roi avec émotion et en respirant des sels.
— Il y a trois mois, sire, c’est le jour, le premier jour où, après la perte de son aumônier, Sa Majesté la reine est venue entendre la messe dans votre chapelle. En revenant dans ses appartements par le parc, elle était accompagnée de madame la comtesse de Gambia, de la marquise d’Escalonne, des duchesses de Zuniga et d’Ossuna, et de plusieurs autres ; je pourrais même citer la duchesse de Santarem, qui était accourue au-devant de Sa Majesté. La reine avait encore avec elle les ducs de Médina, de Gusman, et je crois même le duc d’Uzède. Vous pourrez les interroger tous sur les faits que je vais vous révéler.
Ce jour-là, le soleil était ardent et la température brûlante. La reine, à qui le duc de Lerma donnait la main, fatiguée de la chaleur ou de la promenade, s’assit à l’ombre sur un banc de verdure avant de rentrer dans ses appartements, et devant les dames et seigneurs qui l’accompagnaient, elle dit en riant :
— Je meurs de soif.
Au lieu d’appeler un des gens du service de la reine ou une de ses femmes, ce qui était tout naturel, et ce qui était même commandé par l’étiquette, le duc de Lerma s’élança lui-même, entendez-vous bien, sire, lui-même !
— J’entends, dit le roi, qui écoutait avec la plus vive attention.
— Il s’élança du côté des petits appartements, disparut pendant quelques instants… Je prie Votre Majesté de noter cette circonstance… Il disparut et revint, présentant à la reine, sur une assiette d’argent, un verte d’orangeade glacée que la reine saisit avidement. Après l’avoir bue, elle dit gaiement :
— Cette orangeade a un singulier goût…
Le roi poussa un cri de surprise.
— Ces mots, continua le révérend père, tous ceux qui étaient là les ont entendus !.. Un mois après, l’état de souffrance de la reine a commencé, et deux mois plus tard elle n’existait plus !.. Tous ceux qui connaissent les effets de ce poison vous diront que c’est là le temps nécessaire à son développement ; daignez rapprocher ce fait des symptômes que la reine a éprouvés, et peut-être Votre Majesté trouvera que les bruits qui se répandent ne sont point si déraisonnables.
Quant à moi, je ne puis faire partager ma conviction à Votre Majesté, mais je dirai à vous, sire, à vous seul : Je sais, à n’en pouvoir douter, que ce verre contenait du poison.
— Comment le savez-vous ? s’écria vivement le roi.
— S’il m’était permis de le dire, je n’appellerais pas cela une conviction, je l’appellerais une preuve ; et ce n’est pas à Votre Majesté seulement, c’est à la justice humaine que j’aurais fait cet aveu ; mais la manière dont ce mystère m’a été révélé ne me permet pas de le proclamer devant les hommes. Je ne puis que dire à Votre Majesté : Ce verre contenait du poison, je le sais !
Le roi, pâle et haletant, regardait celui qui parlait ainsi avec un mélange de terreur et d’indécision ; il hésitait encore, tremblant de croire et tremblant plus encore de repousser la vérité. Soudain il jeta un cri : une idée lui était venue d’en haut ; il courut prendre un livre qui était sur son prie-Dieu, et l’ouvrant devant le père Jérôme :
— Jurez sur l’Évangile, mon père, jurez ! et je croirai tout.
Le moine pâlit et garda un instant le silence ; mais se rappelant les opinions d’Escobar à ce sujet, et les restrictions mentales depuis longtemps admises par les premiers casuistes de leur ordre, il se remit de son trouble ; et levant la main, il dit gravement et lentement :
— Je jure, sur l’Évangile, que le duc de Lerma a présenté ce verre à la reine !… Je jure que ce verre contenait du poison !
Le roi cacha sa tête dans ses mains et garda quelques instants le silence : il était anéanti.
— Lui ! se disait-il avec douleur, lui à qui j’avais donné toute ma confiance ! lui dont j’admirais le zèle, les lumières, la haute et puissante capacité !..
— Si ce n’est que cela, sire, dit le révérend, que Votre Majesté mette un terme à ses regrets. Sur ce dernier sujet, j’ai, grâce au ciel, mieux que ma conviction, je puis donner des preuves et démontrer à Votre Majesté que ce ministre zélé vous a toujours trahi ; que ce ministre éclairé vous a conduit, vous et la monarchie, au bord du précipice ; que ce ministre si capable a ruiné vos finances, détruit vos flottes et vos armées, et livré l’Espagne sans défense à l’ennemi qui va l’envahir.
— Que dites-vous ! s’écria le roi avec effroi.
— À l’heure qu’il est, presque toute l’Europe se lève contre vous, et vous n’en savez rien, sire ! et votre ministre, qui le sait, au lieu de songer à votre gloire ou à votre salut, ne songe qu’à ses intérêts, et vous force à demander pour lui le chapeau de cardinal, qu’il aurait déjà obtenu, si moi et mes frères ne nous étions pas opposés, près la cour de Rome, à la consommation d’une telle injustice.
— Tout cela n’est pas possible ! s’écria le roi, que tant de coups inattendus jetaient dans une espèce d’égarement. Tout cela ne peut se concevoir, et ma raison se refuse à admettre une semblable trahison.
Cette fois, et sans détours jésuitiques, il était facile au révérend père de démontrer la vérité de tout ce qu’il avançait, et les lettres particulières, les gazettes étrangères, toutes les preuves, en un mot, qu’il déploya aux yeux du roi, rendirent encore plus vraisemblable et plus évidente la première partie de l’accusation.
Une capacité plus forte, une volonté plus énergique que celle du roi, aurait reculé peut-être devant une situation pareille. Pour tenir tête à l’orage qui l’accablait, pour réparer de si grands désastres, il fallait une de ces organisations supérieures, un de ces génies qui apparaissent de temps en temps au milieu des tempêtes, ou plutôt que les tempêtes semblent faire naître, et qui reçoivent de Dieu la mission de les apaiser.
Le roi n’avait aucune des qualités que commandait sa situation. Il était bon et religieux, deux vertus qui ne servent aux rois que dans les temps calmes. Incapable de prendre un parti dans ce moment, il congédia le père Jérôme.
— Merci, mon père, merci, lui dit-il ; bientôt… nous nous reverrons… demain, j’examinerai… je réfléchirai.
Le père Jérôme courut chez la comtesse d’Altamira, qui l’attendait, et s’écria :
— Cette fois, je le jure, notre ennemi est enfin renversé.
LIV.
l’audience de castille.
Le roi passa une nuit affreuse. Contrairement à ses habitudes, il l’employa tout entière à réfléchir et à prendre un parti quelconque, et quand le jour parut, il n’en avait pris aucun. S’il avait osé, c’est à la seule Aïxa qu’il se serait adressé ; mais Aïxa, malgré ses talents, sa grâce et son esprit, ne pouvait empêcher la France de faire la guerre à l’Espagne. D’ailleurs il y avait d’autres secrets que le faible monarque n’aurait osé confier à personne, et qu’il aurait voulu se cacher à lui-même. Il sentait bien qu’il fallait renverser le duc de Lerma, le faire arrêter et mettre en jugement ; et cette obligation le rendait le plus malheureux des hommes. Tel est cependant l’empire de l’habitude sur une âme sans énergie ! Il était depuis si longtemps façonné au joug de son ministre, qu’il n’osait le briser… et tremblait à l’idée de ne plus être esclave !
Au milieu de toutes ces incertitudes et ne sachant à quelle résolution s’arrêter, il fit appeler le père Jérôme, le seul auquel il pût se confier.
C’était un résultat prévu ; le révérend s’y attendait et fut à l’instant aux ordres de Sa Majesté.
— Je n’ai d’espoir qu’en vous, mon père, donnez-moi votre avis. Que feriez-vous à ma place ?
— Votre Majesté me prend bien à l’improviste, dit le moine, qui depuis longtemps avait mûri et médité la question… mais enfin je répondrai de mon mieux à l’honneur qu’elle daigne me faire. D’abord le ciel nous commande l’indulgence et nous en donne lui-même l’exemple. Quelque grandes que soient nos fautes, sa clémence est plus grande encore ; je ferais comme lui.
— Très-bien ! dit le roi, qui n’était pas pour les moyens violents.
— À la place de Votre Majesté, je n’ébruiterais point les détails que je lui ai donnés hier, et qui ne sont déjà que trop connus de tout le monde. Je ne mettrais point en accusation un homme qui a eu ma confiance et mon amitié.
Le roi approuva de la tête.
— Sans compter que, tout en ayant maintenant la même conviction que moi, Votre Majesté ne pourrait peut-être pas réunir assez de preuves matérielles pour le faire condamner, ce qui serait alors un grand scandale. Je me tairais donc sur cette horrible affaire. Bien plus, je n’en parlerais pas au duc de Lerma, pas même en particulier.
— Vous croyez ! dit vivement le roi, auquel ce système convenait parfaitement.
— Je garderais avec lui un silence accablant ; c’est noble, c’est digne ! c’est le seul reproche qu’il convienne à un roi ! Qu’importe, après tout, que Votre Majesté ait l’air d’ignorer son crime, si au fond du cœur elle le connaît et en a la certitude ? Je sais bien qu’après cela, il ne peut rester à la tête des affaires, mais le moyen de le renverser se présente de lui-même ; les faits que j’ai mis sous les yeux de Votre Majesté seront dès demain à la connaissance de tous. Ils constituent et au delà, sinon le crime de trahison, du moins ceux d’imprévoyance et d’incapacité, qui le rendent indigne de porter plus longtemps le titre de premier ministre de Votre Majesté.
— C’est vrai, dit le roi.
— Demain donc, en plein conseil… car c’est demain, je crois, que le conseil doit avoir lieu.
Le roi fit un signe affirmatif.
— Je demanderais compte au duc de Lerma de tous les faits dont j’aurai l’honneur de remettre la note exacte à Votre Majesté, avec les preuves à l’appui, et comme il est impossible qu’il puisse y répondre, comme les faits parleront toujours plus haut que toutes les raisons qu’il pourrait donner, je lui déclarerais que, dans ma bonté et dans ma clémence, je me contente de lui retirer ma confiance… et son portefeuille…
— Très-bien ! dit le roi.
— Pas autre chose. Un petit discours de quelques lignes, très-froid, très-sévère, mais plein de réserve et de convenance, comme Votre Majesté sait les faire. Je lui en donnerai l’esquisse, si Sa Majesté veut le permettre.
— Très-bien, dit le roi ; mais qui mettrons-nous à sa place ?
— Je vais parler contre moi-même, sire, car c’est exposer à la vengeance du fils celui qui a renversé le père ; mais pour prouver que dans cette résolution nous n’avons en vue que l’intérêt de l’Espagne et qu’il n’entre en notre cœur aucune animosité personnelle, je proposerai à Votre Majesté le duc d’Uzède.
— À merveille, dit le roi, à qui ce choix plaisait fort, car ce n’était point un homme nouveau à étudier ni de nouvelles habitudes à former. Le duc d’Uzède avait été longtemps son favori ; il lui avait toujours conservé de l’affection, et, ce qui lui plaisait plus encore, le duc n’était point d’une capacité effrayante.
— À merveille ! s’écria-t-il, cela ne sortira pas de la famille. Ce n’est pas une révolution, c’est une succession. Mais, vous, mon père ?
— Moi ! sire, dit le révérend avec humilité, je ne demande rien, car je suis sûr que Votre Majesté ne m’oubliera pas ; elle exigera que l’on donne à la fidélité ce chapeau de cardinal qu’on allait accorder à la trahison.
— C’est de toute justice, reprit le roi ; j’écrirai dès demain à la cour de Rome… une lettre…
— Dont je proposerai le brouillon à Votre Majesté, si elle le désire…
— Très-bien, dit le roi.
— En même temps, continua le révérend, je demanderai pour le frère Escobar, que l’on devait nommer aumônier de la reine et à qui l’on a fait un passe-droit, je demanderai la place de confesseur de Votre Majesté.
— Mais j’ai déjà le frère Gaspard de Cordova.
— Qui est, dit-on, au plus mal ; il n’y a guère d’espoir, c’est ce qui nous donne celui de…
— Bien… bien, dit le roi, si l’évènement arrive, je me rappellerai votre demande ; une fois le duc de Lerma renversé, comment ferons-nous pour réparer ses fautes et sortir de la position où nous sommes ?
— Nous ferons alliance avec l’Empereur, que cette ligue protestante menace ainsi que nous… et puis les intelligences que j’ai ménagées avec le père Cotton, confesseur du roi de France et membre, comme moi, de la Compagnie de Jésus, nous permettront de connaître et d’entraver, si Dieu le permet, les desseins du roi Henri IV. Que Votre Majesté se rassure et se repose sur nous du soin de la défendre ; nous veillerons à ses intérêts comme aux nôtres. L’important, l’essentiel, c’est que demain le duc de Lerma ne soit plus ministre.
— Je vous en réponds, dit le roi vivement.
— Cela ne dépend que de Votre Majesté… et de sa volonté.
— Ma volonté, reprit le roi avec colère, est qu’il parte, qu’il s’en aille. Je lui ai retiré ma confiance, c’est déjà bien assez que je ne le fasse pas mettre en jugement… J’ai peut-être tort… mais enfin je vous l’ai promis, je tiendrai ma parole. Qu’il n’en demande pas davantage. Mais pour ce qui est de le laisser au pouvoir, il n’y restera pas un quart d’heure ; je serai là-dessus inexorable, et que personne ne vienne me parler pour lui ! Demain, après le conseil, il aura quitté la cour et Madrid… je vous le jure, et vous pouvez compter sur ma parole royale.
Le père Jérôme s’inclina avec respect et se retira enchanté. Il passa le reste du jour avec le duc d’Uzède, la comtesse d’Altamira et Escobar, pour mettre en ordre et rédiger les divers documents qu’il avait promis au roi. Les conjurés prirent ensuite toutes les mesures nécessaires et prévinrent les amis qu’ils avaient à la cour et surtout à l’audience de Castille, les d’Escalonne, les Gusman, les Médina, en un mot tous les ennemis secrets du duc de Lerma, c’est-à-dire la grande majorité du conseil.
Le soir, le père Jérôme retourna au palais, remit au roi les notes qu’il avait préparées, sans oublier l’esquisse du discours, écrit en entier, et le modèle de la lettre pour la cour de Rome ; il voulait, en même temps, recommander encore au monarque une fermeté inébranlable dans la séance du lendemain, mais il le vit tellement animé, qu’il jugea la recommandation inutile.
D’un autre côté, le duc de Lerma, Sandoval et tous les siens avaient passé la nuit dans les plus grandes inquiétudes. Le père Jérôme avait été reçu plusieurs fois au palais, et le roi en avait fait un mystère à son ministre. Les nouvelles du dehors devenaient si alarmantes et étaient maintenant tellement connues qu’il n’y avait plus moyen de les cacher, et dans le conseil qui devait se tenir le lendemain au palais, il était impossible de ne pas en parler.
Il fallait donc tout avouer au roi et aux membres du conseil. La disgrâce du duc devenait inévitable, et le chapeau de cardinal n’arrivait pas. En revanche, les bruits calomnieux qui couraient contre le duc de Lerma avaient pris une telle intensité, que ses amis en étaient effrayés et que lui-même ne savait comment parer les coups invisibles qui lui étaient portés.
Telle était la situation de tous les partis, lorsque arriva le grand jour, le jour du conseil.
Les ducs de Médina, d’Escalonne, Gusman de Mendoza, tous les ennemis du ministre étaient arrivés les premiers. Fidèles au rendez-vous que leur avait donné le père Jérôme, ils formaient différents groupes, et parlant à voix basse, ils se concertaient entre eux. En ce moment entra le marquis de Miranda, de la maison de Zuniga, président de l’audience de Castille ; il avait été nommé à cette place importante par le duc de Lerma et était un de ses partisans les plus dévoués. Il était accompagné de plusieurs autres conseillers, comme lui, amis ou créatures du ministre. Quelques-uns des nouveaux arrivants aperçurent les groupes déjà formés et s’en approchèrent. On s’y entretenait des nouvelles publiques, à voix basse, il est vrai, mais de façon à être entendu.
— Oui, le Milanais est envahi par Lesdiguières, disait l’un.
— L’intention du roi Henri, disait l’autre, est de commencer par s’emparer de la Franche-Comté et de la réunir à la France.
— Il y réussira sans peine, disait le duc de Médina ; j’en arrive, et il n’y a pas un soldat pour l’en empêcher, de sorte que, possédant de grands fiefs dans ce pays, je vais devenir sujet du roi de France.
— Et que fera-t-on de l’Espagne ? disait d’Escalonne.
— Je l’ignore, répondit Gusman, mais je sais bien ce qu’on devrait faire de son ministre…
À ces paroles, les amis du duc de Lerma pâlirent, et se mêlant aux différents groupes, ils laissèrent le marquis de Miranda, leur président, absolument seul. Etonné de cet abandon, il s’approcha à son tour, et entendant prononcer le nom du ministre :
— Que dites-vous là, messeigneurs, demanda-t-il avec Hauteur, de notre glorieux duc de Lerma ?
— Qu’il est perdu, répondit d’Escalonne.
— Hein ! qu’est-ce que c’est ? s’écria le président en changeant de couleur et en parlant beaucoup moins haut. Expliquez-vous, messieurs.
On le mit au fait, en lui déclarant que le moment était venu de servir, non plus un homme, mais l’Espagne, et qu’il fallait abandonner celui qui les avait ainsi conduits à leur perte. Ces raisons, débitées avec chaleur, étaient d’autant plus spécieuses qu’elles étaient données, non pas seulement par les ennemis du duc de Lerma, mais par ses partisans eux-mêmes, qui venaient de passer dans les rangs opposés ; aussi le président Miranda de Zuniga, déjà tenté de les suivre, hésitait encore et se contentait de répéter :
— C’est grave… très-grave !
Les membres du conseil arrivaient successivement ; les uns se plaçaient à côté de Médina et de Gusman ; les autres, en petit nombre, s’asseyaient près des fauteuils où se tenaient d’ordinaire le duc de Lerma et Sandoval. Ceux-ci ne paraissaient pas encore, et chacun s’en étonnait.
— Il y a de mauvaises nouvelles, dit d’Escalonne, des nouvelles plus fâcheuses encore que les premières ; j’ai vu un courrier qui venait de France descendre au palais de Sandoval.
À ce mot, plusieurs des conseillers déjà assis se levèrent et allèrent s’asseoir auprès du duc d’Escalonne.
En ce moment le duc d’Uzède entra.
Il se fit un grand silence. Tous les yeux se dirigèrent vers lui, et l’on se demandait s’il irait se placer à gauche auprès du groupe le plus nombreux, ou à droite auprès du duc, son père.
Uzède salua tout le monde en silence et alla s’asseoir au milieu, près du fauteuil royal.
Un grand bruit annonça l’arrivée du roi, qui, contre son ordinaire, portait à la main des papiers qu’il avait l’air de feuilleter ; son front était sombre et soucieux, et il marchait rapidement.
Chacun se leva avec respect.
— Bien ! bien ! messieurs, dit-il d’un ton brusque, asseyez-vous. Nous avons à traiter aujourd’hui des affaires importantes.
Tout le monde s’assit. Le roi se couvrit.
Il n’avait pas encore osé regarder le duc de Lerma. Alors seulement il jeta les yeux vers l’endroit où il se tenait ordinairement ; et voyant son fauteuil vide, ainsi que celui de son frère Sandoval, leur absence lui donna sans doute un nouveau courage, car il dit avec amertume :
— Je vous remercie de votre exactitude, messieurs ; vous n’êtes point de ceux qui craignent de se montrer au moment du danger.
À ces mots significatifs et d’autant plus étonnants qu’ils étaient prononcés par le roi, lequel ne parlait presque jamais, un sourd murmure circula dans l’assemblée, et chacun se regarda d’un air qui voulait dire : C’en est fait ! le ministre est renversé.
La porte du vestibule s’ouvrit, et le duc de Lerma parut suivi du grand inquisiteur Sandoval son frère.
Dans ce moment on n’entendit plus dans la salle du conseil que le battement du balancier de la pendule, tant le silence qui se fit tout à coup était morne et profond.
Sandoval avait l’air sombre mais impassible. Le duc de Lerma avait l’air fort agité.
— Je demande pardon au roi et à messeigneurs les conseillers, dit-il en s’inclinant avec respect, de les avoir fait attendre. Un retard involontaire…
Un murmure de désapprobation se fit entendre dans cette assemblée, d’ordinaire si patiente et si docile.
— Un retard involontaire continua le duc, et que je n’ai pu prévoir…
— Il ne prévoit jamais rien, dit d’Escalonne, bas, à l’oreille de Gusman.
— Oui, messeigneurs, reprit le ministre en regardant d’Escalonne, un retard impossible à prévoir. On a arrêté ma voiture. Le peuple l’avait entourée et nous jetait des pierres en poussant des cris sur lesquels je désire avant tout m’expliquer devant vous, messeigneurs, et devant Sa Majesté le roi. Qu’on me dise de qui viennent les bruits que l’on fait circuler, quelle en est la source ?
— Il suffit, dit le roi, nous savons qu’en penser.
— Comment, sire ! s’écria le duc avec indignation, qu’entend par là Votre Majesté ?
— J’entends… dit le roi un peu troublé, que je ne vous accuse point, monsieur le duc… je désire même… je veux qu’un pareil sujet ne soit pas traité ici… par vous, ou je croirai… que… l’importance… qu’on attache… à une accusation… chimérique… a pour but de détourner notre attention… de plusieurs autres griefs et reproches qui ne sont que trop réels.
Le roi paraissait ému, et sa voix était beaucoup plus faible en terminant cette phrase qu’en la commençant ; mais pour lui un tel effort était déjà beaucoup : c’était, aux yeux de tous, une manifestation éclatante du mécontentement royal et un indice certain de la chute du ministre.
— J’attends avec respect, dit le duc de Lerma, les reproches qu’il plaira à Sa Majesté le roi, mon seigneur et maître, de vouloir bien m’adresser.
Le roi jeta les yeux sur un papier qu’il avait placé sous sa main, en feuilleta plusieurs autres, revint au premier, et dit d’une voix qu’il avait cherché à raffermir :
— Toute l’Europe est en armes contre nous, une ligue de tous les princes protestants s’est formée contre l’Espagne. Est-ce vrai ?
— Oui, sire, dit le ministre.
— On ajoute que le roi de France a rassemblé une armée formidable, plus de soixante mille hommes, une nombreuse cavalerie, et que lui, Roi Très-Chrétien, est l’âme et le chef de cette guerre. J’aime à croire que ce n’est qu’un vain bruit.
— Non, sire, c’est la vérité,
Un murmure général circula dans l’assemblée.
— On assure mème que le Milanais est envahi, que le duc de Savoie se prépare à nous attaquer, que le roi Henri a dû quitter Paris, il y a quatre jours, pour se mettre à la tête de ses troupes… Ces renseignements sont-ils faux ou exacts ?
Le duc parut hésiter… et le roi, reprenant sa hardiesse à mesure que son ministre perdait de la sienne, répéta d’une voix ferme :
— Je vous demande si ces renseignements sont exacts ?
— De la plus grande exactitude, dit le duc.
— Et comme jusqu’à présent vous n’avez pas jugé à propos de nous donner le moindre avis de ces graves événements, ni à nous ni aux membres du conseil, nous devons penser que vous avez pris les mesures nécessaires pour soutenir l’honneur de l’Espagne. Nous vous demanderons le nombre de nos vaisseaux équipés et de nos soldats prêts à entrer en campagne ?
— Permettez-moi, sire… balbutia le ministre.
— Où sont réunies nos armées… et quels généraux avez-vous choisis pour les commander ?
— Aucun de nous n’a reçu d’ordre, dit Gusman de Mendoza.
— Et pas une compagnie, pas un escadron ne défend les frontières ! s’écria le duc de Médina ; j’en arrive !
— Sommes-nous donc livrés sans défense à nos ennemis ? dit Gusman.
— Répondez donc au roi ! s’écria impétueusement d’Escalonne, et rendez-lui compte des destinées et de la gloire de l’Espagne, qu’il vous a confiées.
— C’est là ce que je demande, dit avec force le roi, qui, se sentant soutenu par tout le monde, avait la voix éclatante et l’air menaçant.
— Parlez ! parlez ! criait-on de tous les coins de la salle, et chacun accablait le ministre, excepté le marquis de Miranda, qui, seul, ne s’était pas encore prononcé et avait le courage… de se taire.
— Sire, dit le ministre, et vous, messeigneurs, je n’ai jamais cessé de veiller à la gloire et à l’indépendance de l’Espagne. Il me serait facile de vous détailler quelles mesures j’avais prises pour défendre notre territoire, quelles négociations j’avais entamées pour dissoudre cette ligue, quelles alliances j’avais formées pour lui résister.
— Dites-nous-les donc ! s’écria le roi avec impatience.
— Ce serait abuser des instants de Votre Majesté. Des murmures éclatèrent de tous les côtés.
— Oui, je le répète, ce serait complétement inutile, dit le ministre d’une voix forte, qui domina toute l’assemblée.
— Inutile ! s’écria Médina ; et pourquoi ?
— Parce que nous n’avons plus rien à craindre des ennemis du dehors, répondit le ministre en regardant ses adversaires ; parce que l’armée du roi de France ne franchira pas la frontière ; parce que cette ligue des princes protestants, formée avec tant de peine, et qui dépendait tout entière d’un seul homme, cette ligue est déjà anéantie dans la personne de son chef : le roi Henri IV… n’est plus !
À cette nouvelle, chacun resta immobile et frappé de stupeur.
— Le roi de France n’est plus !… répéta le duc d’Uzède, pâle, foudroyé et ne pouvant croire à ce qu’il venait d’entendre.
— Mort !.. dit le grand inquisiteur d’un air sombre ; mort sous le poignard d’un assassin. Des lettres que j’ai reçues ce matin de France, du duc d’Épernon, nous annoncent que le roi, au moment où il se rendait à Notre-Dame pour le couronnement de la reine, a été frappé dans sa voiture, rue de la Ferronnerie, par un nommé Ravaillac.
— À coup sûr, s’écria le duc de Lerma, ce n’est pas ainsi que devait mourir un si grand prince, et nous déplorons sa perte.
— Nous la déplorons ! répéta le grand inquisiteur, tout en adorant les décrets célestes et en reconnaissant la main de Dieu dans le châtiment aussi prompt que terrible du chef de ces hérétiques ; car il a succombé au moment même où il menaçait un peuple catholique fidèle serviteur de l’Église !
— Dieu protége l’Espagne ! dit le roi en levant les yeux vers le ciel.
— Dieu nous a sauvés ! s’écria Miranda.
— Mais nous l’eussions encore été par nous-mêmes, s’empressa d’ajouter le ministre. C’est avec douleur que Marie de Médicis voyait cette guerre impie et sacrilége ; c’est avec regret qu’elle avait renoncé à l’alliance que depuis longtemps je lui avais proposée, et que repoussaient le roi Henri et Sully, son ministre ; mais aujourd’hui que Marie de Médicis devient régente de France et souveraine absolue, au lieu de la guerre, elle s’empresse de nous offrir la paix. Voici les lettres signées d’elle que nous adressent d’Épernon et Concini.
En entendant ces mots, tous les visages s’épanouirent, à commencer par celui du roi.
— Au lieu d’une rivale, nous aurons désormais dans la France une nation amie, prête à nous aider de ses armes et de ses subsides ; prête à nous prodiguer les soldats et les trésors rassemblés par Henri IV ; une fidèle alliée qui demande à mêler son sang au nôtre, car la reine Marie nous propose un double mariage, celui de sa fille avec le prince des Asturies et celui de notre jeune infante Anne d’Autriche avec le jeune roi Louis XIII. Trouvez-vous, sire, et vous, messeigneurs, que j’aie trahi les intérêts et la gloire de l’Espagne[20] ?
— Vive le duc de Lerma ! s’écria le marquis de Miranda.
— Vive notre glorieux duc ! répéta une partie de l’assemblée que le vent du succès avait déjà fait tourner vers le ministre.
Quant au roi, étonné, interdit, il ne savait s’il devait s’affliger ou se réjouir, et le duc d’Uzède, la rage dans le cœur, courut chez la comtesse d’Altamira apprendre au père Jérôme et à Escobar, qui s’attendaient à un triomphe, que jamais le duc de Lerma n’avait été plus fort, plus glorieux et plus roi d’Espagne que dans ce moment.
LV.
une résolution du roi.
Après la mort de la reine, rien n’avait pu retenir Carmen à Madrid. Elle comprenait qu’en y restant elle n’aurait point la force d’exécuter le sacrifice qu’elle avait juré d’accomplir.
Aïxa et Fernand s’aimaient, elle n’en pouvait douter, elle l’avait entendu. En épousant son cousin, elle faisait trois malheureux ; en renonçant à cette union, il n’y avait qu’une infortunée, et c’était elle. Aussi, et malgré les instances de Fernand d’Albayda, malgré les larmes d’Aïxa, elle avait voulu partir ; elle s’était enfermée dans le couvent des Annonciades de Pampelune, où elle s’empressa de commencer son noviciat.
Aïxa, ne pouvant suivre son amie, voulait, et c’était son devoir, retourner à Valence, près de son père ; elle le pouvait maintenant : le départ de Carmen, la mort de la reine, ne lui permettaient plus de rester à Madrid, et elle devait ses soins et son amour au vieillard qui l’aimait si tendrement et qui depuis tant d’années était privé de sa présence.
Juanita était déjà partie : elle allait à Valence retrouver Pedralvi et annoncer l’arrivée d’Aïxa, que la maladie de Yézid retenait encore à l’hôtel de Santarem.
Le jour où Piquillo se présenta devant son frère et lui dit : La reine n’est plus ! Yézid poussa un cri horrible, et tomba dans un morne désespoir et une insensibilité qui fit craindre pour sa vie et pour sa raison. Des semaines entières se passèrent pour lui sans sommeil et sans qu’il parlât ni à Piquillo ni à sa sœur.
De temps en temps, il répétait à voix basse : Marguerite ! Marguerite ! Puis, comme effrayé d’avoir prononcé ce nom, il regardait autour de lui, cachait sa tête dans ses mains et s’enfuyait. Il recevait les soins de son frère et de sa sœur sans les remercier… il ne les reconnaissait pas.
Un jour seulement, Piquillo eut l’idée de lui présenter une bague : c’était une turquoise sur laquelle était gravé le mot arabe Toujours.
À cette vue la raison sembla lui revenir. Au grand étonnement d’Aïxa, ce talisman magique parut le rappeler à la vie ; mais la surprise d’Aïxa redoubla quand elle crut reconnaitre la bague que la reine portait d’ordinaire.
— Qui te l’a donnée, frère ? s’écria Yézid en frémissant.
— Celle qui n’est plus, mais qui veille encore sur nous. Yézid tomba à genoux.
— Elle m’a dit de te la remettre en t’ordonnant de vivre, et de consacrer, comme moi, à tous les tiens, ces jours que tu lui avais donnés. Lui obéiras-tu ?
— Toujours ! répondit Yézid en portant la bague à ses lèvres.
Il fut décidé que dès que la convalescence de Yézid le permettrait, il retournerait avec sa sœur à Valence. Fernand d’Albayda devait aussi plus tard s’établir dans ses beaux et riches domaines qu’il n’avait pas visités depuis longtemps.
Une vague et douce espérance dont il n’aurait osé parler à personne, et qu’il s’avouait à peine à lui-même, venait parfois faire battre son cœur. Il se la reprochait à l’instant, et continuait à s’y livrer.
Dire que cet avenir lointain ne se présenta pas aussi parfois aux yeux d’Aïxa, c’est ce qu’on ne pourrait affirmer, toujours est-il vrai que pas un mot, pas un regard n’avait été échangé entre eux à ce sujet, quoique chaque jour ils parlassent de Carmen. Son souvenir et son image toujours présents eussent fait regarder toute autre idée comme un crime. Le cœur aussi a son veuvage que l’on doit respecter, et que le temps seul permet de rompre.
Le départ d’Aïxa était donc arrêté, mais elle ne pouvait quitter Madrid et la cour sans en prévenir le roi, sans obtenir son agrément, sans lui faire au moins ses adieux, à lui qui s’était toujours montré si affectueux et si bon, et qui, récemment encore, venait de lui témoigner si hautement son estime. Elle fit donc demander une audience à Sa Majesté.
Tous ces arrangements de famille, tous ces détails intérieurs, avaient eu lieu pendant les graves évènements dont nous venons de faire le récit.
À peine remis des rudes frayeurs qu’il avait éprouvées, le duc de Lerma contemplait avec joie, mais avec frayeur encore, la profondeur du précipice dont un miracle l’avait retiré. Il avait cru tout perdu, et il voyait tout sauvé. Il triomphait des événements, de ses ennemis et même de son roi. Son imprévoyance lui comptait, grâce au succès, pour du talent, et son inhabileté pour une haute et sage politique. Jamais, pendant tout le temps de son administration, il n’eut un moment plus brillant et plus glorieux.
La paix garantie pour longtemps par les nouvelles et solides alliances qu’il venait de former, lui donnait enfin le loisir de réparer toutes ses fautes passées, de fermer toutes les plaies du royaume, de former une armée, de rétablir les finances, de ranimer surtout le commerce, l’agriculture et l’industrie, que les Maures seuls soutenaient en Espagne.
Mais au lieu de se livrer à tous ces grands et utiles travaux, le ministre et son frère Sandoval ne rêvaient déjà qu’aux moyens de porter à l’Espagne les derniers coups sous lesquels devait expirer sa prospérité.
Dès le lendemain du succès, le grand inquisiteur s’était hâté de rappeler la promesse que son frère lui avait faite aux jours du danger. Le duc avait promis que s’il échappait à la tempête qui le menaçait, il ne s’opposerait plus aux desseins du ciel et de son frère, et qu’il seconderait celui-ci de tout son pouvoir, afin d’arriver à l’expulsion totale des Maures d’Espagne.
Le premier ministre, s’il avait été son maître, aurait entrepris sur-le-champ une autre croisade qui lui paraissait plus urgente et plus utile à ses intérêts particuliers ; c’était l’expulsion immédiate et complète des révérends pères jésuites, ses ennemis mortels. La fermeté inusitée que le roi avait déployée dans le conseil, l’air gêné et contraint avec lequel il accueillait son ministre, l’espèce d’antipathie et de répulsion que maintenant encore il lui témoignait, tout cela était l’ouvrage du père Jérôme, qui, quelquefois encore, continuait à voir le roi en secret.
Le duc commençait à le comprendre, c’était de là que venaient les calomnies qui circulaient sur son compte ; c’était de là que viendrait sa ruine, et il lui tardait de dissoudre une coalition implacable et intime dont son fils était le chef.
Le ministre, désormais défilant, avait tout examiné avec soin.

Les renseignements qu’il avait acquis par Piquillo s’étaient trouvés tous exacts. Lui et Sandoval ne pouvaient se dissimuler que ce moine inconnu et obscur les avait mieux servis que leurs amis les plus dévoués. C’était lui qui les avait sauvés, et ce qui redoublait leur étonnement, c’est que ce moine, humble et modeste, sans intrigue comme sans ambition, se tenait à l’écart et semblait prendre à tâche de s’effacer, lorsque la faveur dont il jouissait près du roi, et surtout près de la reine, aurait pu le porter au premier rang.
Ignorant surtout les liens qui l’attachaient à Aïxa, le ministre et le grand inquisiteur le regardaient comme un auxiliaire utile dont ils ne se servaient pas, mais dont ils pouvaient se servir.
L’occasion ne tarda pas à se présenter.
Ainsi que l’avait prévu et espéré l’habile supérieur de la Compagnie de Jésus, on venait d’apprendre la mort du cordelier frey Gaspard de Cordova.
Il fallait lui donner un successeur.
C’était là le but des visites secrètes que le père Jérôme faisait au roi. Il comptait faire nommer à cette place de confesseur quelqu’un de son ordre. Il avait déjà parlé, comme nous l’avons vu, du frère Escobar, que le duc d’Uzède soutenait de tout son pouvoir, manœuvres auxquelles s’opposaient le ministre et surtout le grand inquisiteur, qui voulait cette fois que le confesseur du roi fût pris dans l’ordre de Saint-Dominique.
Il proposa donc un cousin à lui.
À sa profonde surprise, le roi eut le courage inouï, pour ne pas dire l’audace, de refuser. À son tour, et dans son dépit, l’inquisiteur eut l’insolence de repousser nettement Escobar, que le roi lui avait désigné.
Or, comme le consentement royal et l’approbation du saint-office étaient également nécessaires, il n’y avait pas moyen de mettre fin à ce débat, et le roi courait risque de rester sans confesseur, ce qui eût été le plus grand des scandales.
Le duc de Lerma pensa à Piquillo, qui lui était dévoué, et dont l’humilité et la modestie lui convenaient fort : de plus, il en avait eu la preuve, c’était l’ennemi mortel du père Jérôme et d’Escobar.
L’inquisiteur l’accepta, car c’était un dominicain, et le roi, déjà effrayé d’avoir montré tant de courage, n’eut garde de le refuser, car c’était le frère d’Aïxa, secret connu de lui seul et de don Fernand.
Ce fut ainsi, et comme l’attestent tous les historiens contemporains[21], que frey Luis Alliaga, sans le vouloir et sans même y penser, arriva, par le duc de Lerma, à la place de confesseur du roi, place inoffensive avec lui et si redoutable avec un prêtre intrigant.
Aussi Escobar, se voyant encore une fois supplanté par Piquillo, malgré les bonnes intentions du roi et la protection du duc d’Uzède, commença à croire qu’il y avait mauvaise volonté de la part de celui-ci.
Dès ce moment commença entre les anciens alliés une mésintelligence que le ministre prit soin d’augmenter, et qui, ainsi qu’on le verra, ne tarda pas à éclater.
En attendant, Piquillo était confesseur du roi ; il était dans sa destinée de s’élever par ses ennemis et de leur devoir sa fortune.
Le grand inquisiteur promit à son tour au duc de Lerma de favoriser plus tard, et de toute son influence, le bannissement des pères de la Compagnie de Jésus. Tout l’y portait, son inclination, son intérêt et l’amitié qu’il avait pour son frère, mais il voulait qu’avant tout on s’occupât de l’expulsion des Maures, et il employa un dernier argument qui décida sur-le-champ le ministre :
Le chapeau de cardinal que le duc avait sollicité de la cour de Rome, et que les intrigues du père Jérôme l’avaient jusqu’ici empêché d’obtenir, ce chapeau, objet de tous ses vœux, avait été formellement promis par le pape le jour où les Maures seraient chassés d’Espagne, et jamais les circonstances n’avaient été plus favorables. Tous les obstacles semblaient d’eux-mêmes s’aplanir à la mort de la reine, qui laissait leurs ennemis sans protection aucune ; la paix avec la France, qui leur permettait de disposer de toutes les forces militaires de l’Espagne et de les concentrer, en cas de résistance, sur les provinces de Valence et de Grenade ; enfin, les services rendus récemment par le ministre et qui lui donnaient le droit de tout exiger.
Il fallait donc se hâter de présenter au roi le décret de bannissement et l’engager à le signer.
Il y avait un obstacle, il est vrai, l’amour du roi pour Aïxa ; mais le roi avait ignoré jusqu’ici que celle qu’il aimait fût une Maure ; on pouvait bien le lui cacher encore, et s’il venait à le découvrir, trois moyens restaient : gagner Aïxa, ou la perdre, ou enfin effrayer le roi, en opposant à sa maîtresse la cour de Rome, et à son amour l’excommunication.
Le jeune roi, qui ne se doutait pas des nouvelles inquiétudes et des nouveaux combats qui allaient l’assaillir, se trouvait déjà bien malheureux. Jamais il ne s’était vu dans une position pareille. Forcé de subir, bien plus, d’approuver et de louer avec tout le monde un ministre qu’il n’aimait plus, qu’il craignait et qu’il regardait comme coupable, comment maintenant lui faire son procès ? le roi ne l’avait pas osé la veille de sa chute, à plus forte raison le lendemain de son triomphe.
Il ne pouvait même pas, quoique l’envie commençât à lui en venir, destituer un ministre qui venait de sauver l’Espagne, mais peu habile à dissimuler, il n’avait pu cacher à son favori, qui du reste s’en était aperçu, l’espèce d’éloignement et de crainte instinctive qu’il éprouvait pour lui. Mais ses craintes, ses tourments, ses humiliations, à qui les confier ? Il regardait autour de lui et ne se voyait pas un ami. Il était seul au milieu de la cour.
Pour comble de maux, il aimait Aïxa plus que jamais, et depuis qu’il ne la voyait plus, son amour avait redoublé, indifférent aux destinées de l’État, dont il avait abandonné les rênes, il ne rêvait plus qu’aux moyens de se rapprocher de la seule personne qui lui fût chère.
C’est dans ce moment qu’il reçut d’elle une demande d’audience ; Sa Majesté ne la fit pas attendre.
Au moment où entra la duchesse de Santarem, le roi pâlit, et son trouble fut si visible qu’Aïxa elle-même en fut déconcertée.
— Qu’avez-vous à me demander, madame la duchesse ? Parlez, Que me voulez-vous ?
— Remercier Votre Majesté de toutes les bontés dont elle m’a comblée, et lui faire mes adieux.
— Vous partez, vous ! dit le roi.
Il resta interdit et murmura avec un air de profonde douleur :
— Je suis bien malheureux !
— Vous, sire ?
— Oui, depuis quelques jours, tout semble m’accabler… C’est là le dernier coup.
— En vérité, sire, je ne puis croire à ce que vous me dites là. Mon départ est un événement de si peu d’importance !
— Écoutez-moi, duchesse.
Il s’arrêta, comme s’il luttait contre sa timidité ; puis, rassemblant tout son courage, il lui dit d’une voix qu’il essayait de rendre ferme, et qui tremblait d’émotion :
— Je vous aime !….. Oui… oui… c’est la première fois que ce mot sort de ma bouche… mais il ne vous a rien appris.
Aïxa avait trop de franchise et de loyauté pour chercher de vains détours : elle se contenta de garder le silence, et le roi reprit :
— Oui, vous savez bien que je vous aime, et vous comprendrez alors combien ce départ m’afflige. Je n’avais aucun plaisir, aucun bonheur… que celui de vous voir.
— Et depuis longtemps, sire, depuis la mort de la reine, je ne venais plus à la cour.
— Avez-vous besoin de le dire, et croyez-vous que je ne m’en sois pas aperçu ? j’ai si peu d’amis que quand il ne m’en manque un, il ne m’en reste plus. Voilà ce que j’ai éprouvé en votre absence ! Vous n’étiez plus là, c’est vrai, mais je vous savais à Madrid… Je pouvais vous rencontrer… comme l’autre jour, par exemple. Cela n’arrivait pas, continua-t-il avec un sentiment douloureux, mais j’espérais que cela arriverait… c’était quelque chose, c’était une émotion dans ma vie !
À l’aveu de cet amour exprimé si simplement et si franchement, Aïxa ne savait que répondre ; elle balbutia quelques mots de respect et de dévouement pour le roi…
— Oui, s’écria celui-ci avec amertume : le roi ! toujours le roi ! c’est-à-dire celui que personne n’aime… Celui qui est condamné au respect et à l’isolement, c’est là le roi ! Voyez-vous, duchesse, je n’ai eu qu’un jour heureux dans ma vie, ou plutôt une soirée, celle où j’étais Augustin de Villa-Flor… votre cousin… ou que du moins vous me traitiez comme tel… Et quand je bénis cette soirée… je ne sais pas pourquoi… car c’est depuis ce temps-là que je vous aime !
— Votre Majesté me permettra-t-elle de lui dire…
— Parlez-moi comme alors, parlez-moi franchement, dussiez-vous tourner en dérision ma faiblesse.
— Jamais, sire ; aujourd’hui comme alors, je vous remercierai de votre amitié. Aujourd’hui comme alors, je vous dirai : pourquoi le roi remet-il à d’autres le pouvoir que le ciel lui a confié ? pourquoi ne cherche-t-il pas dans les devoirs, dans les travaux qui lui sont imposés, une distraction à des chagrins qui s’effaceront bien vite… pourvu qu’il le veuille seulement.
— Oui, il n’y a que vous qui m’ayez jamais parlé ainsi ; mais ce courage et cette force de volonté, il ne suffit pas de me les conseiller, il faut me les donner, et je ne les ai que quand je vous entends, quand vous êtes là ! Ne me quittez donc pas, duchesse, je ne suis rien par moi-même, je suis tout par vous.
Et dans les yeux du pauvre roi roulait une larme qui, mieux que ses paroles, semblait dire : restez.
— Je le voudrais, sire, mais cela n’est pas possible.
— Restez pour me donner la force de déjouer les piéges qui me menacent, pour démasquer les traitres qui m’entourent…
— Serait-il vrai, sire ?
— Oui, oui, ce dont je vous parlais l’autre jour… Tout cela n’est que trop vrai… je ne vois ici que des ennemis… je ne puis me fier qu’à vous, et vous m’abandonnez !
Alors, dans un trouble inexprimable, il tomba à ses genoux ; et saisissant sa main, qu’il baigna de ses larmes, il s’écria avec chaleur :
— C’est moi ! c’est votre roi… non, c’est votre ami qui vous supplie. Restez, pour que ce peuple qui me méprise m’honore et m’estime ; restez, pour que mon règne soit glorieux… ou plutôt… restez pour que je vous aime, pour que je jette à vos pieds ce sceptre et cette couronne, auxquels je n’aurai dû qu’un jour de bonheur, celui où je vous les aurai donnés !
— Sire ! sire ! relevez-vous ! lui dit Aïxa ; revenez à la raison et daignez m’écouter.
Je ne puis rester en ce palais sans manquer à la mémoire de la reine, votre femme et ma bienfaitrice, sans manquer moi-même à mes devoirs ; et pouvez-vous penser qu’au moment où je vous rappelle les vôtres j’oublierais les miens ?
Mon seul bien, ma royauté à moi, c’est mon honneur, et cette royauté, je saurai la conserver et la défendre comme je vous conseillais de défendre la vôtre.
Ne vous fâchez pas de mes paroles, sire, votre amitié seule me toucherait plus que vos grandeurs. Je n’ai point d’ambition ; je n’en ai qu’une du moins, celle de rester une honnête femme, et si je cédais à vos vœux, vous qui prétendez m’aimer, vous seriez à jamais malheureux, car le jour où je deviendrais votre maîtresse serait le dernier de ma vie : je me tuerais !
Ces mots étaient prononcés avec une simplicité et une franchise si énergiques, qu’il n’y avait pas à douter qu’ils ne partissent du cœur, et qu’Aïxa n’eût dit la vérité.
Le roi en fut comme effrayé. Il la regarda quelque temps en silence et avec respect. Puis, comme frappé d’une idée nouvelle, son front s’éclaircit, son cœur oppressé respira plus librement.
— Vous avez raison, duchesse, et je vous prouverai que j’étais digne de vous comprendre ; je vous prouverai que mon amour n’était pas un amour ordinaire. Ne partez pas, cependant, accordez-moi encore huit jours. Vous ne les refuserez point à votre roi… à votre ami !
Aïxa s’inclina en signe d’assentiment.
— Bien, bien, duchesse, je vous remercie de cette promesse ; j’en demande une seconde, c’est que vous ne partirez point sans me faire vos adieux.
— Je remercie Votre Majesté de l’honneur qu’elle veut bien me faire et je me rendrai à ses ordres.
— À mes ordres… non ! mais à ma prière. Je vous attendrai donc ici, dans huit jours, à la même heure.
La duchesse fit au roi une profonde révérence et se retira.
Le roi la suivit longtemps encore des yeux pendant qu’elle traversait les vastes salons du palais. Il admirait cette taille majestueuse, cet air noble et fier, cette démarche de reine.
— Oui, se disait-il avec chaleur : elle mérite ce que je veux faire pour elle ; c’est une belle et généreuse pensée qu’elle seule pouvait inspirer, et depuis qu’elle m’est venue, mes inquiétudes se dissipent, le présent ne m’effraie plus, l’avenir me sourit. Que sera-ce donc quand cette idée sera exécutée ? c’est là le difficile ! mais, comme elle le disait, il ne s’agit que de vouloir pour renverser tous les obstacles, et cette fois j’aurai une volonté.
Le roi avait, en effet, conçu un projet que nul, à coup sûr, n’eût pu soupçonner, et que son amour seul pouvait faire comprendre. Voyant bien que la duchesse de Santarem n’était pas femme à céder à ses désirs de roi ; persuadé, comme elle le lui avait dit, qu’elle se tuerait plutôt que d’être sa maîtresse, et, d’un autre côté, ne pouvant se résoudre à renoncer à elle, il avait résolu d’en faire sa femme et son premier ministre.
Puisqu’il était dans son caractère d’être subjugué et dirigé, il valait mieux l’être par Aïxa que par le duc de Lerma, et décidé, sitôt qu’il le pourrait, à se défaire de celui-ci, il ne pouvait pas choisir un successeur qui lui convint mieux et qui lui fût plus agréable.
LV*[22].
le mémoire de l’archevêque.
Le roi ne s’était pas dissimulé les difficultés qu’il aurait à vaincre pour arriver à l’exécution de son projet : l’orgueil de la noblesse espagnole, le rigorisme de la cour, l’inflexible sévérité de l’étiquette.
Mais si la duchesse de Santarem ne pouvait devenir reine d’Espagne, rien n’empêchait qu’elle ne devint la femme du roi. Il était veuf, il était libre. Les mariages de la main gauche étaient alors fréquents chez les personnages de la plus haute distinction. L’Espagne même avait vu Maria Padilla s’asseoir sur les degrés du trône de don Pèdre ; il ne fallait pour cela que trouver appui et protection chez les personnages les plus influents du clergé et de la cour ; leur approbation entraînerait celle des autres, et chacun, s’empressant d’imiter leur exemple, fléchirait le genou devant la nouvelle reine.
Il répugnait au roi de confier ce projet au duc de Lerma et surtout au grand inquisiteur, et cependant c’étaient eux qui pouvaient le mieux le faire réussir ; mais aucune sympathie n’attirait plus le roi vers eux ; tout lui disait au contraire qu’ils étaient les ennemis nés d’Aïxa, et que, loin de servir ce mariage, ils emploieraient tout leur crédit à l’empêcher.
Le duc d’Uzède aurait mieux convenu au roi, mais il n’avait pas assez d’influence, ou pour mieux dire il n’en avait aucune.
Le père Jérôme aurait sans doute favorisé ce dessein auprès de la cour de Rome ; le roi le croyait du moins, et grande était son erreur ; le père Jérôme était au plus mal avec Sandoval, le duc de Lerma et le saint-office, et le prendre pour allié, c’était se donner tous les autres pour adversaires. Une autre idée vint au roi.
Il avait sur sa table un mémoire d’une belle écriture qui portait ces mots : Important et secret… pour le roi seul.
Il lui était adressé par le patriarche d’Antioche, l’archevêque de Valence, Ribeira. Ce mémoire démontrait par des arguments victorieux la nécessité d’expulser le plus promptement possible les Maures de l’Espagne. Le roi n’avait pas lu ce mémoire ; il s’était contenté d’en regarder la signature, et le nom de Ribeira lui avait désigné l’homme qui pouvait, s’il le voulait, seconder ses desseins.
Son influence était immense en Espagne et dans la chrétienté, où on le regardait comme un saint. Ce mariage béni par lui ne rencontrerait que des approbateurs, et obtiendrait même le concours du saint-office, dont Ribeira était un des principaux membres.
Il ne s’agissait donc que de gagner ce prélat, et ce fut à lui que le roi résolut de confier le premier son projet, honneur qui devait d’abord le flatter.
Le roi lui écrivit donc, de sa main, pour le prier de quitter Valence et d’accourir à l’instant même et en secret à Madrid.
L’archevêque, persuadé de l’effet qu’avait produit son mémoire, et rêvant d’avance l’adoption de tous ses plans, s’empressa de quitter son palais épiscopal, ses ouailles et même deux conversions presque achevées que venait de lui expédier l’œuvre de la Rédemption, toujours dirigée par le curé Romero et par le frère Acapulco, nos anciennes connaissances.
L’archevêque arriva sans que le duc de Lerma et le grand inquisiteur en fussent instruits. Il se rendit directement dans le cabinet du roi, où l’on se hâta de l’introduire ; les ordres étaient donnés, et le roi, en l’apercevant, courut au-devant de lui, le visage épanoui et l’œil rayonnant.
— Asseyez-vous, mon père, dit le monarque de l’air le plus affectueux, en forçant l’archevêque à s’asseoir près de son bureau ; et le prélat goûta cette jouissance indicible d’amour-propre que les auteurs religieux ou laïques peuvent seuls bien savourer et comprendre, celle de voir son ouvrage, son mémoire, sous les yeux et presque sous la main du roi.
— Il le lit sans cesse ! se dit-il.
— Mon père, dit le roi, je vous ai fait appeler pour une importante affaire.
— Mon mémoire, répéta le prélat en lui-même.
— L’affaire qui me tient le plus au cœur.
— Mon mémoire, se dit le prélat.
— Une affaire enfin qui m’occupe jour et nuit.
— Je le vois bien, dit le prélat en montrant du doigt le mémoire.
— Comment cela, mon père ? reprit le roi.
— Votre Majesté, répondit le prélat avec satisfaction, veut me parler de mon mémoire.
— Non, mon père…
— Votre Majesté cependant l’a lu ?
— Pas encore.
Si le roi avait été moins occupé de l’idée qui, en ce moment, l’absorbait tout entier, il aurait été frappé du coup d’œil foudroyant du saint prélat et de la décomposition totale de ses traits à ce seul mot : Pas encore !
— Il s’agit cependant, s’écria-t-il avec feu, du triomphe de la foi !
— Nous en parlerons plus tard. Écoutez-moi d’abord.
Le pieux archevêque, qui arrivait persuadé que la cause était définitivement jugée, tomba dans un profond découragement en voyant qu’elle n’était pas même plaidée, et il lui fallut toute sa patience évangélique ou plutôt toute l’envie qu’il avait de gagner son procès, pour prêter au roi l’attention que celui-ci lui demandait.
Le roi, avec plus d’adresse, de chaleur et d’esprit que son auditeur ne lui en aurait supposé, développa son idée et ses projets.
L’archevêque, disposé peu favorablement et les yeux toujours fixés sur son mémoire encore intact, secouait la tête d’un air de doute et de désapprobation, et finit par dire que l’affaire lui paraissait impraticable et impossible.
Le roi pâlit, se mordit les lèvres et répondit sèchement :
— Soit, monsieur l’archevêque ; nous avions compté sur vous pour nous seconder, nous nous adresserons à d’autres.
— Sire, j’ai répondu à Votre Majesté en mon âme et conscience, et c’est avec la même franchise que je lui parlerai du projet qui m’amène. Il s’agit des Maures, vos sujets.
Le roi n’écouta pas.
— Le mémoire que j’ai eu l’honneur de remettre à Votre Majesté…
— Bien, monsieur l’archevêque, je le lirai, dit le roi avec une froideur glaciale.
Et prenant le mémoire qui était sous sa main, il le jeta plus loin sur une pile de papiers indéfiniment ajournés.
— Dans ce mémoire, dit l’archevêque un peu troublé, j’avais l’honneur d’exposer à Votre Majesté…
Le roi se leva, marcha dans la chambre d’un air agité, et oubliant totalement l’archevêque, se mit à rêver à Aïxa.
Le prélat commença à comprendre sa faute, et sentit qu’il avait commis la même maladresse à l’égard du roi, que celui-ci à l’endroit de son mémoire.
Or, comme c’était là la principale affaire de sa vie, et qu’il tenait à son projet autant que le roi tenait au sien, il pensa, comme le frère Escobar, qu’en raison de l’intention, une transaction était permise, et que telles affaires impossibles séparément devenaient, en se réunissant, d’une exécution facile.
Il toussa assez fortement pour rappeler l’attention du roi, alors totalement absente, et dit d’un air mielleux :
— Je suis pour ce que j’en ai dit…
— Et qu’avez-vous dit ? demanda brusquement le roi.
— Je suis fâché que Votre Majesté n’ait pas lu mon mémoire.
Le roi haussa les épaules avec impatience.
— Votre Majesté y aurait justement vu un article qui se rapporte à la question qu’elle a d’abord daigné me soumettre.
— En vérité ! reprit le roi en se rapprochant du prélat.
— Il y a tel projet dont la pensée première peut ne pas être irréprochable, et qui le devient par la manière dont il est exécuté. Permettez-moi donc, sire, de conserver la franchise de mes opinions et ma liberté de conscience.
— Je permets, dit vivement le roi.
— Je n’approuve pas, je l’ai dit, le mariage que désire Votre Majesté. Il excitera les réclamations du peuple et de la noblesse, et je ne sais mème pas jusqu’à quel point il sera agréable à Dieu.
Le roi commençait à donner des signes d’impatience ; aussi le prélat s’empressa-t-il d’ajouter à voix haute :
— Mais…
Le roi se calma.
— Mais si l’on commençait par conquérir l’approbation des hommes et l’agrément du ciel par une œuvre grande, pieuse et désirée de tous, par une œuvre utile à la religion comme à l’État, oh ! alors, sire, permettez-moi de vous le dire avec la même franchise, ce serait bien différent.
— J’entends, dit le roi.
— On trouverait tous les esprits disposés à accueillir les idées de Votre Majesté, on penserait qu’après avoir assuré le bonheur de ses sujets, il lui est permis de penser au sien, et je vais plus loin, si quelques-uns blâmaient encore, si quelques casuistes rigoureux osaient dire qu’il y a faute, on répondrait, et moi tout le premier : Non, il n’y a pas faute, car elle était expiée ; dès qu’il y a expiation, il n’y a plus faute. Or, nous avons ici expiation, bien mieux, expiation d’avance, ce qui fait que la faute est effacée avant même d’être commise.
— J’entends, répétait le roi avec joie, quoiqu’il ne comprit pas parfaitement.
— Ainsi, continua le prélat avec chaleur, si Votre Majesté approuvait les idées contenues dans ce mémoire…
— Je les approuve, s’écria le monarque, et de confiance : ne viennent-elles pas de vous !
— Si Votre Majesté consentait à signer, et le plus tôt possible, ce décret si ardemment, si impatiemment attendu de tous…
— Je signerai tout ce que vous voudrez… je vous le promets.
— Et moi, j’ose promettre à Votre Majesté que son mariage, approuvé par le grand inquisiteur et le saint-office, obtiendra l’approbation générale de ses sujets et la bénédiction du ciel.
— Je consens ! je consens ! s’écria le monarque au comble de ses vœux, à condition que vous vous chargerez de tout auprès du ciel, auprès de Sandoval, et mème auprès du duc de Lerma, avec qui je ne voudrais pas, en ce moment, avoir à traiter un pareil sujet.
— Je me charge de tout, répondit le prélat radieux.
— Et le plus tôt possible.
— Je le promets à Votre Majesté, et ne lui demanderai plus qu’une seule chose.
— Laquelle ?
— C’est de lire mon mémoire.
— À l’instant même.
Et le roi, rappelant le malheureux manuscrit de l’exil qu’il lui avait imposé, s’empressa de l’ouvrir au moment où le prélat s’éloignait.
Mais dès la première page, il en abandonna la lecture et se mit à penser avec ivresse à la duchesse de Santarem et à la surprise qu’il allait lui causer le jour où elle viendrait, selon sa promesse, pour prendre congé de lui.
LVI.
la signature.
Quant à l’archevêque de Valence, laissant le roi tout entier à ses rêves d’amour et de bonheur, il courut au palais du saint-office, où il trouva Sandoval et le duc de Lerma réunis.
— Eh bien ! s’écria-t-il avec un sourire orgueilleux, la cause du ciel est gagnée. Pendant que vous délibérez, je combats : pendant que vous cherchez les moyens de vaincre, je triomphe ! Le roi a reçu mon mémoire, et l’expulsion des Maures est décidée ; le roi signera le décret de bannissement aussitôt qu’on le voudra, et le plus tôt possible, ce sont ses propres expressions.
L’inquisiteur et le ministre restèrent stupéfaits et ravis. L’un croyait voir la chrétienté à ses pieds, et l’autre le chapeau de cardinal sur sa tête. Ribeira leur raconta avec détail la conversation qu’il venait d’avoir avec le roi, et à mesure qu’il parlait, Sandoval et son frère cessaient de sourire et leurs fronts se rembrunissaient.
— Ainsi donc, continua Ribeira en terminant son récit d’un air triomphant, pourvu qu’on laisse faire au roi ce mariage, mariage secret, mariage de la main gauche, après tout, qui nous importe peu, il consent, il signe : j’ai tout obtenu.
— Vous n’avez rien obtenu, dit Sandoval d’un air sombre : celle qu’il veut épouser est la duchesse de Santarem, qu’il adore.
— Eh bien !
— La duchesse est la fille de Delascar d’Albérique ! elle est Maure ! dit le duc de Lerma.
— Et n’a jamais été baptisée, ajouta le grand inquisiteur.
L’archevêque demeura accablé de son prétendu triomphe.
Le roi, c’était évident, ne pouvait s’allier, même secrètement, au sang mauresque ; c’eût été un scandale trop grand pour que le saint-office l’approuvât, une mesure politique trop absurde pour que le premier ministre y consentit, car si le roi d’Espagne épousait une Maure, il ne pouvait plus signer le bannissement de ses frères ; la nouvelle épouse du roi saurait bien s’y opposer, et son autorité serait bien autrement puissante que celle de la dernière reine. C’était un obstacle invincible.
— Comment le roi n’a-t-il pas parlé de cette difficulté, qui est la plus grande de toutes ? s’écria l’archevêque.
— Le roi n’en sait rien, répondit Sandoval.
— Eh bien ! faisons comme lui, ignorons tout. Qu’il signe ce décret ; une fois sa signature donnée et l’édit publié, ce sera irrévocable, et pour le reste, nous verrons après.
— Au fait, dit Sandoval, le roi l’entendait lui-même ainsi : l’archevêque de Valence s’est engagé à lui faire épouser une chrétienne.
— Mais non pas une Maure, s’écria Ribeira, et les Maures une fois bannis du royaume par l’édit royal, la duchesse de Santarem doit quitter l’Espagne comme les autres.
On s’arrêta à cette dernière idée, et le lendemain le ministre et les deux prélats se rendirent chez le roi.
Il attendait avec impatience, car c’était le huitième jour, le jour où Aïxa devait, comme elle le lui avait promis, se rendre au palais pour prendre congé de son souverain.
Le roi fit à l’archevêque de Tolède l’accueil le plus affectueux ; celui qu’il fit à Sandoval fut plus réservé, et le duc de Lerma remarqua avec étonnement que le roi affectait de ne point rencontrer ses regards.
— Ainsi que je l’ai promis à Votre Majesté, s’écria Ribeira, nous venons lui apporter à signer un édit qui illustrera son règne. Ce que Charles-Quint n’avait osé tenter, ce que Philippe II s’était contenté de rêver, Votre Majesté va l’accomplir et assurer à jamais la sécurité de l’État et l’unité religieuse de l’Espagne.
Il lui présenta respectueusement le parchemin, que le roi parcourut.
— Je vois bien, dit-il ; je vois qu’on me propose de renvoyer du royaume et de déporter en Afrique les Maures, nos fidèles sujets… Et ce projet, mes pères, est approuvé et signé par vous ?
— Oui, sire.
— Et par vous aussi, monsieur le duc ?
— Comme la mesure la plus utile que puissent vous conseiller les amis de Votre Majesté.
— Votre avis, dit le roi, est d’un grand poids dans cette affaire. Puis-je espérer rencontrer en vous la même unanimité pour le projet dont monsieur l’archevêque de Valence a dû vous parler ?
— Sa Seigneurie nous a annoncé que Votre Majesté désirait épouser secrètement une de ses sujettes.
— Oui, messieurs.
— Une personne de rang et de naissance.
— La duchesse de Santarem.
— Une personne élevée dans la religion catholique, apostolique et romaine.
— Sans contredit.
— S’il en est ainsi, dit l’inquisiteur en regardant ses deux collègues, je n’y vois et n’y mets aucune opposition.
— Ni moi, dit le duc.
— Ni moi non plus, ajouta l’archevêque de Valence.
Le roi, au comble de ses vœux, serra vivement la main des deux prélats et jeta sur le duc de Lerma un regard presque gracieux.
— Vous m’apportez alors cette décision signée par vous ?
— Non, sire… mais nous allons la rédiger pendant que votre Majesté signera l’édit.
— Je désire, messieurs, répondit le roi, que ce mariage soit célébré avant tout.
— Et pourquoi donc, sire ? s’écria l’archevêque avec inquiétude ; cela nous retardera beaucoup.
— N’importe, dit le roi ; si j’ai bien compris le système dont vous me parliez l’autre jour, s’il y a faute, comme vous me l’avez expliqué, j’aime mieux décidément la commettre avant, et que vous, mes pères, vous vous chargiez de l’effacer après. Ainsi, le jour même de mon mariage, en sortant de la chapelle, je signerai cet édit, qui doit, dites-vous, me concéder tous les cœurs et toutes les bénédictions de mes sujets ; il en rejaillira quelque chose sur ma femme. Voyez donc vous-mêmes, mes pères, continua le roi, le moyen de hâter, sans blesser les convenances, cette union sur laquelle nous sommes tous d’accord.
Les trois conseillers se regardèrent avec embarras, et cet embarras redoubla quand le roi, sourd à toutes leurs représentations, déclara, contre son habitude, nettement et fermement, qu’il ne signerait aucun édit et ne s’occuperait d’aucune affaire d’État avant son mariage.
Les trois ministres étonnés crurent que leur souverain avait des soupçons et qu’il avait été prévenu ; il n’en était rien : le roi était pressé, voilà tout.
— Eh bien ! mes pères, dit-il en voyant leur hésitation et leur trouble, qu’il y a-t-il donc ?
— Il y a, sire, une difficulté, dit le grand inquisiteur, décidé à aborder la question.
— Quelle difficulté ? s’écria le roi en pâlissant.
— L’intention de Votre Majesté est d’épouser une chrétienne ?
— Eh bien ! est-ce que la duchesse de Santarem ne professe point la religion catholique, apostolique et romaine ?
— Non, sire !
— Ah ! mon Dieu ! s’écria le roi effrayé, est-ce qu’elle serait par hasard luthérienne ou calviniste ?
— Pire que cela,
— Ô ciel ! juive !
— Pire encore !.. elle est Maure !
— Maure ! dit le roi accablé de douleur et d’effroi.
— C’est la fille de Delascar d’Albérique de Valence, qui avait tenu cette enfant éloignée de la maison paternelle pour l’élever en secret dans sa croyance et surtout pour la soustraire au baptême.
— Oui, sire, dit Ribeira, celle que le Roi Catholique voulait épouser n’a même pas été baptisée.
— Notre zèle pour Votre Majesté, continua le duc de Lerma, nous a fait acquérir tous ces renseignements, et c’est pour sauver notre souverain…
— Que vous vouliez me faire d’abord signer le bannissement et peut-être la mort de celle que j’aimais !
— Je ne voyais que mon souverain ! s’écria le duc.
— Oui, oui, je le sais, dit le roi avec amertume, vous n’aimez pas les reines d’Espagne. Messieurs, dit-il d’un air sombre, il y a une fatalité qui me poursuit… Nous examinerons ensemble si décidément Dieu m’ordonne de renoncer à mes espérances, ou si peut-être la conversion d’une personne si haut placée ne serait pas agréable au ciel et ne rendrait pas cette union possible.
Les trois ministres tressaillirent.
— Mais ce que je sais, continua le roi, que l’amour rendait généreux et noble, comme il l’avait déjà rendu clairvoyant, ce que je sais, c’est que je ne persécuterai point celle que j’avais jugée digne de ma main et de mon cœur. Je la respecterai, je la défendrai, elle et ses frères, et surtout, ajouta-t-il avec passion, je ne consentirai jamais à ce qu’elle s’éloigne de l’Espagne !
— Eh bien ! moi, s’écria le fougueux archevêque de Valence, je ne laisserai pas Votre Majesté s’exposer à l’excommunication.
— Compromettre son salut, dit l’inquisiteur.
— Et celui de son royaume, ajouta le duc de Lerma. Mais les deux prélats et le duc eurent beau faire, ils n’obtinrent d’autre réponse que celle-ci :
— Je ne signerai pas cet édit, je ne le signerai jamais !
En vain ils menacèrent des foudres de l’Église, de la colère de Rome, du soulèvement de toute la nation : le roi, avec l’obstination d’un amoureux, répétait toujours :
— Je ne signerai jamais !
Tout à coup son visage, qu’animait le feu de la discussion, devint pâle et livide, la parole expira sur ses lèvres, des gouttes de sueur coulèrent sur son front, et ses yeux, où brillaient l’espérance et l’amour, devinrent ternes et hagards, et demeurèrent fixés sur un petit papier que seulement alors il venait d’apercevoir sur son bureau. Sans songer aux trois conseillers qui, assis devant lui et immobiles, examinaient attentivement ses traits et ses moindres gestes, il lisait tout bas, et tout à coup il s’écria avec fureur :
— Je signerai, messieurs, l’édit que vous me proposez !
Les trois ministres firent un geste de surprise et de joie, et le roi continua :
— Oui, je signerai cet édit, mais je veux que ce soit à l’instant, à l’instant même !.. Donnez-le-moi.
— Nous avons eu l’honneur, dit le duc de Lerma, de le présenter à Votre Majesté, qui l’a placé là… sous sa main.
— C’est juste, dit le roi, je vais le lire.
Au lieu de l’édit il prit le petit billet et lut une seconde fois ces mots, qui avaient déjà produit sur lui un effet si terrible :
« Sire, Aïxa vous trompe ; elle aime éperdument Fernand d’Albayda ; c’est pour lui qu’elle a fait rompre le mariage de Carmen d’Aguilar ; c’est pour lui qu’elle se rend à Valence, où Fernand la rejoindra. Tous deux y vont pour se marier. »
Ce billet était de la même écriture que le premier. Nul doute pour le roi qu’il ne vint d’un ami dévoué.
Cet ami, dont le monarque était loin de se douter, c’était la comtesse d’Altamira. Pendant le temps qu’Aïxa avait demeuré chez elle près de Carmen, et avant l’aventure de don Augustin de Villa-Flor, la comtesse, on l’a vu déjà, avait cru remarquer que les assiduités de Fernand chez elle avaient pour but Aïxa encore plus que sa fiancée.
Elle pensa s’être trompée en voyant que le mariage tant désiré par d’Aguilar avait toujours lieu.
Mais, le matin même de ce marnage, on se rappelle qu’elle monta dans l’appartement de sa nièce, en proie alors à une fièvre ardente, et les phrases que celle-ci avait proférées dans son délire avaient suffi pour confirmer les soupçons de la comtesse et lui apprendre l’amour de Fernand et d’Aïxa.
Quant aux moyens de faire parvenir cet avis, rien n’était plus facile ; Latorre, valet de chambre du roi, avait été placé au palais par le duc d’Uzède, son ancien maître, lequel le regardait toujours comme à son service, vu les appointements énormes qu’il continuait à lui payer.
Le roi restait donc absorbé devant ce billet, et les trois ministres, sans deviner d’où arrivait en leur faveur ce secours inconnu et subit, attendaient avec angoisses le dénouement qu’ils désiraient et qu’ils n’osaient hâter. Enfin, le roi sortit de sa stupeur et dit vivement et avec force :
— Une plume !.. une plume !.. donnez, que je signe !
Le grand inquisiteur lui en offrit une, le duc de Lerma déroula le parchemin, et l’archevêque de Tolède approcha l’écritoire. Le roi d’une main agitée y trempa sa plume et s’apprêta à signer.
L’huissier de la chambre annonça en ce moment madame la duchesse de Santarem.

LVII.
les conditions.
Le roi, prêt à signer, s’arrêta, jeta vivement la plume et s’écria avec colère :
— La duchesse de Santarem ! nous serons ravis de la voir ! Qu’elle entre ! qu’elle entre ! Pardon, mes pères, et vous, monsieur le duc ; nous reprendrons cette affaire plus tard.
Il y avait dans son geste et dans sa voix une expression tellement impérative qu’il n’y avait pas moyen de rester davantage. Ils sortirent donc. Le duc, en s’éloignant lança un coup d’œil d’indignation à l’huissier malencontreux qui avait annoncé la duchesse et qui venait ainsi, sans le savoir, de renverser leurs projets.
Le pauvre huissier n’aperçut pas le regard foudroyant du ministre, car dans ce moment il s’inclinait jusqu’à terre pour le saluer.
Mais le lendemain il fut destitué sans avoir jamais pu deviner la cause de sa disgrâce.
Le roi n’avait jusque-là connu dans son amour qu’un tourment, c’était de ne pas voir celle qu’il aimait ; qu’une crainte, c’était de n’en pas être aimé. Il ne lui était pas venu à l’idée que ce cœur insensible pour lui pût ressentir de l’affection pour un autre.
Il avait toujours et complétement ignoré le supplice de la jalousie ; celle qu’il ressentait en ce moment venait, comme toute passion nouvelle et non encore éprouvée, l’envahir tout entier.
À la vue d’Aïxa, son sang avait reflué vers son cœur ; il était pâle ; ses lèvres tremblantes balbutiaient des mots inarticulés qu’il achevait à peine, et son trouble était d’autant plus violent qu’il faisait tous ses efforts pour le cacher.
Enfin, il lui fit signe de s’asseoir, en essayant de 
C’est toi que je revois ! s’écrie Yézid en le pressant sur son cœur.
sourire, et ce sourire donna à tous ses traits une expression
convulsive dont Aïxa s’effraya.
— Qu’avez-vous donc, sire ? s’écria-t-elle.
— Ce que j’ai, ingrate !..
Et alors tout ce que son cœur contenait de rage et de douleur comprimées s’échappa avec des cris et des sanglots.
Ce n’était plus cet homme apathique et indolent, ce roi que rien ne semblait émouvoir, pas même la misère de ses peuples : c’était un amour outragé, furieux, jaloux ! et la jalousie a son éloquence, qui est là même pour tous, pour l’homme du peuple comme pour le roi ; car dans les grandes passions, dans l’expression d’un sentiment violent et énergique, le langage de l’un s’élève, et le langage de l’autre s’abaisse.
Ainsi, le roi, oubliant son rang, le roi, furieux comme le dernier de ses sujets, accabla Aïxa de reproches et de menaces, de mépris et de haine, et finit par tomber à ses pieds ivre de colère et d’amour.
Aïxa avait fait d’inutiles efforts pour calmer cet accès de fièvre chaude et de délire, auquel elle n’aurait rien compris, sans le nom de Fernand, que le roi répéta souvent.
— Quels reproches ai-je donc mérités de Votre Majesté ? dit-elle enfin, quand il lui fut permis de se faire entendre ; avais-je accepté ses vœux ?..
— Non… non, dit le roi ; mais vous avez accueilli ceux de Fernand !
— Avais-je promis à Votre Majesté mon cœur et mon amour ?
— Non, mais vous les avez donnés à Fernand… l’oserez-vous nier ? Et ce n’est rien encore ! continua-t-il avec une impétuosité de paroles que rien ne pouvait interrompre ; si vous me quittez… si vous retournez à Valence, n’est-ce pas pour l’épouser ?.. Répondez, répondez-moi donc !.. Qui vous empêche de répondre ?
— Vous seul, sire ; j’attends que Votre Majesté me le permette.
— Moi ! dit le roi avec rage ; moi qui vous supplie, à genoux, de parler, de me dire la vérité !
— Vous la connaîtrez tout entière, sire !.. je ne sais qui a pu m’accuser auprès de Votre Majesté d’aimer don Fernand d’Albayda.
— Ce n’est donc pas vrai ? dit le roi avec un transport de joie en étendant les mains vers elle.
Aïxa se recula, baissa les yeux et répondit :
— C’est vrai… sire !
— Et vous osez me l’avouer, à moi !
— Oui, sire ! Mais là, je vous le jure, s’arrêtent mes crimes, et celui dont vous m’accusez encore n’est jamais venu à ma pensée ni probablement à la sienne. Maîtresse de ma main, je n’en ai point disposé… je ne l’ai promise à personne… pas même à lui !
Et, élevant la voix, elle ajouta avec force :
— Je me rends à Valence, non pour épouser don Fernand d’Albayda, je vous le jure, mais pour revoir et embrasser mon père, Delascar d’Albérique, qui est un Maure.
— Je le sais.
— Et qui m’a élevée dans sa croyance, sire.
— Je le sais… je le sais… répéta le roi avec impatience et avec humeur. Ainsi, et d’après votre propre aveu, à vous, qui êtes la franchise même, vous ne voulez point et vous n’épouserez jamais Fernand d’Albayda ?
— Je n’ai pas dit cela, sire.
— Quoi ! s’écria le roi furieux, elle ne m’accordera même pas cette consolation, ce bonheur, cette espérance ! Et que dites-vous donc, alors ?
— Je dis que, dans ce moment, et pour rien au monde, je ne consentirais à l’épouser.
— À la bonne heure ! reprit le roi plus adouci. Et pourquoi ?
— Parce qu’il était le fiancé de Carmen d’Aguilar, ma meilleure amie, presque ma sœur, et que je n’épouserai jamais Fernand d’Albayda… tant que je pourrai croire que Carmen l’aime encore.
— À la bonne heure ! répéta le roi avec une satisfaction mêlée de crainte, pourvu que Carmen soit fidèle et constante. Mais qui peut se fier à ces jeunes filles ! n’a-t-elle pas déjà une autre idée ? ne veut-elle pas, m’a-t-on dit, entrer dans le couvent des Annonciades de Pampelune comme novice ?
— Elle y est déjà, sire.
— Qui l’a permis ?
— La reine, sire.
— C’est un tort qu’elle a eu : je n’y aurais jamais consenti. Et, reprit-il avec une colère qu’il cherchait à modérer, si elle prononce ses vœux, si elle devient religieuse, si elle renonce décidément au monde et à Fernand, que ferez-vous alors ?
— Je l’ignore, sire.
— Et si ce Fernand voulait vous épouser, que feriez-vous ?
— Je l’ignore.
— Vous me trompez ! vous le savez ! Répondez-moi donc ! répondez ! S’il vous offrait sa main, continua-t-il avec fureur, que feriez-vous ?
Aïxa fléchit un genou et dit avec sa douce voix :
— Peut-être alors, sire, viendrais-je demander à Votre Majesté la permission de l’accepter.
— À moi !
— À vous, qui seriez trop bon et trop juste pour me la refuser.
— Moi ! dit le roi ; moi y consentir ! Mais vous ne savez donc pas, continua-t-il avec un cri de douleur et de passion, que je voulais vous épouser !
— Vous, grand Dieu ! Ce n’est pas possible !
— Demandez à ce duc de Lerma qui sort d’ici ; demandez à ces ministres du ciel : ils vous le diront ; ils vous attesteront que je voulais vous placer sur le trône d’Espagne, que je voulais vous faire reine !
— Et moi je ne l’aurais pas voulu ! s’écria vivement la jeune fille ; j’aime trop Votre Majesté, je suis trop attachée à sa gloire, pour lui permettre de descendre jusqu’à sa sujette. L’Espagne vous aurait blâmé, et l’inquisition vous eût maudit… je suis Maure !
— Eh bien ! qu’importe ? dit le roi en la regardant avec amour.
— Je suis d’un sang et d’une croyance qu’ils détestent.
— Mais moi, je t’aime ! s’écria-t-il… et tiens !… tiens ! dans ce moment encore, voilà un édit qu’ils veulent me faire signer, un édit qui bannit d’Espagne et ton père et les tiens !
— Est-il possible ! s’écria Aïxa tremblante.
— Un édit qui les proscrit, qui confisque leurs biens, qui les condamne à errer et à mourir sur une terre étrangère… et cet édit…
— Vous ne le signerez pas ! s’écria Aïxa.
— Jamais ! si tu m’aimes, si tu es à moi…
— Je ne le puis, sire… mais ne signez pas !
— Le ciel le veut, et mon Dieu me le commande ; c’est ce qu’ils disent tous… Eh bien ! je braverai la volonté du ciel et la colère mème de Dieu… si tu es à moi, si tu y consens !
— Mon devoir me le défend !
— Et mon devoir à moi, s’écria le roi hors de lui, mon devoir m’ordonne d’être impitoyable !
— Grâce ! sire, grâce ! s’écria-t-elle en tombant à genoux, je vous en supplie !
— Et moi aussi je t’ai suppliée en vain, et tu m’as repoussé, tu en as aimé un autre !
— Je ne l’aimerai plus, j’y renoncerai, je vous le jure.
— Cela ne me suffit plus ; maintenant, vois-tu, je n’ai plus le courage de résister ni de combattre, je n’ai plus la force d’être généreux ; ceux pour qui tu supplies ne sont pas plus infortunés que moi, car je meurs, vois-tu bien, je meurs, si tu n’es pas à moi !
Aïxa, interdite, craignant de redoubler l’égarement du roi et la crise effrayante où elle le voyait, se contentait de joindre les mains et de murmurer d’une voix suppliante : Mais mon honneur, sire ! mais mon devoir !
— Ton honneur ! s’écria Philippe hors de lui, ton honneur et tes jours appartiennent à ton roi ! et ton devoir… ton devoir est de sauver ton père et tous les tiens ! Et puisque mon amour ne peut rien obtenir, continua-t-il avec une exaltation toujours croissante, puisque je ne puis rien devoir à ta tendresse ni à ta pitié, je m’adresserai à d’autres sentiments ; je verrai si ta haine pour ton roi est plus forte que ton amour de fille ou de sœur !
— Grâce, sire ! grâce ! continua-t-elle en se trainant sur les genoux.
— Non, non, point de grâce ! s’écria le roi en délire. Et saisissant avec force la main d’Aïxa : Écoute-moi bien… tu seras ici… demain soir… à la nuit… demain… demain, tu entends bien ! et alors je déchire cet édit, j’assure à jamais le bonheur et la prospérité de tes frères et de tous les tiens !… Mais tu viendras… Je t’attendrai !… ici, demain, tu me le promets… tu me le jures ?
— Jamais ! jamais ! s’écria-t-elle en se relevant.
— Tais-toi ! tais-toi ! dit le roi en lui mettant la main sur la bouche, car ce ne serait pas moi, alors, ce serait toi qui signerais la ruine, l’exil et la mort de ton père !
— Mon père ! répéta Aïxa épouvantée, moi, causer sa mort !…
Puis avec un mouvement d’effroi involontaire elle s’écria hors d’elle-même :
— Grâce ! grâce ! je viendrai !
Le roi poussa un cri de joie, et ses yeux brillèrent d’un éclair de bonheur.
— Non, non ! c’est blasphémer, dit vivement Aïxa en se reprenant, non, non ! jamais !..
Mais le roi, comme s’il craignait d’entendre son désaveu, avait déjà quitté Aïxa et s’était élancé dans la pièce voisine, dont la porte venait de retomber.
Quant à la pauvre jeune fille, elle se traîna jusque chez elle ; désolée, éperdue et tombant à genoux, elle s’écria en levant les yeux et les mains vers le ciel :
— Viens à mon aide, ô mon Dieu, et conseille-moi !
LVIII.
le sacrifice.
Cependant, Bernard de Sandoval et l’archevêque Ribeira avaient pris depuis longtemps les mesures nécessaires à l’exécution de leurs plans ; à Valence, à Grenade et dans toute l’Andalousie, dans l’Aragon et les deux Castilles, des émissaires répandaient les bruits les plus alarmants et soulevaient toute la population espagnole contre les Maures.
Le mémoire rédigé par Ribeira, et que le roi n’avait pas lu, circulait dans tout le royaume et faisait grande impression, non-seulement sur les membres du clergé, mais sur les personnages les plus puissants et les plus influents d’alors.
Le saint prélat démontrait que l’Espagne avait dans son sein un million d’ennemis vaincus, mais non subjugués, qui formaient une nation à part, et qui ne se rallieraient jamais franchement à la religion, aux mœurs et aux intérêts espagnols.
Il attestait que les Maures conspiraient continuellement, et que dernièrement encore, lors des dangers auxquels l’Espagne n’avait échappé que parle génie et la prévoyance du duc de Lerma, les Maures, en apprenant les préparatifs du roi Henri IV, lui avaient offert de l’or et des soldats[23] ; que si, par un miracle exprès de la Providence, le roi Henri n’était pas mort, l’Espagne se serait vue attaquée à la fois au dedans et au dehors ; que pareil événement pouvait se représenter, et que si à la première guerre étrangère tous les Maures du royaume prenaient les armes, les Espagnols seraient, comme leurs ancêtres, forcés de se soumettre au joug du vainqueur, ou de chercher encore, comme au temps de Pélage, un abri dans les rochers et les montagnes des Asturies.
Ces raisonnements produisaient un grand effet sur les classes élevées ; et pour le peuple, l’archevêque Ribeira avait recours à d’autres moyens. On parlait d’une conspiration qui ne tendait à rien moins qu’à faire débarquer en Espagne Muleïsilan, le sultan de Maroc.
Les Maures, disait-on, lui avaient promis de se soulever à son approche, de lui fournir cent cinquante mille combattants, de l’aider à piller les églises, à profaner les hosties et à pendre tous les moines et curés du royaume ; laquelle conspiration, ajoutait-on, venait d’être découverte par le tribunal du saint-office[24].
L’effroi était grand, les prêtres inventaient des récits étranges, merveilleux, qui passaient de bouche en bouche, et ajoutaient à la frayeur générale.
On disait qu’à Daroca, le bruit des trompettes et des tambours avait retenti dans les airs au moment où la procession sortait du monastère ; qu’à Valence on avait aperçu pendant plusieurs jours un nuage d’une éclatante blancheur, sillonné de bandes sanglantes ; qu’une image de la Vierge avait paru tout inondée de sueur[25], et qu’enfin la cloche de Villila avait sonné d’elle-même pendant plusieurs jours[26].
Les esprits, en émoi et vivement frappés, étaient dans l’attente d’un grand événement, et, comme Ribeira le disait au roi, le vœu général appelait l’ordonnance dont les conséquences pouvaient être si fatales pour l’Espagne.
Yézid reçut de Valence toutes ces nouvelles, et le lendemain du jour dont nous venons de parler, il entra de bonne heure dans la chambre d’Aïxa. Il la trouva pâle et debout. Elle ne s’était pas couchée de la nuit ; elle l’avait passée tout entière à prier, à invoquer sa mère et à lui demander conseil.
— Sœur ! lui dit le jeune Maure, il n’y a plus à tarder, il faut partir aujourd’hui même pour Valence.
— Et pourquoi ?
— Notre père et tous nos frères courent les plus grands dangers, notre place est près d’eux.
Il lui fit connaître alors une partie de ce que nous venons de raconter, ajoutant que déjà les jours de Delascar d’Albérique avaient été menacés, que la populace furieuse, et excitée par des agents secrets, avait voulu mettre le feu à son habitation.
Aïxa tressaillit.
— Ce n’est rien encore, continua Yézid, tous les vaisseaux dont l’Espagne peut disposer sont réunis sur nos côtes, toutes ses troupes ont ordre de marcher sur Valence et sur Grenade. Quelque odieux complot se prépare contre nous, et pour le déjouer j’ignore ce que médite mon père, mais il m’écrit que pour sauver sa religion et ses frères, tout est permis.
— Il a dit cela ! s’écria Aïxa en pâlissant.
— Voici sa lettre. Il nous demande pardon de ce qu’il va faire ; mais il sait que nous pensons comme lui, et que nous n’hésiterions pas un instant à sacrifier tout ce que nous avons de plus précieux et de plus cher.
— Il a dit cela ! s’écria Aïxa avec terreur.
— Vois toi-même… Voici ses derniers mots : sauver nos frères, et puis mourir !
Aïxa prit la lettre d’une main tremblante, et pendant qu’elle la lisait :
— Qu’as-tu, ma sœur ? s’écria Yézid en voyant la pâleur mortelle qui couvrit tous ses traits.
— Laisse-moi cette lettre, mon frère.
Elle la serra dans son sein, et dit :
— Tu as raison… nous ne pouvons rester ici… il faut partir ; fais tous tes préparatifs. Dispose pour ce soir une voiture… il doit tarder à mon père de revoir sa fille. Tu la lui ramèneras, Yézid, lui dit-elle froidement.
Yézid allait sortir. Il se retourna et vit Aïxa chanceler ; il revint vivement sur ses pas, et cherchant à la calmer :
— Je t’ai effrayée, ma sœur, lui dit-il, en t’apprenant brusquement toutes ces nouvelles, et en te parlant de malheurs qui, je l’espère, ne se réaliseront pas. Mon père saura les détourner.
— Il ne le pourrait qu’au prix de ses jours ! dit Aïxa.
— Puis, se remettant de son trouble, elle ajouta avec calme :
— J’espère comme toi que nos ennemis reculeront devant l’exil ou le massacre de nos frères. Piquillo vient d’être appelé au palais de l’inquisition : il nous apprendra ce qu’on a décidé, et peut-être ce soir pourras-tu porter à Valence la nouvelle que le roi et son ministre ont renoncé pour jamais à leurs sinistres desseins.
Elle prononça ces derniers mots avec une oppression si visible que Yézid lui dit encore :
— Tu veux me le cacher, sœur, tu souffres !
— Non, je n’ai rien… À quelle heure comptes-tu partir ?
— Ce soir, pour qu’on ne nous voie pas ; ce soir, à onze heures.
— C’est bien… je serai prête.
Et la voiture t’attendra.
— Pas ici… Je ne voudrais plus rentrer dans cet hôtel.
— Et pourquoi ?
— Tu le sauras. Attends-moi près la petite porte du palais, celle qui conduisait aux appartements de la reine… tu sais bien ?
Yézid tressaillit.
— Oui, je la connais, dit-il ; mais pourquoi à cet endroit ?
— Parce qu’il est solitaire… et puis pour d’autres raisons que tu sauras… je te les dirai.
— Pourquoi pas tout de suite ?
— Pourquoi ! reprit-elle en tremblant de tous ses membres ; ne me le demande pas, je t’en conjure. Puis, joignant les mains, elle lui dit : Va-t’en !
Yézid la regarda avec surprise. Mais il respecta son secret, se rappelant qu’autrefois, lui aussi, avait voulu qu’on respectât les siens. Il embrassa sa sœur et sortit.
LIX.
la chambre du roi.
Aïxa restée seule demeura longtemps immobile et anéantie. Elle relut la lettre de son père, et d’un air égaré, elle répéta plusieurs fois ces mots :
« Vous penserez comme moi, mes enfants ; vous n’hésiterez pas à sacrifier ce que vous avez de plus cher et de plus précieux pour la défense de notre religion et le salut de nos frères. Les sauver et mourir, c’est là notre devoir. »
— Je suivrai vos ordres, mon père, murmura-t-elle, vous serez sauvé par moi, et ce soir Yézid vous ramènera votre fille… mais il vous la ramènera morte !
Elle se mit à genoux et pria.
Se sentant alors plus de force, elle se leva, alla prendre le flacon de cristal que Piquillo avait enlevé à la comtesse et qu’elle avait voulu conserver ; elle le regarda quelques instants avec intention comme le seul ami, le seul espoir qui lui restât.
Il y manquait à peine quelques gouttes, et en prenant tout ce qui restait, la mort ne devait pas tarder.
Ne craignant plus alors de survivre à sa honte, et certaine de mourir, elle respira plus librement et reprit courage, mais ce courage manqua de l’abandonner ; quand sa pensée se reporta sur l’avenir qui l’attendait et auquel elle allait renoncer.
Encore quelque temps, et Fernand, qu’elle aimait, pourrait lui offrir son cœur et sa main. Encore quelque temps, et elle allait être à lui, et cet amour, depuis si longtemps caché, elle pourrait l’avouer aux yeux de tous ! Et maintenant il fallait perdre à la fois et ce bonheur et l’amour de Fernand, peut-être même son estime !
Mourir avec son mépris ! Cette idée était au-dessus de ses forces, et elle voulut du moins lui écrire et tout lui apprendre ; mais alors son sacrifice devenait impossible, car Fernand ne souffrirait pas qu’elle s’immolât, même pour son père.
— Non ! se disait-elle, non ! demain seulement il saura toute la vérité. Mais lui qui fut si bon et si dévoué, je ne puis le quitter à jamais sans lui dire un dernier adieu.
Et elle lui écrivit seulement ce mot : « Venez ! »
Quelques instants après, sa porte s’ouvrit, et parut Fernand d’Albayda.
— Est-il possible ! s’écria-t-il avec joie, une lettre de vous ! on me l’apporte, et j’accours.
— Je vous remercie, dit Aïxa avec un doux sourire.
— C’est donc bien vrai… c’est vous qui m’appelez ?
— Oui, Fernand… c’est moi… moi qui désirais vous voir, dit la jeune fille avec émotion.
— Je puis donc vous être utile… vous rendre quelque service… Parlez, commandez ! s’écria Fernand avec chaleur.
— Non, répondit tristement Aïxa, je n’ai rien à vous demander.
— Et que me vouliez-vous donc ?
— Vous voir… Fernand !
À ces mots, le cœur du jeune homme tressaillit de joie, et ses yeux, pleins d’ivresse, témoignaient assez d’une reconnaissance que sa bouche n’osait exprimer.
— Oui, répéta-t-elle, vous voir et vous remercier de tout ce que je vous dois. Vous m’avez consacré votre vie ; soumis à mes ordres, docile à mon regard, vous avez imposé silence à votre tendresse, vous avez eu le courage et l’amour de renoncer à moi !… Pour moi, vous vous êtes dévoué ; pour moi, vous avez souffert !… Que puis-je donc à mon tour pour payer tant de dettes et tant de sacrifices ? Je n’ai rien qui puisse m’acquitter… rien qu’un mot ; mais si je vous connais bien, ce mot, je crois, suffira. Écoutez-moi donc, Fernand… Je vous aime !..
Elle avait prononcé ce mot, non pas timidement et les regards baissés, mais avec les yeux pleins de larmes et d’amour, et comme si son âme tout entière s’était échappée de ses lèvres. Fernand, frappé de surprise et d’ivresse, était tombé à ses genoux et couvrait de baisers ses belles mains, qu’elle ne retirait pas ; mais tout à coup il s’arrêta stupéfait, la voyant fondre en larmes et éclater en sanglots.
— Ô ciel ! s’écria-t-il, après un tel aveu, d’où vient votre douleur ?
— C’est que ce jour, lui répondit-elle, est le dernier qui me soit accordé.
— Que voulez-vous dire ?
— Que je ne vous reverrai plus, Fernand, que je ne dois plus vous voir. Il vous faut renoncer à moi !
— Et pourquoi, grand Dieu ?
— Ne me le demandez pas !… Vous devez me connaître, et puisque je vous parle ainsi, moi qui vous aime, moi qui eusse été fière de vous donner ma vie et d’embellir la vôtre… vous pensez bien, Fernand, qu’un nouvel obstacle élève désormais entre nous une barrière insurmontable.
— Et laquelle ?
— Ne m’interrogez pas ! qu’il vous suffise de savoir que toutes les douleurs que vous pourriez imaginer n’approchent pas en ce moment de la mienne.
— Dites-la-moi donc !..
— Moi ! s’écria-t-elle en reculant épouvantée ; je me trompais. Il y a un supplice plus grand encore que ceux que j’éprouve, ce serait de vous le dire ! Aussi n’est-ce pas pour cela que j’ai voulu vous voir, mais pour vous faire mes adieux.
— Vos adieux ! vous me quittez ?
— Je vous ai dit qu’il le fallait, que vous ne deviez plus penser à moi.
— C’est impossible !
— Mais, Fernand, ma seule pensée sera à vous ! à vous, mon premier et mon dernier amour !
— Et vous voulez que je vous abandonne ! s’écria Fernand enivré de ses paroles, que je renonce à vous en un pareil moment !
— Il le faut ! il le faut ! répéta la jeune fille avec égarement ; hâtez-vous ! car ce que je vous dis là… je puis le dire encore… mais bientôt…
— Bientôt ! s’écria Fernand avec effroi, qu’est-ce que cela signifie ? parlez, de grâce ! parlez !
— En ce moment… c’est impossible….. mais plus tard, je vous le promets… vous saurez… Oui, continua-t-elle en cherchant à rassembler toutes ses forces, demain, vous recevrez une lettre de moi.
— Demain, vous me le jurez, je saurai tout ?
— Je vous le jure !
— Par mon amour ! s’écria Fernand ; et il ajouta avec crainte : Par le vôtre !
— Par mon amour ! répéta Aïxa.
À ce mot, et malgré toutes ses appréhensions et ses angoisses, Fernand sentit l’espoir renaître dans son cœur. Sans doute, et puisque Aïxa le disait, des obstacles terribles pouvaient bien les séparer encore et s’opposer à leur bonheur. Mais des obstacles, en est-il dont on ne puisse triompher quand on aime, quand on est aimé ? et c’est le dernier mot qui retentissait sans cesse à l’oreille et au cœur de Fernand. Seul, il eût suffi pour lui faire braver tous les dangers et supporter tous les maux.
Aussi la jeune fille, étonnée du sourire d’espoir et de bonheur qui brillait sur ses traits, lui répéta d’une voix émue :
— Partez ! partez ! Qu’attendez-vous encore ?
— Une dernière grâce, dit-il.
Aïxa, pâle et immobile, ne répondit pas. Fernand s’approcha d’elle, et passant son bras autour de cette taille si gracieuse et si belle, il murmura à voix basse à son oreille :
— Aïxa, ma bien-aimée, un baiser de toi !
Aïxa frissonna, mais elle ne s’éloigna pas et se dit en elle-même :
— Je le puis encore, je suis encore digne de lui !
Fernand voyant qu’elle ne répondait pas, serra contre son cœur le cœur de la jeune fille, et dans son délire ses lèvres brûlantes rencontrèrent celles d’Aïxa : elles étaient froides et glacées comme le marbre de la tombe.
Il poussa un cri. Aïxa lui fit signe de la main de s’éloigner, et Fernand s’enfuit heureux et désespéré.
À peine eut-il disparu, que la pauvre jeune fille courut à son secrétaire et écrivit à celui qu’elle venait de quitter.
Elle lui avouait tout et lui demandait pardon, non pas de sa mort, qui devait lui rendre l’estime de Fernand, mais du crime qui avait rendu cette mort nécessaire. Bien des fois la plume lui tomba des mains, biens des fois elle s’arrêta, prête à déchirer cette lettre et à renoncer à son dessein… mais elle pensait à son père ! cette idée ranimait son courage et lui donnait la force d’accomplir ce sacrifice.
Piquillo, qui s’était rendu au palais de l’inquisition, n’était pas rentré. Lui aussi, sans doute, avait appris les nouvelles que Yézid venait de recevoir ; lui aussi, sans doute, intercédait pour ses frères près de Sandoval et du duc de Lerma : efforts inutiles, elle le savait bien, l’édit qui les menaçait dépendait du roi… ou plutôt c’était d’elle seule maintenant que dépendait le sort de toute une nation, sa prospérité ou son exil, sa vie ou sa mort.
Déjà la nuit était venue, et plus le moment approchait, plus Aïxa sentait redoubler sa terreur et son incertitude. Les yeux fixés sur la pendule, dont l’aiguille rapide semblait voler, elle avait déjà entendu sonner sept heures, puis huit, puis neuf. Son cœur battait avec violence, sa tête était en feu, elle se sentait en proie à une fièvre ardente qui produisait sur elle une étrange hallucination.
Elle voyait Fernand à ses genoux la retenant, l’empêchant de sortir ; elle allait lui obéir. Tout à coup, elle se croyait transportée dans les rues de Valence, elle entendait sonner la cloche de Villila ! c’était le signal du massacre !
Des familles entières, des familles maures, voulaient en vain fuir les poignards espagnols. Au milieu de la foule, des moines à la figure sinistre, le glaive d’une main et la croix de l’autre, criaient :
« Frappez ! frappez ! »
Ni les enfants ni les femmes n’étaient épargnés !
Enfin elle aperçut son père qu’un meurtrier poursuivait, son père qui lui disait : « Sauve-moi, ma fille ! sauve-moi ! » Elle s’élançait pour l’entourer de ses bras, pour lui faire un rempart de son corps. Il était trop tard ! Le vieillard venait d’être frappé, son sang avait rejailli sur elle ; elle le voyait à ses pieds, elle voyait ses cheveux blancs trainés dans la fange.
En ce moment la pendule sonna dix heures.
Aïxa poussa un cri horrible ; la cloche même de Villila n’aurait pas produit sur elle une plus grande terreur.
Sans hésiter, sans réfléchir, elle se couvrit d’une mante et d’un voile épais, sortit vivement de l’hôtel et s’élança dans la rue. La nuit était sombre.
Comme pour éviter le remords, qui déjà la poursuivait, elle fit d’abord quelques pas en courant, puis elle s’arrêta : la fraicheur du soir avait soudain rafraichi ses sens et calmé son délire ; elle était revenue à elle-même et à toutes ses craintes.
Elle regarda autour d’elle ; il lui sembla que tout le monde examinait d’un œil curieux que tout le monde lisait déjà sa honte écrite sur son front. Elle quitta la grande rue, où était situé son hôtel, et prit des rues désertes et détournées pour se rendre au palais.
Bientôt elle se trouva seule et éprouva alors une autre espèce de terreur. Dans une rue solitaire, elle entendit marcher derrière elle et vit un homme enveloppé d’un manteau qui la suivait de loin. Si c’était un voleur, un meurtrier ! si l’on en voulait à mes jours ! se dit-elle.
— Tant mieux ! c’est Dieu qui m’envoie la mort.
Et par un mouvement involontaire et irréfléchi, elle se retourna et fit quelques pas au-devant du poignard.
À son grand étonnement, l’homme au manteau s’éloigna d’un pas rapide. Elle poursuivit sa route et prit intrépidement une petite rue obscure et tortueuse qui conduisait directement à la porte dérobée du palais.
Là, elle aperçut encore quelqu’un qui semblait épier tous ses pas et tous ses mouvements. Ce n’était pas celui qu’elle avait déjà vu ; la taille n’était pas la même ; mais comme le premier, il se hâta de s’éloigner dès qu’il crut être remarqué.
Aïxa se trouvait près de la porte secrète qui conduisait aux appartements occupés autrefois par la reine, un corridor mystérieux et isolé, où personne ne passait, régnait derrière cet appartement : c’était celui par lequel la reine se rendait chez le roi.
Aïxa était entrée, la porte s’était refermée, elle avait franchi le seuil de la honte et de l’infamie. Elle comprit que tout était fini pour elle ; sa perte était désormais inévitable, rien ne pouvait la sauver.
En entrant, elle aperçut un homme qui semblait l’attendre. Elle tressaillit et voulut retourner en arrière. Ce n’était plus possible ; cet homme était le valet de confiance du roi, ce Latorre, vendu au duc d’Uzède et à la comtesse Altamira. Le roi lui donnait rarement de pareilles commissions, et celle-ci, toute nouvelle pour lui, le charmait fort ; il aurait vivement désiré connaître la beauté mystérieuse que Sa Majesté attendait ainsi à dix heures du soir, par curiosité d’abord, et puis pour en rendre compte à la comtesse Altamira, par qui ses rapports étaient chèrement payés.
Malheureusement, le voile épais qui couvrait les traits d’Aïxa ne lui laissait rien voir, et la discrétion du roi ne lui permettait aucune conjecture.
Tout ce qu’il put deviner, c’est que c’était un premier rendez-vous, car l’inconnue était tremblante et se soutenait à peine.
— Senora, dit le valet de chambre d’un air de protection, le roi mon maître m’a chargé de vous conduire près de lui.
Aïxa restait à la même place, immobile comme une statue.
Latorre lui offrit alors gracieusement sa main, qu’elle repoussa du geste et sans la toucher.
À cet air de mépris, le valet s’inclina avec respect et se dit en lui-même :
— C’est une grande dame.
Il se contenta alors d’ouvrir la porte du corridor ! secret qui conduisait dans la chambre du roi ; il passa devant, tenant un flambeau à deux branches.
Il marchait lentement, car Aïxa avait peine à le suivre, et de peur de tomber, elle s’appuya contre les riches tapisseries qui décoraient la muraille.
Enfin ils arrivèrent à la porte de la chambre royale, et dans ce moment la pauvre jeune fille sentit son courage et ses forces prêtes à l’abandonner entièrement.
Par bonheur, il n’y avait personne.
— Senora, dit Latorre, le roi mon maître m’a chargé de vous dire qu’il voulait lui-même se trouver à votre arrivée, mais qu’à neuf heures et demie le grand inquisiteur et le duc de Lerma s’étaient présentés chez lui, qu’il n’avait pu, à son grand regret, refuser de les recevoir. C’était pour l’importante affaire que connaissait la senora, ce sont les propres paroles de Sa Majesté… Mais la senora peut être tranquille, a ajouté le roi : rien au monde ne le fera manquer à sa parole.
Aïxa lui fit signe de la main que cela suffisait et qu’elle n’avait pas besoin d’en savoir davantage.
— Très-bien, dit Latorre, la senora m’a compris… Je pense que Sa Majesté est encore avec messeigneurs de Lerma et de Sandoval ; mais la senora peut se rassurer, elle n’attendra pas longtemps. Le roi, je puis le lui dire, avait l’air tellement contrarié et il a reçu si mal le ministre et le grand inquisiteur lui-même, qu’ils ne tarderont pas, je pense, à prendre congé de Sa Majesté. Que la senora veuille bien s’asseoir.
Il lui montra de la main une ottomane et poursuivit d’un air complaisant :
— Je retourne près de Sa Majesté, dès qu’elle m’apercevra, je n’aurai besoin de rien dire : elle devinera, à ma vue seule, que la senora est arrivée et saura bien se défaire des importuns.
Latorre salua de nouveau et se retira par une petite porte cachée dans la draperie qui conduisait directement au cabinet du roi.
Quand Aïxa se vit seule dans la chambre du roi, soit que les propos respectueusement insolents de Latorre eussent rendu plus honteuses encore à ses yeux et sa démarche et sa situation, soit que l’approche du déshonneur l’eût épouvantée, elle sentit un profond mépris d’elle-même, et un dégoût affreux de la vie s’empara de son cœur.
— Non, non, je ne resterai pas ici ! s’écria-t-elle en se levant et en marchant dans la chambre, Fuyons ! je le puis encore !
Il n’était plus temps. Elle entendit des pas précipités. Elle poussa un cri, et dans son trouble, dans son effroi, elle tomba à genoux. Une porte venait de s’ouvrir.
LX.
l’enlèvement.
— Grâce ! grâce ! s’écria Aïxa d’une voix étouffée en étendant ses mains suppliantes.
— Que vois-je !.. une femme ici… à mes pieds ! dit une voix bien connue.
Aïxa leva les yeux.
La porte qui venait de s’ouvrir n’était pas la porte qui donnait sur le cabinet du roi, mais celle du corridor par où elle-même venait d’entrer.
— Piquillo ! s’écria-t-elle en poussant un cri horrible, et, succombant à la violence des émotions qu’elle venait coup sur coup d’éprouver, elle chancela, ferma les yeux et s’évanouit.
Alliaga courut à elle plus pâle que la mort ; et, la relevant, la soutenant dans ses bras.
— Aïxa, lui disait-il, toi, ma sœur… ici… à une pareille heure ! qui t’amène ?
La jeune fille ne pouvait répondre ; elle était toujours sans connaissance, la tête appuyée sur l’épaule de son frère… et celui-ci, éprouvé déjà par tant de tourments, en subissait un nouveau, inconnu jusqu’ici. Un soupçon horrible venait, comme un éclair, de luire à sa pensée ; un serpent s’était glissé jusqu’à son cœur et le déchirait de sa morsure, une sueur froide coulait de son front… et il cherchait vainement à s’expliquer le sentiment qui l’agitait.
— Il y a ici une trahison que je déjouerai, et malheur à ceux qui l’auront tramée ! Car c’est mon sang… c’est ma sœur !.. C’est à moi de défendre sa réputation et son honneur !
Voilà ce qu’il croyait se dire, et une autre voix lui criait :
— Ce n’est pas seulement ta sœur que tu veux défendre… c’est une autre qui t’est plus chère encore ; la fureur que tu éprouves… c’est de l’amour… c’est de la jalousie !..
— Et bien ! oui, s’écria-t-il avec rage !… jaloux… jaloux… je le suis : Aïxa, réponds-moi, dis-moi que c’est par force, par violence que l’on t’a attirée dans ces lieux… Me voilà pour te protéger… pour te soustraire à tes ennemis ; mais ce n’est pas de ton consentement, c’est malgré toi, n’est-ce pas, que tu es ainsi en leur pouvoir ?.. sinon, s’écriait-il avec rage, et fût-ce le roi lui-même…
En ce moment il entendit la voix du roi. Celui-ci sortait de son cabinet et traversait le vaste salon qui le séparait de sa chambre.
Le roi causait avec Latorre, et lui disait à voix haute avec impatience :
— Pourquoi ne pas dire à l’instant et devant eux que la personne que j’attendais était arrivée ? M’exposer à la faire attendre !
Plus de doute, Aïxa venait d’elle-même et pour le roi.
Dire ce qu’éprouva Piquillo est impossible. Dans l’espace de quelques secondes deux ou trois projets s’offrirent à sa pensée : il n’est pas bien sûr que l’un d’eux ne fût pas de tuer le roi ; mais avant tout il lui fallait enlever Aïxa, et sans calculer, sans réfléchir, sans se demander si ce qu’il voulait faire était exécutable, il saisit la jeune fille dans ses bras.
La colère et la jalousie doublèrent ses forces ; il s’élança dans le corridor qu’il venait de parcourir, s’arrêta un instant, referma la porte derrière lui, poussa le verrou, et reprit sa marche, emportant avec lui sa proie.
Une seconde après, la porte en face venait de s’ouvrir ; le roi s’était retourné, et de la main avait fait signe à Latorre de s’éloigner.
Le cœur palpitant de trouble et d’amour, il s’élança dans l’appartement où le bonheur l’attendait.
Cet appartement était désert, il n’y avait plus personne. Il regarda autour de lui et ne pouvait en croire ses yeux.
Nous n’essaierons point de peindre sa surprise, son inquiétude et son désespoir.
Pendant qu’il sonnait à briser toutes les sonnettes, pendant qu’il appelait et interrogeait Latorre, aussi étonné que Sa Majesté elle-même, Alliaga, la mort dans l’âme, le front couvert de sueur, n’avait point abandonné son fardeau ; il traversa dans l’obscurité le corridor, puis l’oratoire de la reine. Tout était silencieux et désert. La prudence du roi et les soins de Latorre avaient éloigné tout le monde. Ces appartements n’étaient pas même éclairés ; mais Alliaga les connaissait si bien qu’il pouvait s’y aventurer sans crainte.
Arrivé à l’oratoire, il entra dans l’appartement que lui-même avait longtemps occupé, et descendit par l’escalier dérobé qui conduisait hors du palais. C’était celui-là qu’Aïxa avait pris en arrivant.
Épuisé par la fatigue et plus encore par les émotions qu’il venait d’éprouver, Alliaga s’arrêta un instant et chercha à rassembler ses idées. Il fallait à tout prix sortir du palais. C’était là que le danger était le plus menaçant.
Par malheur Aïxa était toujours évanouie. Il avait bien pu la porter jusque-là ; mais à supposer qu’il eût la force d’arriver ainsi jusqu’à l’hôtel de Santarem, que ne dirait-on pas en voyant un moine, un dominicain traverser les rues de Madrid, emportant dans ses bras une jeune femme ! Il est vrai que la nuit était sombre et qu’il était tard. D’ailleurs il n’y avait pas d’autre parti à prendre.
On pouvait venir du palais et lui enlever Aïxa, la ramener dans l’appartement du roi. Tout autre danger lui paraissait moins terrible que celui-là ; il n’hésita plus ; il ouvrit la porte secrète qui donnait sur la rue, la referma, et fit quelques pas en avant.
Il se trouvait dans une petite place peu fréquentée le jour, et ordinairement déserte à une pareille heure.
Il regarda autour de lui et aperçut avec autant de surprise que d’effroi deux hommes enveloppés de manteaux noirs, qui avaient l’air de veiller et d’attendre. Ils étaient placés aux deux extrémités de la place, et leurs yeux semblaient fixés sur la petite porte du palais. C’étaient sans doute les deux hommes qui avaient suivi Aïxa.
À la vue de Piquillo, ils s’avancèrent rapidement vers lui.
— Tout est perdu, se dit Alliaga ; je n’ai plus d’espoir !
Les deux hommes jetèrent un coup d’œil rapide sur Aïxa et sur le jeune moine, qu’ils semblèrent reconnaître. Ils tressaillirent. Puis l’un d’eux s’approchant, dit à voix basse :
— Dieu soit loué, frère ! C’est vous qui nous aurez tous sauvés.
Alliaga, interdit, n’osait interroger le protecteur inconnu que le ciel lui envoyait. Celui-ci continua rapidement et à demi-voix :
— Que faut-il faire ? Disposez de nous.
— M’aider à porter cette jeune dame, dit Alliaga.
L’inconnu donna un coup de sifflet, et plusieurs spadassins également couverts de manteaux noirs et qui se tenaient cachés aux environs accoururent à l’instant.
— Où faut-il la conduire ? dit l’inconnu.
Alliaga, de plus en plus étonné, hésita un instant.
De tous les endroits où Aïxa pouvait se réfugier, l’hôtel de Santarem lui paraissait le plus dangereux.
— Il faut sortir de Madrid, dit-il.
— Très-bien.
— À l’instant même.
— C’est encore mieux.
— Mais comment ?
— Pendant que nous étions en sentinelle, j’ai aperçu le long des murs du palais… à deux pas d’ici, au détour de cette place, une voiture attelée de deux bonnes mules et dont le conducteur semblait attendre ses maîtres. Allez, dit l’homme au manteau noir à ses gens, qu’on s’en empare. Au nom que vous prononcerez tout doit obéir.
L’étonnement d’Alliaga redoubla, et l’inconnu continua toujours à voix basse :
— À cette heure les portes de Madrid seront fermées. Par laquelle voulez-vous sortir ?
— Par celle d’Alcala, dit Piquillo.
L’inconnu fit un geste à l’un de ses compagnons qui s’éloigna rapidement. En ce moment on entendit le roulement de la voiture qui s’avançait. Le conducteur ou le maître de cette voiture se débattait, entouré par les spadassins, qui lui disaient :
— Silence ! silence !
— Je ne me tairai pas ! cria à haute voix le jeune homme qu’on entraînait, j’aurai justice d’un attentat pareil.
Alliaga stupéfait reconnut la voix d’Yézid. Il s’avança à sa rencontre, lui prit la main, qu’il serra fortement, et lui dit :
— Non, vous ne réclamerez pas ; vous obéirez en silence, vous m’aiderez à l’instant même à emmener cette jeune dame hors de Madrid, et vous en serez, je puis vous le promettre, largement récompensé.
Yézid, interdit, venait de reconnaître Piquillo et Aïxa. Il s’inclina et répondit brusquement :
— C’est différent ; quand on s’y prend bien et qu’on donne de bonnes paroles ! Ce n’est pas comme ceux-ci qui m’entrainaient de force. Je suis à vos ordres, mon père.
Un instant après, Aïxa, transportée dans la voiture, se trouvait en sûreté entre ses deux frères.
— Qu’est-ce que cela signifie ? s’écria Yézid.
— Silence ! tu le sauras. Dirige-toi vers la porte d’Alcala.
Les gardiens de la porte, qui déjà étaient prévenus, attendaient avec respect. La voiture roula sur la route, sortit de la ville et se trouva en pleine campagne.
Tout ce que nous venons de raconter depuis la sortie d’Alliaga de la chambre du roi s’était passé en moins d’un quart d’heure, et le mouvement de la voiture, la fraicheur de la nuit et l’air plus vif de la campagne firent enfin revenir la jeune fille de ce long et effrayant évanouissement, qui eût ressemblé à la mort, si les battements de son cœur n’eussent rassuré les deux frères.
— Où suis-je ? s’écria-t-elle en revenant enfin à la vie et en regardant autour d’elle avec effroi.
— Près de nous, près de tes frères, dit Yézid en la serrant dans ses bras.
— Vous ! c’est bien vous ! dit-elle en poussant un cri de joie. Puis se rappelant tout ce qui était arrivé, elle s’écria :
— Vous et le ciel m’avez sauvée, mais vous êtes perdus !
Alors, et pendant que la voiture roulait rapidement, elle leur dit la scène qui avait eu lieu deux jours auparavant dans le cabinet du roi. Elle leur apprit cet édit qui allait leur enlever leur famille, leur patrie, leur existence, cet édit qui proscrivait toute une nation et qu’on voulait obliger le souverain à signer. Elle leur avoua la condition que le roi avait mise à son refus, et Yézid poussa un cri d’indignation en pensant de quel prix on avait osé faire dépendre leur salut.
— Oui ! s’écria la jeune fille en leur racontant ses tourments, son désespoir et ses combats, oui, pour sauver mon père et vous tous, j’acceptais la honte et l’opprobre ! Mais rassurez-vous, leur dit-elle en leur montrant le flacon qu’Alliaga connaissait si bien, je n’y aurais pas survécu, je l’avais juré. Je faisais mal, sans doute, puisque notre Dieu en a décidé autrement ; que sa volonté soit bénie ! Mais que faire, et maintenant surtout qu’allons-nous devenir ? Toi qui gardes le silence, parle donc, Piquillo.
Au lieu de répondre, celui-ci, baissant la tête et 
Il m’a seulement ordonné de redescendre la montagne au plus vite.
joignant les mains, se mit à fondre en larmes en lui
disant :
— Pardon… pardon, ma sœur !
— Et de quoi ?
— D’infâmes soupçons… d’horribles idées dont mon cœur est brisé, et que moi je ne me pardonnerai jamais ! sais-tu qu’en te voyant dans la chambre du roi j’ai eu une pensée qu’il m’a fallu repousser et combattre ?
— Et laquelle ?
— Celle de te tuer !
— Merci, frère ! lui dit-elle en lui tendant la main ; si le ciel me réduisait à la même extrémité, n’oublie pas ta promesse.
— Non, non, dit Yézid, il est impossible, quelles que soient sa passion et sa colère, que le roi consente à une mesure aussi injuste, aussi atroce, aussi impolitique ! Il ne voudra pas consommer la perte de l’Espagne. C’est à nous, du reste, à lui faire connaître la vérité. Nous aurons pour nous tous les barons de Valence, que notre départ ruinerait à jamais, et qui nous viendront en aide. Rassurez-vous, rassurez-vous ; j’ai encore de l’espoir, et quoiqu’il arrive, nous aurons du moins sauvé notre sœur.
Ils s’arrêtèrent au point du jour à Alcala, et pendant qu’ils faisaient rafraîchir leurs mules, ils aperçurent à la porte de l’hôtellerie Pedralvi, qui, en zélé serviteur, plaçait avec soin un coffre pesant sur une voiture de voyage.
— Toi ! Pedralvi ! s’écria Alliaga ; comment te trouves-tu ici ?
— Avec le seigneur Delascar d’Albérique, votre père, qui se rend à Madrid.
— Mon père ! mon père ! répétèrent les trois jeunes gens.
— Yézid et Piquillo s’élancèrent de la voiture, aidèrent Aïxa à descendre, et un instant après, le vieillard se voyait entouré des caresses de ses enfants.
— Ah ! s’écria le Maure en levant les yeux au ciel, quels que soient les dangers qui nous menacent, quelles que soient les rigueurs que le sort nous réserve, je te remercie, à mon Dieu, de la joie que tu m’envoies en ce moment ! Nous voici donc tous réunis, dit-il, en les regardant avec tendresse ; je vous vois tous les trois près de moi, je vous presse tous les trois sur mon cœur. C’était là mon seul vœu, et maintenant qu’il est comblé, que le Dieu d’Ismaël rappelle à lui son serviteur !
Il les embrassa de nouveau et leur demanda :
— Où alliez-vous ainsi ?
— Près de vous… à Valence.
— C’est maintenant mon seul refuge, dit Aïxa.
Les deux frères racontèrent au vieillard les dangers, d’Aïxa et son dévouement. À mesure qu’ils parlaient, d’Albérique tremblait d’étonnement et d’effroi.
— Est-il possible, s’écria-t-il avec une sainte indignation. T’immoler pour moi et pour nous ! Qui t’en avait donné le droit ? qui te l’avait permis ?
— Vous, mon père ! vous ! dit-elle en retirant de son sein sa lettre, qu’elle lui montra.
— Oui, répondit le vieillard, j’ai dit qu’il fallait sacrifier pour ses frères les biens les plus précieux, la fortune et la vie, et je suis prêt à le faire. Mais l’honneur de ma fille, mais notre honneur à nous, est un bien dont nous ne pouvons pas disposer. Nous devons le rendre intact comme nous l’avons reçu. Oui, continua-t-il avec chaleur et en levant les yeux au ciel, nos existences et nos biens sont au roi, mais notre honneur est à Dieu !..
Aïxa était tombée à ses genoux qu’elle embrassait.
— Lève-toi, lui dit-il, lève-toi, mon enfant bien-aimée, j’espère qu’il ne nous en coûtera pas si cher. À moins qu’un esprit d’erreur et de vertige n’ait frappé notre souverain et ses ministres, ils accepteront les offres que je vais leur faire.
— Et s’ils refusent ? s’écria Yézid.
— Il faudra bien, répondit le vieillard, abandonner notre patrie, partir pour l’exil, et aller mourir sur le sol étranger.
— Il y a encore un autre parti, dit Yézid d’un air sombre.
— Et lequel ?
— Défendre cette patrie les armes à la main, et y mourir, si l’on n’y peut vivre.
— Non, non, s’écria le vieillard, espérons encore… mais hâtons-nous, les moments sont précieux. Si ce fatal édit était signé, tous nos efforts seraient inutiles.
Aïxa tressaillit, et Yézid secoua la tête d’un air de doute ; Piquillo seul partageait les espérances du vieillard.
— Je vous accompagnerai, s’écria-t-il ; il faudra bien que le duc de Lerma vous entende !
— C’est là le plus difficile, dit d’Albérique ; on prétend qu’il est presque impossible d’arriver jusqu’à lui, pour nous autres du moins.
— Je vous conduirai moi-même, et il vous recevra, je vous en réponds.
Il fut donc convenu que Aïxa et Yézid continueraient leur route pour Valence et que Piquillo reviendrait le matin même à Madrid avec le vieillard.
Quelques _heures après, Delascar et Piquillo descendaient à l’hôtel de Santarem, que Aïxa avait mis à la disposition de son père ; et à peine celui-ci eut-il pris le temps de se reposer, qu’il s’achemina avec son fils vers le palais du duc de Lerma.
LXI.
delascar d’albérique.
Jamais foule plus nombreuse n’avait encombré les appartements du ministre. Le duc était parvenu au plus haut point de fortune et de grandeur où puisse s’élever un sujet.
Le roi n’était plus rien dans l’État ; le ministre était roi ! Depuis les plus importantes fonctions jusqu’aux plus petits emplois, tout était dans sa main. Les titres, les honneurs, la faveur ou la disgrâce, tout dépendait de lui ; aussi ce n’était plus chez le roi, c’était chez le duc de Lerma que se tenait la cour. Les rangs des courtisans et des solliciteurs étaient serrés, et jamais, comme il le disait bien, Delascar d’Albérique n’eût pu se frayer un passage. Mais à la vue de frey Luis Alliaga, confesseur du roi, la foule s’ouvrit, les huissiers s’inclinèrent, et ils parvinrent jusqu’à la porte même du duc.
— Faut-il que j’entre avec vous, mon père ?
— Non… il y a quelques-unes de mes paroles qui ne doivent être entendues que de lui seul. La présence d’un tiers en empêcherait l’effet. Au sortir de l’audience, je te dirai ce qui se sera passé.
— Bien ; je vous attendrai à l’hôtel de Santarem.
Puis s’adressant à l’huissier, il lui dit :
— Annoncez à Son Excellence le seigneur don Albérique Delascar.
À ce nom, à ce titre surtout, qui rappelait l’ancienne protection de la reine, le ministre se leva surpris d’une visite aussi imprévue, visite qui, dans les circonstances actuelles, l’embarrassait beaucoup, et qu’il ne pouvait s’expliquer.
— Vous à Madrid, seigneur Albérique !
— J’arrive à l’instant même, Excellence.
Sachant que les instants d’un ministre sont comptés, surtout quand il reçoit malgré lui, d’Albérique se hâta d’arriver au fait.
— Je viens, monseigneur, au nom des Maures d’Espagne, vous parler…
— De leurs intérêts, dit le duc.
— Non, monseigneur, des vôtres.
Le duc le regarda d’un air étonné, et en même temps ne put s’empêcher d’admirer les beaux cheveux blancs et la tête noble et calme du vieillard. Celui-ci continua :
— Votre Excellence est accablée de tant d’occupations ou entourée de tant de gens qui ont intérêt à lui cacher la vérité, qu’il lui semblera peut-être nouveau et utile de la connaître ; je veux lui rendre ce service si elle veut bien me le permettre.
Déroulant alors une petite note qui ne contenait que des faits et des chiffres, il lui démontra que l’agriculture, l’industrie et tout le commerce du royaume étaient entre les mains des Maures ; que l’Espagne s’était affaiblie par la guerre et surtout par ses colonies d’Amérique, qui lui avaient enlevé le tiers de la po- pulation ; que les Maures, au contraire, ne suivaient point la carrière des armes et n’émigraient jamais ; qu’il n’y avait parmi eux ni moines ni monastères ; qu’aussi leur population doublait-elle tous les dix ans ; qu’elle s’élevait dans ce moment à plus de deux millions de fidèles sujets du roi d’Espagne, lesquels cultivaient les trois quarts des terres de l’Andalousie, des deux Castilles, des royaumes de Grenade, de Murcie et même de la Catalogne ; que les Maures avaient construit des routes, creusé des canaux, amélioré le lit des fleuves et uni toutes les villes d’Espagne par des relations commerciales ; que Valence, Malaga, Barcelone et Cadix, ports de mer par où s’écoulaient les riches produits de l’industrie musulmane, rapportaient au roi d’immenses impôts, auxquels il faudrait renoncer ; que les villes manufacturières allaient être dépeuplées, les campagnes les plus fertiles désertes et incultes ; et qu’enfin l’expulsion des Maures allait tarir toutes les sources de la prospérité nationale.
D’Albérique termina ce simple exposé par ces mots : Voilà ce que rapportait l’Espagne.
— Le duc le savait bien.
— Et voici ce qu’elle rapportera. Il lui remit alors une série de chiffres, que le duc parcourut d’un œil effrayé.
Jusque-là Sandoval et Ribeira ne lui avaient parlé que du triomphe de la foi, de la volonté du ciel, des bénédictions de la chrétienté. D’Albérique lui présentait la question sous une autre face, et il faut dire, à la honte du ministre, qu’il ne lui était jamais arrivé de l’envisager ainsi. Lui, si prodigue et si fastueux ; lui qui trouvait que les revenus d’Espagne suffisaient à peine à ses caprices, ne pouvait penser sans frémir que ces revenus allaient être diminués de plus d’un tiers. Il faut dire aussi, et d’Albérique le savait bien, que chez le duc l’amour des richesses égalait son ambition. Ce n’était pas qu’il fût avare, ses coffres étaient toujours vides ; il aimait l’or, non pour l’amasser, mais pour le jeter à pleines mains.
Il restait donc pensif et silencieux devant la perspective effrayante que d’Albérique avait eu l’habileté de mettre sous ses yeux. Celui-ci le laissa quelque temps livré à ses réflexions, puis il continua d’une voix calme :
— On assure que les conseillers de la couronne sont tous d’avis de signer l’édit de bannissement, mais Votre Excellence ne voudra pas que sous son administration, je dirai plus, sous son règne, on prenne une mesure qui doit à jamais ruiner le royaume ; vous ne voudrez pas que ce soit du duc de Lerma que date la décadence de l’Espagne !..
Le duc tressaillit, et d’Albérique, dont les yeux étaient fixés sur les siens, poursuivit avec chaleur :
— Au contraire, vous voudrez que, par vous, elle devienne plus florissante que jamais ; que par vous, elle augmente ses finances, ses armées et ses flottes ; et cela dépend d’un seul mot.
— Vous connaissez ce secret ? dit le duc en souriant.
— Je viens l’offrir à Votre Excellence, sans qu’il lui en coûte rien.
— Et que faut-il faire pour cela ? continua le ministre du même ton.
— Ne rien faire, monseigneur, absolument rien ! Laisser les choses comme elles sont.
Le duc rapprocha involontairement son fauteuil de celui de d’Albérique. Le vieillard ne perdant point de vue le ministre, dont les yeux restaient baissés, continua d’une voix calme et lente :
— Si l’on renonce à l’édit que l’on médite, les Maures, dont les premières familles et les principaux chefs m’ont chargé de venir trouver Votre Excellence, les Maures consentent à ce que l’on augmente d’un quart les impôts de toutes sortes qu’ils paient déjà.
Le duc leva la tête et redoubla d’attention.
— Comme on les accuse de n’être point sujets du roi, ils demandent à le servir et s’engagent à tenir toujours au complet douze régiments qui, sur tous les champs de bataille, verseront leur sang pour l’Espagne. Comme on les accuse d’entretenir des intelligences secrètes avec les puissances Barbaresques, ils promettent d’équiper une flotte qui protégera continuellement le commerce et les côtes du royaume. Comme on les accuse de haïr les catholiques et d’être leurs ennemis, ils offrent de racheter tous les chrétiens captifs en Barbarie[27].
Le duc étonné fit un mouvement pour parler.
— Attendez, dit d’Albérique, des vaisseaux et des soldats ne suffisent pas quand les coffres de l’État sont vides, et pour les remplir nous proposons d’y verser immédiatement douze millions de réaux[28].
— En vérité ! dit le duc, étourdi de tout ce qu’il entendait. Vous êtes donc bien riches ! vous autres Maures ?
— J’ai tant de confiance en Votre Excellence, répondit froidement d’Albérique, que je lui avouerai franchement la vérité. Nous pourrions réunir d’immenses capitaux ; et si nous les retirions de l’Espagne, pour les emporter avec nous en France, en Angleterre et en Hollande…
— J’entends ! j’entends ! dit vivement le duc ; des nations rivales ou ennemies qui s’enrichiraient de tous les trésors…
— Dont s’appauvrirait l’Espagne !.. dit d’Albérique en achevant sa phrase. Mesure tellement impolitique, qu’elle suffirait pour ternir à jamais le gouvernement le plus glorieux et le plus habile jusqu’alors.
— C’est vrai, se dit le duc en lui-même en se mordant les lèvres. Et il se leva avec agitation.
— Que Votre Excellence veuille bien attendre encore un instant, s’écria d’Albérique, je n’ai pas fini.
— Qu’est-ce donc ? dit le duc avec un vif sentiment de curiosité.
— Je n’ai parlé jusqu’ici qu’au nom de mes frères, poursuivit le vieillard ; mais moi, qui suis plus riche qu’eux tous, je n’entends point me laisser surpasser par eux. Je suis né sur le sol d’Espagne, je tiens à y mourir. À mon âge, monseigneur, on doit s’occuper de son tombeau, et je veux que le mien soit à ma guise, dût-il m’en coûter cher.
— Ce sera donc, dit le duc avec intérêt, un monument magnifique ?
— Une simple pierre, mais cette pierre sera placée à Valence au milieu de tous les miens, et portera cette seule inscription : Et ego in Hispania ! (Et moi aussi je suis resté en Espagne !) Je tiens tant à cette inscription que, pour laisser à mes héritiers le droit de la graver sur ma tombe (et cela dépend de vous, monseigneur), je n’hésiterais pas à acheter ce droit de mon vivant et à le payer, s’il le fallait, un million de réaux.
— Y pensez-vous ? dit le duc en se récriant ; une pareille somme !…
— Est trop faible, sans doute, répondit le vieillard en feignant de se méprendre sur l’étonnement du ministre, et vous avez raison, elle doit être digne de celui à qui j’ose l’offrir, digne surtout du puissant ministre qui va sauver l’Espagne, et Votre Excellence me permettra bien d’élever cette somme jusqu’à deux millions de réaux. La reconnaissance sera encore au-dessous du bienfait !
— Mais ce n’est pas possible ! seigneur Albérique, c’est de la folie !
— Que voulez-vous, répondit froidement le vieillard, j’ai des goûts sédentaires, et je tiens à ne pas me déplacer.
Ils étaient seuls, personne ne les entendait. D’Albérique, en réservant cet argument pour le dernier, savait bien ce qu’il faisait, il avait frappé juste. Les raisonnements qui avaient précédé celui-ci revenaient alors avec bien plus de puissance et de clarté à l’esprit du duc ; aussi, convaincu en lui-même, mais n’osant pas le paraître, il répétait avec embarras :
— Quoi !.. vraiment, seigneur Albérique, vous voulez…
— Supplier Votre Excellence de faire mon bonheur et celui de l’Espagne par-dessus le marché ; oui, monseigneur, vous n’enlevez point au roi de fidèles sujets, au royaume des bras qui le nourrissent.
— Certainement ! dit le duc en hésitant, je n’avais point encore étudié la question sous ce point de vue ; j’ai, grâce au ciel, l’habitude de saisir assez promptement les affaires, et aux premiers mots que vous m’avez dits de celle-ci, j’ai embrassé d’un coup d’œil ses inconvénients et ses avantages. Je vous déclare, avec la franchise d’un homme d’État, que, pour ma part, mes idées se sont complétement modifiées, et s’il ne tenait qu’à moi…
— Quels que soient nos adversaires et leurs insistances, il sera facile à Votre Excellence d’en triompher. Tout doit céder devant l’intérêt et le salut de l’État et si quelqu’un osait résister à une raison pareille, ce ne serait plus nous, ce serait lui qui serait un ennemi du roi et du pays ; ce serait celui-là qu’il faudrait condamner et bannir !
— C’est possible, mais ce sont des personnages si puissants et si haut placés.
— J’ai beau regarder, je ne les vois point, répondit d’Albérique.
— Vous ne les voyez point ! s’écria vivement le ministre.
— Celui à qui je parle m’empêche de les voir. Son élévation est telle qu’elle domine tous les autres ; sa volonté suffit pour emporter la balance, et si j’étais de lui…
— Que feriez-vous ?
— Je serais charmé d’être seul de mon avis, pour avoir seul la gloire de sauver et d’enrichir l’Espagne.
— C’est une idée, dit le duc, et j’y songerai. Mais, continua-t-il lentement et en pesant sur chaque parole, si je prenais sur moi une pareille responsabilité, et si je me décidais enfin…
Albérique tressaillit de joie.
— Qui me répondrait de l’exécution des promesses que vous venez de me faire, car je stipule ici pour l’État ; c’est à moi de veiller à ses intérêts, et je ne puis m’engager sans garantie.
— D’abord, répondit froidement le vieillard, les deux millions de réaux dont je parlais tout à l’heure à Votre Excellence lui seront remis comptant, dès demain, par une personne de confiance.
— Quelle personne ? dit le ministre avec inquiétude.
— Frey Luis d’Alliaga, confesseur du roi, seul admis dans cette confidence, et par qui seul je désire correspondre avec vous.
— Très-bien, répondit le duc.
Et il se dit, en lui-même, avec joie et confiance :
— Alliaga est mêlé dans cette affaire ! C’est étonnant ! toutes les chances heureuses qui m’arrivent depuis quelque temps me viennent de lui. Et après ? continua-t-il à voix haute, et en se retournant vers Albérique.
Celui-ci répondit :
— Les douze millions de réaux que nous devons verser dans les caisses de l’État, seront payés avant huit jours par moi, et sans que vous ayez besoin d’aucun autre percepteur. Je pars ce soir, je vais trouver mes frères ; je leur annonce les bienveillantes intentions de Votre Excellence ! Tous s’empresseront d’acquitter la dette contractée en leur nom, et dont je suis responsable.
— Ah ! c’est vous qui en répondez ? dit le ministre étonné.
— Oui, Excellence… chacun vous dira que je le puis.
— Quoi ! vos biens suffiraient ?..
— Et audelà, répondit froidement le vieillard ; j’ai soixante-dix ans, Monseigneur, et il y en a soixante que je travaille. Quant à la flotte et aux soldats que nous nous engageons à équiper, et pour l’exécution de toutes nos autres promesses, moi, mon fils Yézid et quatre de nos frères, les chefs de nos plus riches familles, nous viendrons nous remettre, comme otages, entre vos mains, prêts à payer de nos têtes le premier manque de foi ou la première révolte.
Il y avait dans la parole du vieillard, dans ses yeux, dans son attitude, tant de dignité, de courage et de véritable dévouement, que le duc, entrainé par un ascendant irrésistible, peut-être aussi par un sentiment d’amour national, par une lueur de patriotisme qu’il n’est pas impossible de rencontrer chez un homme d’État, le duc s’écria avec chaleur :
— Je vous crois ! je vous crois ! seigneur d’Albérique !
— Votre Excellence accepte mes propositions et celles de mes frères ?
— C’est convenu.
— Vous me le jurez, monseigneur !
— Je vous le jure !
Le vieillard serra la main du ministre et lui dit :
— Dieu vous a entendu, et bientôt l’Espagne va vous bénir !
Demain frey Alliaga sera chez Votre Excellence, et moi, dès ce soir, je pars.
Albérique courut à l’hôtel Santarem, où son fils l’attendait avec impatience. Il lui raconta dans les plus grands détails, et presque mot pour mot, la conversation qu’il venait d’avoir avec le duc de Lerma. Piquillo, qui ignorait les immenses ressources dont son père pouvait disposer, s’effraya d’abord des engagements que le généreux vieillard venait de prendre. Celui-ci lui prouva qu’il lui était facile de les acquitter ; qu’il venait, au prix d’une partie de ses trésors, d’acheter le repos, l’avenir de ses frères, et de leur donner à jamais une patrie. On ne pouvait payer trop cher de pareils résultats.
D’ailleurs le Maure était lui-même un financier trop habile, pour ne pas comprendre, ainsi que ses frères, que les nouveaux impôts dont ils offraient de se charger seraient chaque année couverts et au delà par l’extension immense qu’allaient prendre en Espagne l’industrie, le commerce et l’agriculture, dont ils avaient presque le monopole. Jamais spéculation n’avait été ni meilleure, ni plus noble. En échange de son adoption, ils forçaient leur nouvelle patrie à devenir riche, puissante et heureuse.
Aussi, certain désormais du succès de sa cause, Albérique partit le soir même, pour aller porter lui-même à Valence, à Murcie et à Grenade, ces heureuses nouvelles, tandis que Pedralvi allait parcourir par ses ordres les deux Castilles, l’Aragon et la Catalogne.
C’étaient les provinces habitées spécialement par les Maures, et d’Albérique connaissait si bien la population et les ressources de chaque ville, de chaque village, de chaque campagne, que la répartition faite par lui fut sur-le-champ adoptée. Dès les premiers jours chacun accourait avec empressement apporter sa part de l’impôt pour son rachat et celui de ses frères, et jamais contribution aussi énorme ne fut acquittée avec plus de facilité et plus de joie.
Albérique, avant son départ, avait remis à Alliaga les deux millions de réaux promis au duc de Lerma. Il les lui avait donnés en traites, non-seulement sur Barcelone et Cadix, mais sur Venise et Constantinople, sur Londres, Marseille et Amsterdam.
Muni de ces valeurs, Alliaga se rendit le lendemain chez le duc de Lerma.
Toutes les portes lui furent ouvertes, et le domestique de confiance le conduisit, non pas dans le cabinet, mais dans la chambre même du duc, en le priant de vouloir bien attendre.
Le ministre était en conférence secrète au palais du saint-office avec son frère Bernard de Sandoval.
— J’attendrai, dit Alliaga.
Il venait de s’asseoir, et se releva tout à coup à la vue d’un riche tableau placé en face de lui ; c’était le portrait d’un jeune homme de vingt à vingt-cinq ans qui lui fit jeter un cri de surprise.
Ce portrait était celui d’un moine, et ce moine ressemblait exactement à Piquillo. Il détourna un instant les yeux de cette peinture et se rencontra encore face à face avec elle dans une grande glace de Venise, devant laquelle il se regardait.
Étonné d’un pareil hasard, il rappela le domestique au moment où celui-ci allait s’éloigner.
— Quel est ce portrait ? lui dit-il.
— Celui du fils de monseigneur.
— Comment, c’est là le duc d’Uzède ?
— Oui, mon révérend ; peint à vingt-cinq ans par le peintre du roi, Pantoja de la Cruz.
— Pourquoi est-il en moine ?
— Comment, mon révérend, vous ne savez pas cela ?
— Eh non ! puisque je vous le demande.
— C’est l’usage à Madrid et dans toute l’Espagne : chaque enfant de grande maison est, au moment de sa naissance, affilié à quelque confrérie. Le duc d’Uzède l’a été à celle des dominicains, et il s’était fait peindre sous leur costume pour faire plaisir à son oncle Sandoval, à qui ce portrait était destiné ; mais le duc de Lerma a voulu le garder chez lui, dans sa chambre à coucher.
— Je comprends alors, dit Alliaga, pourquoi le duc d’Uzède est habillé comme moi.
— C’est vrai, dit le domestique en levant les yeux sur Alliaga, c’est exactement le même costume…
Il poussa tout à coup un cri, s’arrêta et dit en tremblant :
— Ah ! mon Dieu ! et la même figure… On dirait que c’est le portrait qui marche… et qui parle. Qu’est-ce que cela veut dire ?
— Rien, dit Alliaga en s’efforcant de sourire, un jeu du hasard… tous les moines se ressemblent… Laissez-moi.
Le valet se retira tout interdit, regardant plusieurs fois encore le moine et le portrait.
Cet incident avait jeté Alliaga dans un trouble inexprimable.
Cette ressemblance est donc bien réelle, se dit-il, je ne suis pas le seul qui l’ait rêvée, puisque ce valet l’a remarqué ainsi que moi.
Alors ses anciens doutes se réveillèrent dans sa pensée, et un affreux désespoir s’empara de lui. Les yeux fixés sur ce portrait, il se disait avec rage :
— Si je dois la vie à cet homme que je déteste, si ce sang odieux est le mien, il m’était donc permis d’aimer Aïxa. Je pouvais donc sans crime réclamer son amour !
En parlant ainsi, il laissa tomber sa tête sur sa poitrine où tant d’amour brûlait encore, où le feu couvait toujours caché sous la cendre ; il aperçut alors sa robe de moine, cet autre signe d’esclavage, cet obstacle éternel élevé entre lui et Aïxa, et il maudit de nouveau les auteurs de sa perte. En ce moment parut le duc de Lerma.
LXII.
l’édit.
Alliaga s’empressa de cacher son trouble ; mais le duc l’avait remarqué et lui en demanda la cause.
— Je pensais, répondit-il en balbutiant, à nos ennemis communs, au père Jérôme, à Escobar.
— À merveille, dit le duc ; nous nous en occuperons bientôt, et c’est par la main de leur complice, c’est par d’Uzède lui-même que je veux les punir et vous venger.
— Moi, monseigneur, je n’en demande pas tant.
— Et nous, nous vous devons bien cela, frère Luis Alliaga ; nous le disions tout à l’heure encore avec mon frère Sandoval ; aucun de ceux que nous avons gorgés d’or ou comblés de bienfaits ne nous a rendu autant de services que vous.
— En quoi donc, monseigneur ?
— N’est-ce pas vous qui m’avez prévenu de la trahison de d’Uzède mon fils et de ses complots avec Altamira et les pères de Jésus ? N’est-ce pas vous qui nous avez appris le premier la ligue du roi Henri et de la France contre l’Espagne ? N’est-ce pas vous enfin qui dernièrement nous avez sauvés du plus grand de tous les dangers ?
— Vous vous exagérez mes services, monseigneur.
— Non, nous ne savions plus à quel moyen avoir recours. Le roi était sourd aux observations du grand inquisiteur et aux miennes. Il était évident qu’Aïxa déciderait seule, désormais, des destinées du royaume, car Philippe ne voulait plus se guider que par les avis de la favorite ; c’est comme je vous le dis, mon frère, notre roi en perd la tête.
— En vérité ! répondit Piquillo en essayant de sourire.
— Et comme nous insistions, il nous avait quittés sans daigner nous répondre. Il nous avait laissés dans son cabinet et venait de s’élancer dans sa chambre, où la duchesse de Santarem l’attendait ! C’en était fait de nous, lorsque par une résolution audacieuse, par un coup de main intrépide et que je ne puis m’expliquer encore, vous l’avez enlevée.
— Qui vous l’a dit ?
— Nos affidés… ceux même que j’avais chargés de surveiller toutes les démarches de la duchesse et qui l’avaient suivie depuis l’hôtel de Santarem jusqu’à la porte du palais, sans oser tenter ce que vous avez si heureusement exécuté.
— J’avais, en agissant ainsi, monseigneur, dit Piquillo avec embarras, mon projet, mes idées, dont je n’ai pas cru devoir vous prévenir.
— Nous ne vous en faisons pas un reproche, s’écria vivement le duc ; dans cette affaire, comme dans les autres, vous ne dites rien, je le sais, mais vous agissez, cela vaut mieux. C’est comme dans celle pour laquelle vous venez aujourd’hui.
— Je vous apporte les deux millions de réaux…
— Je le sais.
— Que Delascar d’Albérique m’a dit de vous remettre.
— Je le sais, répéta le duc à demi-voix, et vous êtes trop notre ami, vous nous êtes trop dévoué pour vous rien cacher de cette affaire, dont vous devez partager toutes les chances avec nous.
— Je ne veux rien… je ne demande rien ! s’écria vivement Alliaga. À vous seul la gloire et la récompense d’une si noble entreprise.
— C’est ce que nous n’entendons point !… d’autant que chaque jour, à chaque instant, et par votre position auprès du roi, nous aurons besoin de vous. Nous ne pouvons rien sans votre concours.
— Il vous est acquis.
— Je le sais.
— Je suis prêt à vous seconder de tout mon pouvoir dans la tâche que vous avez entreprise… et qui maintenant, je l’espère, n’offre plus de difficultés.
— Au contraire ! de très-grandes. Cela devient plus compliqué que jamais.
— Comment cela ?
— Je vous dis tout à vous, parce que vous êtes non-seulement un homme d’exécution… mais un homme de bon conseil… J’ai promis à ce Delascar d’Albérique…
— Vous lui avez juré ! monseigneur.
— Je le sais bien.
— Il y compte.
— Et c’est bien là ce qui m’embarrasse.
— En quoi donc ? le traité qu’il propose est moins avantageux encore pour lui… que pour vous… et pour le pays !
— Certainement ! Aussi je ne demandais pas mieux que de l’exécuter… je le voulais même ; mais j’en ai parlé… à mon frère Sandoval, tout à l’heure, au palais de l’inquisition.
— Eh bien ! qu’est-il arrivé ?
— Ce qui est arrivé… dit le duc à demi-voix… le chapeau de cardinal pour moi !
— Pour vous, monseigneur !
— Oui, sans doute, la cour de Rome, qui me l’avait promis, me l’envoie… et quand le Vatican tient ses promesses, comment ne pas tenir les miennes ?
— Et celles que vous avez faites au Maure Delascar d’Albérique ?
— C’est vrai !.. mais vous comprenez, mon frère, qu’entre un Maure et le pape… on ne peut pas hésiter. C’est ce que m’a dit Sandoval ; c’est ce que le conseil suprême de l’inquisition n’a cessé de me répéter… C’est tromper Sa Sainteté, c’est manquer au serment que je lui ai fait ; c’est extorquer un chapeau de cardinal ; il y a de quoi me faire mettre au ban de la chrétienté… Il y va de mon avenir et de mon salut !
— Et l’avenir et le salut de l’Espagne, que l’expulsion des Maures doit ruiner à jamais ! et la prospérité que vous lui enlevez, et les richesses qui étaient promises !.. que dis-je ! assurées au pays et à vous !
— Et voilà justement, s’écria le duc, le point de la question. Il faudrait concilier tout cela, et Sandoval à trouvé un moyen.
— Lequel ?
— C’est là-dessus que je veux vous consulter, mon frère : d’abord pour avoir votre avis, ensuite pour que vous déterminiez le roi à l’adopter, dans le cas où il y aurait de sa part des indécisions, des hésitations qu’il n’avait jamais autrefois, et qui maintenant ne sont que trop fréquentes.
— Quel est ce moyen ? dit Alliaga.
— Le voici : les Maures nous font des propositions incroyables, fabuleuses !
— Je les connais.
— Ils nous offrent des sommes énormes.
— Et vous les refusez.
— Non pas ! nous ne consentirons jamais à ce que des capitaux aussi considérables sortent du royaume.
— À la bonne heure !
— Suivez alors le raisonnement de Sandoval : puisqu’ils nous offrent une part dans ces immenses richesses, c’est qu’ils les ont, c’est qu’ils les possèdent.
— Sans contredit.
— Eh bien ! en insérant dans l’édit de bannissement un article ainsi conçu : Les Maures seront expulsés du royaume, et leurs biens confisqués au profit de l’État…
— Que dites-vous ! s’écria Alliaga avec indignation.
— Je dis qu’on leur défendra, sous peine de mort, de rien emporter avec eux. C’est la rédaction que propose Sandoval, et qui concilie tout. Les Maures sont chassés, mais leurs trésors nous restent. Qu’en dites-vous ?
— Je dis, monseigneur, s’écria Piquillo d’une voix tonnante, que c’est une infamie… et que l’auteur d’une telle proposition doit être voué à l’exécration de l’Europe et de la postérité !
La foudre serait tombée en ce moment, que le duc eût été moins effrayé et moins surpris que de ce qu’il venait d’entendre.
— Quoi ! balbutia-t-il d’une voix tremblante, c’est vous, frey Alliaga, qui parlez ainsi… vous ? que nous avons placé près de Sa Majesté !.. vous, sur lequel nous comptions !
— Vous pouvez y compter encore, monseigneur, si vous le voulez ! cela dépend de vous ! Repoussez les infâmes suggestions de votre frère… Renoncez à votre chapeau de cardinal, plutôt qu’à votre honneur, exécutez vos promesses ! déclarez, dans un édit que nous allons faire signer au roi, que les Maures seront traités désormais comme les autres sujets de l’Espagne, et je redeviens à l’instant ce que j’étais tout à l’heure, fidèle à Votre Excellence, dévoué à vos projets… et prêt à les seconder.
— Je ne le puis, je ne le puis ! j’ai accepté, j’ai promis. Le légat du pape a reçu mes serments.
— Le pape lui-même, reprit Alliaga avec sa brutale franchise, ne peut ordonner le parjure, et vous avez promis hier à Albérique ! Le pape lui-même ne peut approuver ce que flétriraient toutes les lois divines et humaines.
— Que voulez-vous dire ?
— L’exil qu’on vous propose est une injustice ! et la confiscation un vol…
— Mon frère, mon frère, s’écria le duc alarmé, je ne reconnais là ni votre rectitude de jugement, ni votre raison ordinaire ; ce qui serait mal pour un particulier, ne l’est pas pour un ministre ! La politique l’excuse et permet bien des choses, et quand vous aurez réfléchi…
— Mes réflexions sont faites, je cours chez le roi.
— Quel est votre projet ?
— De lui dire la vérité, de l’éclairer sur ses vrais intérêts, ceux de l’Espagne.
— Telle n’est pas votre mission ; je ne vous ai placé près de Sa Majesté que comme directeur de sa conscience.
— Et vous croyez qu’il n’y a aucun rapport entre le malheur du peuple et la conscience d’un roi ! Je désire, monseigneur, que la vôtre ne vous reproche rien ; cela vous regarde, je n’en suis pas chargé ; mais si vous préparez des remords au roi, mon devoir, à moi, c’est de les lui épargner, et j’y cours de ce pas.
— Vous n’irez pas ! dit le ministre en se plaçant devant lui ; il est en ce moment avec le grand inquisiteur et le légat du pape.
— J’irai. Je puis entrer à toute heure… je connais mes droits, et j’en userai.
— Eh bien ! s’écria le ministre, si vous parlez contre nous, si vous mettez obstacle à nos projets, rappelez-vous que la main qui vous a élevé saura bien vous renverser.
— Monseigneur, répondit Alliaga, je n’ai point demandé le poste où vous m’avez placé ; mais, en l’acceptant, j’ai promis d’en remplir tous les devoirs, et je le fais. Votre Excellence peut-elle en dire autant ? Je le lui demande.
— Pour m’interroger ainsi, s’écria le duc avec hauteur, oubliez-vous donc que vous me devez tout ?
— Et j’ai payé mes dettes, répondit Alliaga, vous en êtes convenu vous-même. Oui, poursuivit-il avec chaleur, j’ai pris parti pour vous contre l’étranger : c’était le devoir d’un Espagnol. J’ai pris parti pour vous contre un fils qui trahissait son père : c’était le devoir d’un honnête homme. Mais ici, monseigneur, cesse notre alliance. Je n’en veux plus avoir avec un homme qui trahit son pays et son roi.
— Cette parole vous coûtera cher ! s’écria le duc.
— Je sais que votre colère est redoutable, monseigneur. Tout vous cède, tout vous obéit. Vous avez le droit de tout tenter, de tout oser, même la tyrannie et l’injustice ! En un mot, vous êtes au faîte de la puissance ; mais n’oubliez pas que les arbres les plus élevés sont les premiers frappés de la foudre !
— Est-ce là votre espoir ?
— Vous l’avez dit. Vous m’avez reproché souvent d’ignorer l’ambition. Eh bien ! puisque vous m’y forcez, je ferai connaissance avec elle, non pour m’élever, Mais pour vous abattre !
Et il sortit.
Le duc le suivit quelque temps des yeux avec inquiétude et se dit :
— Il est confesseur du roi, par moi ! c’est une faute !
Puis un sourire de satisfaction et de sécurité vint éclairer sa physionomie.
— Oui, mais je suis cardinal ! on pouvait renverser le duc de Lerma, on ne renverse pas un cardinal ; on ne se brouille pas avec la cour de Rome, avec l’inquisition, avec un homme qui tient dans sa main toutes les destinées du royaume ! le roi le voudrait maintenant qu’il ne l’oserait pas, et quant à frey Luis Alliaga, que peut-il faire ? s’allier avec mes ennemis, le père Jérôme, Escobar, la Compagnie de Jésus et même avec mon fils ! tant mieux ! qu’ils se réunissent, je les atteindrai tous ensemble et du même coup.
Alliaga, cependant, s’était rendu en toute hâte au palais du roi.
Depuis le départ d’Aïxa, celui-ci n’avait pas dormi.
Il était en proie à une incertitude et à des tourments
d’autant plus grands qu’il n’osait se confier à personne. 
Haletant, épuisé, respirant à peine, il arriva au sommet du rocher.
Quelque désir qu’il eût d’expliquer cette mystérieuse
aventure, pour lui si fatale et si douloureuse, il sentait
bien qu’elle avait un côté ridicule dont il désirait qu’on
n’eût pas connaissance. Aussi avait-il recommandé la
plus grande discrétion à Latorre, qui s’empressa de
tout raconter à la comtesse.
Le roi, n’osant hasarder aucune démarche qui pût compromettre la duchesse de Santarem, attendait toujours d’elle une visite ou une lettre, et il ne pouvait se rendre compte de son silence ; car enfin elle était venue d’elle-même au palais ; elle y était venue seule ; elle avait attendu le roi dans sa chambre, et le roi avait laissé échapper une pareille occasion, il n’avait pas su s’emparer du bonheur qui lui était offert et pour lequel il aurait donné sa vie.
Pour un amant, il y avait de quoi se pendre, fût-il un simple particulier, à plus forte raison pour un roi, qui, d’ordinaire, n’a pas l’habitude d’être contrarié.
Aussi, le second jour, il fut impossible au souverain d’attendre plus longtemps. Il envoya Latorre, sans livrée, porter une lettre à la duchesse, et Dieu sait avec quelle impatience il attendit la réponse.
On rapporta la royale missive non décachetée : la duchesse de Santarem n’était plus à son hôtel. Elle avait disparu de Madrid, sans qu’on la vît partir, et l’on ne savait pas où elle était allée.
Pour le coup, le roi pensa en devenir fou. Il y avait dans sa figure, dans ses manières, un tel changement, que ses plus fidèles serviteurs en étaient effrayés. Lui, d’ordinaire si bon et si doux, était dans un état continuel d’irritation et de dépit.
C’était une crise nerveuse dont les effets retombaient sur tous ceux qui l’entouraient ; il ne savait à qui s’en prendre de son malheur, mais il semblait cependant réserver une antipathie particulière et spéciale pour le duc de Lerma et Sandoval, qu’il accusait en lui-même d’être la cause de son premier échec. C’étaient eux dont la visite importune et les instances réitérées avaient donné à la duchesse le temps de se dérober à sa vue.

Aussi ne prononçait-il leurs noms qu’avec des signes visibles de mécontentement et de dépit.
Un matin, au lieu de s’apaiser, l’accès redoubla. Latorre entendit sonner avec tant de violence qu’il accourut épouvanté. Le roi, dans un état difficile à décrire, pâle, hors de lui-même, les traits décomposés et la voix si émue qu’il pouvait à peine parler, le roi lui ordonna de courir à l’instant même à l’hôtel de don Fernand d’Albayda, et de lui dire de se rendre au palais.
Pendant que le fidèle serviteur s’acquittait de ce message, le roi relisait de temps en temps et froissait avec rage un petit papier qu’il avait encore trouvé sur son bureau et qui était ainsi conçu :
« On s’est joué indignement de Votre Majesté. La nuit même où le roi attendait la duchesse de Santarem, celle-ci partait, en voiture de poste, en tête-à-tête avec don Fernand d’Albayda. Tous deux se rendaient en secret à Valence, où, dans ce moment, ils doivent être mariés ! »
Le pauvre roi aurait fait pitié, même à ses plus cruels ennemis. La colère, la jalousie, le mépris, bouleversaient toutes ses facultés. Il était à moitié fou, et cependant il ne pouvait croire encore à tant de perfidie, et quand Latorre revint :
— Eh bien ! lui dit-il en l’interrogeant du regard plus encore que de la voix, Fernand d’Albayda est sur tes pas, il te suit ?
— Non pas, sire ; il n’est pas à Madrid.
— Et où est-il donc ? dit le roi, dont tous les traits étaient contractés par une agitation convulsive.
— Il est, dit-on, parti pour Valence !
— Et depuis quand ?
— Depuis trois jours.
Le roi poussa un cri de douleur. Puis il dit au valet de chambre :
— Laisse-moi ! laisse-moi !
Il se livra alors à tout son désespoir, à toute sa rage. Il jura de se venger sur Fernand, mais surtout sur Aïxa et sur tous les siens. Il rêvait, il cherchait dans sa tête les moyens de l’humilier, de lui prouver son indifférence et son mépris ; tout ce qu’il désirait alors, c’est qu’elle fût bien convaincue de sa haine.
C’est dans ce moment qu’Alliaga s’était rendu au palais du duc de Lerma et avait avec le ministre l’entretien que nous avons raconté plus haut, c’est dans ce moment qu’on annonça chez le roi le grand inquisiteur Sandoval et le légat du pape.
Ils apprirent au roi que Sa Sainteté le pape Paul V venait d’élever son premier ministre, le duc de Lerma, à la dignité de cardinal ; que la cour de Rome, en donnant à celle d’Espagne cette nouvelle marque de sincère alliance, espérait bien que le roi accorderait enfin à l’Église catholique la satisfaction qu’elle réclamait depuis si longtemps : l’expulsion des hérétiques.
Le roi poussa un cri de joie, et interrompant l’inquisiteur, qui croyait devoir appuyer cette proposition par de nouveaux arguments :
— C’est bien, c’est bien ! s’écria-t-il, avez-vous là cet édit ?
— Toujours, sire, il ne me quitte pas.
— Lisez-le-moi.
Sandoval, transporté de joie, jeta au légat un regard de triomphe et lut à haute voix et lentement l’édit, qui contenait sept articles[29]. Le premier était l’expulsion immédiate de tous les Maures qui habitaient l’Espagne.
On leur enjoignait expressément, sous peine de mort, de se tenir prêts, hommes, femmes et enfants, à partir dans trois jours, pour les ports désignés comme lieux de l’embarquement : là ils devaient se rendre à bord des vaisseaux destinés à les transporter en pays étranger.
Le second article prononçait la confiscation de tous leurs biens au profit de l’État et des seigneurs dont ils étaient vassaux, et peine de mort pour ceux qui tenteraient d’en cacher ou d’en détruire quelques-uns.
Le troisième article avait rapport aux enfants au-dessous de quatre ans, qui pouvaient rester en Espagne, à condition que…
— Donnez ! dit le roi, qui n’avait pas écouté et qui croyait que l’inquisiteur avait achevé sa lecture ; donnez, donnez ! je suis ravi que monseigneur le légat puisse dire à la cour de Rome tout ce que nous faisons en considération de Sa Sainteté.
— Sa Sainteté le saura, dit le légat en s’inclinant ; elle n’attendait pas moins du Fils aîné de l’Église, du Roi Très-Catholique. Je vais aujourd’hui même envoyer un courrier pour que le Te Deum retentisse sous les voûtes de Saint-Pierre.
— Et dans toutes les églises d’Espagne, dit le grand inquisiteur.
Le roi prit la plume, et d’une main qu’affermissait le dépit, il signa sans hésiter, et presque sans le savoir, la condamnation de deux millions de ses sujets.
— Maintenant, sire, s’écria Sandoval, à nous l’exécution de cette glorieuse ordonnance, et si Votre Majesté veut m’en croire, elle se dérobera à toutes les sollicitations et réclamations qui vont l’assaillir.
— Comment cela ? dit le roi.
— Cette nation mauresque a, même parmi nous tant de protecteurs et d’amis…
— Je n’en écouterai aucun ! je refuserai.
— Votre Majesté est si bonne qu’elle en sera désolée ; et si j’étais d’elle je partirais à l’instant pour Valladolid.
— Quitter Madrid ! quitter ce palais ! s’écria vivement le roi, c’est tout ce que je demande ! l’air ! le grand air… c’est ce qu’il me faut ; je suis oppressé, j’étouffe ! dit-il en portant la main à son cœur.
Sans lui donner le temps de réfléchir, en quelques minutes, tout fut prêt par les soins du grand inquisiteur. Sous prétexte d’une promenade à une lieue de Madrid, le roi partit, sans que les gens même de sa suite fussent instruits du but de son voyage.
Un quart d’heure après, des courriers s’élançaient dans toutes les directions, annonçant à tous les évêques du royaume le triomphe de la foi sur l’hérésie, et l’importante mesure que le roi venait de prendre ; prescrivant, en même temps, à tous les vice-rois de province et à tous les gouverneurs de villes, de mettre, à l’instant même, à exécution la présente ordonnance.
Sandoval et le saint-office étaient dans la jubilation ; Ribeira versait des larmes de joie, et le duc de Lerma se disait à part lui en souriant : Pour un futur ambitieux, Alliaga commence mal ; il n’a pas su choisir son temps pour se brouiller avec nous, et il lui sera aussi difficile maintenant de me renverser que de sauver d’Albérique et les siens.
En effet, quand arriva Alliaga, tout était fini : l’acte d’iniquité était consommé !
LXIII.
les barons de valence.
En quittant le duc de Lerma, Alliaga s’était rendu sur-le-champ au palais du roi.
On lui avait dit que Sa Majesté venait de partir pour une promenade. Il avait attendu ; les heures s’étaient écoulées, le roi n’était pas revenu.
Alliaga, décidé à voir le monarque, n’avait pas quitté le palais ; il y était resté jusque bien avant dans la nuit. Alors, épuisé de fatigue, accablé d’inquiétudes, craignant quelque nouveau complot contre le roi lui-même, il sortit, rentra quelques instants à l’hôtel de Santarem, et y trouva ces mots que le roi lui avait adressés avant son départ :
« Je pars pour Valladolid. Je suis le plus malheureux des hommes ; venez me rejoindre, mon cher Alliaga, je n’attends plus de consolations que de vous seul. »
Que s’était-il donc passé ? qui avait pu déterminer ce départ, cette fuite du roi ? Ce n’était ni au ministre ni à son frère qu’Alliaga pouvait maintenant le demander. Le plus terrible, c’est qu’il y avait déjà plus de douze heures de perdues, et qu’il en fallait autant pour franchir les quarante lieues qui séparent Madrid de Valladolid.
Piquillo n’hésita pas ; quoique brisé de fatigue, et n’ayant rien pris depuis le matin, il se jeta dans une voiture, roula toute la nuit, et arriva le lendemain à Valladolid. Le roi a défendu de laisser pénétrer personne jusqu’à lui ; mais cette défense ne regardait point le révérend père Alliaga, confesseur de Sa Majesté.
Toutes les portes lui furent ouvertes.
À peine s’il reconnut le roi, tant ces vingt-quatre heures de souffrances avaient changé ses traits. Sa première colère s’était calmée, la douleur seule était restée, et à l’aspect de Piquillo, les larmes vinrent à son aide.
— Mon frère !.. mon frère, s’écria-t-il, venez à mon secours, venez sauver mon âme ! Tout est fini pour moi, et il me semble que je ne crois plus à rien.
La douleur rapproche les distances, car Piquillo se sentit pressé dans les bras du roi.
— Qu’y a-t-il donc ? demanda-t-il avec effroi. Quel malheur menace l’État ou Votre Majesté ?
— Elle est partie ! s’écria le roi… elle a épousé Fernand d’Albayda.
— Et qui donc ?
— La duchesse de Santarem..
— Cette idée seule fit pâlir Alliaga, qui se hâta de se remettre et répondit :
— On a abusé Votre Majesté : ma sœur n’est pas mariée.
— Mais elle a quitté Madrid avec lui, avec Fernand, la nuit, dans la même voiture !
— Ce n’est pas, ce n’est pas ! s’écria Alliaga ; Fernand était appelé par les barons de Valence pour s’entendre sur leurs plus chers intérêts, et il est parti, mais seul.
— C’est lui, vous dis-je, qui a enlevé la duchesse de Santarem.
— Je puis prouver le contraire à Votre Majesté.
— Et comment cela ?
— D’un seul mot : c’est moi, sire, qui ai enlevé la duchesse.
— Vous, mon frère ! s’écria le roi stupéfait ; et pourquoi ?
— Parce qu’en se donnant à Votre Majesté, elle avait juré de se donner la mort ; et vous, sire, qui tout à l’heure encore me conjuriez de sauver votre âme, je n’ai pas voulu que vous puissiez paraître devant Dieu chargé d’un double crime.
Le roi pâlit.
— Celui d’avoir ravi l’honneur et la vie à une jeune fille.
— Ne m’accusez pas, ne m’accusez pas, mon pêre ! je vous le dis, et Dieu le sait, je voulais l’épouser.
Piquillo tressaillit et dit froidement :
— Qui donc en a empêché Votre Majesté ?
— Le duc de Lerma et l’inquisiteur. Ils m’ont affirmé qu’il n’était pas permis d’épouser une Maure, et maintenant je le voudrais que je ne le pourrais pas, car, en présence de l’inquisiteur et du légat du pape, on m’a dit, on m’a prouvé…
— Quoi donc ? reprit Piquillo en frémissant de terreur.
— Que les Maures étaient des hérétiques qui causeraient la perte du royaume.
— Ils font sa force et sa prospérité ! s’écria Piquillo. Et avec éloquence, il lui déroula en peu de mots le tableau exact et fidèle que l’on avait jusque-là caché à ses yeux. Il lui montra la vraie situation et les vrais intérêts de l’Espagne, lui peignit à grands traits les projets du grand inquisiteur, l’orgueil de Ribeira et l’ambition du duc de Lerma, qui tous trois entraînaient le royaume vers sa perte.
À chaque mot, le roi, effrayé, étourdi, le contemplait d’un œil hagard et désespéré ; puis tout à coup il l’interrompit en s’écriant :
— Assez ! assez ! il n’est plus temps, tout est fini, j’ai signé !
Piquillo poussa un cri de douleur.
— Signé !.. signé !.. répéta-t-il comme anéanti. Votre Majesté a signé ?
— Oui, oui… j’étais hors de moi… j’étais furieux, et tu n’étais pas là.
Il lui raconta alors ce qui s’était passé, et en voyant le profond désespoir et la morne douleur d’Alliaga, il s’arrêta lui-même et se prit à regarder avec épouvante et remords l’acte coupable arraché à sa faiblesse.
— N’y a-t-il donc point un moyen de révoquer un pareil édit ? s’écria Alliaga.
— Et comment ? répondit le roi ; c’était en présence du légat, qui déjà en a prévenu la cour de Rome… Déjà sans doute il est publié en Espagne ; et peut-être même, dit-il à voix basse, a-t-on commencé à l’exécuter.
En ce moment on vint annoncer à Alliaga qu’on le demandait. Il sortit un instant et vint redire au roi que Fernand d’Albayda et les principaux barons du royaume de Valence, redoutant le coup fatal dont on les menaçait, s’étaient rendus à Madrid et de là à Valladolid, pour supplier Sa Majesté de ne point réduire d’anciens chrétiens et de fidèles sujets du roi au désespoir et à la misère, en leur enlevant les bras qui faisaient valoir leurs champs, les ouvriers qui exploitaient leurs manufactures.
— Il sont là, poursuivit Alliaga ; ne pouvant arriver jusqu’à Votre Majesté, c’est à moi qu’ils se sont adressés. Ils ignorent encore que l’arrêt est porté. Voulez-vous les recevoir ?
— Que leur dirais-je ! s’écria le roi avec désespoir ; le mal est irréparable.
— Peut-être, dit Alliaga ; et s’il y avait moyen d’adoucir leurs maux et de les rendre moins cruels, Votre Majesté n’y serait-elle pas disposée ?
— Qu’ils entrent, qu’ils entrent ! s’écria le roi.
Nous n’essaierons point de dépeindre la désolation de tous ces nobles seigneurs, qui aimaient leurs vassaux, et qui tenaient encore plus à eux qu’à leurs richesses. L’histoire a conservé le souvenir des démarches ardentes qu’ils firent en faveur des Maures, du dévouement paternel et des soins généreux qu’ils leur prodiguèrent jusqu’au dernier moment. L’histoire a même gardé les noms de ces nobles Espagnols, dont l’humanité exceptionnelle défendit l’honneur du pays et protesta hautement contre les cruautés de l’inquisition, de Ribeira et du duc de Lerma.
C’étaient Fernand d’Albayda, le duc de Gandia, dont l’immense fortune était entièrement détruite par l’expulsion des Maures ; c’étaient les comtes d’Allagnas, de Bunol, d’Anna, de Sinarcas, et le duc de Magneda[30].
Lorsqu’ils furent en présence du roi, Piquillo, pour défendre l’honneur de son souverain, déclara que le roi d’Espagne, obligé, dans l’intérêt de la foi, à une mesure dont lui-même déplorait la rigueur, ne demandait pas mieux que de chercher les moyens de l’adoucir.
Alliaga proposa alors, pour que les campagnes et les travaux ne fussent pas en même temps et complétement abandonnés, qu’il fût permis à une certaine partie de la population proscrite de rester en Espagne ; que l’on choisit dix familles sur cent pour enseigner aux chrétiens les procédés que les Maures avaient portés à un si haut degré de perfection, la culture des mûriers, les manufactures de soieries, le raffinage des sucres, la conservation des magasins à riz, l’entretien des canaux et des aqueducs, et tous les arts enfin dont eux seuls étaient alors possesseurs.
Les barons de Valence, Fernand et le roi lui-même, avaient trop d’intérêt à ce que certaines personnes ne fussent pas exilées et restassent en Espagne, pour que cette mesure ne fût pas adoptée sur-le-champ.
Fernand d’Albayda, nous n’avons pas besoin de le dire, avait revu à Valence la duchesse de Santarem ; il avait appris par elle les scènes que nous avons décrites plus haut, et heureux de l’idée qu’Aïxa et Yézid lui seraient conservés, il repartit le soir même pour Valence.
Dans l’égoïsme naturel aux amants, le plus grand de tous les malheurs, pour lui, était la perte ou l’éloignement de celle qu’il aimait. Rassuré sur ce point, le reste n’était plus rien, et tout en franchissant la distance, il se répétait en lui-même : Maintenant pour moi, plus de craintes, plus d’obstacle ; Aïxa ne peut plus m’empêcher de lui offrir ma main et ma fortune… Le malheur même dont les siens sont menacés va, grâce au ciel, me donner le droit de la défendre et de la protéger.
LXIV.
l’embarquement.
Ainsi que nous l’avons dit, le grand inquisiteur et Ribeira n’avaient point perdu de temps pour la publication de l’ordonnance. Le jour même où l’édit venait d’être signé, il avait été expédié et répandu dans toute l’Espagne, et quand la nouvelle en arriva à Valence, toutes les mesures étaient déjà prises depuis longtemps pour son exécution.
On avait ordonné secrètement à tous les commandants des forces navales, dans tous les ports d’Espagne, de Portugal et d’Italie, de recevoir à bord de leurs vaisseaux un certain nombre de troupes, et de se rendre tous à la même époque à Alicante, à Denia et dans tous les ports situés sur la côte du royaume de Valence.
En même temps, don Augustin Mexia, homme dur et inflexible, officier d’une grande expérience, et gouverneur de la ville d’Anvers, se rendit à Valence auprès du vice-roi, le marquis de Cazerena, neveu du duc de Lerma, pour s’entendre avec lui, et prendre, en cas de révolte, les mesures nécessaires.
Toutes les forces dont nous venons de parler étaient arrivées depuis une semaine environ en vue de Valence ; et le matin même du jour où l’ordonnance devait se publier, les troupes de débarquement et les régiments venus de Castille et de l’Andalousie entrèrent en même temps dans la ville.
D’Albérique Delascar, qui était à Grenade, avait reçu un exprès envoyé par Piquillo. Celui-ci lui racontait son entrevue avec le duc de Lerma, et le vieillard épouvanté, comprenant qu’il n’y avait ni foi ni honneur chez leurs ennemis, s’était hâté de revenir à Valence, où régnaient déjà la consternation et le deuil. Les boutiques et les croisées étaient closes, et tous les travaux abandonnés. Des groupes se formaient dans les rues ; des ouvriers aux mains noircies, des laboureurs aux fronts basanés, regardaient le ciel avec indignation, et semblaient lui demander la justice et l’appui que la terre leur refusait. Des femmes et des enfants pleuraient ensemble, et les soldats, chargés de dissiper les rassemblements, les dispersaient le sabre à la main, ou les foulaient sous les pieds des chevaux.
— Nous n’avons plus de patrie ! s’écriait cette multitude éplorée ; nous n’avons plus d’asile ! on nous bannit de la terre que nous avons cultivée et enrichie ; on ne nous laisse rien, pas même le fruit de nos travaux ! C’est là la reconnaissance et la justice des chrétiens !
Telle était la situation de la ville, lorsque d’Albérique entra dans le vaste et somptueux hôtel qu’il habitait vis-à-vis du gouverneur.
Yézid et Aïxa vinrent au-devant du vieillard. La douleur était empreinte sur leurs traits. Les principaux chefs des familles maures s’étaient déjà réunis chez celui qu’ils regardaient comme leur protecteur et leur père. À chaque instant la foule augmentait, et quand Delascar parut, tous étendirent les bras vers lui. Les femmes se mettaient à genoux et lui présentaient leurs enfants en lui disant : Sauvez-les !
— Mes frères, mes frères, s’écriait le vieillard, si notre malheur est grand, que notre courage soit plus grand encore !
— Comment nous soustraire à ce désastre ?
— Je l’ignore ; mais je viens le partager.
Ces mots, et plus encore la vue du vieillard, avaient ramené un peu de calme dans l’assemblée.
— Partons ! s’écriaient les principaux chefs ; ne demandons à nos ennemis ni grâce ni délai ! Emportons avec nous la prospérité qu’ils nous devaient ! que ce soit là notre vengeance !
Mais à cette idée les femmes s’abandonnaient au désespoir et versaient des torrents de larmes en pensant à tous les maux qui les menaçaient dans l’exil et dans la traversée.
Non-seulement il fallait renoncer aux riches et belles campagnes de Valence et dire un éternel adieu à leur pays natal, mais elles ignoraient ce qu’on voulait faire d’elles ; elles tremblaient d’être égorgées, elles et leurs enfants, dès qu’elles seraient à bord des vaisseaux préparés pour les transporter en pays étranger.
— Oui, s’écria Yézid, on doit s’attendre à tout de la part des chrétiens, et mieux vaut courir aux armes que de livrer entre leurs mains ce que nous avons de plus cher ; mieux vaut mourir comme des hommes, en combattant pour nos biens et nos familles, que de nous laisser lâchement dépouiller du fruit de nos travaux, ou égorger sans défense. Il est encore dans l’Espagne des montagnes et des rochers, remparts de la liberté, où nous pourrons, comme nos ancêtres, résister à la tyrannie. Les sommets des Alpujarras et les gorges de l’Albarracin vous diront comment on peut vivre et mourir indépendants ; et ces montagnes, arrosées de notre sang, comme les champs de Valence l’ont été de nos sueurs, produiront quelque jour peut-être des frères et des vengeurs.
— Oui ! oui ! aux armes ! crièrent tous les jeunes gens.
— Hélas ! s’écria d’Albérique en réclamant de la main le silence, vous voulez courir aux armes, et vous n’en avez même pas ! Surpris à l’improviste, sans soldats, sans munitions, comment lutter contre les troupes nombreuses et aguerries qui nous entourent ? Qu’opposerez-vous à leurs cuirasses et à leur artillerie ? Pauvres ouvriers, bons laboureurs, vous n’avez que le fer de vos outils ou le soc de vos charrues ; habitués au travail, et non au combat, ignorant la tactique et la discipline militaires, comment résisterez-vous à ces vieilles bandes espagnoles, déjà répandues dans tout le royaume sous le commandement d’officiers expérimentés ? Craignez plutôt, par votre courage imprudent, de fournir aux Espagnols ce qu’ils n’ont pu trouver jusqu’ici, un prétexte pour justifier leur cruauté. Ne légitimez pas leur fureur, et ne diminuez pas leur infamie. Que leur honte reste pleine et entière aux yeux de l’Europe ! Partons… allons demander asile à nos frères les enfants d’Ismaël ; nous trouverons chez ceux de notre croyance appui et protection. Pauvres et sans biens, il faudra, il est vrai, recommencer nos labeurs ; mais le travail et la peine en Afrique valent mieux que l’esclavage en Espagne !
— Il a raison ! s’écrièrent les vieillards.
— Quant à vos craintes, continua Albérique en s’adressant aux femmes, pourquoi Philippe aurait-il rassemblé tous ces vaisseaux sur nos côtes ? pourquoi tous ces préparatifs immenses, s’il avait la pensée de nous faire périr dans la traversée. N’a-t-il pas d’autres moyens d’exécuter, à moins de frais, un si exécrable dessein ? Ne nous tient-il pas ici en son pouvoir ? Et s’il veut donner l’ordre de nous égorger tous, manquera-t-il de bras pour exécuter le crime, d’archevêques pour le bénir et de pape pour le justifier ? Non ! il ne voudrait point, par une trahison si dispendieuse et si inutile, ajouter à la honte qu’il vient d’acquérir et qui suffit à l’opprobre de tout un règne ; de plus ambitieux encore s’en contenteraient ; ne craignez donc rien et partons.
— Partons donc, dirent-ils, partons tous !
— Non, pas tous ! s’écrièrent plusieurs étrangers qui arrivaient en ce moment et qui se précipitèrent dans la salle.
C’étaient Fernand d’Albayda et les barons de Valence. Fernand, au milieu de cette foule compacte, avait du premier coup d’œil distingué et reconnu Aïxa, et ses yeux rayonnants de joie lui avaient déjà dit : Rassurez-vous, je viens vous protéger.
— Oui, mes amis, s’écria-t-il en se retournant vers l’assemblée, nous aurions voulu vous sauver tous, mais nos efforts ont été inutiles, et nous avons du moins tenté d’arracher une partie de vous à l’exil qui les menaçait. Oui, noble et généreux Albérique, continua-t-il, vous et les vôtres, et vous aussi, principaux chefs de cette assemblée, vous conserverez votre patrie et vos richesses, et vous pourrez de loin encore protéger et secourir vos frères.
Il leur expliqua alors que dix familles sur cent resteraient en Espagne ; que le roi y consentait ; que c’était la seule faveur qu’ils eussent pu obtenir, et qu’ils venaient leur apporter dans leur malheur cette dernière consolation.
Des cris de joie et des bénédictions accueillirent don Fernand.
Mais bientôt tous les membres de l’assemblée, s’interrogeant du regard avec inquiétude, semblaient se demander : Qui de nous jouira de cet avantage ? qui sera assez heureux pour être choisi ?
Alors ils se tournèrent tous vers Albérique, Yézid et Aïxa, et leur dirent : Vous qui êtes de la famille de nos rois, et nos vrais souverains ; vous, les derniers des Abencerages, restez, restez dans notre patrie pour nous en rouvrir un jour les chemins ; mais désignez vous-mêmes ceux qui doivent demeurer avec vous.
— Oui, oui, choisissez, cria toute l’assemblée, nous nous en rapportons à vous !
Albérique se leva, et le plus profond silence succéda au tumulte.
— Mes frères, s’écria-t-il, je remercie d’abord en votre nom et au mien don Fernand d’Albayda et les nobles barons, nos généreux protecteurs, qui ont cherché à adoucir nos maux et à alléger nos misères. Ce qui m’étonne, c’est qu’ils aient pu obtenir une pareille concession ; ce qui m’effraie, c’est que le roi l’ait accordée, c’est que l’inquisition ne l’ait pas encore fait révoquer. Il faut, alors, qu’une pareille clémence cache un piége. C’est pour eux et non pour nous ; c’est dans leur intérêt et non dans le nôtre qu’ils se sont faits miséricordieux. S’ils nous retiennent, c’est qu’ils ont besoin encore des bras et de l’industrie du Maure pour diriger et instruire les chrétiens ; et cela seul suffirait pour nous faire rejeter la grâce qu’ils nous offrent, si d’autres motifs plus impérieux encore, ne nous ordonnaient de la repousser. Qui de nous voudra séparer son sort de celui de ses frères ? qui voudrait rester dans des contrées d’où ils sont bannis, et conserver une patrie quand ils n’en ont plus ? Quant à moi, la mienne sera désormais où vous serez ! je pars avec vous.
À ces mots, un cri d’admiration retentit dans l’assemblée.
— Oui, continua le vieillard en tendant la main à Yézid et en posant l’autre sur l’épaule d’Aïxa, mes enfants ne me désavoueront pas.
— Oui, mon père, s’écria la jeune fille, nous vous suivrons.
— Nous vous suivrons tous ! répéta l’assemblée.
— Partons donc ! s’écria-t-on tout d’une voix. Fernand jeta un regard de désespoir sur Aïxa, et celle-ci, les yeux pleins de larmes, lui montra le ciel et son père.
Bientôt la résolution des Maures se répandit dans toute la province de Valence, dans celle de Grenade et dans toute l’Espagne. Les Maures de l’Aragon, des deux Castilles et de la Catalogne abandonnèrent, d’un commun accord, leurs champs et leurs foyers, et se rendirent au rivage pour s’embarquer avec leurs frères et pour vivre et mourir avec eux. Quant à l’article de l’édit qui permettait de laisser en Espagne les enfants au-dessous de quatre ans, pas une mère ne voulut en profiter : quel que fût le sort qui les attendît sur des bords inconnus, quels que fussent les dangers de la traversée, et l’air contagieux des vaisseaux, elles préféraient voir périr leurs enfants sous leurs yeux que de les livrer aux chrétiens et de les abandonner à des dieux qui conseillaient des actes aussi barbares.
On vit donc accourir sur les côtes et dans les ports de l’Espagne toute la population mauresque du royaume. Les vaisseaux préparés par les ministres de Philippe devinrent insuffisants, et dans beaucoup d’endroits, on manqua des moyens de transport.
Profitant de ce prétexte, Fernand d’Albayda et les barons de Valence essayèrent de retarder de quelques jours l’exécution de l’édit ; mais le vice-roi Cazarena et surtout l’archevêque Ribeira se montrèrent impitoyables ; tout ce que Fernand et ses amis purent obtenir par leurs pressantes sollicitations fut, qu’il serait permis aux Maures qui le pourraient, de fréter des bâtiments pour eux et leur famille. Pedralvi fut chargé de ce soin par Yézid, et il s’entendit avec un capitaine napolitain, Giampietri, qui, plus d’une fois avait transporté dans sa tartane, pour le compte de la maison d’Albérique, des marchandises de Cadix à Naples et à Marseille. Par malheur, il ne savait comment former son équipage.
Les marins étaient si rares que le capitaine Giampietri craignait de ne pas en trouver, lorsque, le soir, sur le port, à la posada de la Sirène, rendez-vous ordinaire des matelots, une espèce de contrebandier, au teint basané, aux épaules larges et carrées, lui dit :
— Combien vous faut-il d’hommes pour faire manœuvrer votre tartane ?
— Douze, au moins.
— Vous en aurez quinze.
— Où les trouverez-vous ?
— Cela me regarde.
— Il n’y a plus de matelots.
— J’en ferai, s’il le faut ; il ne s’agit que de les payer. Que leur donnez-vous ?
— Vingt piastres à chacun pour aller d’ici à Alger.
— C’est bien. On nous paiera comptant ?
— Soyez tranquille : ma tartane est frétée pour le compte de la famille Delascar d’Albérique.
À ce nom, les yeux du matelot brillèrent d’une joie sinistre.
— Le Maure Delascar ! s’écria-t-il vivement.
— Lui-même.
— C’est différent ; nous ne demandons point de garantie, et au lieu de vingt piastres, nous nous contenterons de la moitié.
— Ah ! dit le capitaine Giampietri avec émotion, je comprends ; vous le connaissez, vous avez fait comme moi des affaires avec d’Albérique ou avec les siens, et vous avez envers eux quelques dettes de reconnaissance à acquitter ?
— Oui, dit le matelot avec un sourire équivoque, nous avons des comptes à régler ensemble.
— Qu’à cela ne tienne, reprit Giampietri, je vais en parler, dès ce soir, à son fils Yézid.
— Non, non… dit le matelot en le retenant, nous réglerons cela à bord. Marché conclu.
— Touchez là !
Tous deux se donnèrent la main et se séparèrent.
Fernand cependant avait couru chez Aïxa.
— Ah ! lui dit celle-ci avec tristesse, vous venez me faire vos adieux.
— Moi, senora, au contraire !
— Que voulez-vous dire ?
— Que je ne vous quitte plus ! Vous partez, je pars.
— Fernand, lui dit-elle avec émotion, votre rang, vos titres, le nom même que vous portez, tout vous retient en Espagne. Abandonner pour moi votre patrie et la terre où reposent vos aïeux, ce serait mal… je ne consentirai pas à un pareil sacrifice !
— Vous perdre, n’en serait-il pas un plus grand encore ?
— Et puis, continua la jeune fille avec crainte et en même temps avec amour et reconnaissance, oser suivre une exilée, une proscrite, une Maure, n’est-ce pas vous exposer vous-même à voir aussi vos biens confisqués et vos jours proscrits.
— Peu m’importe, si vous m’aimez !
Cette demande parut sans doute inutile à Aïxa, car elle n’y répondit pas, et continua en baissant la tête :
— Mais, chrétien, mais sujet du roi Philippe et soldat de l’Espagne, n’avez-vous pas des serments et des devoirs à remplir ? vous est-il permis d’y manquer, sans entacher votre honneur de Castillan et de gentilhomme ?
— Écoutez, lui répondit froidement le jeune homme, j’ai pensé à tout ce que vous me dites là ; mais il y a un mot qui a renversé tous mes calculs et mes raisonnements, ce mot, Aïxa, c’est que je vous aime ! non pas que j’entende faire bon marché de mon nom ni de mon honneur ; tous deux vous appartiennent et je dois les défendre, ne fût-ce que pour avoir le droit de vous les offrir purs et intacts. Aussi, croyez-le bien, si l’Espagne était en guerre, si le roi avait besoin de mon bras, si, comme officier, il m’appelait sous ses drapeaux, je ne songerais même pas à résigner mon grade et mes emplois ; ce serait, comme vous le dites, entacher mon blason, ce serait donner à la noblesse de Valence et à la grandesse de Castille le droit de m’appeler lâche, et je crois que j’aimerais mieux mourir que de subir un tel affront ; mais, grâce au ciel, le roi Philippe est, en ce moment, en paix avec toute l’Europe ; je puis envoyer ma démission d’officier de ses armées et lui demander la permission de quitter l’Espagne. Alors…
— Alors ? dit Aixa en tressaillant.
— Je vous suivrai sur la terre étrangère ; le pays où vous vivrez sera ma patrie, et votre sort sera le mien.
Aïxa attendrie lui tendit la main.
— En attendant, poursuivit Fernand, vous ne vous exposerez pas sans moi aux dangers de la traversée ; je pars demain avec vous.
— Non, Fernand, dit Aïxa en baissant les yeux, cela ne se peut pas.
— Qui m’en empêcherait ? Duchesse de Santarem, aux jours de votre prospérité, vous m’avez donné votre amour ; vous n’avez plus droit de le retirer quand vous êtes proscrite et malheureuse, car votre malheur m’appartient, et je le réclame ainsi que votre amour, ainsi que vous-même. Oui, continua-t-il avec chaleur, vous ne pouvez refuser ma main, vous devez l’accepter !
— Je ne puis cependant pas.
Fernand la regarda de désespoir.
— Pas encore, se hâta d’ajouter Aïxa.
— Et pourquoi ?
— Parce que… pour ce mariage, dit-elle avec quelque hésitation, il faut encore obtenir un autre consentement que le mien.
— Celui de votre père.
— Non, il le donnera.
— Vous lui en avez donc parlé ?
— Oui, dit la jeune fille en rougissant, à lui, à lui seul ! Mais il est un autre aveu aussi nécessaire, aussi sacré que le sien.
— Et lequel ?
— Celui de Carmen, votre fiancée.
— Elle s’est consacrée à Dieu, elle a renoncé au monde, elle m’a dégagé de ma foi.
— Mais elle ne m’a pas dégagée de ma foi, moi ! s’écria Aïxa, moi qui suis sa sœur et son amie. Elle ne m’a pas donné le droit de lui enlever son fiancé, celui qu’elle a aimé ; et tant qu’elle n’aura pas elle-même permis et approuvé cette union, je la regarderai comme une trahison envers don Juan d’Aguilar et sa fille.
Elle tendit une main au jeune homme, qui semblait consterné.
— Vous devez me comprendre, Fernand.
— Oui, oui, répondit celui-ci en baissant la tête.
— Eh bien, an lieu de quitter l’Espagne et de me suivre, ce que je vous défends, vous partirez demain pour Pampelune ; vous irez au couvent des Annonciades trouver Carmen, dont l’année de noviciat doit être près d’expirer, et vous lui direz… toute la vérité.
— Je lui dirai donc que je vous aime et que vous me l’avez permis.
— Non… c’est elle, au contraire, qui vous en donnera la permission.
— Et si elle me l’accorde…
— Vous viendrez me demander ma réponse… à moi…
— Où cela ?
— Sur la terre étrangère où je vous attendrai.
À cet espoir, à ces doux rêves d’avenir qui leur faisaient oublier le présent, les deux amants sentirent leur courage renaître. Eux seuls échappaient à l’exil ; ce n’était plus être bannis que de l’être ensemble… C’était le temps seul de la séparation qui désolait Fernand. Les journées allaient lui paraître si longues !
— Hâtez donc le départ, lui dit-elle, pour hâter le retour !
Fernand éperdu la pressa contre son cœur,
— Partez, lui dit-elle ; obéissez à votre devoir, et moi au mien. Encore quelques jours d’absence, et puis réunis pour toujours.
Le délai fatal était expiré ; l’édit allait être exécuté. Le quatrième jour, de grand matin, toutes les cloches des églises sonnaient à pleine volée, l’encens fumait dans les temples chrétiens ; l’archevêque de Valence, revêtu de ses plus riches habits pontificaux, entonnait dans la cathédrale un Te Deum solennel, et rendait grâce au ciel de la richesse de la population et de la prospérité de l’Espagne, détruites par ses soins.
En ce moment s’accomplissait cet acte immense, impolitique, cruel, qui causa dans toute l’Europe un frémissement d’horreur ; cet acte que Richelieu lui-même appelle « le plus hardi et le plus barbare conseil dont l’histoire de tous les siècles précédents fasse mention[31]. »
On voyait arriver des familles entières, de longues files de femmes, de vieillards et d’enfants, abandonnant leurs richesses et leurs foyers ; tous, les yeux pleins de larmes et le désespoir dans le cœur, saluaient d’un dernier adieu le beau ciel et les champs de Valence, où ils étaient nés, où ils avaient espéré mourir. Bientôt une foule immense et compacte s’entassa sur le rivage. Plus de cent cinquante mille Maures venant du royaume de Valence étaient rassemblés seulement sur ce point ; à droite et à gauche du rivage, les régiments de Castille étaient sous les armes, et une nombreuse artillerie, à laquelle aurait répondu celle des vaisseaux, était prête à foudroyer cette foule inoffensive, au premier mouvement de résistance vu au premier cri de révolte. On n’entendit rien que des pleurs et les sanglots des mères qui pressaient leurs enfants contre leur sein.
Un historien espagnol contemporain fait un portrait sublime de la jeunesse et de la beauté des femmes maures, se réjouissant, dans l’excès de leur fanatisme, des mauvais traitements auxquels elles étaient en proie. De farouches soldats les arrachaient du rivage et les poussaient vers les embarcations, qui presque toutes étaient des bâtiments de guerre et non de transport, et mal disposés pour cet usage ; des vieillards, des femmes et des enfants étaient entassés par milliers dans l’entre-pont des vaisseaux, au risque d’être suffoqués par le manque d’air, Toute réclamation était repoussée, toute plainte était punie. Le frère ou le mari qui osait défendre les siens ou menacer un soldat était sur-le-champ jeté à la mer. Cependant, et pour l’honneur du nom espagnol, hâtons-nous de dire que bien des cœurs généreux désavouèrent et flétrirent ces cruautés ; que jusqu’au dernier moment les barons de Valence prodiguèrent leurs consolations et leurs soins à leurs vassaux persécutés. L’édit leur abandonnait une partie des biens de ces malheureux ; loin d’user de ce droit barbare, ils permirent aux Maures, non seulement d’emporter avec eux leurs trésors, mais tous les effets qu’ils pourraient convertir en argent, et de transporter à bord des bâtiments équipés par eux leurs meubles les plus précieux et leurs manufactures. Non contents de cet acte de bonté, ou plutôt de justice, presque tous les barons accompagnèrent leurs infortunés vassaux jusqu’au rivage[32]. On se doute bien que Fernand était à leur tête.
Aïxa cependant guidait les pas de son père, qui s’appuyait sur elle, et ses regards bienveillants, sa voix consolante, ranimaient le courage de ses jeunes compagnes et de ses serviteurs. Arrivés au rivage, où le capitaine Giampietri et son équipage les attendaient, ils regardèrent autour d’eux et furent surpris de ne pas voir Yézid.
— Mon fils !.. mon fils !.. dit le vieillard, où est-il ?
Pedralvi s’avança et lui dit à demi-voix :
— Ne le demandez pas, maître, ces chrétiens pourraient vous entendre.
Puis, faisant quelques pas en avant et se trouvant seul avec le vieillard et Aïxa, il leur dit :
— Cette nuit, Yézid a reçu un message de la sierra de l’Albarracin. Tous les Maures de la montagne y sont rassemblés. Ils n’ont pas voulu fuir, ils restent ; ils prétendent que, retranchés dans ces défilés et ces rochers, ils peuvent défier leurs persécuteurs et venger leurs frères ; ils ont écrit à Yézid : « Nous sommes vingt mille, mais il nous faut un chef. Nous t’attendons. »
— Il est parti ! dit le vieillard en tressaillant.
— Il a bien fait, mon père ! s’écria Aïxa ; que Dieu le guide et le protége !
— Je voulais l’accompagner, continua Pedralvi ; mais il m’a fait promettre que je vous conduirais jusqu’en Afrique, vous, mon maître, la senora Aïxa et Juanita, et puis après je reviendrai.
— Toi ?
— Oui, dès que vous serez en sûreté, je reviendrai près de Yézid pour me battre à ses côtés, et qui sait ? pour le sauver, peut-être !
D’Albérique et Aïxa pressèrent dans leurs mains celles du fidèle serviteur, puis le vieillard essuyant une larme, la dernière qu’il devait verser sur le sol d’Espagne, leva les yeux au ciel et s’écria :
— Que la volonté d’Allah soit faite !
— Allah ! Allah ! répétèrent ses serviteurs en s’élançant avec lui sur le vaisseau, qui, à l’instant même, déploya ses voiles.
Debout sur le pont du navire et agitant son écharpe légère, Aïxa, tant qu’elle put l’apercevoir, salua de loin Fernand d’Albayda, qui, immobile sur le rivage, contemplait, les yeux pleins de larmes, le vaisseau qui emportait son bonheur. Longtemps le lourd bâtiment resta en vue, puis, peu à peu, on le vit blanchir, décroître et disparaître.
Toute l’escadre s’était mise en mouvement. Ce rivage tout à l’heure si peuplé, si animé, était maintenant désert et aride… Triste coup d’œil ! sinistre emblème ! image de l’avenir de l’Espagne !
Pour obéir aux volontés de sa bien-aimée, Fernand quitta le jour même Valence afin de se rendre à Pampelune ; mais arrivé à Cuença, au moment où il se disposait à franchir l’Albarracin, il fut rejoint par un courrier venant de Madrid et porteur pour lui de dépêches du roi et du mimistre.
Que devint-il en les lisant !
On lui donnait un commandement de trois régiments destinés à réduire les Maures, qui, sous les ordres de Yézid, venaient de se révolter dans la sierra de l’Albarracin.
LXV.
la compagnie de jésus.
Le roi, après avoir reçu la visite des barons de Valence, était revenu à Madrid avec Piquillo, dont il ne pouvait plus se passer. Chaque jour le crédit du jeune confesseur s’augmentait par un double motif. Le premier, c’est qu’il ne parlait presque jamais au roi d’affaires politiques, et le second, c’est que le roi pouvait toute la journée lui parler d’Aïxa.
Un grand changement s’était opéré dans Piquillo ; jusqu’alors sans ambition, il en avait une maintenant, c’était de réparer les désastres du fatal édit qu’il n’avait pu empêcher. Il comprenait que le retour de ses frères dépendrait de son crédit et de sa puissance ; c’était donc pour eux et non pour lui qu’il fallait en acquérir.
Rendre à son roi le repos, à l’Espagne sa prospérité, aux Maures leur patrie, telle fut désormais l’unique pensée de sa vie. Jamais ambitieux ne conçut un plus noble et plus généreux complot.
Quant au roi, il ne rêvait qu’à la seule Aïxa. Il était persuadé qu’elle ne quitterait point l’Espagne ; il venait d’accorder aux principales familles maures la permission de rester dans le royaume, et nul doute que la famille d’Albérique ne profitât la première de ce privilége. Ce qui inquiétait seulement Philippe, c’était le moyen de rappeler de Valence la duchesse de Santarem et de la faire revenir à Madrid ; c’était, pendant le retour de Valladolid à Buen-Retiro, la seule question dont se préoccupât le roi. Il avait voulu que Piquillo montât près de lui dans sa voiture de voyage, et chacun d’eux, plongé dans ses réflexions, gardait depuis longtemps un profond silence, lorsque le roi, sortant de sa rêverie, demanda brusquement à son confesseur :
— Croyez-vous, mon père, qu’Aïxa aime quelqu’un ?
Piquillo, étonné, leva la tête et répondit vivement :
— Non, sire, personne !
— On m’a cependant assuré le contraire.
— On a trompé Votre Majesté.
— Ah ! dit le roi avec un sentiment de satisfaction, vous croyez qu’on m’a trompé ? On m’avait parlé de Fernand d’Albayda.
— C’est une indigne fausseté ! s’écria Alliaga avec conviction ; et cependant, à ce nom, à cette idée qui jamais ne lui était venue, il se sentit saisi d’un froid mortel.
— Vous en êtes bien sûr, mon père ?
— Oui, sire ; le prétendu amour ressemble au prétendu mariage dont on a parlé à Votre Majesté ; je l’atteste et je le prouverai.
— Comment cela ?
— Par un seul mot : c’est qu’Aïxa, ma sœur, qui 
Delascar se précipita au-devant de sa fille, l’entoura de ses bras.
me dit tout, qui me confie ses plus secrètes pensées,
qui m’a avoué même l’amour de Votre Majesté et le
dessein où elle était d’attenter à ses jours, Aïxa ne
m’a jamais parlé de don Fernand d’Albayda, à moi,
son frère !
— C’est juste, c’est une preuve. Et cependant, le jour où je la pressais de céder à mes désirs, elle n’a pas nié, elle m’a presque avoué, à moi, le roi, qu’elle avait au fond du cœur un sentiment, une affection cachée.
— En vérité ! s’écria Piquillo en pâlissant ; c’est qu’alors elle espérait par ce mensonge se soustraire aux vœux de Votre Majesté, car pour elle l’honneur est le premier des biens ; elle l’estime plus que la vie et le place au-dessus de tout, au-dessus même de l’amour d’un roi.
— C’est vrai ! c’est vrai ! dit le monarque avec joie, je n’avais jamais pensé à ce que vous me dites là, mon père.
Il serra affectueusement les mains de son compagnon de voyage et se replongea dans ses réflexions, qui, cette fois, devaient être d’une nature agréable, à en juger par la physionomie gracieuse du monarque.
Celle de Piquillo, au contraire, s’était rembrunie et assombrie. Ce qu’il avait attesté tout à l’heure être une insigne fausseté ne lui paraissait plus aussi impossible. Cependant le silence d’Aïxa eût été, selon lui, une telle trahison, qu’il ne pouvait y croire, et décidément il n’ajoutait aucune confiance à cette idée.
Il se le disait, il se le répétait, et malgré lui son cœur battait avec violence, sa tête était en feu, et la vive affection qu’il avait portée jusqu’alors à don Fernand venait, tout à coup et sans qu’il s’en aperçût, de se changer en indifférence, pour ne pas dire plus.
Un brusque mouvement du roi le tira encore une fois de sa rêverie.
— Mon père, est-il permis à un chrétien d’épouser une Maure ?
— Cela vaut mieux que de la déshonorer ! répondit brusquement Alliaga.
— Ce n’est pas là, mon père, ce que je vous demande ; croyez-vous, par de bonnes œuvres ou par des dons pieux, racheter un pareil péché, ou bien y a-t-il, ipso facto, comme disait le frère Gaspard de Cordova, damnation éternelle, sans rémission… le croyez-vous ?
— Non, sire, je ne le crois pas !
— Est-il possible ! s’écria le roi avec joie, Dieu n’en serait pas offensé ?
— Les hommes le seraient sans doute, répondit Alliaga ; mais non pas Dieu.
— Dieu pardonnerait ! dit le roi, tout tremblant d’émotion.
— Je vous l’atteste, sire.
— Et si celui qui veut épouser une Maure… était un roi ?
— Il n’y aurait aucune différence.
— En vérité !
— Ce serait exactement la même chose aux yeux du ciel.
— Ainsi, vous ne craindriez pas, mon père, de me donner l’absolution d’un pareil péché ?
— À l’instant même.
— Et vous en prendriez sur vous toute la responsabilité ?
— Sans hésiter ! Aux yeux de Dieu, sire, de Dieu seulement !
— C’est là l’important.
— Mais pour ce qui regarde vos sujets, je ne répondrais de rien.
— Cependant, dit le roi, si par cette union une hérétique devenait chrétienne, si elle était baptisée ! ce serait là un triomphe de la foi ; ce serait une âme sauvée, et Rome elle-même, au lieu de blâme, me devrait des louanges.
— Mais la personne dont vous parlez consentirait-elle, même pour une couronne, à changer de croyance ?
— Ce serait à vous, alors, mon père, à la décider.
— À moi, sire !
— Qui pourrait y parvenir si ce n’est vous, Alliaga, dont l’influence et le zèle…
— Jamais, sire, jamais ! s’écria Piquillo avec un sentiment de colère qu’il ne pouvait maîtriser.
— Et pourquoi ?
— Pourquoi, sire ? parce qu’on m’accuserait d’avoir employé à mon élévation et à celle de ma sœur la position que j’occupe auprès de Votre Majesté et la confiance dont elle m’honore.
— Vains scrupules ! dit le roi ; nous y reviendrons ; nous en parlerons plus tard.
Le roi se remit de nouveau à rêver, et son compagnon en fit autant. Honteux du mouvement de dépit qu’il avait éprouvé d’abord, il chercha avec force et courage à éloigner les idées qui malgré lui revenaient toujours l’assaillir, et lorsque enfin il y fut parvenu, lorsque, maître de son trouble, il lui fut possible d’envisager avec sang-froid l’étrange et inconcevable proposition qu’on venait de lui faire, il commença à comprendre que jamais la fortune ne lui offrirait pour d’Albérique et les siens d’occasion plus honorable et plus belle d’exécuter ses desseins. Ces Maures qu’on voulait abattre se relevaient plus glorieux que jamais. C’était assurer non-seulement leur retour, mais une alliance éternelle entre la race des vainqueurs et celle des vaincus, et ce caprice inouï de l’amour pouvait être justifié jusqu’à un certain point, par les raisonnements d’une saine et généreuse politique.
Restait à savoir si la duchesse de Santarem approuverait un pareil projet ; mais si, pour sauver son père et ses frères, elle n’avait pas reculé devant le sacrifice de son honneur et de ses jours, pouvait-elle refuser leur salut qu’on lui offrait de nouveau, non pas cette fois au prix de l’infamie, mais au prix d’un trône ? Quels que fussent ses sentiments secrets, elle ne devait pas hésiter, et quant à Piquillo, tout en sentant gronder encore au fond de son cœur un reste de colère contre ce mariage, il lui semblait qu’il serait moins malheureux de voir Aïxa reine malgré elle, que marquise d’Albayda de son plein gré.
Le roi et son confesseur étaient encore préoccupés de ces idées, quand le carrosse royal entra à Madrid et s’arrêta sous le vestibule du palais de Buen-Retiro.
Dès le lendemain, le duc de Lerma, inquiet d’un si prompt retour, se hâta d’accourir. Le roi s’était renfermé et écrivait… à qui ?.. à Aïxa sans doute, et dans le salon qui précédait le cabinet de Sa Majesté, salon particulier où personne ne pénétrait, le ministre aperçut un homme assis et plongé dans une profonde rêverie.
C’était Piquillo.
Celui-ci, au bruit de la porte qui s’ouvrait, leva la tête et vit devant lui le cardinal-duc : c’était ainsi que le ministre se faisait alors appeler.
— Eh bien, seigneur Alliaga, lui dit-il avec un sourire dédaigneux, comprenez-vous maintenant qu’il eût mieux valu pour vous rester dans nos rangs et nous demeurer fidèle ? Vous vouliez empêcher cet édit et il a été obtenu, signé et publié. Vous vouliez le faire révoquer, et il a été exécuté, sans bruit, sans révolte, sans la moindre résistance. En voici la nouvelle que je reçois à l’instant. L’archevêque de Valence et le vice-roi Cazarera, mon neveu, m’envoient à ce sujet des détails dont je m’empresse de faire part à Sa Majesté.
— Monseigneur répondit froidement Alliaga, Votre Éminence l’emporte, mais si un pareil triomphe restait impuni, il n’y aurait plus de justice sur terre, et grâce au ciel, il y en a une.
— Que voulez-vous dire ? s’écria le cardinal avec hauteur.
— Que j’ai confiance en ses décrets et que je les attends. Heureux si je puis en être l’organe ou l’instrument !
— Vous ! répondit le duc en le regardant avec mépris ; vous, me renverser, frère Alliaga ! Songez donc que, même en tombant, je vous écraserais dans ma chute.
— Et moi, monseigneur, même à cette condition-là, j’accepte.
Le roi sortit en ce moment de son cabinet.
À la vue d’Alliaga, il courut à lui d’un air ouvert et joyeux ; mais apercevant le cardinal-duc, il s’arrêta, et sa figure devint sombre et sévère.
Il s’assit, Piquillo resta debout, et le duc, sans attendre l’invitation du roi, prit un fauteuil et resta couvert.
Sa nouvelle dignité lui donnait ce privilége.
Le roi fit un geste de surprise, puis se remit, et dit froidement :
— C’est juste, monsieur le cardinal, Votre Éminence est dans son droit.
Puis se retournant vers Piquillo d’un air gracieux :
— Asseyez-vous, mon frère, lui dit-il.
— Je viens, sire, dit gravement le ministre, rendre compte à Votre Majesté de l’exécution de ses ordres. Le royaume entier bénit son souverain, et de tous les côtés éclatent des transports d’amour et de reconnaissance.
Le roi pâlit, et interrompant le ministre, lui dit brusquement :
— Bien, bien, j’ai reçu à Valladolid les plaintes des barons de Valence, ils m’ont parlé de leur désespoir et de leur ruine.
— Les plaintes de quelques séditieux n’empêchent point l’ordre et la paix de régner sur tous les points du royaume.
— Je viens d’apprendre, dit froidement Piquillo, que toutes les montagnes de l’Albarracin et les campagnes environnantes sont déjà soulevées et que trente mille Maures viennent de prendre les armes.
— En vérité ! dit le roi, et vous l’ignoriez, monsieur le cardinal ?
— Je le savais, sire.
— Et vous ne m’en parliez pas !
— Pour ne point inquiéter Votre Majesté. Augustin de Mexia, l’ancien gouverneur d’Anvers, actuellement à Valence, marche contre eux avec toutes les forces que nous avions rassemblées ; il a sous ses ordres deux chefs expérimentés : Alvar de Gusman et don Fernand d’Albayda.
— Fernand ! s’écria Piquillo avec surprise.
— Il doit aujourd’hui même, d’après mes ordres, sortir de Cuença pour se diriger vers les montagnes, et bientôt les rebelles seront dissipés ou exterminés. L’important était que les ordres de Votre Majesté, que l’édit signé par elle reçût sa pleine et entière exécution. Mon frère Sandoval, le grand inquisiteur, a quitté Madrid dès hier, avant l’arrivée de Votre Majesté. Il parcourt les deux Castilles, l’Estramadure, Murcie et Grenade, et bientôt il n’y aura plus un seul Maure en Espagne. Quant à ceux de Valence, ils voguent en ce moment vers Tanger et Oran, car je puis vous annoncer avec satisfaction que tous ont été embarqués.
— Tous ? dit le roi.
— Oui, sire.
— Excepté les familles à qui nous avons donné l’autorisation de demeurer en Espagne ?
— Pardon, sire, dit le ministre en regardant Piquillo. J’ignore qui aurait pu donner au roi un semblable conseil. Ce ne pouvait être qu’un ennemi de sa gloire. C’était détruire en partie son pieux ouvrage et de plus exposer la majesté royale au mépris des infidèles.
— Qu’est-ce à dire ?
— Qu’ils ont tous dédaigné et repoussé votre clémence. Aucun d’eux n’a voulu séparer son sort de celui de ses frères.
Piquillo poussa un cri de surprise et d’admiration.
— Et Albérique ? s’écria le roi.
— Il est parti, sire.
— Et la duchesse de Santarem, sa fille ?
— Partie avec lui.
Le roi resta anéanti. Puis jetant sur son ministre un regard de colère :
— Vous allez expédier à l’instant, à l’instant même, à Valence, un courrier qui voyagera jour et nuit, et qui portera au vice-roi, au marquis de Cazarera, votre neveu, l’ordre de faire partir le meilleur voilier de notre flotte. Il rejoindra, il ramènera sur-le-champ la duchesse de Santarem. Si avant huit jours elle n’est pas de retour en Espagne, le marquis votre neveu n’est plus vice-roi de Valence.
— Mais, sire…
— Vous le ferez arrêter et conduire ici, à Madrid, où il aura à rendre compte de sa conduite.
— Il faut cependant, s’écria le duc avec colère et en regardant le jeune confesseur, il faut que j’apprenne ici aux serviteurs de Votre Majesté…
— À obéir au roi, répondit respectueusement Alliaga ; c’est ce que je ferai toujours, et c’est ce que fera Votre Éminence !
— Frère Luis a raison, reprit le roi, enchanté de voir humilier son ministre ; qu’il soit fait ainsi que je l’ai dit. Vous l’entendez, monsieur le cardinal.
Le roi sortit avec Piquillo, et laissa le duc stupéfait de cette énergie inaccoutumée. Sa Majesté ne l’avait jamais, il est vrai, que quand il s’agissait d’Aïxa.
— Le frère Luis Alliaga aurait-il raison ? se dit le ministre avec un peu de crainte.
Dans le doute, il se hâta d’obéir.
Un courrier expédié par lui partit à l’instant pour Valence, et il se rendit le soir au palais pour apprendre au roi que ses ordres étaient exécutés.
Le roi ne le reçut pas.
Le lendemain, il se présenta de nouveau, le roi était avec son confesseur et ne recevait personne. Le surlendemain, le frère Luis Alliaga partit pour une mission secrète, dont le roi ne jugea même pas à propos de prévenir son ministre. Dans la journée Escobar et le père Jérôme se rendirent chez le duc d’Uzède, et le duc d’Uzède passa la soirée entière au palais, sans que le cardinal-duc eût été appelé.
Pour le coup, le ministre commença à s’effrayer, et d’autres causes encore ajoutaient à ses inquiétudes. Depuis l’édit qui bannissait les Maures du royaume, les calomnies contre le duc de Lerma avaient redoublé avec une nouvelle force. Il était prouvé maintenant, disait-on, que c’était pour arriver à ce but que le cardinal-duc et Sandoval s’étaient défaits de la reine ; elle seule s’opposait à leurs desseins ; sa mort leur était nécessaire, et ils n’avaient point reculé devant ce crime.
Mille détails, amplifiés par la rumeur publique, venaient à l’appui de ces calomnies ; elles étaient passées à l’état de chose jugée et de faits constants. On les regardait comme tels dans les hautes classes ; mais chacun s’abstenait, par égard pour le ministre ou par prudence pour soi, d’en parler hautement.
Parmi le peuple on avait moins de politesse ou de réserve : on désignait partout le duc et, ce qui était plus hardi encore, le grand inquisiteur lui-même, comme les assassins de la reine. À Burgos et à Oviédo on avait, dans le désordre d’une fête publique, brûlé deux mannequins de paille représentant le duc de Lerma et Sandoval. La dignité de cardinal, que la cour de Rome venait d’accorder au ministre, n’avait apaisé ni ces bruits calomnieux ni l’indignation publique.
À Tolède même, dont Sandoval était archevêque, les soins du corrégidor, des alguazils et des familiers du saint-office ne pouvaient empêcher la circulation de libelles et de peintures infâmes. L’une, entre autres, représentait le duc de Lerma avec un chapeau noir à larges rebords, à genoux et la tête baissée au pied d’une estrade où était étendue la reine avec un poignard dans le sein. Les gouttes de sang qui s’échappaient de sa blessure tombaient sur le chapeau du ministre, qu’elles finissaient pas rougir entièrement et dont elles faisaient un chapeau de cardinal.
Il était évident pour le duc que toutes ces calomnies, répandues d’abord en secret et avec adresse par le père Jérôme, Escobar et les révérends pères de la Compagnie de Jésus, circulaient maintenant d’elles-mêmes et grandissaient à vue d’œil.
Elles étaient parvenues jusqu’à Rome.
Le pape Paul en avait eu connaissance ; il se repentait presque de la nomination qu’il venait de faire, et les cardinaux s’indignaient du nouveau collègue qu’on leur avait donné. Il était impossible, le duc le sentait bien, que ces bruits ne fussent pas arrivés jusqu’à l’oreille du roi. Il n’avait sans doute pas osé en parler à son ministre ; mais de là venait la froideur qu’il lui témoignait depuis plusieurs mois.
Comment provoquer une explication que le roi semblait éviter, et dans laquelle d’ailleurs le cardinal-duc n’aurait pu apporter d’autres preuves de son innocence que ses protestations et ses serments personnels ? À la vérité, dans les circonstances présentes, le roi ne pouvait pas, même quand il le voudrait, renverser son ministre ; celui-ci n’était que trop bien défendu par la cour de Rome, par le coup audacieux qu’il venait de frapper, et par la complication même des affaires politiques, dont lui seul avait alors le maniement, le secret et la responsabilité.
Le cardinal-duc était donc devenu nécessaire, indispensable ; le royaume, c’était lui.
Mais il n’avait plus, il le sentait bien, l’affection et la faveur du maître, et n’ayant jamais joui de la faveur populaire, et s’étant arrangé pour s’en passer, il prévoyait que, plus tard, lorsque les affaires qu’il avait embrouillées commenceraient à s’éclaircir, lorsque reviendraient la paix et la tranquillité, lorsque enfin on n’aurait plus besoin de lui, ce Piquillo, d’abord méprisé, pourrait devenir un adversaire d’autant plus redoutable qu’il possédait déjà la confiance du souverain. Ennemi aussi implacable qu’il avait été ami utile, il n’y avait plus à espérer de le regagner. Il ne s’était pas réconcilié avec le père Jérôme, il est vrai, mais il devait nécessairement le faire, et appuyé par les révérends pères de la Foi, dont le crédit secret était immense, il pouvait former avec le duc d’Uzède une ligue qui finirait par détruire l’ancien favori dans l’esprit du roi.
Cela commençait déjà.
Le cardinal-duc se disait donc qu’il fallait d’abord attaquer ses ennemis séparément, l’un après l’autre, et avant qu’ils eussent le temps de se rallier et de se réunir.
Sandoval n’était point à Madrid. Il lui rendit compte, par écrit, de la situation, l’engagea à hâter son retour, et comme l’expulsion des Maures l’avait mis en goût pour les coups d’État, il résolut d’en frapper un second, l’expulsion des jésuites.
C’était depuis longtemps son rêve, et le moment lui paraissait venu de le réaliser.
Trop adroit, cependant, pour présenter au roi et lui faire approuver de force une ordonnance qu’après tout il pouvait refuser de signer (et il était certain qu’Uzède et Piquillo lui donneraient ce conseil), le ministre voulut combattre les jésuites, ses ennemis, par leurs propres armes ; il résolut de prendre un détour pour aller plus vite, et le chemin de traverse pour arriver plus droit à son but.
Il était plongé dans ces réflexions, quand le duc d’Uzède, son fils, entra dans son cabinet, et lui demanda, avec un air plein d’intérêt, la cause de sa rêverie.
Le ministre leva sur lui le regard le plus affectueux et le plus paternel.
— Mon fils, mon fils bien-aimé, lui dit-il, voici un grand chagrin qui m’arrive.
— Et lequel, monseigneur ?
— J’ai besoin des conseils d’un ami, judicieux, ferme et éclairé… Voilà ce que je me disais ; et le ciel m’a exaucé, puisqu’il vous envoie à moi.
— Parlez, monseigneur.
— Depuis quelques jours vous voyez le roi ?
— Tous les soirs.
— Il vous a rendu son ancienne faveur ?
— C’est vrai.
— Et j’en suis enchanté. Vous m’aiderez à déjouer des complots qui se trament contre moi.
— Ce n’est pas possible, monseigneur !
— Cela est ! On veut me ravir non-seulement le pouvoir, mais l’amitié de mon souverain.
— Ah ! s’écria le duc d’Uzède avec chaleur, ce serait indigne !
— Ce qui l’est bien plus, dit le ministre d’un air sombre, c’est que ceux qui cherchent à me renverser me doivent tout.
— C’est infâme ! dit le duc d’Uzède ; infâme ! je ne connais pas d’autre expression.
— Bien plus, ils sont admis dans mon intimité, ils sont comblés de mes bienfaits, ajouta le cardinal en serrant la main de son fils, qu’il sentit tressaillir. Et pour tout vous dire, ils me sont alliés par les nœuds du sang : ils sont de ma propre famille !
Le duc d’Uzède pâlit, et cherchant vainement à cacher son trouble, il balbutia ces mots :
— Ce n’est pas ! ce ne peut pas être ! Votre Éminence ne peut croire à de pareilles accusations.
— Elles me sont prouvées. Celui qui conspire contre moi est le marquis de Cazarera, votre cousin, mon neveu.
— Et lui aussi ! se dit le duc d’Uzède avec surprise et en même temps avec joie, car il avait ainsi la preuve qu’il n’était pas même soupçonné, et que son père avait si peu de défiance qu’il venait lui raconter ses chagrins et lui demander conseil.
Il se hâta donc de se remettre ; et laissant tomber ses deux bras d’un air de profonde douleur :
— Votre propre neveu, dit-il, que vous aviez accablé de vos bontés, que vous avez nommé vice-roi de Valence ! lui, notre plus proche parent !
— Eh ! voilà justement ce qui m’arrête et me rend si malheureux, s’écria le cardinal. Je voulais d’abord lui pardonner, assoupir cette affaire, n’en parler à personne ; mais cependant l’intérêt de l’État, mon devoir, ma sûreté personnelle, m’ordonnent de sévir. Qu’en pensez-vous, mon fils ?
— Je pense, s’écria vivement le duc, qui du reste détestait cordialement son cousin, je pense que Votre Éminence ne peut être trop sévère. Conspirer contre le ministre qui gouverne l’État est un crime d’État.
— Votre avis, mon fils, serait donc d’agir en ce sens ?
— Oui, mon père.
— Mais pour de pareils crimes, il y va de la tête.
— La justice avant tout ! s’écria le duc d’Uzède, qu’entraînait la fatalité, ou qui voulait par cet excès de rigueur éloigner l’apparence même d’un soupçon.
— Je vous remercie de votre avis, mon fils, répondit froidement le cardinal. Je prononcerai l’arrêt que vous avez dicté vous-même, et le coupable n’en accusera pas la sévérité, car ce coupable, c’est vous !
— Moi ! balbutia le duc d’Uzède terrifié.
— Oui, monsieur, répéta le cardinal d’un air terrible, vous-même, et si, d’après votre avis, la trahison d’un neveu mérite la mort, que mérite donc la trahison d’un fils ?
Il lui détailla alors tous les complots tramés entre lui, Jérôme, Escobar et la comtesse d’Altamira, et les bruits infâmes répandus par eux à ce dessein.
Le but de toutes ces manœuvres était le renversement, l’exil et peut-être la mise en jugement du premier ministre.
— Suis-je bien informé, monsieur, continua le cardinal, et qu’avez-vous à répondre ?
Le duc n’avait ni assez d’esprit ni assez d’audace pour se tirer d’un si mauvais pas ; il ne répondit rien et se jeta aux genoux du ministre en s’écriant :
— Grâce ! mon père !
— Vous n’avez plus le droit d’invoquer ce nom. Il n’y a ici que le ministre prêt à vous condamner ou à vous laisser vivre, selon les services que vous pourrez lui rendre.
— Parlez, monseigneur, je n’hésiterai pas.
— C’est ce que nous verrons. Il y a aujourd’hui conseil, vous m’y suivrez, et d’après la manière dont vous vous y conduirez, je déciderai le châtiment ou le pardon.
— Qu’exigez-vous de moi ?
— Vous le saurez… Venez.
— Le cardinal emmena son fils à l’audience de Castille, où de graves intérêts se discutèrent, où d’importantes résolutions furent prises et où le secret le plus profond fut expressément recommandé à tous les membres du conseil.
Mais les révérends pères de la Compagnie de Jésus avaient probablement des amis partout, car dès le lendemain Escobar était chez la comtesse Altamira, qui ne put se défendre à sa vue d’un léger trouble.
— Savez-vous ce qui se dit, comtesse ?
— Non, vraiment.
— On prétend que l’expulsion des jésuites a été discutée et décidée hier dans le conseil.
— Je l’ignorais.
— Ce n’est pas possible ; le duc d’Uzède y assistait…
— Depuis quelques jours je vois à peine le duc.
— Il a passé hier la soirée avec vous.
— Oui… c’était mon jour de réception, et il y avait tant de monde…
— Il n’y avait personne… vous étiez seule !
— Suis-je donc environnée d’espions ? dit la comtesse avec dépit, et ne suis-je plus libre de mes actions ?..
— Ce n’est pas cela que je veux dire, répliqua Escobar d’une voix pateline, mais seulement je voulais vous prier…
— Ou plutôt me commander ! s’écria la comtesse avec hauteur, car votre seul but est de me maîtriser, de vous rendre l’arbitre de mes moindres volontés, et de m’imposer les vôtres ; croyez-vous donc que je ne m’en sois pas aperçue ?..
— En vérité, comtesse, je ne vous reconnais plus…
— Et moi, mes pères, je vous connais, et depuis longtemps ! Dans nos plus intimes alliances, vous n’avez eu qu’une seule pensée… vos intérêts, et vous avez toujours fait bon marché des nôtres… Trouvez bon que je suive votre exemple, je n’en connais pas de meilleur.
— Qu’est-ce à dire, madame la comtesse ?
— Que vos maximes à vous sont : Dieu pour tous et chacun pour soi ! maxime que j’adopterai désormais. Je n’en veux pas d’autres. J’ignore ce qui se passe et ne veux point le savoir. Quoi qu’il puisse arriver, je n’entends ni me compromettre ni me mêler désormais de rien, persuadée qu’avec votre adresse et votre esprit ordinaires vous sortirez victorieux de tous les mauvais pas ; je resterai neutre, mon père, et tout ce que peut me permettre le souvenir de notre ancienne amitié, c’est de faire des vœux pour vous.
Elle accompagna ces derniers mots d’une profonde révérence, et se retira.
— Ouais ! dit le bon père, nos amis nous abandonnent, nos alliés se retirent de la congrégation. L’édifice est-il donc déjà si ébranlé que l’on craigne d’être enseveli sous ses ruines ? Voyons cela.
Il se rendit chez le duc d’Uzède, qui eut d’abord l’envie, non pas de soutenir le combat, mais de s’y soustraire en défendant sa porte. Puis il réfléchit qu’une explication était inévitable, et que tôt ou tard elle aurait toujours lieu ; autant la subir sur-le-champ. Il accueillit donc Escobar d’un ait empressé et affectueux.
— Vous voilà, mon bon père, s’écria-t-il, il me tardait de vous voir !
— On dit, monsieur le duc, que de sinistres événements se préparent !
— Ah ! vous les connaissez déjà ?
— Oui, l’on s’est occupé de nous hier… au conseil…
— Voilà justement, dit Uzède avec embarras, ce dont je voulais que vous fussiez prévenu.
— Vous vous êtes peu hâté, monseigneur, car nous en étions déjà instruits.
— Que voulez-vous ! mon père, dit Uzède, déconcerté dès la première attaque… Que voulez-vous ! les mauvaises nouvelles s’apprennent toujours assez vite. Eh bien, oui, je ne peux vous cacher qu’hier dans le conseil… et au moment où l’on s’y attendait le moins, le cardinal-duc a allégué contre vous des choses si odieuses… des faits si absurdes… que j’en ai été indigné.
— Je le sais…
— Ah ! vous le savez, mon père !… s’écria le duc avec joie.
— Oui, votre indignation a été si forte que votre langue en est demeurée glacée, et que vous n’avez pu trouver un mot pour nous défendre.
— Je m’en serais bien gardé !.. dit vivement d’Uzède, moi que l’on soupçonne déjà d’être votre ami et votre allié secret. Le ministre lui-même en est tellement persuadé, que ses yeux ne quittaient pas les miens… le moindre mot, le moindre geste en votre faveur, lui eût révélé notre intimité et aurait redoublé sa colère contre vous ; c’était vous servir que de garder le silence.
— Je vous remercie, monsieur le duc, d’avoir eu la prudence et le courage de vous taire, dit Escobar avec son sourire bonhomme et narquois ; mais quand on a été aux voix sur le rapport que le ministre proposait à Sa Majesté…
— Je m’y suis opposé.
— Comment cela ?
— C’était au scrutin secret, et j’ai déposé une boule noire dans l’urne.
— Personne ne vous a vu !
— C’est pour cela ! mais il y avait une boule noire… je vous l’atteste, on a dû vous le dire…
— Oui… une seule, et trois de nos amis, dans le nombre, prétendent chacun l’y avoir mise : vous êtes le quatrième…
— C’est moi, mon père, moi seul, je vous le jure !…
— Je n’en doute point, monseigneur, dès que Votre Excellence l’atteste ; mais quand le duc de Lerma vous à désigné à haute voix pour faire ce rapport…
— J’ai accepté, c’est vrai, dit le duc en pâlissant.
— Et même avec empressement, monseigneur.
— Je ne dis pas non. C’était nécessaire, indispensable.
— Pourquoi ? continua le bon père d’une voix douce et en tenant fixé sur le duc son regard fin et pénétrant.
— Pourquoi, pourquoi… balbutia d’Uzède avec embarras… parce que c’était le seul et dernier service qu’il me fût permis de vous rendre, j’ajouterai même dans les circonstances actuelles c’en était un immense.
— En quoi, monseigneur ?
— Mais, d’après la presque unanimité des avis, il était impossible que ce rapport n’eût pas lieu. Tout autre que moi en eût été chargé ; plusieurs conseillers avaient même demandé à le faire, et s’il avait été confié à quelqu’un qui ne vous fût pas aussi dévoué que je le suis, quelqu’un qui fût véritablement et franchement votre ennemi, vous n’aviez plus d’espoir.
— Je comprends, dit Escobar : vous vous en êtes chargé dans notre intérêt.
— Certainement !
— Et pour le faire en notre faveur ?
— Non pas ; c’est impossible.
— Alors autant valait le laisser faire à quelqu’un qui fût franchement notre ennemi.
— Quelle différence ! s’écria Uzède tout à fait déconcerté ; en vérité, je ne conçois pas comment vous, mon père, qui avez tant de tact et de finesse, vous ne voyez pas l’avantage qu’il y a à avoir pour ennemi quelqu’un qui vous veut du bien, qui est disposé à adoucir, à atténuer les faits, à les présenter de manière à les rendre, sinon favorables, au moins hostiles, avec bienveillance et affection.
— Je comprends ! je comprends ! dit vivement Escobar : votre intention est de nous laisser faire ce rapport.
— Comment ? dit Uzède étonné.
— Nous nous en chargerons, le père Jérôme et moi ; nous ne nous écarterons en rien de votre idée ; ce sera un rapport éminemment hostile, qui engagera le roi à nous conserver.
— Je ne le puis ! je ne le puis ! s’écria Uzède ; songez donc à ce qui en arriverait auprès du cardinal-duc.
— Ce serait nous sauver !
— Mais ce serait me perdre, moi ! le ministre connaît nos intelligences secrètes et les projets formés pour le renverser ; j’ignore qui a pu l’en instruire, mais il sait tout !
— Tout !… ce n’est pas possible, dit Escobar à demi-voix, il y a des choses qui se sont passées entre Dieu et nous seulement !.. et il ne peut connaître ce qui a rapport à la reine.
— Grâce au ciel ! dit Uzède en frissonnant, mais ce qu’il sait constitue un crime d’État. C’est bien assez pour nous faire mettre en jugement, et nous faire condamner.
— Vous, son fils ! allons donc !
— Moi-même.
— Il reculerait devant une pareille idée, et personne au monde, pas même son plus grand ennemi, n’oserait lui donner un pareil conseil.
— On le lui a donné.
— Eh qui donc a été assez cruel ou assez absurde ?
— Moi-même.
— Vous, monseigneur ! s’écria Escohar en le regardant d’un air qui semblait dire : Vous dépassez toutes mes prévisions et je ne croyais pas que vous eussiez pu aller jusque-là.
— Eh oui ! répondit d’Uzède avec impatience. Je croyais, quand il m’a consulté sur de prétendus conspirateurs, qu’il s’agissait du vice-roi de Valence, du marquis de Cazarera, mon cousin, que je ne puis souffrir, et je l’ai conseillé en conscience, conseil qu’il a juré de suivre si je continuais de vous protéger et de m’entendre avec vous. Il y va donc de ma tête, et, s’il faut vous le dire, mon père, j’y tiens plus qu’à la vôtre.
— Et Votre Excellence a raison, reprit Escobar en s’inclinant. Par saint Jacques ! elle est bien plus précieuse, elle a une bien autre valeur, et je n’ai plus rien à dire dès que c’est vous et la comtesse Altamira qui rompez les premiers notre alliance, dès que chacun de nous est dégagé de son amitié et de ses serments, et reste libre d’agir à sa manière.
— Eh ! certainement, s’écria d’Uzède avec joie et d’un air affectueux ; défendez-vous de votre mieux… j’en serai enchanté ! Tirez-vous de là si vous le pouvez… je ne m’y oppose pas, au contraire ! si je peux vous y aider sans me compromettre… vous me trouverez toujours…
— Trop de bontés, monseigneur, trop de bontés, répéta Escobar en s’inclinant. Nous ne vous en demandions pas tant… Comme disait madame la comtesse, que je viens de quitter : chacun pour soi et Dieu pour tous !
Le révérend père salua de nouveau et quitta le duc, étonné et ravi d’en être quitte à si bon marché.
Il entra dans son cabinet pour faire son rapport, pendant que le bon moine courait chez le cardinal-duc. Il ne fut pas reçu.
Il eut beau insister, répéter qu’il venait rendre au ministre un signalé service, le duc de Lerma se dit sans doute en lui-même : Timeo Danaos et dona ferentes, car il refusa obstinément de l’entendre, non plus que Jérôme, et sa porte fut rigoureusement défendue à tous les pères de la Compagnie de Jésus. Il connaissait leur adresse, et résolu à frapper un grand coup, et décidé à prononcer à tout prix leur expulsion, il ne voulait point s’exposer à se laisser désarmer ou séduire par leurs promesses insidieuses, leurs protestations de dévouement ou leurs offres de service.
Repoussés de ce côté, les bons pères ne savaient plus à quel saint se vouer. Ils n’auraient osé s’adresser à frère Luis Alliaga, leur ancien élève. D’ailleurs Alliaga n’était plus à Madrid, il était parti pour l’Andalousie avec une mission de Sa Majesté. Enfin Jérôme ne pouvait avoir audience du roi et parvenir jusqu’à lui que par le duc d’Uzède ou la comtesse d’Altamira, et tous deux étaient devenus ses ennemis. La position était critique et le danger était pressant ; la Société de Jésus se voyait perdue et n’avait plus d’espoir, mais elle avait Escobar, et celui-ci, dont le génie grandissait avec les périls, jura de sauver son ordre si on le laissait faire.
Le père Jérôme lui donna carte blanche et de plus sa bénédiction.
Escobar partit.
LXVI.
escobar et alliaga.
Le roi n’avait voulu s’en rapporter à personne qu’à Luis Alliaga du soin de ramener à Madrid la duchesse de Santarem. Craignant le mauvais vouloir ou le fanatisme de Ribeira et de tous ceux qui étaient placés sous ses ordres, il avait donné les pouvoirs les plus étendus à son confesseur, qui était homme à s’en servir.
Dès que le vaisseau envoyé par le vice-roi aurait ramené à Valence Aïxa et les siens, ceux-ci devaient être remis à Alliaga et confiés à sa garde exclusive. C’était alors qu’il devait faire part à sa sœur des projets du roi, les appuyer de tout son pouvoir et les lui montrer comme les seuls moyens de rappeler un jour de l’exil leur nation.
Mais quelque grande qu’eût été la diligence du vice-roi, quelque rapide qu’eût été la marche du bâtiment envoyé par lui, Aïxa et son père avaient plusieurs jours d’avance, peut-être même étaient-ils déjà débarqués en Afrique, et à supposer qu’il ne survint aucun contre-temps, aucun vent contraire, dix ou douze jours devaient au moins s’écouler avant leur retour.
Frère Luis Alliaga voyageait dans un carrosse aux armes du roi ; il était seul, mais deux postillons conduisaient quatre mules vigoureuses, richement harnachées. Des cavaliers armés précédaient ou suivaient sa voiture, et d’autres se tenaient constamment aux deux portières du carrosse.
— Est-ce bien moi ? est-ce le pauvre Piquillo ? se disait-il en voyant cette pompe royale et en traversant en si brillant équipage les plaines que naguère encore il avait traversées à pied, fugitif et se cachant sous des haillons pour échapper aux poursuites des alguazils et aux embûches de Juan-Baptista.
Comme en peu de temps son sort avait changé ! À quelle haute et bizarre fortune il avait été poussé, comme malgré lui, par les événements et par ses ennemis eux-mêmes ! Et cependant, en jetant un regard autour de lui, en descendant au fond de son cœur, Luis Alliaga était-il plus heureux que Piquillo ? Non ; ce qu’il avait gagné ne valait pas ce qu’il avait perdu. Ses richesses et ses dignités acquises ne remplaçaient point ses espérances et ses illusions anéanties.
La première fois qu’il avait parcouru les riches campagnes de Valence, il était sans ressources et à la recherche d’une famille plus qu’incertaine ; on le repoussait, on le méprisait, mais il aimait, il se croyait aimé ; l’avenir était à lui, rien ne lui semblait impossible. Aujourd’hui il était arrivé au plus haut point où puissent s’élever les désirs des hommes : la faveur du maître, la fortune, la puissance, et aucun de ses désirs à lui n’était comblé ; il lui était défendu d’aimer, et forcé de renfermer en lui-même jusqu’aux sentiments les plus doux et les plus naturels, cet homme si envié, qui déjà pouvait tout, ne pouvait parler à personne de son amour ni de son malheur !
Toutes ces idées se succédaient rapidement dans son cœur au roulement rapide de la voiture qui l’emportait à travers ces plaines jadis si animées, si peuplées, si riantes, et déjà mornes et désertes.
On n’apercevait plus le laboureur au travail, on n’entendait plus les chants joyeux de l’ouvrier. Partout la solitude et le silence. Seulement, de loin en loin, une charrue abandonnée au milieu d’un sillon inachevé attestait que le maître avait été brusquement arraché à son labeur et à l’espoir de sa récolte, à jamais perdue.
Tout à coup, autour d’un grand arbre qui étendait
au loin ses rameaux, Alliaga vit une cinquantaine
d’hommes réunis, les premiers qu’il eût aperçus depuis
quelques heures. Il baissa les glaces du carrosse et regarda :
c’étaient des alguazils mêlés à quelques familiers
du saint-office. 
On le transporta dans la tente d’Yézid ; les soins qu’on lui prodigua le rappelèrent à la vie.
— Ah ! se dit Alliaga en lui-même, voilà, d’ici à longtemps, les seuls produits de cette terre.
Les alguazils et les familiers du saint-office se rangèrent respectueusement en apercevant le carrosse aux armes du roi et le cortége de Luis Alliaga. Celui-ci vit alors derrière les hommes vêtus de noir une trentaine de malheureux, pâles, amaigris, presque sans vêtement et enchaînés deux à deux.
— Qu’est-ce, monsieur l’alguazil ? demanda Piquillo au chef de la troupe.
— Des Maures que nous dirigeons sur Valence ; des Maures de l’Aragon et des deux Castilles qui sont en retard. Mais, que voulez-vous, mon révérend, on ne peut pas tout faire à la fois. Il y en avait tant de ces hérétiques ! on en trouve de tous les côtés, et il faudra encore bien des mois avant que l’ordonnance de Sa Majesté soit entièrement exécutée.
— Mais l’ordonnance du roi ne dit pas qu’ils seront, ainsi que des malfaiteurs, trainés et enchainés deux à eux.
— C’est vrai, mon révérend, mais c’est plus commode.
— Pour eux ?
— Non, pour nous ; ils sont ainsi plus faciles à garder.
— Le roi n’entend pas non plus qu’ils soient ainsi presque nus. On les a donc dépouillés de leurs vêtements ?
— Pour voir, mon révérend, s’ils ne cachaient point sur eux de l’or ou des bijoux ; mais c’est une horreur ! ces Maures, qu’on disait si riches, n’ont rien, pas un maravédis !
— C’est tout simple, l’édit ne leur a-t-il point défendu, sous peine de mort, de rien emporter avec eux ?
— Oui, monseigneur, mais ces mécréants sont si obstinés, si endurcis, qu’ils ont caché ou enfoui tous leurs trésors ; on n’a trouvé presque rien, et ça sera perdu pour tout le monde.
— Ah ! dit Piquillo en lui-même, le duc de Lerma et Sandoval n’avaient pas pensé à cela.
Il fit ouvrir la portière de la voiture et descendit. 
Viens à mon aide, ô mon Dieu, et conseille-moi.
Le premier prisonnier qu’il aperçut était un beau
jeune homme, à la taille élevée, à l’air fier et hautain.
Quoique garrotté et à moitié nu, ce n’était pas l’humiliation,
mais la colère et le désir de la vengeance qui
respiraient sur son front.
Ses traits, du reste, n’étaient pas inconnus à Alliaga ; il se rappela l’avoir vu au Val-Paraiso, chez Delascar d’Albérique, et son cœur s’en émut comme s’il retrouvait quelqu’un de sa maison ou de sa famille.
— N’es-tu pas, lui dit-il avec bonté, Alhamar-Abouhadjad, un des serviteurs favoris d’Yézid ?
Le Maure tressaillit.
— Ne crains rien, frère, lui dit Piquillo à voix basse en lui serrant la main, et compte sur moi.
À ce nom de frère, le Maure regarda le moine avec un étonnement qui redoubla encore lorsque, sur un geste de frey Alliaga, on s’empressa de défaire les cordes qui le tenaient garrotté.
Le confesseur du roi s’avança alors vers les pauvres gens qui étaient assis à terre sous le grand arbre.
— C’est bien, dit Alliaga au chef de la troupe, vous les avez fait asseoir à l’ombre pour les faire reposer.
— Oui, monseigneur, et puis parce que nous allions pendre un des leurs.
— Et pourquoi cela ? demanda vivement Piquillo.
— Parce que c’est une meilleure pratique que les autres. Il avait caché dans son albarda[33] une quarantaine de ducats dont nous nous sommes emparés.
— Et vous allez le pendre pour cela ?
— Sans doute… ce ne sera pas le premier[34].
Piquillo poussa un cri d’indignation et s’avança vers le patient à qui on avait déjà lié les mains derrière le dos ; mais un tremblement subit le saisit lorsqu’il eut jeté les yeux sur lui.
— Est-il possible ! Est-ce bien là Gongarello ?
À ce nom, à cette voix, le pauvre barbier, déjà à moitié mort de terreur, resta immobile de surprise.
Piquillo, s’adressant au chef des alguazils, lui dit d’un ton d’autorité :
— Déliez cet homme.
— Mais, monseigneur… le texte de l’édit le condamne à la peine de mort, pour les quarante ducats qu’il voulait nous dérober.
— Vous allez les lui rendre… l’édit permet à ces pauvres gens d’emporter avec eux ce qui leur est nécessaire pour les besoins de la route.
— Mais, monseigneur, j’ai des ordres exprès.
— De qui ?
— De Son Éminence le cardinal-duc et du grand inquisiteur.
— Et moi, j’ai des ordres du roi… du roi lui-même ! Lisez plutôt.
Piquillo tira de sa poche un parchemin scellé du sceau royal et signé de la main de Philippe III ; il portait ces mots :
« Vous aurez pour agréable de vous conformer à ce que vous ordonnera, de ma part, le digne frère Luis Alliaga, notre révéré confesseur. Car tel est notre bon plaisir.
— C’est différent, dit l’alguazil avec respect ; qu’ordonnez-vous ?
— Que ces malheureux soient tous déliés et marchent en liberté.
Puis, s’adressant à un des cavaliers de sa suite :
— Prenez dans la poche à droite de la voiture un sac de doublons.
Le cavalier obéit, et Piquillo se mit à distribuer ces pièces d’or aux pauvres prisonniers, sans oublier Alhamar-Abouhadjad, à qui il donna double part.
— Mais, monseigneur, s’écria le chef des alguazils, le texte de l’édit défend aux Maures d’emporter de l’or…
— Qui leur appartienne !.. mais celui-ci n’est pas à eux, il est au roi. Forcé, dans l’intérèt de la religion, de sanctionner le décret de bannissement, il a voulu du moins en adoucir la rigueur, et c’est pour cela qu’il m’envoie. Quel est votre nom, monsieur l’alguazil ?
— Cardenio de la Tromba.
— Seigneur Cardenio de la Tromba, je vous confie ces braves gens ; vous les conduirez à petites journées et avec tous les égards possibles jusqu’à Valence, où je serai avant vous. Si cependant, ce qui est possible, je n’étais pas encore arrivé, ils logeront dans le palais de Delascar d’Albérique, où ils attendront mon retour. Tel est l’ordre du roi. Si d’ici là on s’avisait de les dépouiller ou de les maltraiter encore, c’est à vous que je m’en prendrais.
L’alguazil s’inclina avec respect, et les Maures, étendant vers Piquillo leurs mains qu’on venait de délier, laissèrent éclater les transports de leur joie et de leur reconnaissance, pendant qu’Alhamar-Abouhadjad répétait avec émotion : « Oui, frère, frère toujours ! Adieu, monseigneur, nous nous retrouverons. » Quant à Gongarello, il n’était pas encore revenu de sa stupeur. En entendant la voix de Piquillo, il avait cru que c’était un nouveau compagnon d’infortune qui leur arrivait, et que son ancien ami venait, prisonnier comme eux, partager leur exil et leur misère ; mais quand il entendit le jeune moine parler en maître et commander au nom du roi, quand il vit avec quelle obéissance, avec quel respect ses ordres étaient exécutés, quand il se vit de nouveau préservé de la mort par la bienheureuse intercession de Piquillo, il le regarda décidément comme son bon ange et se jeta à ses pieds,
— Relève-toi, lui dit Piquillo, et suis-moi ; je t’emmène.
— Comment, monseigneur, dit l’alguazil étonné, ce prisonnier qui a été remis à ma garde, vous l’emmenez ! Et en quelle qualité ?
— En qualité de barbier. Il m’en faut un, et pourvu qu’il soit rendu à Valence, peu vous importe qu’il y arrive à pied ou en voiture. Il y sera, je vous en réponds.
— Mais cependant, monseigneur, dit l’alguazil en insistant.
— Tel est l’ordre du roi, monsieur, répliqua gravement Piquillo.
À cet argument, il n’y avait pas de réponse, et l’alguazil s’inclina de nouveau en signe d’obéissance.
Luis Alliaga remonta en voiture, fit placer à côté de lui le barbier, salua d’un geste et d’un sourire affectueux les Maures, qui se remirent en marche, et l’escorte du jeune moine partit au grand galop. Gongarello, encore étourdi de tout ce qui venait de se passer, regardait d’un air effaré son compagnon de voyage.
— Où suis-je ? demanda-t-il.
— Près d’un ami.
— Oui, vous avez toujours été mon sauveur.
— N’as-tu pas été le mien ? oublies-tu l’hospitalité que j’ai reçue à Alcala dans la boutique du barbier ?
— Et ce beau carrosse !
— Et ta carriole ! Nous sommes quittes !
— Ah ! dit le barbier, en contemplant la riche voiture aux coussins moelleux, aux larges galons et aux crépines d’or, c’est moi qui vous dois du retour, sans compter la vie par-dessus le marché, Tout cela est donc à vous ?
— Non, c’est au roi.
Et la surprise du barbier redoubla quand il apprit qu’il était monté dans le carrosse du roi ; il n’en fut pas plus fier et voulut se jeter aux pieds d’Alliaga, qui le releva, le serra contre son cœur, et pour la première fois peut-être la royale voiture vit de franches poignées de main et de loyales étreintes.
Le soir même on arriva à une riche hôtellerie. Au nom seul de frère Luis Alliaga, confesseur de Sa Majesté, maîtres et valets couraient, s’empressaient et se prosternaient avec une humilité et un respect qui ne se trouvent qu’en Espagne, et qui jetaient Gongarello dans de nouveaux étonnements. Lui-même, sans pouvoir s’en défendre, se sentait gagner peu à peu par ce respect général ; il avait oublié Piquillo le bohémien, page et serviteur du bandit Juan-Baptista ; il ne voyait plus que le haut dignitaire de l’Église, le confident du prince, le possesseur de tous les secrets d’État et presque le confesseur de la monarchie espagnole.
Aussi, quand Alliaga lui fit signe de se placer à côté de lui à table, il osait à peine s’asseoir sur l’extrême bord de son fauteuil, il déployait sa serviette en silence. Alliaga le regarda en souriant et dit à son convive :
— Par saint Jacques, je crois que tu n’oses pas avoir faim.
— C’est vrai.
— Il ne faut pas que ma grandeur t’ôte l’appétit. Allons, mange et bois.
— À votre santé, monseigneur !
Le barbier eut bientôt retrouvé son appétit de simple particulier et resta à table bien longtemps encore après que Alliaga l’eut quittée. Celui-ci écrivit le soir même au roi ce qui s’était passé dans la journée, lui demanda la permission de garder près de lui à son service l’honnête barbier, et il finissait ainsi :
« Pour que la mesure désastreuse adoptée par le duc de Lerma et son frère Sandoval puisse au moins rapporter quelque chose à l’État, ordonnez, sire, que le décret de confiscation soit aboli, et que les Maures aient le droit d’emporter librement leurs richesses, à la seule condition d’en abandonner au fisc une portion que Votre Majesté déterminera. Cette mesure vaudra aux exilés un abri contre la misère, à Votre Majesté des bénédictions, et aux coffres de l’État des sommes immenses perdues sans cela pour tout le monde. De plus, et si Votre Majesté ne se hâte d’y porter remède, les meilleures terres du royaume deviendront stériles. J’ai déjà vu des campagnes désertes et les travaux des champs abandonnés. Les Maures se livraient seuls à l’agriculture, où ils excellaient ; les Espagnols n’y entendent rien et n’y ont aucun goût, ils méprisent la profession de laboureur ; il faut donc la relever à leurs yeux ; comme, et avant tout, ils sont avides de gloire et de titres, je propose à Votre Majesté d’accorder des lettres de noblesse à ceux de vos sujets qui se livreraient à la culture des terres et s’y distingueraient. »
Quelques jours après, au grand étonnement de l’Espagne, et surtout du duc de Lerma, on vit paraitre deux édits que le roi avait rendus de lui-même, sans consulter son ministre. Il les avait seulement envoyés au conseil de Castille, qui s’était hâté de les enregistrer.
Par l’un, il était permis aux Maures d’emporter avec eux leurs trésors et même le prix de leurs biens vendus, à la condition d’en abandonner la moitié à l’État.
L’autre édit accordait des lettres de noblesse à tout Espagnol qui se distinguerait dans la profession de laboureur.
À la lecture de ces deux ordonnances, le duc de Lerma fut d’autant plus atterré, qu’elles obtinrent l’approbation générale ; ne doutant point que lui seul ne les eût proposées, chacun lui en fit compliment. Ses flatteurs, qu’il n’osa démentir, célébrèrent ses louanges, l’élevèrent aux nues. Ses ennemis eux-mêmes convinrent que si le ministre avait toujours signalé son administration par de pareils actes, il aurait fallu le regarder comme le soutien et la gloire de la monarchie.
Heureux du bien qu’il avait fait en secret et dont personne ne lui savait gré, Alliaga continua sa route, protégeant par sa présence, consolant par ses paroles les pauvres exilés qu’il rencontrait et qui de tous les points du royaume étaient dirigés vers les côtes de l’Andalousie.
Chaque injustice, chaque abus qu’il découvrait (et la récolte était abondante), étaient sur-le-champ signalés par lui au roi ; bien souvent celui-ci n’avait ni la force ni le pouvoir d’y remédier ; il commençait cependant à comprendre comment un roi bon, mais faible, peut faire autant de mal qu’un roi méchant. Il s’effrayait des malédictions et de la haine que le duc de Lerma avait amassées sur sa tête. Il voyait clairement l’abîme où on l’avait entrainé ; mais indécis et incertain, son bon naturel luttait contre sa faiblesse ; il ne se sentait pas l’audace de reculer. Tout son courage en ce moment consistait à s’arrêter, à ne pas aller plus avant, et pour prendre un parti, il attendait le retour de Piquillo.
Celui-ci continuant sa route arriva à Carrascosa, vers l’extrémité de la sierra de l’Albarracin, qu’il voulait traverser le lendemain pour se rendre à Cuença et de là à Valence.
Le village où il s’était arrêté avait été la veille encombré de troupes qui avaient fait main basse sur toutes les provisions, et pour offrir à souper au révérend frère Luis Alliaga, confesseur du roi, l’hôtelier qui avait l’honneur de le recevoir fut obligé de mettre à contribution toutes les maisons environnantes.
Enfin, et tant bien que mal, il était parvenu à composer un repas fort modeste, auquel Piquillo et le barbier se disposaient à faire honneur, quand une dispute se fit entendre dans la chambre voisine.
— Qu’est-ce ? demanda Piquillo.
L’hôtelier, son bonnet à la main et multipliant les révérences, vint supplier monseigneur de ne pas s’inquiéter de ce bruit : c’était un pauvre moine fatigué et affamé, auquel il ne pouvait donner à souper et qui exprimait avec énergie sa mauvaise humeur.
— Qu’il entre ! qu’il entre ! s’écria Piquillo. Dites-lui que je le prie de vouloir bien partager ce que nous avons.
— Par saint Dominique, il ne se fera pas prier. Entrez, entrez, mon frère, dit-il en faisant quelques pas vers la porte principale. Monseigneur daigne vous admettre à sa table.
Un moine entra et salua profondément, puis levant la tête, il rejeta en arrière son capuchon et s’écria :
— Piquillo !
— Frère Escobar !
Escobar, car c’était lui-même, contempla d’un œil étonné et envieux tout le faste qui environnait Alliaga : les gens de l’hôtellerie presque prosternés devant lui, les domestiques à la livrée du roi qui s’empressaient de le servir, le fauteuil d’honneur où son ancien élève trônait vis-à-vis d’un excellent potage qu’on venait de lui présenter.
— C’est pourtant ma place qu’il occupe là, se dit-il, et c’est à moi qu’il la doit.
Alliaga, à la vue d’Escobar, se leva et lui dit :
— L’invitation que j’avais offerte au voyageur inconnu serait peut-être peu agréable au frère Escobar, et je vais ordonner que l’on porte dans sa chambre la moitié de ce repas.
— Pourquoi donc, répondit le révérend père en s’approchant, je serais désolé de déranger Votre Seigneurie. Et il ajouta à voix basse : On se déteste et on soupe ensemble ; cela n’engage à rien.
— Je ne déteste personne, dit froidement Alliaga.
— C’est juste, répondit Escobar en souriant, c’est vous qui recevez… vous devez faire les honneurs. C’est l’usage.
— Ce ne sont point de vaines formules, mais les maximes mêmes de l’Évangile, que vous connaissez mieux que moi.
— Oui, certes, car ces maximes-là, dit Escobar avec amertume, c’est moi qui vous les ai enseignées.
— Et c’est moi qui les mets en action, répondit Alliaga ; puis d’un air affable il ajouta : Un couvert au frère Escobar.
Celui-ci se hâta de s’asseoir en face de Piquillo, et les deux ennemis soupèrent ensemble, s’observant mutuellement et se regardant avec inquiétude : Escobar, parce qu’il ne connaissait pas assez les intentions d’Alliaga, et celui-ci, parce qu’il connaissait trop bien celles de son convive.
Dès qu’on eut servi les confitures et les fruits, et que les domestiques se furent retirés, le révérend père jésuite commença le premier l’attaque.
— Eh bien ! mon frère, dit-il à demi-voix et après avoir quelque temps contemplé Alliaga avec un silence admiratif, que vous avais-je prédit autrefois ? N’avais-je pas raison quand je prétendais que de nos jours le froc du moine était le seul moyen possible d’arriver aux dignités, aux richesses… à la puissance ! Quel chemin n’avez-vous pas fait en si peu de temps !.. Et pourtant vous refusiez de me croire, vous repoussiez mes salutaires avis, bien plus, vous m’avez accablé d’outrages et de haine, moi la cause première d’une fortune aussi inouïe ! — car sans moi, monseigneur, permettez-moi de vous le dire avec franchise, vous ne seriez rien.
Piquillo, qui jusque-là avait tenu ses yeux baissés, les leva en ce moment sur le moine, et celui-ci y vit tant de désespoir et de regrets qu’il s’arrêta interdit.
Toutes les douleurs de Piquillo venaient de se réveiller ; sa poitrine oppressée, ses joues pâles, ses lèvres tremblantes de colère, ses yeux où l’indignation brillait au milieu des larmes, tout démontrait évidemment à Escobar qu’il venait de s’égarer et de faire fausse route. Il était trop habile pour s’y méprendre, mais pas assez pour deviner ce qui se passait dans le cœur de Piquillo, et quand même celui-ci lui eût avoué la vérité, le révérend père n’eût pu la comprendre.
— Oui, je vous dois toutes mes souffrances, toutes mes douleurs ! s’écria le jeune homme… c’est de vous que viendra peut-être mon malheur éternel !.. Ne me le rappelez pas, ou malgré moi vous ranimerez cette haine dont vous parliez tout à l’heure et que je m’efforce d’éteindre ; effaçons ces souvenirs, chassons toutes ces pensées…
Il s’arrêta un instant, comme faisant un effort sur lui-même, et malgré lui un sourd gémissement s’échappa de son sein.
Hélas ! il est des douleurs qu’on rappelle en essayant de les bannir !
Il resta quelque temps la tête cachée dans ses mains ; puis, honteux de son émotion et du trouble qu’il venait de laisser paraitre aux yeux d’un ennemi, il reprit soudain tout son empire sur ses sens, et, avec un calme dont Escobar lui-même fut étonné, il lui dit froidement :
— Parlons d’autres choses, mon frère. Vous venez de Madrid ?
— Oui, monseigneur.
— Quelles nouvelles ?
— C’est à vous que j’en demanderai, vous qui connaissez tous les secrets du roi.
— Cela n’est pas, mon frère ; mais si cela était…
— Eh bien ? demanda vivement Escobar.
— Eh bien ! je les garderais fidèlement, et alors…
— C’est juste ! cela reviendrait au même.
— Mais vous, mon frère, comment se fait-il que vous ayez quitté le couvent et l’université d’Alcala, où votre présence est si nécessaire, et que vous vous trouviez ainsi dans ce misérable village au pied de la sierra de l’Albarracin ? Si toutefois, ajouta-t-il en se reprenant, il n’y a pas d’indiscrétion à ma demande.
— Aucune, répondit Escobar, qui depuis quelques instants semblait sous la préoccupation d’une idée qui venait de surgir en lui, aucune, mon frère. J’étais parti, je vous l’avouerai franchement, dans une intention que votre rencontre vient de modifier. Je me rendais incognito près du grand inquisiteur Sandoval y Royas, qui dans ce moment, dit-on, parcourt ainsi que vous l’Andalousie.
— C’est vrai.
— Je tenais à le voir pour lui rendre un important service, que j’aime mieux vous rendre à vous.
Alliaga s’inclina silencieux.
— Et pour lui révéler un secret qui sera mieux entre vos mains.
Alliaga s’inclina de nouveau sans répondre.
— J’y aurai du moins plus d’intérêt, je crois.
— C’est différent, dit Alliaga. Parlez, mon frère, je vous écoute.
— Le cardinal-duc vous a fait arriver au poste où vous êtes, et peut, s’il est possible, vous pousser plus haut encore ; votre fortune dépend de la sienne.
Alliaga garda le silence.
— S’il s’élève, vous vous élevez ; s’il est renversé, vous tombez. Donc, si je m’y connais (et je crois m’y connaître), vous devez lui être tout dévoué, n’est-il pas vrai ?
Alliaga ne répondit pas.
— Or, je puis, dans son intérêt, c’est-à-dire dans le vôtre, vous donner, si vous le voulez, un moyen éclatant et infaillible de confondre ses ennemis, de faire taire tous les bruits calomnieux et d’affermir à jamais son pouvoir. Ce service éminent et qu’il paierait de tous ses trésors, je puis le lui rendre d’un seul mot.
— Vous ?
— Moi !
— Ce n’est sans doute pas dans l’intérêt seulement du ministre, et vous y avez probablement le vôtre.
— Je croyais être assez connu du seigneur Alliaga pour qu’il me fit l’honneur de m’épargner une semblable question. J’irai donc droit au but et sans périphrase.
Le cardinal-duc, non content d’avoir exilé les Maures, veut encore expulser du royaume tous les membres de la Compagnie de Jésus.
— En vérité ?
— Ce qui est une seconde faute.
— Ou plutôt une expiation de la première. C’est du moins mon opinion.
— Ce n’est pas la mienne, et si le ministre consent à renoncer à ce projet ; s’il permet et autorise notre établissement en Espagne ; s’il nous donne surtout des garanties, et c’est là ce que je viens vous demander, je vous rends possesseur d’un secret qui le sauve et consolide à tout jamais sa puissance. Qu’en dites-vous ?
En prononçant ces mots, Escobar, les yeux attachés sur Piquillo, semblait plonger dans le fond de son âme, pour y chercher le point essentiel, c’est-à-dire sa pensée, car pour lui les paroles n’étaient rien, si ce n’est, comme l’a dit plus tard un homme d’État de son école, un simple accessoire propre à déguiser le principal.
— Dans ce que vous me proposez, répondit froidement Alliaga, il n’y a qu’une difficulté.
— Laquelle ?
— C’est que je ne tiens pas du tout à maintenir le duc de Lerma au pouvoir.
Escobar ne put retenir un geste de surprise, et Alliaga continua :
— Au contraire, je veux le renverser.
— Dites-vous vrai ?
— Je le lui ai dit à lui-même ! C’est mon seul but, mon seul désir.
Et il ajouta avec force et après un instant de silence :
— Oui, je le renverserai.
— Soit, dit Escobar sans s’émouvoir, et si je puis vous seconder…
— Vous ! s’écria Alliaga étonné.
— Moi-même ! Je venais pour le sauver ; je suis prêt à le perdre. Les deux moyens sont également dans mes intérêts, mais le second est dans mes goûts, je le préfère : ainsi donc, dit-il gaiement en rapprochant son fauteuil de celui d’Alliaga, entendons-nous.
— C’est impossible.
— Qui s’y oppose ?
— Le passé.
— Est-ce que vous y croyez ? C’est tout au plus si je crois au présent.
— À présent comme autrefois, comme toujours, il y aura haine entre nous.
— Qu’importe ! je ne vous parle pas d’amitié, mais d’alliance. Il s’agit de renverser le duc de Lerma.
— Et si je veux le renverser à moi seul ! s’écria Alliaga avec force.
— En vérité ! répondit Escobar, dont l’étonnement redoublait.
— Oui, j’en ai fait le serment, et pour l’exécuter, je ne veux ni secours ni allié. Je suffirai seul à la tâche que j’ai entreprise. Je ne puis donc accepter vos offres, seigneur Escobar, et je vous laisse le maître de perdre à votre choix ou de sauver le duc de Lerma.
— Ainsi, seigneur Alliaga, votre dernier mot est donc…
— Que tout m’est indifférent, pourvu que je ne me rencontre ni dans le même camp ni sous les mêmes drapeaux que vous.
Il salua de la main le révérend père, appela Gongarello et se retira dans son appartement, laissant Escobar stupéfait du résultat de la conversation.
Elle lui semblait d’autant plus inexplicable, qu’Alliaga lui avait dit la vérité ; or, c’était la dernière chose qu’Escobar se fût avisé de soupçonner, et, persuadé que le confesseur du roi avait été encore plus fin, plus adroit et plus impénétrable que lui :
— Maudit homme, se dit-il, qu’on ne peut ni désarmer, ni tromper, ni comprendre !
Et il ajouta avec un soupir mêlé d’orgueil et de rage :
— On voit bien qu’il a étudié chez nous.
LXVII.
l’albarracin.
Désolé d’avoir perdu toute une soirée à combattre un ennemi qu’il n’avait pu vaincre, frère Escobar se leva de bon matin, quitta l’hôtellerie, sans faire ses adieux au confesseur du roi, et se hâta de continuer sa route, décidé plus que jamais à poursuivre son premier projet.
Il avait quelque confiance dans le grand inquisiteur Sandoval, qui n’avait pas étudié chez Loyola et dont il espérait tirer meilleur parti que de Piquillo.
Le pieux recteur de l’université d’Alcala aurait bien voulu, pour arriver plus vite, prendre la voie du muletier. Les muletiers ne manquaient pas, mais ce qu’il était impossible de trouver, c’étaient des mules, attendu que dans le pays elles avaient été toutes enlevées par les ordres de don Augustin de Mexia, commandant de l’armée du roi. On en avait besoin pour transporter dans la montagne les approvisionnements et surtout les munitions de guerre.
Escobar, en homme de résolution, prit sur-le-champ son parti, celui d’aller à pied, persuadé qu’il trouverait des moyens de transport de l’autre côté de l’Albarracin, à Cuença, qui était une ville de fabrique, une ville de ressources.
Il se mit donc à gravir intrépidement la montagne, qui dans cet endroit n’est pas très-escarpée, car c’est le point où la chaine commence à s’abaisser et à descendre dans la plaine.
Complétement absorbé par les projets qu’il méditait, il suivait un sentier qui s’était offert à lui, à sa gauche, lorsqu’il fut arrêté au milieu de sa marche et de ses réflexions par la voix d’un fantassin espagnol qui lui criait :
— Holà ! mon révérend, Votre Seigneurie veut-elle ajouter un martyre de plus à notre glorieuse légende ?
— Qu’est-ce, mon frère, dit Escobar en levant la tête, et que voulez-vous dire ?
— Que le sentier que vous prenez conduit droit à l’ennemi, à qui votre présence ferait grande joie, car ils aiment surtout les robes de moines.
— En vérité !
— Ils en ont brûlé, dit-on, une douzaine avant-hier.
— Si ce n’est que la robe, mon frère…
— Avec les religieux qui étaient dedans, ajouta le soldat en riant militairement.
Escobar fit le signe de la croix et redescendit vivement le sentier.
— Quelle route faut-il prendre pour aller à Cuença ?
— Celle qui est devant vous, et ne vous en écartez pas.
Le bon père n’avait garde de manquer à ce conseil. Il doubla le pas, et au bout d’une demi-heure de marche il entendit un si grand bruit, des cris, des vociférations et surtout des jurements si énergiques, qu’il crut être tombé dans une embuscade de Maures ou de réprouvés. Il venait de rencontrer un détachement espagnol commandé par Diégo Faxardo, un des lieutenants d’Augustin Mexia.
Le détachement, composé de sept à huit cents hommes bien armés, avait fait halte.
— Oui, Gonzalès, j’ai été ce matin à la chasse dans la montagne, s’écriait un jeune soldat, et j’en ai abattu cinq, dont deux femmes et trois enfants. Cela compte tout de même, le grand inquisiteur Sandoval nous l’a dit.
— C’est possible, Léonardo, répondait un de ses camarades, mais tu as tant de péchés arriérés à expier, sans compter le courant !
— Qu’importe ? tant qu’il y aura des Maures, il y aura toujours des absolutions à gagner.
— Et ils sont beaucoup, à ce qu’on dit !
— Sans armes, sans munition, et presque sans chefs, excepté ce Yézid d’Albérique, qui se bat bien.
— Et dont la tête vaut mille ducats !
— Ce serait bon à prendre.
— Dieu et Notre-Dame del Pilar nous en feront la grâce. En attendant, il peut nous arriver de bonnes aubaines, témoin la nuit dernière.
— Que vous est-il arrivé ?
— J’étais de l’expédition du capitaine Diégo Faxardo, et imagine-toi, Léonardo, un feu de joie magnifique… c’était la Saint-Jean… et nous avons brûlé en son honneur…
— Un cierge ?
— Non, tout un village, celui de Barredo.
— Et je n’étais pas là !
— Nous avions tué ou fait prisonniers les Maures qui avaient essayé de se défendre.
— Ceux que je viens de voir…
— Tu l’as dit. Pendant ce temps, leurs femmes s’étaient toutes réfugiées dans une vieille tour.
— Et je n’étais pas là ! répéta le jeune soldat.
— Des femmes superbes, que nous avons faites également prisonnières.
— Sans condition ?..
— Au contraire, à condition !..
— C’était très-mal, mes frères, s’écria Escobar, qui, arrivé depuis quelques instants, venait d’entendre cette conversation.
— Vous avez raison, mon père, répondit Gonzalès en s’inclinant avec respect, car la robe de moine ne perdait jamais son privilége sur le soldat espagnol. C’est un péché ; notre aumônier, le frère Géronimo, nous l’a bien dit, un péché mortel, de contracter alliance avec les filles des Philistins et des Madianites ; aussi, c’est le ciel qui vous envoie, mon père, pour m’en donner l’absolution.
— Moi, s’écria Escobar, vous absoudre d’un tel crime !
— Nous l’avons expié, mon père, reprit vivement le soldat ; sans cela, je n’implorerais pas la clémence divine. Mais rassurez-vous, ce matin même le péché a été expié, il n’en reste plus de trace.
— Que voulez-vous dire ?
— Que les filles et les femmes des Philistins…
— Eh bien ?
— Toutes massacrées ! au nom de la foi !
Escobar poussa un cri d’horreur et recula d’un pas.
— Qu’est-ce, dit Gonzalès, en le regardant de travers et en portant la main à son épée, est-ce que vous ne seriez pas un véritable moine ?
— Si, mon frère, si vraiment ! répondit vivement le prieur.
Et tout en tremblant, il étendait la main vers le soldat, qui s’inclinait devant lui, lorsque par bonheur, on entendit un roulement de tambours.
Chacun courut reprendre son rang.
C’était don Augustin de Mexia qui arrivait, monté sur un beau cheval andalous ; le général était entouré de plusieurs officiers et suivi de trois ou quatre cents hommes qui escortaient un convoi considérable.
Le moine se retira à l’écart près d’un arbre, et don Diégo Faxardo s’avança vers son général.
Augustin de Mexia était un homme d’une cinquantaine d’années, d’une taille moyenne, d’une physionomie grave et sévère. Officier expérimenté, il faisait la guerre depuis trente ans, et s’était distingué surtout dans les Pays-Bas. Espagnol de la vieille roche, il parlait peu, se battait bien, commandait encore mieux, ne donnait rien au hasard et savait attendre pour réussir plus vite.
Son lieutenant, don Diégo Faxardo, lui ressemblait peu ; la bravoure, la jactance et l’orgueil espagnols brillaient en lui au plus haut degré. Quelques duels heureux avaient tellement exalté chez lui la fatuité de la valeur, que rien, c’était là sa conviction, ne devait lui résister, et qu’avec son épée il pouvait arrêter toute une armée.
— Seigneur Faxardo, lui dit gravement don Augustin, vous allez, avec les huit cents hommes que vous commandez et les quatre cents que je vous amène, remonter la montagne jusqu’à la hauteur de Huelamo de Ocana.
— Et tomber sur les rebelles ?
— Non ; vous tournerez sur votre droite, pour vous établir entre un des plateaux de l’Albarracin et Teruel.
— Et de là disperser toute cette canaille mauresque ?
— Non ; avec la munition et l’artillerie que je vous amène, vous attendrez.
— Attendre ! monseigneur… nous, des Espagnols ! attendre quand l’ennemi est là !
— Vous attendrez, reprit gravement le général, que don Fernand d’Albayda, à qui j’ai ordonné le même mouvement sur l’autre versant de la montagne, soit à peu près arrivé au même point en se dirigeant par Culla et Benasal.
— Votre Seigneurie, en les traitant avec tant de cérémonies, fait bien de l’honneur à de misérables révoltés, indignes du nom de soldats.
Don Augustin, sans écouter l’observation de son lieutenant, continua avec la même gravité :
— Don Fernand leur fermera ainsi la retraite du côté de la mer ; le brigadier Comara du côté de l’Aragon ; tandis que moi, avec le principal corps d’armée rassemblé à Hueté, j’attaquerai.
— Et moi, général ?
— Vous, Diégo, vous n’aurez qu’à attendre les rebelles, que nous pousserons vers vous. Retranché dans de fortes positions, avec l’artillerie que je vous confie, il vous sera facile de les exterminer.
— Trop facile, monseigneur, et si Votre Excellence voulait me permettre de lui soumettre une autre idée, beaucoup plus expéditive…
— Parlez.
— Ce serait de balayer moi-même toute la montagne, avec quelques centaines de fantassins. J’ose dire que les Mauresques, qui me connaissent, ne tiendront nulle part devant moi. Je ne demanderais même à la rigueur, contre de tels ennemis, que quelques alguazils et un corrégidor avec sa baguette, car ils ne méritent point que l’épée d’un gentilhomme sorte pour eux du fourreau.
— Vous ne savez pas, comme moi, ce que c’est que la guerre des montagnes, et vous ne connaissez pas le nombre des rebelles.
— Il est vrai, monseigneur, poursuivit fièrement don Diégo, que je n’ai pas l’habitude de compter mes ennemis ; mais je sais ce que nous valons, je sais que c’est un affront pour des soldats espagnols, de les envoyer combattre sérieusement des laboureurs, des ouvriers, des fabricants de draps ou d’étoftes ; et, pour ma part, je déclare à Votre Excellence qu’avec de tels adversaires, je n’emploierai que le plat de mon épée.
— Comme vous l’entendrez, seigneur Diégo, pourvu que mes ordres soient exécutés.
Don Augustin de Mexia s’éloigna au galop, suivi de ses officiers, et le jeune capitaine, rouge encore d’indignation et d’orgueil, mais forcé d’obéir, ordonna à ses soldats de se préparer à gravir la montagne.
On avait formé les rangs et l’on se disposait à partir ; quelques fantassins qui formaient l’avant-garde étaient déjà engagés dans une espèce de défilé ; un jeune muletier, embusqué derrière un rocher, s’élança sur le soldat Gonzalès, celui auquel Escobar n’avait pas eu le temps de donner l’absolution, et il était écrit sans doute qu’il ne la recevrait pas, car le poignard du muletier le frappa mortellement et le fit rouler sanglant sur la poussière.
Les compagnons du blessé se saisirent du meurtrier, qu’ils trainèrent devant leur commandant.
— Qui es-tu ? demanda celui-ci au prisonnier, qui portait la tête haute et fière.
— On me nomme Aben-Habaki. J’étais ouvrier chez le noble Delascar d’Albérique ; n’ayant plus ni ouvrage ni patrie, j’ai été retrouver à la montagne notre chef Yézid, son fils, et je me suis fait soldat.
— Tu veux dire brigand.
— Les brigands, ce sont ceux qui prennent, et les Espagnols m’ont tout enlevé. Il me restait ma femme, qui s’était réfugiée au village de Barrepo, avec d’autres de ses compagnes. J’y suis arrivé ce matin sous ce déguisement pour la voir, pour l’embrasser. Le village avait été brûlé, toutes nos femmes massacrées. C’étaient des soldats espagnols qui avaient commis ce crime pour plaire au Dieu des chrétiens et mériter ses bénédictions. Ils étaient là plusieurs qui s’en vantaient, entre autres ce Gonzalès, que je reconnais bien. Je l’ai suivi de loin, et tout à l’heure, qu’Allah en soit loué ! il est tombé sous mon poignard. Je n’ai qu’un regret.
— Et lequel ?
— De n’avoir pu frapper que lui. Le Dieu d’Ismaël me devait mieux que cela. N’importe ! d’autres s’en chargeront.
Le sort du pauvre Habaki ne pouvait être douteux. On ne l’immola point par le fer, il n’aurait pas eu le temps de souffrir, mais il fut décidé qu’on le brûlerait à petit feu.
Et pendant les apprêts de son supplice :
— Puissions-nous traiter ainsi tous les siens ! s’écria Diego Faxardo. Mais, par malheur, ils sont cachés dans la montagne et il ne nous est pas permis de les poursuivre ; il nous faut les attendre. Mais si, chemin faisant, et sans désobéir au général, nous pouvions les rencontrer et les joindre…
— Que donneriez-vous pour cela ? s’écria vivement le Maure, en levant la tête, qu’il avait tenue baissée jusque-là.
Et il regardait attentivement Diégo et ses soldats, qu’il avait l’air de compter.
— Ce que je te donnerais ? répondit le capitaine, pas grand’chose ! ta vie, par exemple !
Le Maure fit un mouvement de joie.
— Entendons-nous ! à condition que tu me conduiras dans l’endroit de la montagne où sont cachés tes frères ?
— J’y consens.
— À condition que tu nous les livreras tous ?
— Oui, tous ! s’écria vivement Habaki, à l’instant même.
— Vous l’entendez, dit en riant le capitaine Diégo ; vous voyez de quoi les Maures sont capables : pour sauver ses jours, il ferait pendre tous ses frères, le lâche !
Haben-Habaki lui lança un regard d’indignation qui semblait dire : tu te trompes, je ne suis pas un lâche.
Mais ce regard, il se hâta de le réprimer et dit en regardant le soleil, qui dardait ses rayons sur la montagne :
— Que voulez-vous, seigneur cavalier, c’est si beau à voir, le soleil !
— Bien ! bien ! poursuivit le capitaine à ses soldats, éteignez ce brasier qui déjà commençait à flamboyer. Liez le prisonnier, qui marchera à côté de moi. Toi, Léonardo, charge ton escopette, et à la première tentative de fuite ou de trahison, feu sur ce misérable.
— C’est ce que je demande, répondit Habaki, et maintenant suivez.
— Soldats, à vos rangs ! en avant ! cria le capitaine.
Et les douze cents hommes, les bagages, les munitions et l’artillerie commencèrent à gravir la montagne lentement et en bon ordre.
LXVIII.
don augustin de mexia.
L’adroit prieur de la Compagnie de Jésus avait obtenu tout ce qu’il désirait, le maintien de son ordre, et de plus la protection du duc de Lerma, l’alliance de la sainte inquisition, enfin la ruine probable des anciens amis qui l’avaient abandonné ou trahi. Mais, en vainqueur modeste et prudent qui songe bien plus à profiter de ses succès qu’à s’en vanter, il se dirigea droit vers Alcala de Hénarès, s’empressa d’aller confier ces bonnes nouvelles au père Jérôme, et en attendit pieusement auprès de lui les effets.
Quant au grand inquisiteur, certain désormais d’imposer silence à toutes les calomnies, assuré de pouvoir se justifier, ainsi que son frère, aux yeux de l’Espagne et de la cour de Rome, il se hâta de terminer les affaires qui le retenaient dans le royaume de Valence, et choisit le chemin le plus court pour retourner à Madrid.
Il n’eut garde d’oublier la précieuse déclaration signée du père Jérôme et d’Escobar ; il la prit avec lui, et la relut plus d’une fois en voyage. Sa seule préoccupation était de trouver un moyen de ménager l’honneur de sa famille, et d’arriver à un jugement équitable, lequel permit de condamner la comtesse d’Altamira et d’acquitter le duc d’Uzède.
Piquillo, que nous avons laissé à Carascosa, au pied de l’Albarracin, voulait, le jour même du départ d’Escobar, se remettre également en route, mais il reçut le matin même des dépêches du roi, auxquelles il lui fallut répondre.
Pendant qu’il écrivait, Gongarello vint d’un air effrayé lui annoncer une partie des nouvelles qui se répandaient dans le pays ; le pillage, la prise et les massacres de Barredo ; les troupes qui se rassemblaient autour de l’Albarracin, dernier rempart des Maures, et les mesures prises par le redoutable Augustin de Mexia ; il avait, en effet, promis au duc de Lerma de finir cette guerre en peu de jours par l’extermination totale des rebelles ; et tout faisait craindre qu’il ne tint parole.
Gongarello connaissait les montagnes de l’Albarracin, il y avait passé une partie de sa jeunesse, et, excepté quelques endroits escarpés propres aux embuscades ou quelques grottes pouvant servir de retraite, il n’y avait guère moyen, comme dans les Alpujarras, d’y résister longtemps à une armée nombreuse et disciplinée.
Piquillo frémit en pensant à Yézid, qui, avec des soldats sans expérience et presque sans armes, avait à lutter contre ces vieilles bandes espagnoles guerroyant depuis vingt ans en Italie, en France et dans les Pays-Bas. L’issue de la lutte ne pouvait, par malheur, être longue ni douteuse, et le pauvre moine, ne voyant aucun espoir de faire triompher les Maures ses frères, dont il regardait la cause comme perdue, cherchait seulement à obtenir pour eux un pardon, une amnistie, ou du moins les conditions les plus favorables. Il écrivait dans ce sens au roi, mais sans se dissimuler que Sa Majesté, abandonnée à elle-même, et en présence de l’opposition du duc de Lerma, ne se trouverait pas sans doute le courage de faire grâce. Il avisait donc à d’autres moyens plus efficaces lorsqu’un grand bruit se fit entendre en dehors de l’hôtellerie.
C’était le reste des habitants de Barredo, une soixantaine de prisonniers maures que la colonne du capitaine Diégo avait arrachés la veille à leur village embrasé ; ils étaient escortés par quelques soldats espagnols, et presque toute la population de Carascosa les poursuivait avec des huées, des malédictions et des pierres.
Ces malheureux étaient dans un état déplorable, couverts de boue et de sang, accablés de fatigue et pouvant à peine se traîner.
— Où les conduisez-vous ? demanda Piquillo au sergent qui commandait le détachement.
— À Hueté, où nous devons être rendus ce soir, répondit le sergent Molina Chinchon, un des derniers débris de l’ancienne infanterie espagnole.
— Ils ne pourront jamais marcher jusque-là.
— C’est l’ordre de don Augustin de Mexia, et avec lui, qu’on le puisse ou non, il faut marcher ; il n’a jamais pardonné en sa vie une désobéissance ou une faute contre la discipline.
— Accordez-leur du moins de s’arrêter quelques instants dans cette hôtellerie ; il y a, au fond de la cour, une vaste grange où le seigneur hôtelier leur permettra de se reposer et de se rafraichir.
— Volontiers, s’écria le maître de la posada, Mosquito, qui, connaissant déjà l’humeur généreuse de frey Alliaga, voyait en perspective une occasion de forte dépense, attendu que les prisonniers tombaient tous d’inanition.
— Mais l’ordre de mon général ? répondit Molina Chinchon.
— Mais celui de Son Excellence frey Luis Alliaga, confesseur du roi, répliqua l’hôtelier.
— Et si mon général le sait…
— Il ne le saura pas !
— Il me donnera les arrêts ou la prison.
— Son Excellence vous donnera sa bénédiction, et moi un bon dîner et une bouteille de vin de Benicarlo.
— En vérité ! dit le sergent, qui se mourait de soif.
— Et une dernière considération.
— Laquelle ?
— Vous ferez, sergent, un acte d’humanité.
— Ça ne m’effraie pas… au contraire !.. cela seul me détermine, répondit le vieux soldat.
Mais il était aisé de voir que la bouteille de benicarlo aurait suffi.
Les prisonniers furent conduits dans la grange, au grand désappointement de la population de Carascosa, que l’on privait ainsi du plaisir de les maltraiter, et le peuple espagnol tient à ses plaisirs.
On se hâta, par l’ordre de Piquillo, de satisfaire à
leurs premiers besoins, et le sergent, oubliant un instant
les rigueurs de la discipline, s’attabla joyeusement
dans la cuisine, à côté du seigneur Mosquito, qui
voulut absolument tenir compagnie à son hôte, 
Il passa dévot, tenant un flambeau à deux branches.
La bouteille de benicarlo n’était pas à moitié sablée, qu’un bruit de chevaux et de cavaliers se fit entendre, et le verre plein jusqu’aux bords manqua de s’échapper de la main tremblante du sergent : il venait de reconnaitre don Augustin de Mexia et son escorte.
Depuis le matin, l’actif général avait successivement visité tous ses postes, distribué ses ordres et surveillé par lui-même la marche des différents corps qui, à plusieurs lieues de distance et dans diverses directions, gravissaient la chaine de l’Albarracin, pour cerner et entourer la faible armée commandée par Yézid.
Le sergent Chinchon expliqua à voix basse à l’hôtelier comme quoi il était perdu, et l’hôtelier monta rapidement un petit escalier qui conduisait à l’appartement de frey Luis Alliaga, auquel il raconta la chose.
Celui-ci répondit :
— Priez sa seigneurie don Augustin de Mexia de vouloir bien me faire l’honneur de dîner avec moi, et veillez, seigneur Mosquito, à ce que ce repas soit digne de lui et de vous.
L’hôtelier, enchanté de cette mission et surtout du nouveau dîner qu’on aurait à lui payer, se hâta de transmettre au général l’invitation du confesseur de Sa Majesté.
La journée était déjà avancée. Don Mexia, après avoir donné ses derniers ordres aux cavaliers de son escorte, qui partirent sur-le-champ pour les exécuter, se dirigea vers l’appartement de frey Alliaga.
Celui-ci reçut de son mieux l’austère et fier hidalgo, et pour le flatter autant que pour détourner son attention du sergent et des prisonniers, il mit la conversation sur son plan de campagne.
Dur, froid et poli comme l’acier de son épée, le général expliqua gravement, sur la carte, la manière dont il comptait exterminer les rebelles, les marches et contre-marches qu’il avait méditées et les positions qu’il avait fait prendre, le tout au point de vue stratégique, les hommes, bien entendu, n’étant comptés pour rien.
En l’écoutant, Alliaga sentait une sueur froide découler de son front. Il lui semblait impossible que Yézid ni aucun des siens pussent se soustraire au sort qui les menaçait. C’était leur arrêt qu’il venait d’entendre.
C’est dans ce moment que l’hôtelier, le bonnet à la main et la serviette sous le bras, vint avertir leurs excellences que le banquet était servi et qu’on les attendait dans la salle du festin.
Pendant le temps qui venait de s’écouler, les pauvres prisonniers maures avaient pu du moins se reposer et reprendre des forces. Grâce au ciel, le général n’avait encore aperçu ni eux ni le sergent, qui n’avait eu garde de se montrer. Par malheur, l’appartement d’apparat, le plus beau de la maison, celui où était servi le dîner, avait trois fenêtres qui donnaient sur la rue, et l’on entendait les vociférations du peuple réclamant les victimes qu’on lui avait enlevées.
— Qu’est-ce cela ? demanda tranquillement Mexia, qui, au milieu de ces cris confus, ne distinguait rien.
— Une querelle sans doute, répondit Alliaga ; quelques muletiers ou portefaix de la ville qui se battent entre eux.
— Très-bien, répondit le général en s’asseyant vis-à-vis du jeune moine.
Et il se mit à dîner sans faire plus d’attention au tapage effroyable qui avait lieu dans la rue que si le plus profond silence eût régné autour de lui.
Cet admirable sang-froid rassura un instant Alliaga.
Mais bientôt les orateurs du dehors ne se contentèrent pas de crier : les gestes s’en mêlèrent et devinrent des plus expressifs. Des carreaux de la salle furent brisés, et un caillou tomba même sur la table du festin.
Le général leva la tête et dit froidement à Mosquito :
— Faites-moi venir un alguazil.
— Mais, monseigneur… balbutia l’hôtelier interdit, et qui, d’une main tremblante, lui présentait en ce moment une assiette.
— Je vous ai demandé un alguazil.
— J’entends bien… monseigneur… il y en a même deux en bas… qui sont venus pour me parler.
— Montez-en deux.
— Ce ne sera pas assez.
Le général ne daigna pas même lui répondre ; il lui lança un regard qui disait si nettement : Obéissez ! que l’hôtelier ne trouva plus une seule objection et s’empressa de sortir.
Don Augustin, avec le même flegme, la même gravité espagnole, continua son dîner, s’interrompant seulement de temps en temps pour boire à la santé de son convive.
La porte s’ouvrit de nouveau et parurent deux alguazils. L’un n’était pas un étranger pour Alliaga, qui cherchait à se rappeler où cette physionomie avait frappé sa vue ; mais le barbier Gongarello, qui se tenait debout derrière son patron, l’avait déjà reconnu, et pour cause : c’était l’alguazil qui, quelques jours auparavant, le conduisait lui-même prisonnier et avait voulu le pendre. Il murmura son nom à l’oreille de Piquillo.
— Ah ! Cardenio de la Tromba ! s’écria le confesseur du roi, c’est vous que je revois ? est-ce que déjà vous êtes de retour de Valence ?
— Non, monseigneur, les prisonniers que vous m’aviez commandé d’y conduire m’en ont épargné la peine.
— Comment cela ?
… Vous m’aviez ordonné de défaire les liens qui les tenaient garrottés ; on ne parlait, tout le long de la route, que des rebelles rassemblés dans l’Albarracin, sous les ordres d’Yézid d’Albérique…
— En vérité ? dit le général.
— Et quand nous nous sommes approchés de la montagne, mes prisonniers ont tenté de s’évader ; nous n’étions que douze alguazils armés d’escopettes…
— Et vous n’avez pas fait feu ? s’écria don Mexia.
— Si vraiment, monseigneur, et, excepté les douze que nous avons tués, tous les autres ont été rejoindre Yézid.
— Il n’y a pas grand mal, continua le général, nous les retrouverons avec lui, et aucun n’échappera cette fois, je vous le jure. En attendant, monsieur l’alguazil, ayez pour agréable de faire éloigner la foule qui est devant cette maison, et dont le bruit pourrait incommoder le révérend frey Alliaga, confesseur de Sa Majesté.
— Nous avons déjà essayé, monseigneur, et nous n’avons pas pu : ils veulent absolument…
— Quoi ?… Que veulent-ils ?
— Qu’on leur livre les prisonniers.
— Lesquels, monsieur l’alguazil ?
— Ceux que conduisait le sergent Molina Chinchon.
Don Mexia haussa les épaules et répondit :
— Ils doivent à l’heure qu’il est être arrivés à Hueté. Qu’on aille les y chercher si on veut, mais je doute qu’on les y trouve.
— Et moi aussi, se dirent Gongarello et l’hôtelier.
— Car l’ordre du duc de Lerma, continua don Mexia, est de les faire passer par les armes à leur arrivée.
Alliaga ne put retenir un cri d’effroi, et sa seconde pensée fut un remercîment à la Providence, qui lui avait inspiré l’idée de retenir ces malheureux.
— Passés par les armes ! répéta-t-il.
— Tels sont les ordres du ministre et du roi, répondit Mexia avec le même calme et sans interrompre son repas.
Puis s’adressant aux alguazils :
— Annoncez cela, messieurs, aux bourgeois de cette ville ; cela leur suffira, je pense.
— Non, monseigneur, ils n’en croiront rien.
— Et pourquoi, s’il vous plaît ?
— Parce que ces prisonniers sont encore ici, dans cette hôtellerie, enfermés dans la grange qui est au fond de la cour.
— Le sergent qui les conduisait a donc été tué ? dit gravement le général.
— Non, Excellence, répondit timidement l’hôtelier, il vient de dîner avec moi.
— Faites monter le sergent… à l’instant même.
— Il est inutile de l’interroger, seigneur don Augustin, s’écria Alliaga, c’est moi qui suis seul coupable ; c’est moi qui l’ai engagé à accorder quelques heures de repos à ces malheureux qui n’avaient plus la force de continuer leur route.
— Votre Excellence a fait son devoir comme ministre du Seigneur ; Molina Chinchon n’a pas fait le sien comme sergent. Il ira demain, pour quinze jours, au cachot, et en attendant, dit-il à l’alguazil, ordonnez-lui de ma part de se remettre en route avec ses prisonniers.
— Mais le peuple va les massacrer ! s’écria Alliaga.
— Cela regarde le sergent, qui en répond et qui doit les conduire ce soir à Hueté. Il a de la tête et du cœur et en viendra à son honneur, j’en suis certain.
— Et s’il y réussit, ces malheureux n’arriveront que pour être passés par les armes ?
— Nous autres militaires, nous obéissons et ne raisonnons pas.
— Égorger des prisonniers sans défense… un tel ordre…
— Est fâcheux, mais non déraisonnable. Ces ennemis-là, du moins, comme ceux que Votre Seigneurie a délivrés l’autre jour, n’iront pas rejoindre Yézid et les révoltés, que nous sommes chargés de combattre.
— Seigneur Mexia, vous ne prendrez pas sur vous une telle responsabilité, vous suspendrez l’exécution de cet ordre jusqu’à ce que j’en aie écrit à Sa Majesté. Je vous le demande, je vous en prie.
— Je suis désolé d’être obligé de refuser à Votre Seigneurie.
— Eh bien ! au nom du roi, je vous le défends.
— Et de quel droit ? s’écria le fier Castillan.
— Du droit que Sa Majesté m’a donné elle-même. Lisez plutôt !
Il lui remit l’ordre, écrit de la main de Philippe III, qui prescrivait à tous ceux qui le liraient d’obéir à frère Luis Alliaga.
Don Augustin se mordit les lèvres et répondit :
— J’ignore si l’autorité conférée au confesseur de Sa Majesté ne doit pas être limitée aux choses de l’Église et peut s’étendre jusque sur les officiers et soldats du roi, mais ce que je sais, c’est que les instructions que j’ai reçues sont signées, non-seulement du ministre, mais encore de mon souverain lui-même. Et dans le doute où me place ce conflit de pouvoirs et d’ordres contradictoires, je dois obéir d’abord à ceux qui m’ont été directement adressés.
En ce moment les cris redoublèrent ; des flambeaux brillèrent dans la rue et dans la cour de l’hôtellerie, dont le peuple venait de franchir les murs. Son intention évidente était de mettre le feu à la grange où les Maures étaient renfermés.
LXIX.
saint loyola et saint dominique.
Voici par quels moyens Escobar, après l’inutile tentative qu’il avait faite sur l’esprit de Piquillo, était parvenu à conclure une sorte de traité d’alliance entre sa compagnie et la sainte inquisition.
Pendant les dernières scènes que nous avons décrites, à la suite de son entrevue avec le jeune confesseur du roi, Escobar s’était d’abord tenu à l’écart, peu à peu il s’était éloigné du détachement de soldats qu’il avait rencontré en route, et descendait rapidement la montagne, pendant que les troupes du capitaine Diégo suivaient au contraire un mouvement ascensionnel.
Bientôt il les eut perdus de vue, à sa grande satisfaction.
Escobar plaçait trop haut l’esprit, l’adresse, la puissance du raisonnement et de l’argumentation pour estimer la force matérielle et brutale ; les questions qui se décidaient par l’épée lui semblaient indignes d’une nature intelligente, telle que la nôtre. Les animaux féroces ne savent qu’égorger ; l’homme seul sait tromper ! C’était là, selon lui, la preuve de sa supériorité morale et sa véritable mission.
Le révérend père arriva le soir même à Cuença, et s’informa du grand inquisiteur. Il n’était point à Valence, comme il le croyait, et le voyage qu’il avait à faire se trouvait abrégé. Sandoval s’était rendu au Val-Paraiso, dans l’habitation du Maure.
Les propositions que Delascar d’Albérique avait faites au ministre pour empêcher la publication de l’édit ; les régiments et la flotte qu’il avait promis d’entretenir ; les douze millions de réaux qu’il s’engageait à verser immédiatement dans les coffres de l’État et deux autres millions dans la caisse du duc de Lerma, tout cela annonçait des richesses immenses, qu’il fallait bien se garder de laisser sortir du royaume.
Le bruit courait que Delascar était parti avec ses trésors. Il n’en était rien.
Le vice-roi de Valence, le marquis de Cazarena, avait eu l’ordre de visiter soigneusement la tartane qui emportait la famille d’Albérique et n’avait rien trouvé.
Toute cette fortune était donc restée cachée dans quelqu’une des habitations du Maure. Les soupçons s’étaient dirigés tout naturellement sur le magnifique domaine de Val-Paraiso, demeure favorite du vieux négociant.
C’est dans cette idée que Sandoval s’y était transporté. Mais toutes ses recherches avaient été vaines.
Il avait bien trouvé une habitation royale, des tableaux des grands maîtres, des statues, des vases de bronze ou de marbre, des trésors comme objet d’art, mais de l’or ou de l’argent monnayé, il n’y en avait aucune trace.
D’Albérique et son fils connaissaient seuls le souterrain des rois maures, et la reine, fidèle à son serment, avait emporté avec elle ce secret dans la tombe. Ces trésors allaient donc être perdus.
Il en était à peu près de même dans toute l’Espagne.
Les Maures, avant de partir, avaient enfoui leurs richesses, aimant mieux, au risque de ne jamais les retrouver, les laisser au sein de la terre qu’aux mains de leurs persécuteurs.
Quelques-uns avaient trouvé moyen, par des banquiers juifs, de faire passer une partie de leur fortune en pays étranger. Les ambassadeurs de France et d’Angleterre avaient eux-mêmes reçu une masse énorme d’argent et de lettres de change, et malgré les menaces du duc de Lerma, qui parlait de saisir leurs malles, les priviléges et le droit d’ambassade furent respectés[35].
L’expulsion des Maures n’avait donc pas produit, sous le rapport financier, les résultats qu’on en avait espérés. Il n’y avait de positif et de réel jusqu’alors que l’odieux d’une pareille mesure et la réprobation universelle qu’elle avait causée.
Le grand inquisiteur, désappointé et furieux, venait en outre de recevoir de terribles nouvelles. Le cri général qui s’élevait contre lui et contre le duc de Lerma, au sujet de l’empoisonnement de la reine, prenait chaque jour de nouvelles forces ; au bruit de pareilles clameurs, il n’y avait pas moyen de fermer plus longtemps l’oreille. D’ailleurs, les lettres qu’il recevait de toutes parts, et de la cour de Rome et du duc de Lerma lui-même, ne lui permettaient plus d’ignorer le crime dont la voix publique les accusait tous deux. On leur disait, on leur écrivait :
— Justifiez-vous. Prouvez votre innocence.
Mais comment se justifier ?.. Comment donner des preuves authentiques et évidentes ? Où les trouver ? À qui les demander ? Le grand inquisiteur et le ministre ne savaient quel parti prendre, et cependant ils comprenaient tous les deux la nécessité d’une grande manifestation et d’un appel à la nation espagnole ; sans cela ils étaient perdus, et malgré le roi, qu’ils tenaient en tutelle, malgré leur autorité toujours croissante, l’opinion publique, plus puissante qu’eux encore, finirait par les renverser.
Le grand inquisiteur était dans cette disposition d’esprit et en proie à toutes ces inquiétudes, lorsqu’il reçut au Val-Paraiso un billet ainsi conçu :
« Si Votre Excellence veut connaitre un secret qui intéresse au plus haut point la sureté de l’État, celle du grand inquisiteur et celle du cardinal-duc, elle est suppliée de vouloir bien accorder quelques instants d’audience à l’ami dévoué qui a tracé ce billet, et qui attend avec impatience la réponse. »
— Un ami dévoué ! s’écria Sandoval ; qu’il entre ! qu’il entre !
La porte du cabinet s’ouvrit, et le grand inquisiteur vit paraitre devant lui le prieur de la Compagnie de Jésus.
— Vous ici, frère Escobar, vous !
— Moi-même, monseigneur.
— Ce billet n’est donc pas de votre main ? dit Sandoval avec ironie, car il me parlait d’un ami dévoué.
— C’est comme tel que je viens.
— Ou plutôt comme suppliant, car je sais ce qui vous amène mais il n’est plus temps.
Sandoval, prenant alors un parchemin jeté sur sa table au milieu de beaucoup d’autres papiers, ajouta en souriant, autant qu’un inquisiteur peut sourire :
— Vous voyez que je m’occupais de vous, seigneur Escobar, et je ne suis pas le seul. Il a été question dernièrement au conseil du roi des révérends pères de la Compagnie de Jésus.
— Je le sais, monseigneur.
— Notre bien-aimé neveu, le duc d’Uzède, a été chargé de faire un rapport sur votre congrégation, sur sa morale et sur ses principes ; ce rapport est fait et très-bien fait.
— Monseigneur le duc d’Uzède a tant d’esprit !
— Il n’en manque pas.
— Il a de qui tenir.
— Ce rapport est clair, précis, véridique, en un mot foudroyant pour vous. Il conclut à l’expulsion immédiate de votre ordre en vous permettant de vous retirer où vous le jugerez convenable.
— Monseigneur le duc d’Uzède est bien bon.
— Ces conclusions ont été adoptées par le duc de Lerma, qui m’a envoyé ce rapport signé de lui ; il va l’être par moi et envoyé à Sa Majesté, dont le consentement et la signature sont probables.
— C’est-à-dire certains ! le roi signera sans lire !
— C’est assez son ordinaire, et dans quelques minutes, continua Sandoval (en préparant un cachet et de la cire devant une bougie qui brûlait tout allumée sur son bureau de travail), dans quelques minutes cette dépêche sera partie.
— Non, monseigneur, dit froidement Escobar, elle ne partira pas.
Le grand inquisiteur le regarda d’un air étonné, comme doutant de ce qu’il venait d’entendre. Puis il s’écria en fronçant le sourcil :
— Qu’est-ce à dire, seigneur Escobar ?
— Que Votre Excellence est comme le duc d’Uzède son neveu ; elle a trop d’esprit pour renvoyer du royaume des gens qui peuvent seuls, dans ce moment, sauver son honneur et celui du duc de Lerma, prouver votre innocence à tous deux et affermir à jamais votre pouvoir.
— Parlez, s’écria vivement Sandoval, dont les yeux : brillaient de joie, parlez, mon père.
— Cela m’est impossible tant que j’aurai là devant les yeux cet objet qui me trouble et me fait perdre la suite de mes idées.
Il montrait du doigt le parchemin.
— Je comprends bien, dit l’inquisiteur d’un air défiant ; mais il me faut avant tout des preuves authentiques, des preuves que je puisse publier, imprimer et répandre dans toute l’Espagne.
— C’est ainsi que je l’entends : la preuve évidente que ni vous ni le duc de Lerma n’êtes auteur ni complice de l’empoisonnement de la reine.
— C’est la vérité, je l’atteste.
— Je le sais, monseigneur.
— Mais comment le prouverez-vous ?
— D’un seul mot.
— Et lequel ?
— En nommant les vrais coupables ; en racontant, en attestant, en signant, s’il le faut, la relation exacte et véridique des faits, tels qu’ils se sont passés dans les plus petits détails et dans leur moindre circonstance.
— Je vous écoute. Parlez mon père.
— Je vous ai dit, monseigneur, ce qui jetait du trouble et de l’obscurité dans mes idées.
Le grand inquisiteur prit le rapport et l’approcha de la bougie. Le feu y prit, et pendant que la flamme le consumait :
— Je commence à y voir plus clair, dit Escobar d’une voix pateline ; cela dissipe déjà bien des nuages entre nous, non pas qu’on ne puisse aisément faire au roi un second rapport.
— Oui, certes, répéta froidement Sandoval, et sans beaucoup de peine.
— Cette peine, répondit Escobar d’un air affectueux, j’ai voulu même vous l’éviter.
— Qu’est-ce que cela signifie ?
— Que ce second rapport je l’ai fait moi-même et le voici :
Il présenta au grand inquisiteur un papier ployé en quatre, que celui-ci ouvrit et parcourut avec impatience.
C’était bien réellement un rapport au roi, dans lequel les vertus, les talents et la piété de la Compagnie de Jésus étaient exaltés outre mesure. On y parlait surtout, avec éloge, des services que, dans l’université d’Alcala, elle rendait à la jeunesse.
On y démontrait enfin l’utilité, la nécessité même de l’existence des bons pères, et la sainte inquisition elle-même concluait à leur maintien, ad æternum, dans le royaume d’Espagne.
— J’entends, j’entends, dit Sandoval avec un mouvement d’humeur. Puis, se reprenant, il ajouta d’un air fort gracieux : Il est possible que je ne repousse pas, que même j’approuve… et que je signe ce rapport ; mais ce n’est pas dans ce moment, c’est plus tard, c’est quand j’aurai apprécié l’importance des faits que vous avez à m’apprendre ; car, jusqu’à présent, je ne puis avoir confiance en vous qu’à moitié.
— Soit, monseigneur, je ne puis mieux faire que d’imiter Votre Excellence, et je ne vous découvrirai alors que la moitié de mon secret.
— Pourquoi pas tout entier ?
— Cela dépendra de vous… Je puis d’abord vous raconter les faits, plus tard vous dire les noms et enfin vous donner les preuves.
L’inquisiteur frémissant d’impatience et de curiosité, fit signe à frère Escobar de s’asseoir, s’approcha de lui et écouta d’une oreille attentive le récit du bon père.
— Votre Excellence se rappelle-t-elle le jour où mourut l’aumônier de la reine ?
— Qu’importe ?
— C’est bien essentiel, je vais vous dire pourquoi.
Le lendemain, qui était un dimanche, la reine n’entendit point la messe dans son oratoire ; elle se rendit à la chapelle du roi, et c’est ce jour-là que le crime fut commis. Voici comment :
L’inquisiteur rapprocha encore plus son fauteuil, et quoique les deux moines fussent seuls dans le cabinet, Escobar, par un mouvement involontaire continua à voix basse :
— La reine, en sortant de la messe, traversa les jardins pour se rendre à ses appartements ; elle était entourée d’une suite nombreuse, et le duc de Lerma marchait à côté d’elle. On était au milieu du jour et il faisait une chaleur insupportable. Sa Majesté se plaignit d’une soif ardente, et le duc de Lerma, en courtisan empressé, ou plutôt en galant cavalier, s’élança dans les appartements de la reine, qui étaient proches et qui donnaient sur les jardins.
Il entra dans une salle basse où sommeillait une jeune fille, une dame d’honneur de la reine. À côté d’elle, sur une table de marbre était placé dans une assiette d’argent un verre d’orangeade glacée.
Cette circonstance, en apparence peu importante, demande quelques explications préliminaires, essentielles et très-importantes.
Le grand inquisiteur redoubla d’attention.
— Cette jeune demoiselle d’honneur, que je ne nommerai pas à Votre Excellence, mais qu’elle devinera sans peine, déplaisait à quelques personnes influentes de la cour, par la raison toute naturelle qu’elle plaisait trop à un très-grand personnage. Comme elle gênait par là des desseins ambitieux ou autres, on avait résolu de s’en défaire et l’on venait de mettre cette idée à exécution.
Qui, monseigneur, poursuivit Escobar, quelques instants auparavant une main adroite et inconnue de tous, excepté de moi, venait de jeter quelques gouttes de poison dans un verre d’orangeade glacée placé près de la jeune fille endormie.
On ne doutait point qu’elle ne le bût à son réveil. C’était probable, c’était certain. Le hasard en décida autrement et déjoua toutes les combinaisons.
La jeune fille, réveillée en sursaut par l’entrée du duc de Lerma, s’écria vivement :
— Qu’est-ce, monseigneur ? que voulez-vous ?
— Daignez, senora, appeler les femmes de la reine. Sa Majesté est accablée par la chaleur et meurt de soif… Hâtez-vous !
— Eh mais, voici une orangeade glacée préparée pour moi… je vais l’offrir à Sa Majesté.
— Non, non, senora, ne prenez pas cette peine. Le duc, dans l’excès de son zèle, prit des mains de la jeune fille le verre et le plateau, et le porta à la reine, qui s’avançait.
Il présenta ainsi lui-même à sa souveraine le breuvage fatal, le poison lent qui, plus tard, lui donna la mort. De là tous les bruits qui ont couru sur le ministre et sur vous-même, monseigneur ; de là l’horrible accusation qui pèse sur vos têtes.
— Je comprends, je comprends, dit l’inquisiteur, tout pâle encore de ce qu’il venait d’entendre.
— Et maintenant, acheva Escobar d’un air de bonhomie, Votre Excellence sait tout.
— Au contraire ! je ne sais rien encore, et tant que vous ne m’aurez pas dit le nom des auteurs de ce complot…
— Je croyais vous les avoir fait connaitre.
— Et non ! par saint Jacques !
— Ce sera alors quand Votre Excellence le voudra… elle n’a qu’un signe, un geste à faire.
Et de l’œil, l’adroit Escobar indiquait le rapport au roi qu’il était nécessaire de signer.
L’inquisiteur comprit et prit la plume ; il la trempa dans l’écritoire, et pendant qu’il écrivait les premières lettres de son nom, le bon père lui disait à voix basse et lentement :
— La personne qui avait jeté le poison dans le verre d’Aïxa était la comtesse d’Altamira. La personne qui avait tramé ce complot, de concert avec elle, était votre neveu, le duc d’Uzède !
L’inquisiteur poussa un cri de surprise et d’effroi, et laissa tomber de sa main tremblante la plume qui n’avait pas encore tout à fait achevé de tracer ces mots :
« Au nom du saint-office, nous, grand inquisiteur Bernard y Royas de Sandoval… »
— Ah ! se dit Escobar à part lui, j’ai parlé trop tôt.
— Mon propre neveu ! s’écria Sandoval ; le fils du ministre, le duc d’Uzède !
— Lui-même.
— Et comment le savez-vous ?
— Comment je le sais ? reprit le bon père en prenant lui-même le sceau du saint-office, qui était placé sur la table, et en le mettant sous la main de Sandoval ; comment je le sais ! Le révérend père Jérôme et moi le tenons des coupables eux-mêmes. C’est nous qui dirigeons leur conscience.
— Et ils vous ont avoué tous ces détails ?
— À nous-mêmes, répondit Escobar en cherchant Un morceau de cire verte qu’il avait aperçu sur le bureau et qu’il plaçait également à la portée de Sandoval ; c’est à nous qu’ils se sont adressés dans leur effroi pour réclamer nos conseils.
— Et qui prouvera aux autres comme à moi la vérité de ces faits ? qui en prendra sur lui la responsabilité ?
— Le père Jérôme, qui pense à tout, avait bien prévu cette judicieuse observation de Votre Excellence, car j’ai là sur moi le récit, que je viens de vous faire, écrit en entier de sa main ; je suis également prêt à l’attester et à le signer.
— En vérité ! s’écria l’inquisiteur avec joie.
— À l’instant même et sur ce bureau… mais pardon, j’empêche Votre Excellence de mettre la cire et d’apposer le sceau du saint-office à ce papier qu’elle vient de signer. Faites, monseigneur, ajouta-t-il en se reculant d’un pas, d’un air humble et doucereux, que je ne vous dérange point. Rien ne presse, j’écrirai après vous.
Le grand inquisiteur tendit alors le parchemin signé, scellé et en bonne forme à Escobar, qui, à son tour, se hâta de parapher son nom à côté de celui du père Jérôme, au bas de la terrible déclaration qui justifiait pleinement le duc de Lerma et son frère l’inquisiteur, mais qui perdait, sans rémission, le duc d’Uzède et la comtesse d’Altamira.
— Personne, excepté moi, n’a connaissance de ces faits ?
— Non, Excellence.
— Je suis le premier à qui vous en ayez parlé ?
— Je voulais, n’ayant pu pénétrer jusqu’au duc de Lerma et craignant de ne pas être admis devant vous, je voulais d’abord confier ce secret à un des vôtres, à votre âme damnée, à celui qui vous doit tout.
— Qui donc ?
— Frey Alliaga, confesseur du roi.
— Malheureux ! qu’alliez-vous faire ?
— Ce qui m’en a empêché, c’est qu’il m’a déclaré qu’il vous détestait, vous et le duc de Lerma et qu’il avait juré de vous renverser.
— Il vous a dit cela ?
— Je n’en ai pas cru un mot… mais c’est égal…
— Il vous a dit vrai.
— Ce n’est pas possible.
— Il vous a dit la vérité, l’exacte vérité.
— Alors il m’a bien trompé ! s’écria Escobar avec naïveté et pourtant d’un air un peu humilié. C’est un homme bien dangereux et bien adroit.
— À qui le dites-vous ! On ne peut jamais connaître au juste les desseins qu’il médite ou les motifs qui le font agir.
— Le moyen, en effet, de savoir sur quoi compter, s’il pousse la dissimulation jusqu’à dire parfois ce qu’il pense !
— Il s’était d’abord et de lui-même montré tout dévoué à nos intérêts, poursuivit le grand inquisiteur, il nous a même rendu d’immenses services, l’ingrat ! et maintenant il a juré notre perte.
— La nôtre aussi, répondit Escobar en levant les yeux au ciel avec une sainte indignation.
— C’est notre ennemi commun, ennemi d’autant plus redoutable que c’est nous qui l’avons placé auprès du roi.
— La main qui l’a élevé ne peut-elle pas le renverser ?
— Nous y tâcherons du moins, dit Sandoval avec un soupir.
— Et si nous pouvons vous y aider, répondit Escobar, comptez sur notre zèle et sur notre loyauté.
— J’y compte, mon père.
— Et vous faites bien, Excellence, car nous lui portons une haine implacable et vivace.
— Tels sont aussi nos sentiments.
— Qu’ils nous réunissent alors en une sainte ligue contre l’ennemi commun.
— C’est notre intérêt et le ciel qui le veulent.
— La volonté de Dieu soit faite !
Saint Dominique et Loyola se touchèrent dans la main, et la ruine de Piquillo fut jurée.
LXX.
don augustin de mexia.
Revenons à l’hôtellerie où nous avons laissé Piquillo et le général don Augustin de Mexia, au moment où la populace se précipitait dans la cour, poussant des cris de mort, armée de torches et menaçant d’incendier la grange où les prisonniers maures avaient été enfermés.
Au seul mot d’incendie, l’hôtelier sortit tout tremblant non pour les prisonniers, mais pour la récolte que renfermaient ses greniers, et pendant qu’il déployait toute son éloquence pour calmer et désarmer la foule, composée en grande partie de ses voisins et de ses amis, don Augustin de Mexia ouvrit la fenêtre qui donnait sur la cour, et aperçut le malheureux sergent et ses huit hommes rangés en bataille devant la grange.
— Sergent, lui cria-t-il, emmenez vos prisonniers, et s’il vous en manque un seul, vous en répondez sur votre tête. En avant, marche.
Après cet ordre, donné avec la même tranquillité que s’il avait assisté à une revue, le général referma la fenêtre, et revenant se rasseoir :
— Mille pardons, mon révérend, d’avoir quitté la table. Je prie Votre Seigneurie de vouloir bien oublier la contrariété que, malgré moi, je lui ai causée.
— Une contrariété ! s’écria Alliaga indigné ; n’oubliez pas, monsieur le général, que le sang de ces malheureux retombera sur votre tête.
— Soit, mon révérend, c’est le sort de la guerre, répondit tranquillement don Augustin.
— Et si, vous ou les vôtres, vous vous trouviez jamais dans une position pareille…
— Je mourrais en soldat, sans me plaindre et sans demander grâce. Puis il ajouta du même ton : Permettez-moi d’offrir à Votre Seigneurie de ce vin d’Alicante.
— Merci, monsieur le général, répondit sèchement Alliaga.
Don Augustin tenait à la main le verre qu’il venait de remplir, quand le maître de la posada entra vivement dans l’appartement, pâle, hors de lui et respirant à peine.
— Eh bien ! qu’est-ce ? qu’avez-vous, seigneur hôtelier ? demanda tranquillement le général. Ils ont mis le feu à votre grange, je m’y attendais !
— Ce ne serait rien, par saint Jacques ! c’est bien autre chose ! les Maures ! les Maures ! qui descendent la montagne et qui viennent d’entrer dans la ville, pillant et massacrant tout ce qu’ils rencontrent.
— Les Maures ! répondit don Augustin de Mexia en haussant les épaules ; quelle folie !
Et il porta à ses lèvres le verre qu’il tenait à la main.
— Je vous répète, monsieur le général, qu’ils sont descendus de la montagne.
— Et par où ? demanda don Mexia avec impatience.
— Par Huelamo de Ocana.
— Impossible !.. c’est justement par là que s’est avancée ce matin la colonne de Diégo Faxardo, forte de douze cents hommes de nos meilleurs soldats et six pièces d’artillerie ; c’est bien plus qu’il n’en faut pour arrêter l’armée tout entière des rebelles.
— Il paraît qu’ils n’ont rien arrêté, car les Maures sont entrés dans la ville, et tous les bourgeois s’enfuient… Tenez, tenez !.. entendez-vous ?
Plusieurs décharges de mousqueterie retentirent dans les rues éloignées.
— Raison de plus pour que ce ne soient pas eux, dit le général en souriant ; car ils n’ont ni poudre ni munitions. Mais voyons cependant ce que c’est.
Les cris devinrent plus nombreux, plus effrayants, et l’on distingua parfaitement ceux de : Allah ! Allah ! mort aux chrétiens ! mort à l’Espagne !
— Est-ce que, par hasard, vous auriez raison ? dit froidement don Augustin.
Il acheva son verre de vin sans que le cristal vacillât dans sa main, se leva de table d’un pas ferme, prit son épée et se préparait à descendre dans la rue.
— Ne sortez pas ! ne sortez pas, mon général ! s’écria un homme qui s’élança dans l’appartement. Ses habits étaient en désordre, son sang coulait par plusieurs blessures.
— Vous, Diégo, dit le général avec le même flegme qu’un instant auparavant. Qu’est-ce que cela signifie ?
— Ne sortez pas ! moi et quelques officiers nous nous ferons tuer avant qu’on arrive jusqu’à vous. Le sergent et ses huit hommes sont échelonnés sur l’escalier et vous donneront le temps de fuir.
— Moi, fuir ! répondit don Mexia avec un sourire hautain ; vous n’avez pas votre tête, Diégo, remettez-vous. Qu’est-il arrivé ? pourquoi avez-vous abandonné vos soldats ?
— Mes soldats ! s’écria Diégo, à moitié fou de rage et de douleur, tués ! anéantis !
— Mais votre artillerie, vos munitions ?
— Au pouvoir des rebelles.
— C’est impossible !
— C’est ce que je me dis : c’est impossible ! s’écria-t-il en portant à son front sa main, qu’il retira toute sanglante, et cependant ce sang, c’est bien le mien. Ah ! trahison ! trahison ! sans cela le capitaine Diégo, fût-il seul contre eux tous, n’eût jamais été vaincu ! Oui, continua-t-il avec égarement, ce prisonnier, ce Maure, à qui j’avais fait grâce de la vie, à condition qu’il nous livrerait Yézid et les siens…
— Eh bien ! dit don Augustin avec un peu d’émotion.
— Eh bien ! imaginez-vous, après deux heures de marche, une gorge étroite, escarpée, un site effrayant, terrible, des rocs nus, décharnés, se dressant de toutes parts, comme des squelettes gigantesques. « À moi, mes frères, à moi ! s’est écrié le traître ; au prix de mes jours, je vous livre nos ennemis, prenez-les ! » À l’instant je l’ai frappé, et son corps déchiré par nos balles a été dispersé en lambeaux. Mais l’étroit sentier ! par lequel nous venions d’entrer avait été soudain comblé par d’énormes blocs de pierres roulés d’en haut. Plus d’issue, mon général, poursuivit Diégo avec désespoir : partout des montagnes couronnées par des milliers d’ennemis qui nous écrasaient sous des quartiers de rochers. « Vive Allah ! mort aux chrétiens ! » criaient-ils. Que pouvaient faire la valeur, l’ordre, la discipline ? Impossible de combattre, impossible d’avancer, impossible même de reculer. Nous étions une vingtaine… une vingtaine seulement, qui, nous attachant aux ronces, aux racines des arbres, aux pointes d’un rocher moins escarpé que les autres, avons pu sortir de ce gouffre d’enfer. Mais ils se sont aussitôt attachés à notre poursuite, et depuis deux heures nous descendons la montagne en fuyant… Fuir devant eux ! La moitié de mes compagnons est tombée ou de fatigue ou de ses blessures. De vingt, nous n’étions plus que dix en arrivant à cette hôtellerie, où j’ai vu votre drapeau, et comme ils sont maîtres du village…
— C’est ce que nous allons voir, interrompit don Mexia, qui pendant ce terrible récit avait conservé le même sang-froid qu’autrefois Philippe II, en apprenant la destruction totale de la fameuse armada. Vous pouvez vous abuser encore.
Les hurlements de joie et de victoire qui retentirent dans la rue lui prouvèrent que Diégo ne se trompait pas.
— Allah ! Allah ! mort aux chrétiens !
Ce cri dominait les autres. En quelques instants, la porte de l’hôtellerie fut enfoncée, et les Maures se précipitèrent sur l’escalier principal, défendu par le sergent, ses soldats et les officiers compagnons de Diégo.
— Messieurs, s’écria don Augustin en se rapprochant
d’Alliaga, défendons le révérend, car sa robe de moine
va l’exposer le premier à la fureur des hérétiques. 
Vous n’osez pas ! dit le ministre en se plaçant devant lui.
— Ne pensez qu’à vous, général, lui répondit froidement Alliaga ; je suis prêt à mourir.
— Et nous donc ? répliqua en souriant Mexia ; n’y sommes-nous pas toujours prêts ? Je vous le disais encore tout à l’heure, c’est notre état, mon révérend ! Mais vous, c’est autre chose, vous pourriez pâlir, vous en avez le droit, et vous n’en usez pas, dit-il en posant sa main sur le cœur d’Alliaga. Il est aussi calme que le mien. Ah ! continua-t-il sans changer de ton ni de visage, nos pauvres soldats n’ont pu résister longtemps. La porte est brisée ; voici l’ennemi. Diégo, vous êtes blessé, appuyez-vous sur moi ; il faut mourir debout et le front levé.
Les deux Espagnols tirèrent leur épée. Mais Alliaga se précipita devant eux au moment où, comme un flot débordé, les Maures s’élançaient dans la chambre.
— Feu sur le moine ! crièrent-ils en voyant Piquillo, qui de ses bras étendus protégeait ses deux compagnons.
Son capuchon était rejeté sur ses épaules ; sa tête était nue, et il s’offrait le premier, sans défense et sans armes aux coups des meurtriers.
Déjà un Maure avait armé une espingole et le couchait en joue, lorsqu’un jeune homme, d’une haute stature et qui semblait le chef de la troupe, écarta rapidement l’arme fatale, dont le coup partit et alla briser une des croisées.
— Arrêtez ! s’écria le Maure d’une voix foudroyante, que personne ne touche à cet homme, et qu’on le respecte comme Yézid lui-même !
— Oui… oui, s’écrièrent plusieurs voix dans la foule, c’est notre sauveur ! c’est frey Alliaga !
Et malgré le sang et la poussière qui couvraient ses traits, Piquillo crut reconnaître dans celui qui avait parlé le premier Alhamar-Abouhadjad, le fidèle serviteur de Yézid, celui que dernièrement il avait rencontré avec Gongarello au pouvoir de l’alguazil Cardenio de la Tromba.
Alhamar fit un signe de la main : tous ses compagnons
sortirent de la chambre. Il n’y resta que Diégo 
Nous n’avons plus de patrie, s’écriait cette multitude éplorée.
Faxardo, qui, affaibli par ses blessures, venait de
perdre connaissance, et le général, qui s’empressait de
le secourir ; tous les deux étaient à une extrémité de
l’appartement ; à l’autre, Alliaga et Alhamar se tenaient
debout et parlaient à voix basse.
— La dernière fois que je t’ai vu, disait Alhamar, tu nous as appelés frères ! et tes frères sont venus te secourir ; je t’avais bien dit que nous nous retrouverions.
— Merci, frère, répondit Alliaga en lui serrant la main.
— Que puis-je encore pour toi ?
— Épargner ces deux Espagnols, qui voulaient me défendre.
— Quel que soit leur nom ou leur rang, ils ne risquent rien, ils sont sauvés.
— C’est bien, dit Alliaga ; maintenant cours délivrer nos frères du village de Bardero qui sont enfermés dans la grange de l’hôtellerie.
— J’y cours.
— Un mot encore : quoique victorieux, ne reste pas longtemps dans Carascosa ; des détachements nombreux sont postés aux environs, et au premier bruit de cette expédition, ils vont accourir.
— Ne crains rien : nous ne sommes descendus dans la plaine que pour y enlever des provisions et des vivres qui nous manquent ; nous avons saisi plusieurs troupeaux que nous emmenons, et, d’après l’ordre d’Yézid, nous remontons cette nuit même auprès de lui à la montagne.
— À la bonne heure ; mais il faut absolument que je voie Yézid, que je lui parle. Comment faire ?
— Il ne peut nous quitter ni venir te joindre.
— Mais moi, je puis l’aller trouver.
— Tu oserais venir à la montagne ?
— Sans doute ; mais non pas aujourd’hui ni avec vous.
— Eh bien ! demain à la nuit tombante.
— Soit. J’irai seul.
— Je t’attendrai aux trois roches blanches. Mais qui pourra te conduire jusque-là ?
— Gongarello, qui, élevé dans ce pays, connaît la montagne et tous ses sentiers.
— À demain donc, frère.
— À demain.
Toute cette conversation avait eu lieu rapidement à voix basse et à l’autre bout de la salle. Abouhadjad, entendant les cris des siens qui l’appelaient, avait redescendu l’escalier et s’était élancé dans la cour.
Alliaga se rapprocha alors du général et l’aida dans les soins qu’il donnait au capitaine Diégo.
Celui-ci revint enfin à lui ; il se rappela alors sa jactance du matin, sa défaite de la journée et tout ce qui venait de se passer ; son premier mouvement, mouvement de honte et de confusion, fut de cacher sa tête entre ses mains.
— Allons, allons, lui dit gravement le général, courage et patience ; tout peut se réparer. Rien ne vous empêche de vous faire tuer à la première occasion, et cette occasion-là arrivera plus tôt que vous ne croyez.
En parlant ainsi, don Augustin de Mexia se promenait dans la salle de l’hôtellerie. Il regardait de temps en temps sa montre et avait l’air de calculer.
— À quoi pensez-vous, général ? lui demanda Alliaga.
— Je pense que si mes instructions de ce matin ont été exactement suivies, six cents hommes de cavalerie, commandés par Gomès de Sylva, doivent passer ce soir par Carascosa pour aller prendre position à Hueté. Dieu aidant, ils ne peuvent tarder et nous allons rire, poursuivit-il gravement. Pas un seul de cette canaille ne nous échappera !
— Dites-vous vrai ? s’écria le capitaine Diégo en se levant vivement.
Sa figure pâle se colora un moment, et ses yeux brillèrent d’un éclair de joie et de vengeance.
Mais il était dit que ce jour-là serait un jour de malheur pour le pauvre capitaine et que toutes ses prévisions seraient déjouées.
On entendit dans la cour de l’hôtellerie un son de cor répété successivement sur divers points de la ville. C’était Alhamar-Abouhadjad qui rappelait et ralliait tout son monde ; emmenant avec lui tout son butin, de nombreux troupeaux et les pauvres prisonniers de Barredo : il regagna en bon ordre les gorges de l’Albarracin. On entendit pendant quelque temps le son lointain du cor, répété par les échos de la montagne, puis le plus profond silence succéda aux clameurs et une vaste solitude aux scènes de pillage et de dévastation.
Tout se taisait depuis longtemps ; don Augustin de Mexia ouvrit la fenêtre qui donnait sur la cour et appela.
Une seule voix, une voix faible, lui répondit ; c’était celle du sergent Molina Chinchon.
— Que voulez-vous, mon général ?
— Où est Mosquito l’hôtelier ?
— Sauvé… ou caché ; je le soupçonne d’être dans la grange, sous des bottes de paille.
— Appelle alors l’alguazil Cardenio de la Tromba.
— Tué, mon général, ainsi que son camarade.
— Et les soldats que tu commandais ?
— Tous massacrés, général.
— Et toi ?
— Blessé à leur tête !
— Dangereusement ?
— J’espère que non.
— Tu en reviendras ?
— Je vous le jure, mon général.
— Tant mieux ! hâte-toi de te guérir.
— Je me dépêcherai.
— Et tu te rendras alors, pour quinze jours, aux arrêts.
— Oui, mon général.
Un galop de chevaux se fit entendre, au loin, du côté de la plaine.
— Ce sont eux, dit don Mexia, c’est Gomès de Sylva… mais trop tard.
— Eh ! pourquoi donc ? s’écria vivement Diégo, on peut encore les poursuivre.
— Non pas ! non pas ! répondit le prudent général ; je n’irai pas me hasarder la nuit dans la montagne, qu’ils connaissent mieux que nous.
Et regardant le capitaine d’un air sévère :
— C’est assez des désastres de cette journée, il faut nous reposer cette nuit.
Un quart d’heure après, Gomès de Sylva traversait Carascosa avec son détachement. Don Augustin se mit à leur tête avec Diégo Faxardo, qui se soutenait à peine sur son cheval. Pendant toute la route, le général n’ouvrit pas la bouche sur ce qui s’était passé. Mais arrivé à Hueté, il se contenta de dire aux officiers qui l’entouraient :
— À demain le combat, messieurs.
Puis se tournant vers Diégo :
— À demain votre revanche, capitaine.
LXXI.
le camp des maures.
Le lendemain dans la journée, frey Alliaga quitta l’hôtellerie ; mais à peine à une lieue de là, il s’arrêta comme indisposé, se coucha de bonne heure, et quand tout le monde fut endormi dans la misérable posada où il avait cherché asile, il se leva et se dirigea vers la montagne, accompagné de Gongarello, qui devait le conduire, et qui, par un mouvement involontaire, se tenait toujours derrière lui.
Gongarello était dévoué, mais il avait peur, et de plus braves que lui auraient pu être intimidés la nuit dans ces montagnes sauvages et surtout dans le sentier escarpé qu’il leur fallait suivre, et qui était dangereux, même de jour. Il serpentait péniblement sur les flancs d’une montagne à pic, et à mesure qu’on s’élevait, on apercevait à sa gauche un précipice qu’on osait à peine regarder, car sa hauteur pouvait donner le vertige aux meilleures têtes.
Plus on approchait du sommet de l’Albarracin, plus l’air devenait vif et le vent impétueux. Il mugissait sourdement dans les fissures des rochers ou tourbillonnait en rafales dans l’étroit espace que parcouraient nos voyageurs. Parfois, et pour ne pas être renversés, ils étaient obligés de se retenir à des pointes de rocs ou aux liéges et aux sapins, qui, à cette élévation, commencent déjà à être rares ; sans compter que les choucas et les oiseaux de proie, que réveillait cette marche nocturne, ajoutaient par leurs cris sauvages à l’horreur de ce lien formidable.
Enfin ils arrivèrent à un petit plateau couronné par trois cimes de rochers dont les blanches aiguilles brillaient à la lueur des étoiles. Gongarello tressaillit en entendant le bruit des armes et en voyant plusieurs hommes, couchés à plat ventre le long du rocher, se lever brusquement à leur approche.
C’étaient Alhamar-Abouhadjad et ses compagnons.
— Venez, frère, dirent-ils à Alliaga ; notre chef vous attend.
Et ils commencèrent à descendre de l’autre côté de la montagne, par un sentier non moins escarpé, jusqu’à l’entrée d’une caverne masquée par des rochers.
C’était la route à suivre pour arriver au camp, et à moins de connaître parfaitement ce passage, il était impossible de le soupçonner. Depuis cet endroit, le chemin était large et facile, et tout en marchant, Alliaga interrogea Abouhadjad sur les événements de la journée.
— Allah nous favorise, s’écria celui-ci. Ce matin, avant le lever du soleil, Yézid qui est toujours le premier sur pied et qui nous anime de ses discours et de son courage, Yézid s’est mis en marche ; nous pensions tous qu’il allait descendre sur Culla et Benazal pour attaquer le corps d’armée de Fernand d’Albayda. Nous avons aperçu son camp de loin dans la plaine, au lever du soleil.
— Et il a donné le signal ? s’écria Alliaga avec crainte.
— Non, il s’est arrêté. Il a contemplé un instant les tentes de Fernand. J’étais alors, comme toujours, près de mon maître Yézid, et j’ai vu couler une larme le long de sa joue.
Et nous aussi nous étions émus ! car de la plateforme où nous étions, du côté de l’Albarracin qui donne sur la mer, nous voyions se dérouler à nos pieds les plaines de Valence.
— Campagnes que nous avons cultivées, s’est écrié Yézid, séjour de notre enfance ; sol de la patrie, nous ne porterons point dans ton sein la dévastation et le pillage.
Et jetant un dernier regard, un regard de protection et d’amour sur cette terre, arrosée de nos sueurs, Nous avons pris parmi les rochers la route qui tourne du côté de l’Aragon. Là était le second corps d’armée commandé par le brigadier Gomara, qui, parti depuis quelques jours de Checa, devait se lier, par sa gauche, avec les troupes de don Fernand, et par sa droite à l’armée principale, commandée par don Augustin de Mexia, lequel devait, ce matin, se mettre en marche de Hueté pour faire sa jonction avec don Gomara.
— Je le sais, je le sais, dit Alliaga avec impatience. Eh bien ?
— Eh bien, don Gomara et ses troupes, ne nous supposant pas l’audace de les attaquer, dormaient, je crois, dans leurs quartiers, quand les cris d’Allah et le feu de la mousqueterie les ont réveillés. Ils ne nous croyaient ni armes ni munitions, mais les soldats de Diégo nous en avaient fourni la veille ; ils ne nous croyaient ni courage, ni connaissances militaires, mais nous sommes du sang des Abencerages et nous étions commandés par Yézid !
Pendant que nous les attaquions l’épée à la main et de près, ces Espagnols, nos maîtres et nos bourreaux, les coulevrines et les fauconneaux que nous avions trainés avec nous, et que nous avions établis en batterie de l’autre côté de leur camp, tonnaient au-dessus de leur tête et les foudroyaient. C’était la justice céleste, elle venait d’en haut.
Ils ont voulu nous les reprendre, ces canons qui leur appartenaient, et quatre fois ils sont montés à l’assaut en gravissant les rochers ; mais nous étions là ! continua Abouhadjad avec l’exaltation de la vengeance et du triomple ; quatre fois nous les avons précipités de ces remparts de granit que le ciel nous a donnés et qu’il a élevés pour nous !
Ah ! poursuivit le Maure avec un éclat de rire, si vous les aviez vus rouler jusqu’au fond du ravin où ils n’arrivaient que par fragments ! si vous aviez vu leur chef Gomara, après deux heures de résistance acharnée, repoussé de rocher en rocher, attaqué corps à corps par Yézid !.. Yézid lui-même, le fils des Abencerages, le sang des rois maures, Yézid, mon maitre et mon roi, qui, aux yeux de tous, et sur ce rocher élevé, l’a frappé de son épée, pendant que les échos de la montagne répétaient : Allah ! Allah ! Gloire à Yézid ! Gloire aux Abencerages !
Ah ! c’est un beau jour que celui-là, s’écria le Maure transporté de joie, et je peux mourir maintenant ! J’ai vu couler assez de sang espagnol.
— Et don Augustin de Mexia ? demanda Alliaga avec inquiétude.
— Leur général en chef, ce guerrier si vaillant, si habile, si expérimenté, à ce qu’ils disent tous… nous avons entendu le son de ses tambours, les fanfares de sa cavalerie… nous avons vu de loin gravir ses colonnes, pendant que Yézid, ralliant nos soldats, les rangeait sur une esplanade qui dominait la montagne, notre artillerie sur les flancs, six mille hommes en bataille et douze cents arquebusiers retranchés derrière les rochers ; nous l’attendions, ce grand capitaine, et comme les Maures, nos ancêtres, nous l’avons, par nos cris, défié au combat ; il ne l’a pas accepté.
— En vérité !
— Il a contemplé longtemps notre position, et au lieu de nous attaquer, il a tourné du côté de Checa, nous laissant maîtres de tout ce versant de la montagne et de la grande route de Valence à Madrid.
— Quoi ! il s’est éloigné !
— Oui ! s’écria fièrement Abouhadjad, ses soldats étaient plus nombreux du double et il a fui devant nous.
Alliaga n’en croyait rien, et la retraite du général espagnol lui inspirait de vives inquiétudes. Augustin de Mexia n’était pas homme à battre en retraite, sans motif, et Alliaga avait raison.
En apprenant le nouvel échec que venait d’éprouver un de ses lieutenants ; en voyant la forte position occupée par les rebelles, le vieux général avait compris qu’on ne l’enlèverait pas de front sans des pertes considérables ; que peut-être même le succès de l’attaque pourrait être douteux, et fidèle à sa maxime : Attendre pour arriver plus vite, il avait préféré quelques jours de marches pénibles pour tourner la montagne et prendre ses ennemis à revers, pendant qu’il donnait à Fernand d’Albayda l’ordre de les aborder de son côté et de les mettre ainsi entre deux feux.
Ces manœuvres devaient nécessairement donner aux Maures quelques jours de repos, et la confiance d’Abouhadjad et de ses compagnons redoublait la terreur d’Alliaga.
En discourant ainsi, ils approchaient du camp des Maures, où régnait la plus active surveillance, car sur leur chemin, de nombreuses sentinelles se montraient de distance en distance et criaient :
— Qui vive ?
— Ami ! répondait l’escorte d’Alliaga.
Ils traversèrent le camp, arrivèrent à une tente où, malgré l’heure avancée de la nuit, brillait encore de la lumière, et quelques instants après, les deux frères étaient dans les bras l’un de l’autre.
— C’est toi que je revois ! s’écria Yézid en le pressant sur son cœur.
Alliaga, ému jusqu’aux larmes, lui rendait ses caresses et jetait un regard triste et douloureux sur les traits pâles et souffrants de son frère, sur les objets qui l’environnaient, sur cette tente en lambeaux qui lui servait d’abri, sur la natte de paille qui formait sa couche.
— Ah ! s’écria Yézid en devinant sa pensée, je ne suis plus ici dans le Val-Paraiso, dans le paradis terrestre. Mais mon sort est encore digne d’envie, mon frère, si je combats pour la religion et la liberté. Si la récompense n’est pas sur cette terre, elle ne manquera pas pour cela, dit-il en levant les yeux au ciel. Dieu me réunira enfin à tous ceux que j’aime ! Et voyant la douleur de Piquillo, il commence déjà, s’écria-t-il, puisqu’il me permet de voir et d’embrasser mon frère bien-aimé. Qui t’amène, Piquillo ?
— Tes dangers.
— C’est pour cela que tu t’exposes ? Quoi ! tu ne m’apportes pas des nouvelles d’Aïxa et de mon père ?
— Je vais en chercher ; je vais par l’ordre du roi, qui les rappelle de l’exil, les prendre à Valence et les ramener à Madrid. Mais parlons de toi, de toi d’abord. Delascar d’Albérique, notre père, m’avait confié, avant son départ, des valeurs pour plus de deux millions de réaux. Elles devaient être remises au duc de Lerma comme le prix d’une promesse à laquelle il a manqué. Je te les apporte, je te les rends.
— Merci pour nos compagnons qui en auront grand besoin.
Alliaga continua :
— J’ai appris tes exploits et tes triomphes, j’en ai été presque témoin et j’en suis fier. Mais pour être retardée, ta perte n’en est pas moins certaine. Augustin de Mexia n’est pas homme à abandonner sa proie. Il a juré de vous exterminer.
— Soit ! Son serment pourra lui coûter cher à tenir.
— Et des deux côtés ce sera du sang inutilement versé. Car j’ai la certitude que, sous peu, notre roi Philippe aura changé de conseillers ; que bientôt le duc de Lerma sera renversé ; que l’édit contre les Maures sera révoqué ; que toi et mon père vous pourrez rentrer dans vos biens, et nos frères dans leur patrie.
— Que me dis-tu là ! s’écria Yézid stupéfait et sur quel espoir peux-tu fonder de pareilles chimères ?
Alliaga lui raconta alors la passion ardente, délirante du roi pour leur sœur Aïxa. Il lui expliqua le message dont il était chargé.
Sa Majesté Philippe III, roi d’Espagne, voulait épouser secrètement, mais en légitime mariage, Aïxa d’Albérique, la fille et la sœur du Maure.
Yézid pouvait à peine croire ce qu’il entendait.
— Le roi exige seulement qu’elle reçoive le baptême, continua Alliaga.
— Y consentira-t-elle ? demanda Yézid après un instant de silence.
— Ce que j’ai fait pour sauver tes jours et les siens, répondit frey Alliaga avec un douloureux soupir, Aïxa refusera-t-elle de le faire pour délivrer une nation entière, pour racheter tous ses frères de l’exil, de la misère ou de la mort ?
— Oui, c’est possible. Mais épouser le roi, qu’elle n’aime point ! dit Yézid d’un air rêveur ; crois-tu qu’elle consente à ce sacrifice ?
— Qui l’en empêcherait ? s’écria vivement Alliaga, qui devint pâle et tremblant. Connais-tu quelques motifs qui pourraient s’y opposer ? Dernièrement n’était-elle pas décidée, tu l’as vu toi-même, à donner ses jours, et plus encore… son honneur même, pour que ce fatal édit ne fût pas signé. Eh bien ! ne vaut-il pas mieux être la femme que la maîtresse d’un roi ?
— Oui, répondit Yézid, le malheur est préférable à la honte, et quels que soient les sentiments d’Aïxa…
— Les connais-tu ?
— Non, mais je suis persuadé maintenant, comme toi, qu’elle acceptera.
— N’est-il pas vrai ! s’écria Piquillo avec joie ; et alors crois-tu que le roi puisse rien refuser à celle qu’il aime ? penses-tu qu’il veuille la placer sur le trône et laisser ses frères dans l’exil ? Non, non, je te l’ai dit, dans quelques jours tout sera changé. Le vaisseau que le roi a fait envoyer à la poursuite d’Aïxa l’aura ramenée à Valence, et moi, je la conduirai à Madrid, où l’attend son royal époux. À notre arrivée, le duc de Lerma proposera lui-même la révocation de l’édit qui nous a proscrits ; il le signera, ou l’ancien favori sera renversé et brisé.
— Tu dis vrai ! répondit Yézid.
— Ainsi donc, frère, continua Alliaga avec chaleur, tâche seulement de gagner du temps, c’est tout ce que je te demande. Évite des combats dont la chance peut être douteuse et dont le résultat serait à coup sûr inutile.
Je crains les forces et l’adversaire redoutables qui te menacent ; mais quand tu aurais la certitude de l’accabler, préfère la guerre des montagnes. Laisse-toi poursuivre de rocher en rocher. Cherche plutôt à l’épuiser qu’à le combattre ; à le fuir qu’à le vaincre. Me le promets-tu ?
— Oui, frère, je reconnais la prudence de tes conseils ; je les suivrai, si je le peux.
— Et moi je te promets de vous venir en aide le plus tôt possible, et sitôt mon retour à Madrid, d’employer tout mon crédit auprès du roi pour qu’Augustin de Mexia suspende ses opérations et qu’une trêve soit signée entre vous. Le reste nous regarde, Aïxa et moi. Voilà, frère, ce que j’avais à te dire.
— Merci, merci, notre sauveur. Mais voudrais-tu déjà me quitter ?
— Pour te servir et ne pas perdre un moment.
— Attends du moins le jour. Tu n’as rien à craindre, nous sommes maîtres de la route de Valence, et je te conduirai moi-même jusqu’à nos derniers postes.
Les deux frères passèrent quelques heures dans les doux épanchements de la plus vive et de la plus tendre amitié. Yézid ne parlait pas de la reine, pas plus que Piquillo d’Aïxa. Mais tous deux avaient aimé, tous deux aimaient encore ! sans s’être jamais rien avoué, chacun d’eux comprenait que son frère était malheureux, et la souffrance de l’un ajoutait à l’amitié de l’autre.
Enfin le jour commença à paraître et les deux frères se disposaient à partir. Il sembla à Yézid qu’une certaine rumeur, un mouvement inusité régnait dans le camp. On courait, on s’interrogeait.
— C’est lui… tu en es sûr… tu l’as vu ?
— Regarde toi-même. Le voilà qui se dirige vers la tente du général.
— En effet un groupe de soldats entourait un jeune Maure pâle, exténué, auquel on faisait fête, et dont chacun cherchait à serrer la main. Il s’avançait ou plutôt ils se traînait à la rencontre de Yézid et d’Alliaga, qui tous deux poussèrent à l’instant le même cri :
— Pedralvi !
C’était lui, qui avait voulu s’élancer dans leurs bras, et qui venait de tomber sans connaissance à leurs pieds. On le transporta dans la tente d’Yézid ; les soins qu’on lui prodigua le rappelèrent à la vie, lui rendirent ses forces, et il lui fut enfin possible de répondre aux questions dont l’accablaient les deux frères.
— Aïxa, mon père…
— Que sont-ils devenus ?
— Tu étais embarqué avec eux.
— Tu ne devais pas les quitter.
— Tu me l’avais juré.
— Et Dieu sait, s’écria Pedralvi en levant les yeux au ciel, si j’ai tenu mes serments. Je viens vous rendre compte de ma mission, mon maitre, dit-il à Yézid d’un air sombre, et vous jugerez si votre serviteur a pu mieux faire.
Vous n’étiez pas là quand votre père, et la senora Aïxa, et ses femmes, et Juanita, ma fiancée à moi, et tous ceux de votre maison ont mis le pied sur ce vaisseau qui devait nous emporter loin de l’Espagne, c’était une scène de désolation et de douleur que je ne puis vous rendre, et que bientôt devaient suivre d’autres scènes plus terribles encore.
Nos compagnons ne pouvaient détacher leurs yeux des rivages de l’Andalousie et leur envoyaient encore un dernier adieu. Mais quand ils eurent perdu de vue cette terre chérie, quand il ne fut plus possible de l’apercevoir, femmes et enfants se mirent à pleurer, et moi aussi, mon maître, car je venais de quitter ma patrie et je vous y laissais.
Le premier jour, le seigneur Albérique et Aïxa ne voulurent point sortir de leur cabine. Je veillai à ce que rien ne leur manquât, pour qu’ils ne s’aperçussent pas encore de l’exil et qu’ils pussent se croire dans leur habitation de Valence ou du Val-Paraiso. J’examinai notre vaisseau, le San-Lucar, qui était lourd et pesant ; il marchait mal, et même il était en assez mauvais état.
On n’avait pas pu trouver mieux, et Giampiétri, le capitaine avec qui vous aviez traité et que je connaissais de longue main, était un brave et honnête homme. Je ne fus pas aussi satisfait de son équipage. Ils étaient nombreux, car il avait pris une vingtaine de matelots ; c’était plus qu’il ne fallait pour faire manœuvrer un bâtiment de petite dimension tel que le nôtre.
Je lui en fis l’observation.
Il me répondit qu’il n’avait d’abord demandé que dix hommes d’équipage et qu’il s’en était présenté vingt pour le même prix ; que c’était un nommé Géronimo, un contre-maître, qui les avait engagés et qui en répondait.
— À la bonne heure, lui dis-je, mais leur mine ne me plaît guère, et on les prendrait plutôt pour des bandits de la sierra que pour des gens de mer.
Je remarquai en outre qu’ils étaient sans expérience, fort gauches à la manœuvre et surtout paresseux et ivrognes ; dès le premier jour, plusieurs d’entre eux s’étaient grisés.
— Déjà !… leur avait dit brusquement un de leurs compagnons. Il n’est pas temps encore.
Cette voix m’avait fait tressaillir, et j’ignorais pourquoi. Elle ne m’était pas inconnue ; il me semblait l’avoir déjà entendue plusieurs fois dans des circonstances importantes ; mais celui qui parlait ainsi m’était totalement étranger ; ses traits assez beaux, mais durs et ignobles, n’avaient jamais frappé mes yeux.
Je l’avais vu causer plusieurs fois dans la journée avec un Maltais nommé Marco, un ouvrier du port sur lequel je ne pouvais avoir le moindre doute, car celui-là était généralement connu pour un mauvais sujet.
— Quel est cet homme qui te parlait tout à l’heure ? demandai-je au Maltais.
— Géronimo, le contre-maitre, celui qui m’a engagé et qui répond de moi.
— Et qui me répondra de lui ?
— Moi, répliqua le Maltais d’un air insolent qui ne me plut pas, et j’eus envie de le jeter à la mer ! mais cela aurait fait quelque bruit et dérangé peut-être la senora Aïxa ; j’attendis donc patiemment. Toute la nuit cependant je fus sur pied et je surveillai.
Le lendemain, la senora Aïxa consentit à prendre l’air sur le pont. Elle y était depuis quelques instants, appuyée sur le bras de Juanita et lui parlant de vous, messeigneurs, de son frère Yézid et de son frère Piquillo, quand tout à coup je vis la senora tressaillir, pâlir et rentrer vivement dans son appartement. Je me permis de la suivre et de lui demander ce qu’elle avait.
— Une terreur panique, répondit-elle, et dont j’ai honte. Pendant que j’étais sur le pont, j’ai vu passer rapidement à quelques pas de moi un matelot qui allait à la manœuvre.
— Je n’ai vu qu’un nommé Géronimo, lui dis-je.
— C’était lui sans doute, continua-t-elle, et j’ai cru rencontrer quelque ressemblance entre ses traits et ceux d’un bandit au pouvoir duquel je me suis trouvée pendant quelques instants.
— Qui donc ! lui demandais-je.
— Un ennemi mortel de Piquillo, un nommé Juan-Baptista Balseiro.
— À cet endroit du récit, Alliaga sentit une sueur froide couler sur son front.
LXXII.
les maures dans l’exil.
— Juan-Baptista Balseiro ? dit Alliaga à Pedralvi ; es-tu bien sûr que c’était ce nom ?
— Eh oui ! reprit brusquement Pedralvi ; mais ne voulant pas effrayer la senora, je traitai ses craintes de chimériques, quoique au fond du cœur elles ne me semblassent que trop légitimes ; elles m’expliquaient l’effet qu’avait produit sur moi la voix de ce bandit, que j’avais rencontré deux fois seulement dans ma vie et toujours sans le voir : dans notre enfance, un soir, à l’hôtellerie du Soleil-d’Or, pendant que j’étais sur le chaperon du mur, et lui dans la rue ; et plus tard, quand, déguisé en alguazil, il nous arrêta, la nuit, dans les montagnes de Tolède.
Décidé cette fois à connaître ses desseins et à en finir avec lui, je le cherchai des yeux sur le vaisseau, et je n’aperçus ni lui ni Marco le Maltais.
— Ils sont, me dit le capitaine Giampiétri, occupés à nettoyer ma cabine.
J’y descendis. Je ne trouvai que Marco. Mon air avait sans doute quelque chose de mauvais, car il pâlit en me voyant, et moi, allant droit au fait, je tirai un pistolet de ma ceinture et le lui posant sur la poitrine:
— Il faut me dire ici la vérité : ton contre-maitre Géronimo n’est autre que Juan-Baptista Balseiro, le bandit que réclame depuis longtemps la justice.
— C’est vrai, répondit le Maltais en tremblant ; car il était lâche.
— Quels sont ses desseins ? réponds à l’instant, ou je fais feu.
— Lui et ses compagnons veulent piller ce vaisseau, qu’ils supposent chargé des trésors de la famille d’Albérique.
— Où est-il en ce moment ?
Le Maltais n’osait répondre, mais il m’indiquait de l’œil une seconde cabine où le capitaine Giampiétri serrait son or et ses papiers.
Je me dirigeais de ce côté, une porte s’ouvrit brusquement. Un homme parut, je tirai. Il tomba. Ce n’était pas Juan-Baptista, mais un de ses gens. Ils étaient deux.
Profitant du moment on j’étais désarmé, le Maltais me saisit par derrière, pendant que Balseiro, me sautant à la gorge, m’étreignait de ses bras nerveux. Quoique seul contre eux, je résistais, j’appelais du secours, et déjà le capitaine Giampiétri accourait à mon aide, quand Juan-Baptista qui m’entrainait vers l’escalier, cria d’une voix de Stentor :
— À nous, compagnons voici le moment, levez-vous !..
En un instant tout l’équipage, ou plutôt ce ramas de bandits, nous avait saisis, moi et le malheureux Giampiétri, et nous avait lancés à la mer.
Yézid et Piquillo poussèrent un cri d’effroi.
— Moi, ce n’était rien, continua l’intrépide Pedralvi, mais mon pauvre maitre !..
— Mon père ! murmura Yézid avec désespoir.
— Et Aïxa ! s’écria Alliaga.
— Restée, ainsi que Juanita, au pouvoir de ces pirates, de ces brigands… répondit Pedralvi avec un mugissement de rage. Que le Dieu de nos pères leur soit en aide ! lui seul peut les défendre.
— Et toi, Pedralvi, toi, s’écria Yézid en pressant les mains du fidèle serviteur, qu’es-tu devenu ?
— Moi, plongé dans l’abime et bientôt revenu à la surface des flots, je voyais s’éloigner et fuir à l’horizon le San-Lucar, ce vaisseau qui emportait tout ce que j’aimais !… Dans mon désespoir, dans mon délire, je blasphémais !… je poussais des sanglots de douleur et de rage, et des cris qui se perdaient dans le tumulte des vagues.
On venait de m’enlever la moitié de ma vie, et celle qui me restait ne valait pas la peine d’être défendue contre les flots. Le pauvre Giampiétri, entrainé loin de moi, avait déjà disparu, et à l’immensité je n’apercevais rien que des vagues, partout des vagues, dont le bruissement uniforme murmurait à mon oreille : il faut mourir !
Pas une planche, pas un débris, pas une pointe de rocher ! J’étais à vingt lieues du rivage, en pleine mer ! seul avec Dieu ! et avec vous, mon maitre Yézid ; avec vous, Piquillo, mon premier ami, qui ne pouviez plus m’entendre et que pourtant j’appelais encore ! Enfin, décidé à mourir je cessai de disputer mes jours ; mes bras ne me soutinrent plus à la surface des flots, et je descendis dans l’abîme en levant mes yeux vers le ciel.
En ce moment le ciel brillait de tout son éclat ; le soleil de l’Andalousie, dont les feux étincelaient sur la mer et dont j’apercevais encore les rayons à travers les eaux transparentes qui venaient de se refermer sur ma tête. Vous le dirai-je ? cette douce lumière, ce soleil si beau à voir, et que je contemplais pour la dernière fois, rappela en moi le désir de la vie et le regret de la quitter.
— Oui, m’écriai-je, je ne m’abandonnerai pas lâchement à mon désespoir. Je défendrai mes jours jusqu’au bout, et peut-être le ciel me viendra-t-il en aide… il le doit. Il doit me laisser vivre, ne fût-ce que pour venger un jour Juanita et mes maitres, et pour punir leurs meurtriers.
Ranimé par cette idée, je me mis à nager avec vigueur. De quel côté ? je l’ignore. Je ne pouvais me guider ni me diriger, et mes efforts m’éloignaient, peut-être, du rocher ou du banc de sable qui pouvait me sauver. Pendant six heures je luttai ainsi contre la mort. Oui, six heures au moins, car le soleil, qui dardait d’abord ses rayons au-dessus de ma tête, descendait maintenant dans la mer ; mes forces épuisées, ma respiration haletante, me disaient que tout était fini pour moi, et qu’il fallait succomber.
Vingt fois déjà le courage avait été près de m’abandonner… Une espèce de délire ou de vertige me soutenait seul alors… Je n’avais plus ma raison et je luttais toujours, par instinct ou par rage.
D’étranges apparitions passaient devant mes yeux. C’était un port facile qui s’offrait à mes regards ; un sable fin et doux qui m’invitait à me reposer ; des plaines verdoyantes, des arbres touffus qui m’offraient leurs ombrages ; saisi de joie, je m’avançais haletant, et tout disparaissait devant moi !
Enfin, sur le soir et vers les derniers rayons du jour, il me sembla entendre le sillage d’un vaisseau, les cris des matelots, le bruit des cordages, le vent soufflant dans les voiles.
Encore un fantôme ! me disais-je, le fantôme d’un navire qui se dresse devant moi sur les flots ! Je rêvais que des hommes et des femmes amoncelés sur un bâtiment me regardaient et me montraient du doigt ; je rêvais qu’on me jetait un câble, un cordage : que je venais de le saisir, et puis, comme à l’ordinaire, cette fois encore, tout disparut. Je ne vis, je ne sentis plus rien. Je m’étais évanoui.
Quand je revins à moi, j’étais sur le pont d’un navire. Des compatriotes, des Maures m’entouraient ; des femmes me prodiguaient des soins. Juanita, Aïxa, d’Albérique ! m’écriai-je. Personne ne répondit à ces noms. Ils n’étaient pas là. J’étais loin d’eux !
J’avais été recueilli par un bâtiment espagnol qui faisait voile pour l’Afrique, ayant à son bord nos amis et nos frères que l’on conduisait en exil.
Et maintenant (ce que vous ne croirez pas), c’est que la longue agonie, c’est que la mort à laquelle je venais d’échapper devait être moins effroyable que les horreurs dont j’étais destiné à être le témoin. Oui, j’ai vu nos compagnons privés d’air et de nourriture, entassés comme des troupeaux dans des lieux infects ; j’ai vu l’enfant qui avait l’audace de se plaindre, la femme qui osait gémir, frappés et déchirés par le fouet des bourreaux ; j’ai vu le mari ou le père qui tentait de les défendre, massacré sans pitié, et son sang rejaillir sur les siens ; j’ai vu de jeunes filles, dont la beauté avait quelques instants désarmé les meurtriers, regretter la vie qu’on leur avait laissée et appeler la mort ! elle ne se faisait pas attendre, elle arrivait ! mais trop tard encore ! Elle arrivait au milieu des railleries et des outrages les plus infâmes !
J’ai vu tous ces forfaits, répéta Pedralvi avec rage, et je n’ai pu les empêcher, je n’ai pu les punir.
Vous pensez peut-être que c’était assez de tortures, assez d’opprobre, assez de carnage ; que le ciel se lasserait de nous accabler, que les bords africains nous offriraient un refuge. Non ; l’œuvre des chrétiens n’était pas encore achevée ! tous les fléaux s’entendaient avec eux et devaient leur venir en aide.
On nous débarqua aux environs d’Oran, à Canastal. Nous nous trouvâmes six mille, hommes, femmes et enfants, que l’on avait jetés sur la plage aride et déserte, sans vivres, sans armes, presque sans vêtements.
Les vaisseaux espagnols s’étaient éloignés, la nuit était venue. Tombant de fatigue, de froid et de faim, nous cherchions vainement un abri ; nous implorions le ciel !.. Il fut sourd à nos prières, et l’Arabe du désert fut le seul qui nous répondit.
Descendus des montagnes, le Kabyle et le Bédouin vinrent nous piller et nous égorger, nous leurs frères, nous les fils d’Ismaël, nous qui leur demandions secours et protection, et qui, sous le bernous de l’Africain, retrouvions encore le cœur des Espagnols.
Ah ! que cette nuit fut affreuse ! Entendre leurs cris de joie et de carnage, voir massacrer des femmes et des enfants, et n’avoir pour les défendre d’autres armes que les cailloux de la plage !
Le lendemain, la moitié des nôtres avait perdu la vie, et ne pouvant rester sur ce sol inhospitalier, il fallut tenter de gagner Alger, où un prince musulman promettait de nous accueillir.
Vous dirai-je nos nouveaux désastres pendant cette marche, ou plutôt pendant ce cortége funèbre ? À chaque instant un de nos frères tombait épuisé par ses blessures, un autre par la fatigue, celui-ci par la faim, par la soif, par des journées brûlantes et par des nuits glacées. Et chaque soir, quand nous faisions halte, les Arabes du désert venaient choisir leurs victimes et égorger ce troupeau qui ne pouvait se défendre[36].
Nous voulions en vain nous dérober à leurs poursuites. Il était trop facile de suivre notre trace : elle était indiquée par les cadavres qui jonchaient la route et trahissaient notre passage. Enfin nous approchions d’Alger, nous n’avions plus qu’un jour de marche.
De tant de malheureux, trente seulement avaient survécu. La dernière nuit, le yatagan des Bédouins en immola plus de la moitié ; le reste eut à peine la force de se trainer quelques lieues plus loin ; une pauvre mère qui se sentait mourir me tendit son enfant qu’elle n’avait plus la force de tenir. Je le reçus dans mes bras, où quelques instants après il expira !
Dans ce moment on apercevait de loin les portes d’Alger.
J’y entrai… j’y entrai seul !
Pedralvi cacha sa tête dans ses mains. Yézid et Piquillo, glacés d’horreur, l’avaient écouté sans l’interrompre.
Le Maure continua après un instant de silence :
— À Alger, ce fut différent. Là règne le vrai Dieu, et parmi les croyants, parmi nos frères, je trouvai secours et protection. Tous les négociants avec qui nous avions été en relations, Muley-Hassan, Benhoud, Benabad, me parlaient de vous, mon maitre Yézid, et de votre père ; ils voulaient tous me garder avec eux, me donner du travail, un emploi ; ils m’offraient un sort brillant. Je refusai, car vous étiez resté ici à vous battre contre les Espagnols ; je voulais revenir près de vous.
J’avais beau m’informer à tous les patrons ou capitaines de navire ; personne n’avait rencontré en mer le San-Lucar, personne ne pouvait me donner de nouvelles de votre père, ni de sa fille, ni de Juanita. Mais en revanche, chaque jour nous apportait le récit de nouveaux crimes.
Parmi ceux qui, comme nous, avaient été transportés en Afrique, plus de cent mille hommes avaient, dit-on, succombé[37]. Le capitaine Giuseppe Campanella, trouvant son vaisseau trop chargé, avait fait jeter à la mer une partie de son bagage.
Ce bagage, c’étaient nos frères !
C’est ce même Campanella qui, après avoir promis à Zarha-Hakkam la grâce de son père moyennant un prix infâme, montra un instant après à la malheureuse fille le vieillard pendu à la grande vergue de son vaisseau[38] !
Et les Espagnols prétendent qu’ils ont un Dieu ! et ce Dieu, qui permet de telles atrocités, ils veulent que nous l’adorions ! jamais ! jamais ! s’écria Pedralvi ; et, continua-t-il en passant sur son front sa main contractée par la rage, il me tarde d’effacer avec leur sang ce baptême qu’ils m’ont infligé malgré moi.
Oui, maître, dit-il en regardant Yézid, j’ignore si les maux que j’ai soufferts, si les forfaits dont j’ai été témoin ont changé ma nature, mais la mienne à présent, c’est la vengeance, c’est pour elle seule que j’existe.
J’ai juré au Dieu de nos pères et au Dieu des chrétiens d’immoler, de ma main, les premiers auteurs de nos maux : le grand inquisiteur Sandoval, l’archevêque de Valence Ribeira et le duc de Lerma ! C’est là ma mission, je n’en ai pas d’autre, et je la remplirai ! Après cela, je serai content. Allah pourra me rappeler à lui.
— Ami, ami, lui dit Yézid en cherchant à le calmer, toi que j’ai connu si bon et si généreux, c’est le délire, c’est la fièvre qui t’égare encore.
— Cette fièvre-là ne me quitte plus. En apprenant que le capitaine Giuseppe Campanella allait mettre à la voile pour retourner en Espagne, je me suis présenté à lui en qualité de domestique. Je lui ai raconté… que sais-je !.. que, né dans la Biscaye, je voulais y retourner au risque de me faire pendre, si j’étais reconnu et si ma ruse était découverte.
Débarqué près de Murviedro, où il devait plus tard venir reprendre un chargement, il y a laissé son vaisseau ; son dessein était de se rendre à Madrid, pour y voir le duc de Lerma et Sandoval, leur rendre compte de sa conduite et solliciter de la cour quelque récompense !
— Et alors tu l’as quitté ? demanda Piquillo.
— Non, nous avions auparavant des comptes à régler ensemble.
— Comment cela ?
— Ce matin il a traversé la sierra de l’Albarracin avec moi, son domestique, qui portais ses bagages, et pendant qu’il se reposait et déjeunait sur l’herbe, il m’a ordonné d’un ton impérieux de mettre ses armes en état et de les nettoyer, attendu, disait-il, que l’on pouvait rencontrer quelques-uns de ces misérables révoltés.
J’ai obéi, et quand la lame de son épée a été bien brillante, quand ses pistolets ont été chargés par moi :
— Capitaine, lui ai-je dit, vous vous rendiez à Madrid pour demander la récompense que vous méritez ?
— Oui certes.
— Vous l’obtiendrez sans aller à Madrid.
— Qu’est-ce à dire ?
— Que le jour de la justice est arrivé pour vous. Si votre Dieu et vos inquisiteurs ne savent pas punir, c’est moi, c’est un Maure, qui me chargerai de ce soin.
Lui mettant alors le genou et le pistolet sur la poitrine, je lui rappelai nos frères précipités par lui dans les flots ; Zarha déshonorée et son père immolé ; je lui racontai le serment que j’avais fait concernant l’inquisiteur, l’archevêque et le duc de Lerma.
— Mais comme il peut encore se passer du temps, ajoutai-je, avant que ce serment soit accompli, je jure d’ici là, en attendant et pour prendre patience, de tuer un Espagnol par jour. Je commencerai par vous, capitaine.
Ce que j’ai fait.
— Tu l’as tué ! s’écria Alliaga.
— Sans pitié, sans remords, comme un chien ! ou plutôt comme un tigre !
Pedralvi achevait à peine ce récit, qu’Alhamar-Abouhadjad se présenta devant son général.
On venait d’arrêter un personnage qui paraissait d’une haute importance, car il était dans un riche carrosse, trainé par quatre mules et accompagné d’une nombreuse escorte, qu’on avait tuée ou dispersée.
Ce grand personnage venait de Valence et avait l’air de se rendre à Madrid. Ignorant les événements de la veille, et croyant toujours cette partie de la montagne où passait la grande route au pouvoir des troupes d’Augustin Mexia, il s’y était hasardé sans crainte, et son étonnement avait été aussi grand que son effroi en se voyant entre les mains des Maures.
On avait saisi tous les papiers que renfermait sa voiture. Alhamar remit à Yézid et à Piquillo un vaste portefeuille. Quant au voyageur inconnu, qui avait refusé de se nommer, on l’amenait devant le général.
Un des rideaux de la tente se souleva, et Piquillo resta immobile de surprise.
— Le grand inquisiteur Sandoval ! s’écria-t-il.
À ce nom, Pedralvi bondit comme un chacal en poussant un hurlement de joie, et, les yeux pleins de sang, la bouche béante, il ne quitta plus du regard la
proie qu’il dévorait d’avance.
LXXIII.
le portefeuille du grand inquisiteur.
Le grand inquisiteur était pâle et ne marchait point d’un pas très-ferme. Les discours qu’il avait entendus, en traversant le camp des Maures, n’avaient, pour lui, rien de rassurant.
À la seule vue de sa robe de moine, chacun voulait le massacrer, et Alhamar-Abouhadjad, son guide et son protecteur, le défendait d’une manière qui l’effrayait beaucoup.
— Vous voulez le tuer, disait-il froidement aux assaillants, on ne vous en empêche pas et on ne vous dit pas le contraire ; mais, auparavant, il faut que le général l’interroge.
Quelques pas plus loin, d’autres criaient encore :
— Mort au moine !
— Un peu de patience, répétait Abouhadjad, attendez seulement que le général lui ait parlé.
Sandoval n’était donc pas pressé d’avoir son entretien avec Yézid, et le trouble qu’il éprouvait en entrant dans la tente l’empêcha d’abord de voir frey Alliaga, qui se tenait à l’écart.
Un autre incident, d’ailleurs, attira bientôt son attention.
— Vous le voyez, s’écria Pedralvi, le Dieu de nos pères approuve et bénit mon serment, puisqu’il vient me livrer ma première victime.
Et avant que Yézid eût pu l’arrêter, il s’élança sur Sandoval, qu’il saisit par sa robe.
— Bourreau de mes frères, ton arrêt est porté et je viens l’exécuter !
De l’autre main, et d’un mouvement aussi prompt que la pensée, il tira son poignard et frappa. Mais Alliaga, qui était derrière le grand inquisiteur, se précipita au-devant du coup et le para avec son bras. Le sang jaillit à l’instant, et Yézid poussa un cri de terreur.
— Ce n’est rien, dit froidement Alliaga à son frère et à Pedralvi épouvantés.
Puis, ramassant le poignard que dans son effroi ce dernier venait de laisser tomber :
— Je prie seulement Pedralvi de m’écouter.
— J’ai fait un serment, et je dois le tenir, car j’ai juré par le sang de nos frères…
— Et moi, par le mien, répondit Alliaga en montrant son bras ensanglanté, je te supplie de renoncer à ta vengeance.
Pedralvi ne répondit pas.
— Veux-tu donc te rendre toi-même aussi coupable que ceux que tu as juré de punir ? veux-tu commettre les crimes que tu leur reproches ?
— Se venger n’est pas un crime, c’est justice ! et si tu avais été, comme moi, témoin du massacre de nos frères, si tu pensais à ceux qui nous entourent et que l’on menace encore…
Alliaga vit bien que le Maure ne comprendrait jamais son dévouement ni la sainte loi qui ordonne de pardonner à ses plus cruels ennemis. Il eut recours alors à un autre moyen et lui dit :
— C’est parce que je pense à nos frères que je demande les jours de cet homme. Sa mort, quoi que tu en dises, est un crime, un crime inutile, tandis que, lui vivant, il peut nous servir.
— À quoi ? demanda brusquement Pedralvi.
— D’abord, comme otage !
— C’est vrai ! s’écria vivement Yézid ; ses jours rachèteront ceux de nos frères…
— Et feront suspendre les persécutions du saint-office, ajouta Alliaga, ne fût-ce que par crainte des représailles.
— Ah ! traître ! murmura Sandoval.
— Traitre ! répliqua Pedralvi avec colère ; un traître qui te sauve ! Ah ! si vous n’aviez jamais usé envers nous que de pareilles trahisons !
— Tu consens donc à ce que je te demande ? poursuivit Piquillo ; tu renonces à ta vengeance ?
— Dans ce moment, soit, dit-il avec un air de regret, puisque vous prétendez qu’il peut être bon à quelque chose, ce que je ne croirai jamais. Mais n’importe ; j’attendrai et je verrai plus tard ; car, ajouta-t-il en regardant le grand inquisiteur, qui commençait à respirer, ce n’est pas la paix, c’est une trêve : mon serment tient toujours.
Il serra avec force la main de Sandoval, et celui-ci sentit un froid glacial courir dans ses veines.
— Maintenant, dit Alliaga, qui venait de s’asseoir, examinons ces papiers pendant qu’on me pansera.
Et il montrait du doigt le portefeuille du grand inquisiteur.
C’étaient d’abord des lettres adressées à Sandoval et à la sainte inquisition par des gouverneurs de villes ou de provinces, par des capitaines de vaisseau, qui lui rendaient compte de l’exécution de ses ordres concernant les Maures.
Chacun, dans l’excès de son zèle et certain d’être agréable à l’inquisiteur, se complaisait dans les rigueurs qu’il avait déployées (témoin les mémoires de Fonseca et de quelques autres). Quelque grands, quelque horribles que fussent les attentats commis, ils les exagéraient peut-être encore pour faire leur cour au ministre ou à son frère. Assassins par flatterie et bourreaux courtisans, ils n’oubliaient aucun détail et multipliaient à plaisir le nombre et les souffrances de leurs victimes.
Ils ne se doutaient point du mauvais service que leur prétendu dévouement rendait en ce moment à leur maître.
À chaque trait de cruauté, l’inquisiteur baissait les yeux et courbait la tête, voyant avec terreur l’indignation qu’il inspirait, effrayé par la vengeance qui pesait sur lui.
À chaque femme égorgée ou violée, à chaque enfant ou vieillard massacré, Pedralvi rugissait de fureur et s’écriait :
— Voilà les monstres que vous m’ordonnez d’épargner !
Et il y eut un moment où Yézid lui-même, pensant à sa sœur et à son père, s’écria malgré lui :
— Il a raison !
À ce mot, Pedralvi s’élança de nouveau pour reprendre sa proie ; mais Alliaga se leva et plaça devant lui un rempart qu’il n’osa franchir, celui de son bras sanglant que l’on achevait à peine de panser.
— Silence, Pedralvi ! silence, Yézid ! s’écria d’une voix sévère celui dont l’ardente charité protestait en faveur de la sainte croyance dont lui seul en ce moment était le représentant et le véritable apôtre ; silence ! notre juge à tous n’est pas ici !
Il leva les yeux au ciel et fit signe à Yézid de continuer sa lecture.
Le papier suivant était une lettre que le grand inquisiteur avait reçue la veille d’Escobar. Celui-ci s’était arrêté en route pour renouveler à Sandoval ses protestations de zèle, de dévouement et d’entente cordiale. Il lui parlait de l’ennemi commun qu’ils avaient juré de renverser, de frey Luis Alliaga.
Yézid s’arrêta dans la lecture et regarda son frère ; Pedralvi regarda Sandoval, et lui dit à son tour :
— Ah ! traître !
— Continue, répondit froidement Piquillo.
Escobar conseillait à Sandoval de ne point s’amuser à lutter contre Alliaga, mais de frapper sur-le-champ un coup hardi ; d’ordonner, à son arrivée à Madrid, l’arrestation immédiate du confesseur du roi, qui, malgré ce titre, n’était, après tout, qu’un religieux dominicain, soumis, comme tel, à la règle de l’ordre et aux ordres du grand inquisiteur ; une fois dans les cachots du saint-office, on trouverait des moyens pour l’empêcher d’en jamais sortir, et le faible monarque oublierait bien vite, dès qu’il ne le verrait plus, l’ancien directeur de sa conscience, surtout si l’on avait soin de lui en nommer un nouveau, qui pourrait être, par exemple, le frère Escobar !
— Bien, dit Alliaga à son frère, donne-moi ce papier et ceux de la même écriture.
— Il n’y en a qu’un, répondit Yézid.
Et il lui remit la déclaration dressée par Escobar et signée par-lui et par le père Jérôme, cette déclaration qui justifiait le duc de Lerma de l’empoisonnement de la reine et expliquait, en même temps, comment la comtesse d’Altamira et le duc d’Uzède avaient immolé leur souveraine, en voulant frapper la duchesse de Santarem.
Quant aux instigateurs de ce crime, Piquillo les connaissait depuis longtemps ; il avait, dans le couvent d’Hénarès, et dans la cellule du père Jérôme, entendu, de ses propres oreilles, tous les détails de cet horrible complot.
Il resta quelques instants pensif et la tête appuyée sur ses mains. Puis il fit signe aux officiers maures et à Pedralvi de s’éloigner quelques instants.
Ils sortirent avec le grand inquisiteur, celui-ci fort inquiet de son sort et du parti que frey Alliaga allait prendre.
— Frère, dit Piquillo à Yézid, un seul événement, un événement fatal, vient de changer tous nos projets, et de les détruire à jamais, peut-être, si le ciel n’a pas protégé notre père et Aïxa…
— Quant à moi, dit Yézid d’un air sombre, je n’ai qu’un seul désir : les venger et les suivre, car je n’ai plus d’espoir.
— Et moi, j’en ai toujours ! Dieu, en qui j’ai confiance, m’a retiré de si grands dangers et de positions si horribles, que, vois-tu, frère, désespérer du pouvoir ou de la bonté céleste me semble presque un blasphème ! Crois-moi, Aïxa nous sera rendue !
— Et si nous ne devons plus la revoir, ou la revoir avilie !
— Eh bien, alors, répondit Alliaga, dont la figure devint pâle et la voix tremblante, eh bien, le malheur ou l’infamie tombé sur notre famille ne nous empêchera pas de continuer jusqu’au bout notre sainte mission ; nous avons une autre famille encore, des frères dispersés et bannis, à qui il faut rendre leurs foyers et leur patrie. Je l’ai promis à notre père Delascar d’Albérique ; ce sera l’œuvre de ma vie entière ; je veux l’accomplir ou y succomber.
— Et comment espères-tu encore réussir ? lui dit Yézid ; car, pour moi, je ne m’abuse pas sur mes efforts. Les pauvres gens que je commande pourront peut-être, soutenus par leur désespoir, se défendre quelque temps dans ces montagnes, mais nous ne pouvons plus, comme nos ancêtres, conquérir l’Espagne ou lui imposer des lois.
— Je le sais, je le sais, dit Alliaga.
— Et toi, que deviennent les rêves que tu avais formés ? La duchesse de Santarem, élevée au rang de reine d’Espagne, pouvait protéger et défendre ses frères, devenus ses sujets ; mais maintenant, continua-t-il avec douleur…
— Maintenant encore, répondit Alliaga avec douceur, nos ennemis eux-mêmes, ou plutôt le ciel, qui ne nous a pas abandonnés, nous offre des moyens de salut dont il nous est permis de profiter. Ou je m’abuse fort, ou le papier que je viens de lire et que je conserve peut grandement changer les dispositions du duc de Lerma. Le tout est de l’employer habilement et à propos. Cet écrit lui rend son honneur et sa réputation qu’il a perdus, et qu’il tient à recouvrer aux yeux de l’Espagne et de toute l’Europe. Ministre absolu, il peut commander à tous, excepté à l’opinion publique ; il le pourra par cet écrit, et avant de le lui livrer, je saurai obtenir de lui, ta grâce d’abord, amnistie pleine et entière pour tous ceux qui se sont réfugiés dans ces montagnes et combattent avec toi, et, qui sait ! peut-être plus encore. Je le tenterai du moins. Oui, continua-t-il avec chaleur, la réussite est possible, surtout si vous conservez précieusement comme otage entre vos mains le frère qu’il aime, le chef suprême de l’inquisition.
— Je comprends, dit Yézid.
— Et moi, je vais me hâter. Je me rends d’abord à Valence : il le faut ; c’est là seulement que je puis avoir des nouvelles d’Aïxa, de mon père et du vaisseau que, par l’ordre même du roi, j’ai envoyé à leur poursuite. De plus, j’ai pour le vice-roi des instructions que je saurai faire exécuter. Adieu, frère, adieu. Espère encore.
— Je n’espère qu’en toi ! s’écria Yézid en se jetant dans ses bras ; toi, notre sauveur et notre providence ! Pourquoi faut-il nous séparer ? Il me semble que ton départ est toujours pour moi le signal d’un malheur !
— Allons, frère, allons, du courage ! Tu en auras besoin, car il te faudra encore lutter et combattre contre un adversaire actif et infatigable ; mais de là-bas, du moins, je tâcherai de détourner ou d’arrêter ses coups.
En sortant de la tente, les deux frères rencontrèrent à quelques pas le grand inquisiteur et Pedralvi, qui veillait sur lui et ne le quittait pas du regard.
— Eh bien, mes maîtres, leur dit le Maure, son arrêt est-il prononcé ? Qu’ordonnez-vous ?
— Nous ordonnons, répondit Alliaga, que le prisonnier sera confié à ta garde.
— Bien, cela ! dit-il avec joie.
— Et nous te chargeons de le défendre.
— Moi ! s’écria-t-il stupéfait.
— Oui, par ta mère, par Juanita, par le sang de tes maîtres, tu vas nous promettre non-seulement de respecter les jours du grand inquisiteur, mais de le protéger contre le poignard de ses ennemis.
— Ça m’est impossible.
— Vois, cependant ! j’allais partir pour retrouver Delascar et sa fille, pour sauver nos frères, pour leur rendre leurs biens et leur patrie ; mais je ne m’éloignerai pas, Pedralvi, que je n’aie reçu de toi ce serment.
Le Maure hésita quelques instants. Il était en proie à un violent combat. Enfin, triomphant de lui-même, il s’écria :
— Partez donc… je jure… je jure… de protéger celui qui a massacré nos frères, celui que j’avais promis d’immoler. Et vous, dit-il en se tournant vers Sandoval, cessez de trembler, mon révérend. Vous êtes maintenant plus en sûreté ici qu’au milieu du palais de l’inquisition.
— Bien, lui dit Alliaga, je m’éloigne sans crainte ; car je sais que jamais un Maure n’a trahi ni son serment ni l’hospitalité.
— Soit ! murmura Pedralvi, mais pour Ribeira et le duc de Lerma, mon serment tient toujours !
LXXIV.
le retour à madrid.
Alliaga, toujours escorté par le fidèle Abouhadjad et suivi de Gongarello, descendit la montagne jusqu’à la grande route, occupée par les différents postes des Maures. Là, il voulut vainement renvoyer ses guides ; ceux-ci ne consentirent à le quitter que lorsqu’ils eurent franchi presque toute la chaîne de l’Albarracin.
Arrivé enfin au bord du Xucar, rivière qu’il faut traverser pour aller à Cuença, Piquillo les força de s’arrêter, il y aurait eu danger pour eux à aller plus loin, et il continua avec Gongarello à suivre le Xucar jusqu’à la posada où il avait laissé sa voiture et ses gens. Il prétexta une visite qu’il avait voulu faire à pied à un couvent de franciscains situé dans la montagne, au-dessus de Huelamo de Ocana. Il avait voulu, disait-il, s’y rendre en secret, de peur qu’on essayât de l’en empêcher, à cause du voisinage des Maures.
Il ne s’arrêta pas à Cuença, et le lendemain seulement assez tard, il arriva à Valence.
Il courut au palais du vice-roi, le marquis de Cazarena, neveu du duc de Lerma. Les ordres du roi, transmis par le ministre, avaient été si formels et si menaçants, que le vice-roi, tremblant de perdre sa place, s’était empressé de les exécuter. La Vera-Cruz, de la marine royale, excellente caravelle, vaisseau fin voilier, avait été équipée à la hâte ; quelque diligence qu’on y mit, il fallut y employer tout un jour, ce qui donnait une grande avance au San-Lucar, que l’on poursuivait ; mais ce dernier vaisseau naviguait si mal et la marche de la Vera-Cruz était si supérieure, qu’il y avait tout lieu de croire qu’elle rejoindrait promptement Juan-Baptista et son équipage.
Cependant plus de deux semaines s’étaient écoulées, et l’on n’avait eu aucune nouvelle ni de la Vera-Cruz ni du San-Lucar. Il est vrai que des orages terribles avaient éclaté sur les côtes d’Afrique ; qu’un vent contraire, qui régnait depuis plusieurs jours, éloignait tous les vaisseaux et les empêchait d’aborder dans les ports d’Espagne.
Alliaga était désolé et ne pouvait cependant accuser le zèle du vice-roi. Dans son impatience il ordonna à un nouveau bâtiment, le San-Fernando, de mettre à la voile et d’aller à la découverte. Le marquis de Cazarena voulut vainement faire quelques objections ; Alliaga se fit obéir en montrant la lettre de Sa Majesté, qui lui donnait pleins pouvoirs.
D’ailleurs les vents contraires, qui s’opposaient à ce qu’on entrât dans les ports d’Espagne, n’empêchaient pas d’en sortir, et le San-Fernando partit à la recherche de Delascar et d’Aïxa.
Jusqu’à son retour, il fallait attendre, il n’y avait pas moyen de s’éloigner, et cependant Alliaga comprenait combien sa présence était nécessaire à Madrid ; il se disait que chaque jour, chaque instant rendait peut-être la position d’Yézid plus dangereuse ; que, pressé de tous côtés par des forces supérieures et par des chefs habiles, il ne pouvait longtemps résister, et qu’Alliaga ne viendrait à son aide que trop tard peut-être.
Jusqu’alors, heureusement, aucune nouvelle n’était arrivée de l’Albarracin. Il était à croire que, fidèle au plan concerté par les deux frères, Yézid avait évité le combat, se contentant de fatiguer ou de harceler son ennemi dans les gorges et défilés de ces montagnes qu’il connaissait mieux que lui.
Enfin le vice-roi s’empressa de remettre à Alliaga un message qu’il venait de recevoir, non par mer, mais par terre. On assurait qu’un vaisseau, qui ressemblait beaucoup au San-Lucar, avait été signalé en vue de Carthagène, battu par la tempête, abandonné à la dérive et devenu le jouet des vents ; que, du reste, on enverrait à Valence tous les renseignements que l’on pourrait recueillir à ce sujet.
Le lendemain, en effet, un courrier à cheval, envoyé par le gouvernement de Carthagène, annonçait que le vaisseau signalé était bien réellement le San-Lucar ; que le vent ayant subitement changé dans la nuit, le bâtiment avait été jeté à la côte et avait échoué, non pas sur des récifs, mais dans un endroit peu dangereux et où il avait été facile de l’aborder ; mais qu’à la grande surprise des marins qui s’empressaient de porter des secours aux naufragés, on n’avait trouvé personne à bord du navire ; que, malgré de fortes avaries, le San-Lucar avait pu encore tenir la mer ; que ce n’était donc point par suite d’un naufrage que les passagers l’avaient abandonné ; que, d’un autre côté, les habillements, les meubles et les effets précieux laissés dans le navire avaient éloigné toute idée qu’il eût été attaqué ou pillé par des pirates.
Dans l’horrible situation d’esprit où le laissaient de pareilles nouvelles, Alliaga ne savait s’il devait perdre tout espoir ou en conserver encore. En tout cas, sa présence à Valence devenait inutile, et l’intérêt de ses frères le rappelait près du roi. Il laissa au marquis de Cazarena les derniers ordres de Sa Majesté, ou plutôt les siens. C’était, au retour du San-Fernando ou de la Vera-Cruz, de transmettre à l’instant, à Madrid et au roi lui-même, tous les renseignements que l’on recevrait, et si l’un de ces deux navires ramenait la duchesse de Santarem et son père, de les traiter avec les plus grands égards et d’obéir à l’instant à tous les désirs qu’ils exprimeraient sur leur séjour à Valence ou sur le lieu de leur retraite.
Ces derniers soins remplis, Alliaga, la mort dans l’âme, et en proie aux plus sombres pressentiments, reprit la route de Madrid, voyageant jour et nuit sans se reposer.
Il ne s’arrêta qu’un instant en traversant la chaîne inférieure de l’Albarracin, et sans descendre de voiture, il demanda à son ancien hôte, Mosquito, le maître de la posada de Carascosa, s’il avait appris quelque chose des événements de la guerre.
— Je le crois bien ! s’écria celui-ci en faisant le signe de la croix. Son Excellence don Sandoval le grand inquisiteur (c’est un deuil et une désolation pour toute la chrétienté), le grand inquisiteur lui-même est tombé au pouvoir des Maures, des hérétiques, des infidèles.
— Je le sais, je le sais, interrompit vivement Alliaga. Et qu’est-il arrivé depuis ?
— On a tout tenté pour le délivrer, et la semaine dernière nous avons entendu d’ici le canon et la mousqueterie, qui, réunis aux échos de la montagne, faisaient un tapage à empêcher nos voyageurs de dormir. Mais, rassurez-vous, seigneur, se hâta d’ajouter l’hôtelier en s’apercevant de son imprudence, que cela ne vous empêche pas de vous arrêter chez moi ; depuis quelques jours on ne se bat plus, et Augustin de Mexia et ses troupes sont exténués.
— En vérité ! dit Alliaga avec une expression de joie qu’il se hâta de réprimer.
— Je le tiens d’un brigadier courbatu et fourbu qui s’était laissé tomber sur des pointes de rochers. Il prétend que l’armée ennemie, après leur avoir tué beaucoup de monde a disparu un matin avec le grand inquisiteur au moment où elle allait être cernée et faite prisonnière… disparue totalement.
— Ce n’est pas possible !
— Au point que depuis ce moment, et pour la découvrir, nos soldats parcourent les montagnes dans tous les sens. Ils ont beau chercher les Maures, ils ne peuvent pas les trouver, impossible de savoir par où ils ont passé, et l’on n’aurait plus de leurs nouvelles si de temps en temps, la nuit, quelques coups de mousquets ne venaient atteindre nos gens jusque sous leurs tentes.
Les uns disent que c’est un talisman magique qui les rend invisibles, car les Maures ont toujours été savants dans la magie et la sorcellerie, les autres prétendent que c’est Satan lui-même qui les a enlevés et transportés en enfer. Et je le croirais assez, s’ils n’avaient pas avec eux le grand inquisiteur.
— En avant, muletiers ! s’écria Alliaga sans vouloir en entendre davantage.
Et sa voiture s’éloigna rapidement, laissant maître Mosquito sur le pas de sa porte, le cou tendu et son bonnet de laine à la main.
Notre voyageur se dit en lui-même que Yézid, par quelque marche savante et par la connaissance qu’il avait des sentiers de la montagne, s’était dérobé à la poursuite d’Augustin de Mexia. C’était ce qu’il pouvait désirer de plus favorable ; et un peu rassuré de ce côté, il redoubla de vitesse et n’épargna pas les pourboires aux muletiers, qui, en reconnaissance, n’épargnaient pas les coups de fouet à leurs mules.
Alliaga arriva à Madrid au milieu de la nuit et bien après la fermeture des portes. Aussi trouva-t-il tout naturel que pour les lui ouvrir on lui demandât qui il était ; mais quand il eut répondu frey Alliaga, confesseur de Sa Majesté, l’on s’informa s’il se rendait directement au palais.
— Impossible à une pareille heure, répondit-il.
Il ordonna aux muletiers de le conduire à l’hôtel de Santarem. En route, il s’étonna de cette question ; il en eut bientôt l’explication.
Il dormait depuis quelques heures à peine, mais d’un sommeil lourd et agité, quoiqu’il eût grand besoin de repos après les fatigues de toute espèce d’un si long voyage, lorsque Gongarello entre brusquement dans sa chambre au point du jour.
— Qu’est-ce ? lui dit Alliaga en s’éveillant en sursaut.
— L’hôtel est cerné par des uniformes.
— Des soldats ?
— Non, des uniformes noirs que je reconnais trop bien. Des familiers du saint-office, et c’est moi que l’on menace.
— Ce serait moi plutôt, répondit Alliaga en s’habillant à la hâte. Et il se dit en lui-même : Est-ce qu’avant de se mettre en route et au reçu de la lettre d’Escobar, le grand inquisiteur se serait hâté d’exécuter les conseils que lui donnaient les pères de Jésus, ses nouveaux alliés ? Est-ce qu’il aurait expédié, de Valence, l’ordre de guetter mon arrivée, pour me plonger, sans autre forme de procès, dans les cachots de l’inquisition ? Cela ne se peut ; je ne puis le croire.
Il ne lui fut plus possible de douter, car un instant après la porte de son appartement s’ouvrit avec violence.
Un des principaux officiers du saint tribunal, le seigneur Spinello, créature de Sandoval et ennemi déclaré d’Alliaga, se présenta devant lui, et lui montrant dans la pièce voisine un groupe d’alguazils et de familiers du saint-office, s’écria d’un air de joie et de triomphe :
— Seigneur frey Luis Alliaga, religieux de l’ordre de Saint-Dominique, au nom de Son Excellence le grand inquisiteur Bernard y Royas de Sandoval, je vous arrête !
LXXV.
la guerre dans les montagnes.
Notre intention n’est pas de suivre don Augustin de Mexia dans ses opérations militaires et de décrire dans tous ses détails sa courte et sanglante campagne contre les Maures de l’Albarracin.
Après le désastre complet de Diégo Faxardo et la défaite du brigadier Gomara, il avait compris, en général habile et qui tient à sa renommée, qu’en attaquant ses ennemis dans les fortes positions qu’ils occupaient, la victoire lui coûterait trop cher et qu’un échec minerait sa réputation militaire.
Un triomphe bien plus certain et bien plus facile lui était assuré.
Yézid commandait à une quinzaine de mille hommes, dont le tiers seulement était armé et encore grâce, en grande partie, aux mousquets et aux munitions enlevés à Diégo. Ce qui affaiblissait les insurgés, c’étaient les femmes et les enfants qu’ils avaient emmenés avec eux. Il y en avait près de dix mille à protéger et à défendre, et bien plus encore, à nourrir. La montagne ne produisait rien, et nous avons vu que des colonnes expéditionnaires descendaient de temps en temps dans la plaine pour y chercher des vivres et en ramener des troupeaux.
Augustin de Mexia dressa, d’après ces circonstances, son nouveau plan de campagne. Au lieu d’attaquer de nouveau, il se contenta de repousser ses ennemis sur les sommets de la montagne, avançant sur eux pas à pas, occupant et fermant successivement les sentiers praticables par lesquels on pouvait descendre dans la plaine.
Les Maures qui tentèrent de forcer ces passages, garnis de troupes et d’artillerie, trouvèrent une si vive résistance, qu’ils furent obligés de regagner la montagne en désordre et avec de grandes pertes. Ils se réfugièrent dans des endroits presque inaccessibles, où les Espagnols se gardèrent bien de les attaquer ; mais un ennemi bien plus redoutable vint les y atteindre.
Les troupeaux qu’Abouhadjad avait ramenés de son expédition n’avaient pu suffire longtemps à la consommation d’une population aussi nombreuse. En peu de jours ils avaient été épuisés, et nous venons de voir que les Maures avaient tenté vainement de se procurer de nouvelles provisions. Les soldats pouvaient supporter la faim, mais les femmes, mais leurs enfants ! Ils leur avaient déjà abandonné les faibles rations qu’on leur distribuait chaque matin, et il fallait, faibles et se soutenant à peine, subir de nouvelles marches, de nouvelles fatigues, de nouveaux combats.
Don Augustin de Mexia avait choisi ce moment pour les attaquer sur tous les points. Il était redevenu maitre de la route de Valence à Madrid et de tous les postes importants de ce côté de la montagne, car les autres versants, ceux qui donnaient sur les plaines de Valence et sur les côtes, étaient, comme nous l’avons vu, occupés par Fernand d’Albayda, qui, fidèle aux ordres de son général, avait gardé tous les passages, mais n’avait pas une seule fois attaqué les Maures ; au contraire, il avait souvent, et avec une grande sévérité, retenu ses soldats qui demandaient le combat ; conduite habile et prudente qui avait donné de lui la plus haute opinion à don Mexia, surtout quand celui-ci comparait la sage réserve de son jeune lieutenant, à la fougue inconsidérée et fatale de don Diégo Faxardo.
Quant à Yézid, ne pouvant, avec l’immense population qu’il trainait à sa suite et avec des soldats exténués, lutter contre des troupes nombreuses et approvisionnées de tout, il avait opéré sa retraite en bon ordre ; il avait, toujours en reculant, gravi la montagne jusqu’à un plateau assez étendu et que la nature avait pris soin de fortifier. C’était une excellente position, et il s’était arrêté, attendant l’ennemi et lui offrant de nouveau le combat.
Cette fois encore, don Augustin l’avait refusé, comptant toujours sur des auxiliaires qui ne pouvaient lui manquer. En effet, les privations de toute espèce se faisaient plus que jamais sentir ; depuis deux jours, les soldats ne pouvaient plus donner leur part à leurs femmes et à leurs enfants : eux-mêmes n’avaient plus rien.
Yézid voyait devant lui, et à peu près à une demi-lieue au-dessous de son camp, le camp des Espagnols, qui, comme par une trêve tacite, s’étaient arrêtés et attendaient que la faim leur livrât leurs victimes. À sa gauche et à sa droite étaient des rochers presqu’à pic, qui s’élevaient à plusieurs centaines de pieds au-dessus de sa tête. Derrière lui, au midi, commençait la pente de la montagne du côté de la mer ; c’était là qu’étaient échelonnées les troupes de Fernand d’Albayda, impatientes de combattre. Mais de ce côté encore plusieurs rangs de rochers défendaient le camp des Maures, et de pareils retranchements ne pouvaient être facilement enlevés.
S’il n’eût eu que les Espagnols à combattre, Yézid aurait pu encore espérer la victoire ; mais la faim, la faim cruelle commençait déjà à décimer ses soldats, et une nuit que l’inquiétude et l’agitation l’empêchaient de dormir, il se demandait s’il ne valait pas mieux se précipiter lui-même sur les mousquets des Espagnols et aller chercher la mort, que de l’attendre dans des tourments aussi cruels ; tout à coup il crut entendre du côté de la plaine des pas lents et lourds qui gravissaient la montagne ; il écouta de nouveau ; craignant une attaque nocturne, il choisit quelques hommes déterminés et glissa avec eux le long des rochers pour découvrir la marche des ennemis, et les surprendre lui-même s’il le pouvait.
Quel fut son étonnement quand, pendant la nuit, il crut distinguer d’immenses troupeaux qui, formant une longue file, s’élevaient sur le flanc de la montagne et se dirigeaient vers le camp des Maures.
Ce qu’il y avait d’inconcevable, c’était d’abord que ce convoi vint de lui-même, et ensuite que l’armée ennemie ne l’eût pas arrêté. Ceux qui le conduisaient étaient des bergers de la plaine. Leur chef était un nouveau chrétien qui, depuis plusieurs années, avait reçu le baptême, mais qui était resté Maure au fond du cœur.
— Seigneur, dit-il à Yézid, on m’a ordonné de vous amener ces troupeaux de bœufs, que nous avons chargés d’autant de sacs de blé qu’ils ont pu en porter.
— Qui t’a dit de les conduire vers nous ?
— Mon maitre ! un maitre qui envoie cela à ses anciens fermiers, à ceux, m’a-t-il dit, qui pendant tant d’années ont cultivé ses champs et l’ont fait vivre lui-même.
— Ce maître quel est-il ?
— Je ne puis vous le faire connaître.
— C’est, juste ! ce serait exposer sa tête, et toi-même tu as couru de grands dangers. Comment as-tu fait pour tromper la surveillance ennemie ?
— On m’a dit : gravis la montagne la nuit prochaine, du côté gauche du camp, par le sentier qui serpente entre les rochers.
— Il y avait, hier matin encore, un détachement formidable posté au pied de ces rochers.
— Il n’y était pas ce soir. Personne ne nous a arrêtés, aucune sentinelle ne nous a crié : Qui vive ? et depuis trois heures nous montons sans trouver d’autres obstacles que ceux du chemin.
— Je ne saurais payer un pareil service, s’écria : Yézid, mais n’importe, prends !
Et il lui présentait une partie des trésors qu’Alliaga lui avait rapportés.
— Je ne puis rien recevoir, répondit le vieux pasteur, mon maitre me l’a bien défendu : il m’a seulement ordonné de redescendre la montagne au plus vite et de vous remettre, à vous-même, avant mon départ, ce qui m’a servi à guider mon troupeau, ce bâton, qu’il vous recommande de briser et de brûler.
Le pasteur et ses compagnons se hâtèrent de s’éloigner. Les troupeaux furent reçus avec des transports de joie dans le camp, où ils ramenaient l’abondance, et Yézid, resté seul, se hâta de briser le bâton qu’on lui avait remis, et qui contenait quelques lignes d’une écriture déguisée.
Il ne s’en étonna pas. Ce message pouvait être intercepté.
« Mes bons et anciens vassaux.
« Recevez le présent qu’un ami vous envoie et de plus un utile conseil. Quelque forte que vous semble votre position, hâtez-vous de la quitter ; on manœuvre en ce moment pour tourner votre droite, et dans vingt-quatre heures vous serez attaqués et cernés de tous les côtés »
Yézid ne pouvait révoquer en doute la sincérité de cet avis ; c’était un Espagnol, il est vrai, qui le lui adressait, mais c’était un ami. C’était un des grands propriétaires des plaines de Valence qui envoyait ainsi en secret, au camp des Maures, de nombreux troupeaux, formant la partie principale de sa richesse.
Cet ami, Yézid ne pouvait le méconnaître.
— Ô Fernand d’Albayda, s’écria-t-il avec émotion, soyez béni, vous qui arrachez tant de familles à une mort certaine !
Fernand avait, en effet, tout ordonné, tout préparé.
Un vieux serviteur, qui lui était tout dévoué, avait rassemblé ces troupeaux et les avait conduits par le chemin que son maître lui avait tracé.
Pendant huit jours et huit nuits, un nombreux détachement avait étroitement gardé les défilés de ces rochers, et après avoir fatigué, par une surveillance inutile, ces soldats qui en murmuraient eux-mêmes, leur chef leur avait permis de prendre quelque repos la nuit même où cette surveillance devenait nécessaire.
Enfin c’était Fernand d’Albayda qui, sans vouloir être reconnu, adressait à Yézid ce salutaire avis que lui seul, au monde, pouvait donner.
Il fallait donc le suivre ; mais comment ?
Devant Yézid, le corps d’armée d’Augustin de Mexia ; derrière lui, les troupes de Fernand ; à sa droite, des montagnes qu’il était possible de gravir, il est vrai, et par lesquelles on pouvait opérer une retraite, mais c’était justement de ce côté que l’ennemi l’avait tourné et s’avançait pour le cerner.
À gauche, il ne fallait même pas y penser. Aucun moyen de fuite. Des rochers de hauteurs différentes, mais de plusieurs centaines de pieds chacun, et taillés presque à pic.
On tint conseil. Un des chefs, Cogia-Hassan, né dans ces montagnes, où depuis son enfance il avait mené paître ses chèvres, prétendit qu’il y avait au milieu de ces rochers un chemin en apparence impraticable, et en réalité des plus dangereux, par lequel on pouvait, avec de la vigueur et du courage, se hisser jusqu’au haut de ce rempart de granit, et que là on trouverait, à la cime même de ces rochers, une vaste plaine, une prairie arrosée par l’eau d’un torrent supérieur formé par des neiges.
Quel que fût le danger d’une pareille entreprise, c’était le seul moyen de salut ; il fallait le tenter. Mais en l’adoptant on était obligé d’abandonner l’artillerie, les bagages, et, bien plus encore, les femmes et les enfants aux mains des ennemis ; car il n’y avait que des hommes vigoureux qui pussent entreprendre un trajet aussi pénible, aussi périlleux, et rester pendant près d’une heure suspendus au-dessus des abimes et des précipices. Quant à leurs familles, c’était les exposer à une mort certaine.
Il est vrai que les livrer aux Espagnols offrait exactement le mème résultat.
— Si ce n’est que cela, dit Cogia-Hassan, je peux vous enseigner un moyen de mettre nos femmes, nos enfants et nos provisions à l’abri de tout danger et de les dérober même aux regards de tous les Espagnols.
Chacun l’écouta avec attention.
— Il y a non loin d’ici une grotte immense qui, à l’intérieur, offre près d’un quart de lieue d’espace. Elle est justement placée sous les rochers que nous voulons franchir. On n’y entre que par une seule ouverture, de quatre ou cinq pieds, qu’il sera facile de fermer en dedans dès que nous serons entrés.
Cette grotte, peu élevée en certains endroits, offre en d’autres plus de quarante pieds de hauteur et elle n’est pas obscure, on y aperçoit même le ciel, car elle reçoit du jour d’en haut par une immense ouverture pratiquée au milieu des rochers amoncelés sur la grotte.
Cette retraite, presque taillée dans le roc, les espagnols ne la devineront pas, et même ils la soupçonneraient, qu’ils ne pourraient la découvrir, ni surtout y pénétrer.
L’avis de Cogia-Hassan prévalut. Il n’y en avait pas de meilleur, et du reste on était pressé par le temps et par les Espagnols qui allaient arriver. On trouva, on examina la grotte, la plus belle de toute la sierra de l’Albarracin. Elle était, en effet, vaste, spacieuse, bien aérée et suffisamment éclairée en certaines parties par l’espèce de soupirail supérieur dont nous avons déjà parlé. Les parois intérieures et toute la voûte étaient en granit, et nul éboulement n’était à craindre.
Cette grotte, qui s’étendait au loin sous la montagne, pouvait contenir, et au delà, tous ceux qui, dans ce moment, lui demandaient un asile. On s’empressa donc d’y renfermer les vieillards, les femmes et les enfants, au nombre, disent les historiens du temps, de sept à huit mille ; de plus les bagages de toute espèce, l’artillerie et la plus grande partie des troupeaux que l’on devait à la générosité de Fernand d’Albayda. Une autre partie des bestiaux fut tuée pour l’approvisionnement de l’armée, qui, dans le chemin escarpé qu’elle avait à gravir, emportait avec elle ses armes et ses vivres pour quelques jours.
Le grand inquisiteur Sandoval, qui depuis le départ d’Alliaga avait été traité par Yézid avec les plus grands égards, était toujours resté prisonnier des Maures. Il fut décidé que ce précieux otage serait renfermé dans la grotte, dont Yézid confia le commandement et l’administration à Pedralvi et à quelques soldats déterminés.
Dès qu’ils furent tous entrés, Pedralvi donna ordre
de fermer en dedans l’ouverture ; pour plus grande
précaution, Yézid fit rouler, à l’extérieur, des masses
de rocs et de terres ; les interstices mêmes des rochers 
Carmen l’interrogeait d’un œil inquiet ; les larmes d’Aïxa lui répondirent.
furent garnis d’herbes, de mousses et de plantes sauvages
qui dérobaient aux yeux les plus clairvoyants
l’entrée déjà si difficile de ce souterrain.
Yézid et ses soldats espéraient se soustraire ainsi, pendant quelques jours, aux Espagnols qui les poursuivaient. Des cimes élevées où il allait asseoir son camp il pourrait défier, non-seulement leurs attaques, mais même leurs recherches, et attendre sans crainte l’effet des promesses d’Alliaga.
Dès que les Espagnols, fatigués de parcourir inutilement les sommets âpres et inhabitables de l’Albarracin, seraient redescendus dans la plaine ou dans les parties inférieures de la montagne, Yézid et les siens descendraient à leur tour des pics de leurs rochers et viendraient rendre à la liberté les prisonniers de la grotte.
Le soir même, guidée par Cogia-Hassan, l’armée commença sa marche ascensionnelle, et Yézid voulut être le premier à explorer le chemin effrayant qu’on allait suivre. Qu’on se figure une armée entière, une longue file de soldats gravissant un à un une muraille de granit, presque à pic, s’appuyant sur les pointes de roches saillantes, se retenant aux racines d’arbres ou aux plantes vigoureuses qui tapissaient le flanc de la montagne, et chacun, si un faux pas l’entraînait dans l’abime, risquant sa vie et celle du compagnon qui était au-dessous de lui.
Il faut dire que cette muraille de rochers, qui, à l’œil et de loin, paraissait droite et perpendiculaire (et c’est un effet éprouvé par tous ceux qui voyagent dans les montagnes), cette muraille offrait, à une trentaine de pieds de hauteur, un sentier escarpé, inaperçu d’en bas, et que Cogia-Hassan connaissait bien. Ce sentier, serpentant en zig-zag le long de la montagne, était encore d’une difficulté extrême, et surtout donnait d’effroyables vertiges à ceux qui avaient l’imprudence de regarder au-dessous d’eux, mais enfin c’était une espèce de chemin de corniche, praticable, et qui conduisit presque toute l’armée des Maures aux sommets des remparts de granit qu’elle avait à franchir.
Là, ainsi que l’avait promis Cogia-Hassan, une plaine 
Non, dit le matelot en le retenant, nous règlerons cela à bord ; marché conclu, touches-là.
s’offrit à leurs regards. Quelques arbres y croissaient
encore ; l’herbe y verdoyait dans quelques endroits,
car ce sol de rochers, ce terrain aride, était arrosé continuellement
par les eaux abondantes d’un torrent
dont la source supérieure bouillonnait au-dessus de
leur tête.
Fatigués par cette longue et pénible marche, les Maures bénirent cette onde bienfaisante qui leur permettait de se rafraichir et d’accomplir, en signe d’actions de grâces, les ablutions commandées par les rites de leur croyance.
Pendant ce temps, et au moment où les premiers rayons du jour éclairaient la montagne, Augustin de Mexia et ses troupes s’avançaient pour attaquer le camp des Maures. Le général espagnol avait fait faire à une partie de ses soldats une manœuvre admirable pour tourner la montagne de droite, la seule qui lui parût accessible. Il avait calculé les jours et les heures que devait leur coûter cette longue et difficile opération ; il avait envoyé ses ordres en conséquence à don Fernand d’Albayda, et toutes les mesures de l’habile général avaient été si bien prises, qu’il gravissait lui-même le nord de la montagne pendant que don Fernand se mettait en marche par le midi, et que la colonne expéditionnaire franchissait les derniers rochers qui régnaient à l’est.
Les trois corps d’armée, étonnés de n’avoir pas été inquiétés dans leur marche, débouchèrent à la même heure et presque au même instant sur le plateau qui était censé occupé par les Maures, qu’ils devaient ainsi accabler par trois côtés différents. Quant au quatrième côté, nous savons qu’il était fermé par une muraille de granit à pic.
Rien ne peut rendre la stupéfaction de don Augustin de Mexia au profond silence et surtout à la vaste solitude qui régnaient autour de lui.
Aucune apparence, aucun vestige de ce camp qu’ils venaient détruire, de ces Maures qu’ils venaient massacrer. Tout avait disparu ! et comment dix à douze mille soldats, sept ou huit mille femmes et enfants avaient-ils pu, en quelques heures, s’évanouir comme un nuage, comme une fumée ou devenir invisibles !
C’était un enchantement, une magie ! Aussi, le bruit s’en était-il répandu sur-le-champ dans les rangs espagnols, et il n’était pas étonnant que l’hôtelier de Carascosa, le seigneur Mosquito, eût fait part de cette opinion à Alliaga, lorsque, ainsi que nous l’avons vu plus haut, celui-ci, à son passage, avait interrogé le digne maître de la posada sur les opérations de l’armée.
Don Augustin de Mexia n’était pas homme cependant à croire aux corps d’armée enlevés par un coup de baguette. Après avoir bien examiné la position, il lui fut prouvé que Yézid et ses soldats n’avaient pu lui échapper que par les murailles des rochers qui s’élevaient à l’ouest. Pensant bien que les Espagnols, qui avaient découvert le Nouveau-Monde, sauraient découvrir le camp des Maures au milieu d’une montagne, il envoya en éclaireurs plusieurs soldats adroits et intrépides.
Ceux-ci vinrent lui rapporter qu’il y avait réellement sur le flanc du rocher un sentier en zig-zag qui pouvait conduire des chevriers et leurs troupeaux jusqu’au sommet de la montagne ; mais qu’il était impossible d’y faire gravir une armée et surtout de l’artillerie ; qu’ils ne pouvaient donc croire que les Maures eussent tenté de le faire.
Il faut pourtant bien qu’ils l’aient fait, se disait en lui-même don Mexia ; car ils sont au haut de ces rochers, c’est évident. Quant à les en débusquer, quant à essayer même de les y attaquer, il n’en eut pas un instant la pensée, quoique ce fût l’avis de Diégo Faxardo, qui, impatient de venger son affront et malgré sa bonne volonté, remarquait avec désespoir qu’on ne se battait plus depuis… qu’il avait été battu.
— Rassurez-vous, lui répondit son général, je vais vous offrir une occasion de prendre une revanche et de rendre à l’armée un signalé service.
Voici de quoi il s’agissait :
En gravissant les plus hauts sommets opposés et qui étaient accessibles, don Augustin avait découvert ou du moins deviné à peu près la position des Maures. Ils devaient être campés sur un terrain aride et inculte, ne pouvant rien produire, ne leur offrant aucune ressource. Ils ne pouvaient descendre de ces hauteurs inexpugnables pour se procurer des provisions et des vivres. Comment avaient-ils pu en emporter avec eux, c’est ce que le général ne s’expliquait pas ; mais ces vivres, quelque abondants qu’ils fussent, devaient cesser un jour ou l’autre. Ce qui durerait plus longtemps, c’était l’eau qu’ils avaient en abondance, c’était ce torrent qui, tombant des sommets neigeux de l’Albarracin, alimenterait sans cesse leur camp.
Il voulait donc, pour les forcer à se rendre, pour les prendre à la fois par la faim et par la soif, détourner l’eau de ce torrent et l’empêcher de tomber dans la vallée où campaient les Maures. Il fallait pour cela, avec des fatigues inouïes, tourner les montagnes de neige qui, de haut et de loin, dominaient la position d’Yézid. C’était difficile et dangereux, c’est pour cela que le général en chargeait don Diégo de Faxardo.
Celui-ci eût mieux aimé des dangers où sa bonne épée pût lui servir, dût-il, à lui tout seul, combattre les Maures, non dans les rochers, car les rochers lui portaient malheur ; mais en plaine il se faisait fort de prendre sa revanche et de les mettre en déroute.
En attendant, il s’empressa d’obéir au général et partit avec une centaine d’hommes portant des cordages, des bâtons ferrés et des tentes, enfin tout l’appareil et les bagages nécessaires pour une expédition dans les montagnes et dans les neiges.
LXXVI.
la grotte del torrento.
La première journée fut fatigante : la seconde encore plus. Mais ils approchaient ; ils entendaient le bruit du torrent impétueux. Ils apercevaient ses flots bouillonnants d’écume tomber du sommet des neiges, se précipiter en magnifique cascade et descendre de rocher en rocher jusque dans les vallées inférieures.
Certain d’atteindre bientôt le but de son expédition, le capitaine Diégo, avant de tenter sa dernière ascension, permit à ses hommes de se reposer et de se refaire. Ils s’assirent au milieu d’un groupe de rochers, à côté d’une ouverture en entonnoir qui devait donner dans les profondeurs de la terre et qu’ils n’avaient nulle envie de sonder. Ils mangeaient de fort bon appétit des oignons crus, repas ordinaire du soldat espagnol, lorsqu’une fumée épaisse les entoura. Cette fumée apportait avec elle un parfum de cuisine et surtout de bœuf rôti, inusité dans ces montagnes, parfum qui étonnait à la fois et ravissait leur odorat. Ils se levèrent et examinèrent avec attention, l’oreille et le nez au vent.
Cette fumée, qui s’élevait au-dessous de leurs pieds, venait de l’ouverture souterraine qu’ils avaient remarquée. Serait-ce un soupirail de l’enfer, se dirent quelques-uns des soldats avec effroi.
Diégo les rassura, et se couchant à plat ventre au bord du cratère de cette espèce de volcan, il regarda attentivement. La fumée qui s’en échappait l’empêchait de rien distinguer et manquait de le suffoquer ; mais il entendait ce bourdonnement confus et incessant que produit une masse d’hommes réunis ; il entendait en outre le mugissement des bœufs, le bêlement des moutons.
En ce moment la fumée avait cessé, et Diégo aperçut quelques pointes de rochers qui s’avançaient çà et là, sur lesquelles on pouvait poser le pied et descendre dans l’intérieur de la caverne jusqu’à une profondeur à peu près d’une douzaine de pieds. C’était un moyen d’examiner de plus près, et par son ordre trois ou quatre soldats se hasardèrent à tenter l’entreprise. Mais le premier, après avoir descendu pendant quelques minutes, en s’attachant des pieds et des mains aux aspérités des rochers, cria à voix basse à ses compagnons qu’il n’y avait pas moyen d’aller plus loin, vu qu’au-dessous de lui les parois de la grotte étaient à pic, et qu’il y avait encore un autre danger, c’est qu’on apercevait de la lumière au fond de la caverne, et qu’il avait cru distinguer d’en haut des femmes, des enfants, et surtout des hommes avec des mousquets.
Cette dernière assertion fut confirmée à l’instant même d’une manière trop évidente, car plusieurs coups de feu partis d’en bas atteignirent les soldats, qui roulèrent dans l’abime en poussant un effroyable cri. Leurs deux autres compagnons se hâtèrent de remonter.
Plus de doute, la grotte qui était là sous leurs pieds servait de refuge aux Maures leurs ennemis. Mais comment pénétrer dans ce lieu souterrain ? Ce ne pouvait être par l’ouverture que le hasard venait de faire découvrir ; il devait donc en exister une autre, et le capitaine Diégo laissa une vingtaine de soldats qu’il chargea d’explorer les environs, et continua sa route avec le reste de ses gens pour mettre fin à l’expédition dont son général l’avait chargé.
À une demi-heure de marche, et toujours en s’élevant vers la région des neiges, à une espèce de premier bassin où tombait le torrent, ils aperçurent distinctement au-dessous d’eux le camp des Maures.
Le général espagnol, ainsi qu’on le voit, ne s’était trompé dans aucune de ses conjectures ; mais impossible d’aller chercher et de combattre l’ennemi dans une position pareille. Il n’y avait d’autre moyen de le réduire qu’en le privant de toutes ressources, à commencer par l’eau qui l’approvisionnait[39].
Le torrent, comme nous l’avons dit, se précipitait d’abord dans un vaste bassin qu’il s’était creusé lui-même au milieu des rochers ; de là, il s’échappait par une large échancrure et roulait vers la vallée où campaient les Maures.
Il s’agissait d’abord de lui donner une issue du côté opposé et de le diriger de là vers un autre endroit de la montagne.
Le capitaine Diégo ordonna à l’instant à ses soldats de se mettre à l’œuvre. Les pioches et les hoyaux qu’ils avaient apportés remplacèrent dans leurs mains les mousquets et les épées, et ils travaillèrent toute la journée avec vigueur et courage. Le soir, ils furent rejoints par ceux de leurs camarades qu’on avait envoyés la veille à la découverte.
Ceux-ci déclarèrent qu’ils avaient exploré vainement l’extérieur de la grotte, depuis le haut jusqu’en bas, qu’ils n’avaient aperçu et ne pouvaient même soupçonner aucune entrée, aucune issue, autre que celle qui s’était d’abord offerte à eux, laquelle était impraticable ; et cependant, d’après l’étendue probable de cette caverne, plusieurs milliers de Maures avaient dû s’y réfugier ; c’était là sans doute qu’ils avaient caché leurs femmes, leurs enfants, leurs provisions, et à coup sûr leurs trésors.
À ces derniers mots, tous les soldats frémirent d’impatience et de curiosité, et Diégo, leur chef, de rage. Tenir si près de soi ses ennemis et sa vengeance, et les laisser échapper ! retourner près de son général et de ses compagnons sans avoir effacé par une revanche éclatante l’affront de sa première défaite ! Il ne pouvait s’y résoudre. Le souvenir de sa honte passée ranimait dans son cœur une fureur nouvelle, et cette fureur lui inspira une idée horrible, atroce, diabolique, qui ne devait que trop bien réussir.
Il commanda à ses soldats de redoubler d’efforts et de creuser au torrent un nouveau lit large et profond, en le dirigeant au milieu des rochers vers l’ouverture qu’ils avaient découverte, travail d’autant plus facile, que la grotte était placée à une centaine de pieds au-dessous du premier bassin où tombait la cascade.
Quand cette espèce de canal fut achevé, ils remontèrent vers la première chute, rompirent les digues qu’ils avaient élevées, et le torrent, abandonnant son ancienne direction, se précipita vers le nouveau lit qu’on venait de lui préparer et qui était plus bas que l’autre. Ses eaux bouillonnantes s’élancèrent en grondant et couvrirent de leur fracas les hurlements de vengeance et de joie que poussèrent en même temps Diégo et ses soldats.
— Meurent ainsi tous les infidèles ! s’écria le capitaine ; meurt avec eux le souvenir de mon affront !
Et se tournant vers ses compagnons :
— Nous sommes vengés, dit-il, et notre mission est remplie.
Il descendit alors la montagne, le cœur battant de joie, et alla rendre compte de son expédition à son général, qui occupait alors l’ancien camp abandonné par Yézid, et avait établi ses tentes presque au-dessous des rochers mèmes que Diégo venait de quitter.
Le torrent cependant, s’engouffrant dans les entrailles de la terre, venait d’envahir la retraite souterraine dans laquelle les Maures étaient comme prisonniers, et rien ne peut exprimer leur surprise et leur effroi quand cette masse d’eau énorme, terrible, incessante, commença à tomber par la vaste ouverture qui, naguère encore, leur donnait la lumière, et qui, dans ce moment, leur apportait une mort horrible et inévitable.
La première pensée de Pedralvi fut de donner un écoulement à l’inondation, qui menaçait de les engloutir, et au risque de tomber entre les mains de don Augustin de Mexia, il cria à ses compagnons de l’aider à dégager l’entrée intérieure, celle par laquelle ils avaient pénétré dans la caverne.
Vaine précaution, inutiles efforts.
La grotte avait été presque murée à l’extérieur par les soins d’Yézid et de ses soldats.
— Plus d’espoir ! s’écria-t-on.
Pedralvi en avait toujours, et quoiqu’il fût déjà accablé de fatigue, quoique ses mains fussent en sang, il s’écria :
— Du fer ! du fer ! pour renverser ces derniers remparts et pour frapper les ennemis qui voudraient s’opposer à notre passage !
Ranimés par son énergie et surtout par son exemple, ses compagnons se remirent à l’ouvrage ; mais ils furent bientôt forcés de l’interrompre. L’issue qu’ils voulaient dégager était placée dans l’endroit le plus bas du souterrain. C’est là que les eaux se dirigèrent naturelPage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/346 Page:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/347 Page:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/348 Page:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/349 Page:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/350

— Une telle audace ! s’écria Alliaga avec colère.
— Tu en es indigné… effrayé… et moi aussi. Ne sachant ni ce que je dois craindre ni ce que je dois croire, n’osant me décider entre le père et le fils, j’ai vingt fois déjà changé d’idée, et dans le doute, dans l’indécision, je ne dors pas, j’ai la tête en feu, j’ai la fièvre ! j’en mourrai ou j’en deviendrai fou ! Il n’y a que toi, Alliaga, qui puisse me tirer de ces tourments, ou plutôt de cet enfer ; c’est en toi que j’ai confiance, et c’est toi que je veux croire. Donne-moi un conseil… Oui, s’écria-t-il vivement en regardant autour de lui, nous sommes seuls et personne ne peut nous entendre ; qui des deux faut-il envoyer en exil ? lequel faut-il garder ? Prononce toi-même, ce que tu diras, je le ferai.
Jamais personne ne s’était trouvé dans une situation pareille. Jamais sujet, parti de si bas, n’était arrivé si haut. Lui Alliaga, le Maure, le mendiant, appelé à prononcer sur les destinées de la monarchie espagnole, et pouvant à son gré conserver ou renverser le ministre qui, depuis dix-huit ans, régnait en souverain absolu[40] !
S’il avait osé, et ce fut là sa première pensée, il eût dit au roi : « Au lieu des deux concurrents que me propose Votre Majesté, je lui conseille d’en choisir un troisième. » Mais le roi, effrayé à l’idée seule de se donner un nouveau ministre, c’est-à-dire un maître nouveau et inconnu, aurait préféré garder l’ancien ; d’ailleurs, il fallait brusquer l’événement, se décider à l’instant même ; et Alliaga n’avait ni les moyens ni le temps d’étudier et de proposer l’homme d’État le plus capable.
La question resta donc posée entre le duc d’Uzède et son père. Il était aisé à Alliaga de justifier le duc de Lerma. Il le pouvait d’un mot, et le premier ministre, MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/352 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/353 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/354 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/355 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/356 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/357 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/358 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/359 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/360 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/361 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/362 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/363 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/364 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/365 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/366 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/367 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/368 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/369 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/370 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/371 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/372 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/373 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/374 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/375 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/376 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/377 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/378 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/379 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/380 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/381 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/382 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/383 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/384 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/385 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/386 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/387 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/388 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/389 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/390 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/391 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/392 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/393 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/394 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/395 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/396 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/397 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/398 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/399 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/400 MediaWiki:Proofreadpage pagenum template#lst:Page:Scribe - Piquillo Alliaga, ou Les Maures sous Philippe III, 1857.djvu/401
- ↑ Les fueros de Navarre, sans être aussi étendus que ceux d’Aragon, étaient garantis comme ceux-ci par une loi spéciale qui défendait à tout soldat étranger, c’est-à-dire à tout soldat castillan, de mettre le pied sur le sol navarrais.
- ↑ Cette tendance à l’isolement, qui n’est pas encore, même de nos jours, entièrement détruite en Espagne, s’opposera peut-être long-temps encore à son unité politique.
- ↑ Louis Viardot, Études sur l’Espagne, p. 402.
- ↑ Vingt-six centimes
- ↑ Relation de Khevenhiller.
- ↑ Id.
- ↑ Watson, Histoire de Modèle:Roi, t. Modèle:Rom, p. 62.
- ↑ Fondation de la régence d’Alger, t. Modèle:Rom, p. 281. Fonseca, Modèle:Lang, p. 430.
- ↑ Mendoza, Modèle:Lang, lib. Modèle:Rom, p. 20, 241, édition de Valence.
- ↑ Itinéraire de l’Espagne, par Alexandre Delaborde.
- ↑ Khevenhiller, Annal. Ferdin., de l’année 1598. Léopold Raulke.
- ↑ En Espagne, le roi et la reine tutoient tout le monde.
- ↑ Khevenhiller, Modèle:Lang
- ↑ Léopold Rauke, p. 210.
- ↑ Sorte de champignon, de l’espèce la plus rare et la plus délicate.
- ↑ Léopold Ranke, Modèle:Pg.
- ↑ Il m’a semblé que, dans un moment où la chambre des députés et la France entière s’occupaient enfin de lois et de travaux sur les irrigations, premières sources de la richesse agricole, il serait peut-être intéressant de mettre sous les yeux de nos lecteurs un système inventé, il y a huit cents ans, par les Maures de Valence. Cette description est prise dans l’excellent Voyage en Espagne de Modèle:M., un de nos littérateurs les plus distingués, et fils de notre ancien et bien-aimé professeur de rhétorique. au lycée Napoléon. Je suis heureux de reconnaître ici tout ce que je dois au fils et au père.
- ↑ Cardonne, Histoire d’Afrique.
- ↑ Charles Weiss, t.Modèle:Lié4, p.Modèle:Lié277.
- ↑ Si l’on songe que le roi d’Espagne n’avait fait aucuns préparatifs de défense, et que l’assassinat de Modèle:Roi le délivra d’un ennemi redoutable ; si l’on songe que Marie de Médicis était tout Espagnole de cœur, qu’elle formait avec l’ambassadeur de Modèle:Roi des projets pour le mariage de ses enfants ; que les Italiens qui l’entouraient n’avaient cessé d’entretenir des relations
avec l’Espagne ; si l’ou songe enfin que le duc d’Épernon, dont la conduite avait été si suspecte au moment de l’assassinat, était le représentant de la politique espagnole, et qu’à lui se rattachaient tous les catholiques ardents qui maudissaient une guerre entreprise
contre une puissance catholique, avec l’aide des protestants d’Allemagne et de Hollande, on ne peut s’empêcher de soupçonner que les vrais coupables sont restés impunis.
Modèle:Em Il ne faut pas oublier non plus que l’inquisition avait approuvé en 1602 le livre de Mariana Modèle:Lang, qui justifie la doctrine du tyrannicide. Cette doctrine était entendue, il est vrai, au profit du roi d’Espagne. Modèle:Droite - ↑ Le duc de Lerma s’imagina de tirer d’un couvent le moine Louis Alliaga, qu’il introduisit à la cour et fît nommer confesseur du roi ; homme obscur, mais d’une probité reconnue. (Watson, Histoire de Modèle:Roi, vol. 2, liv. 6, page 289).
- ↑ Note Wikisource : C’est le 2Modèle:E chapitre numéroté « LV. » dans le fac-similé. Cependant nous conservons la numérotation d’origine pour éviter de décaler toute la numérotation des chapitres jusqu’à la fin de l’ouvrage…
- ↑ Fonseca, page 445.
- ↑ Fonseca, passim.
- ↑ Mémoire de Ribeira, archevêque de Valence.
- ↑ Sully, Économies royales, t.Modèle:LiéModèle:Rom, p.Modèle:Lié328.
- ↑ Toutes ces propositions furent faites par les Maures. — Lettres manuscrites de Cottington en possession de lord Hardwick. — Et Mémoires du temps.
- ↑ Fonseca.
- ↑ Fonseca, liv.Modèle:LiéModèle:Rom, chap.Modèle:Lié3.
- ↑ Waston, tom.Modèle:LiéModèle:Rom, liv.Modèle:LiéModèle:Rom.Modèle:Rom
- ↑ Mémoires du cardinal de Richelieu, tom.Modèle:LiéModèle:Rom, p.Modèle:Lié234.
- ↑ Waston, t.Modèle:LiéModèle:Rom, liv.Modèle:LiéModèle:Rom, page 78.
- ↑ Un coussinet semblable à ceux destinés au transport des outres renfermant les vins d’Espagne.
- ↑ Watson, tom.Modèle:LiéModèle:Sc, pag.Modèle:Lié474.
- ↑ Lettres du chevalier Cottington au premier lord de la trésorerie.
- ↑ Le sort de la plupart de ceux qui touchèrent à la côte de Barbarie ne fut pas moins déplorable. À peine eurent-ils débarqué sur ce rivage stérile, inhospitalier, qu’ils furent attaqués par les Arabes-Bédouins, espèce de voleurs sauvages qui habitent sous des tentes et ne vivent que de chasse et du butin. Les Maures, sans armes, embarrassés de leurs femmes et de leurs enfants, furent souvent pillés par ces barbares, qui les assaillaient avec des corps nombreux, forts quelquefois de cinq ou six mille hommes. Aussi souvent que les Maures essayèrent de leur résister avec des pierres et des frondes, leurs seules armes, aussi souvent ils furent presque tous moissonnés par le fer. Beaucoup d’autres aussi périrent de fatigue et de faim, ou par l’inclémence de l’air, dont ils ne purent se garantir pendant les longues et pénibles marches qu’ils entreprirent à travers les brûlants déserts de l’Afrique, pour atteindre Mostaganem, Alger et d’autres places où ils espéraient qu’on leur permettrait de se fixer. En effet, peu de Maures parvinrent jusqu’à ces places, puisque, de six mille hommes qui se mirent en marche de Canasta, ville située aux environs d’Oran, pour se rendre à Alger, un seul, nommé Pedralvi, eut le bonheur d’échapper. Modèle:Droite
- ↑ De ceux qui furent transportés en Afrique la mort dévora plus de cent quarante nille hommes dans un espace de quelques mois. Fonseca, pag.Modèle:Lié284.
- ↑ Fonseca, pag.Modèle:Lié285.
- ↑ Don Agustin de Mexia, officier célèbre par son expérience et par la haute réputation qu’il s’était acquise dans les guerres de Flandres, fut envoyé, avec l’élite des troupes réglées, contre les Maures réfugiés dans la montagne, au nombre de près de trente mille hommes, femmes et enfants, et qui avaient juré de se défendre jusqu’à la dernière extrémité. Le général espagnol les réduisit par le manque d’eau, dont il les avait privés. Modèle:Droite
- ↑ Alliaga délibéra en faveur de qui, ou de Lerma ou d’Uzède, il ferait pencher la balance. L’alternative qu’embrassa ce moine est digne de la plus sérieuse attention, à cause des conséquences politiques qui en furent le résultat. Modèle:Droite
- ↑ Le roi enjoignit à son ministre en termes exprès, dans un billet écrit de sa propre main, de sortir de Madrid, avec pleine et entière liberté de se retirer en tel lieu qu’il lui plairait de choisir, pour y jouir en paix des effets de ses anciennes bontés. Modèle:Droite
- ↑ Dans cette douloureuse situation, Lerma, oubliant sa dignité,
ne rougit point de paraître en suppliant aux pieds d’Alliaga,
et de conjurer, au nom de la reconnaissance, le moine ingrat
d’intercèder en sa faveur auprès du roi.
Modèle:Em(Watson, Histoire de Modèle:Roi, vol.Modèle:LiéModèle:Rom, liv.Modèle:LiéModèle:Rom, page 303.
— Vittorio Siri, tom.Modèle:LiéModèle:Rom — Gonzalo de Cespedes y Meneses). - ↑ Il prit la route de Guadarrama, où il passa la nuit. Il y reçut, avec un cerf tué à la chasse de la propre main du roi, une lettre de Sa Majesté Catholique dont le contenu a toujours échappé aux esprits les plus pénétrants. Modèle:Droite
- ↑ Watson, Histoire de Modèle:Roi, t.Modèle:LiéModèle:Rom, Liv.Modèle:LiéModèle:Rom, p.Modèle:Lié87.
- ↑ Bouche, Histoire de Provence, t.Modèle:LiéModèle:Rom, liv.Modèle:LiéModèle:Rom, p.Modèle:Lié850.
- ↑ Ch.Modèle:LiéWess, l’Espagne, tom.Modèle:LiéModèle:Rom, pag.Modèle:Lié322, Archives du ministère des affaires étrangères, Modèle:CorrModèle:LiéEspagne.