Papers by Frédéric Guelton
HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe), 1998
Revue Historique des Armées, Jan 3, 2015
La France et la Grèce au XXe siècle : des archives à l’histoire, 2021

La France et les Français en Russie, 2011
« La Russie est dans le ciel, le tsar dans le sanctuaire, l’église dans la caserne, l’aumônier so... more « La Russie est dans le ciel, le tsar dans le sanctuaire, l’église dans la caserne, l’aumônier sous le drapeau, le soldat tout autour et le peuple au milieu » (cité par le capitaine de Laisle, état-major général, Mission militaire en Russie, 6 décembre 1875, Service historique de la défense, DAT, 7N 1468).Les archives militaires françaises forment un ensemble sui generis remarquable pour quiconque s’intéresse à l’histoire des relations entre la France et la Russie. Celles consacrées à la période qui s’étend de la guerre de Crimée aux débuts de la première guerre mondiale présentent un intérêt particulier en raison de leur volume global et de leur caractère spécifique, tous deux liés à cet événement majeur des relations internationales de la fin du XIXe siècle que fut la signature d’une convention militaire entre les deux pays généralement connue et présentée sous le vocable simplificateur mais évocateur d’« l’alliance franco-russe ». L’évolution générale des relations extérieures de la France et de la Russie, depuis le temps des premiers contacts réalisés sous le Second Empire jusqu’à la signature de la convention et à la naissance de l’Alliance font passer les deux États de la posture d’ennemis mortels à celle d’alliés indéfectibles. Cette période faste des relations franco-russes survit, dans des conditions dramatiques, à la Grande Guerre, jusqu’à ce que la tourmente révolutionnaire emporte l’empire russe. Elle connaît son épilogue au début des années vingt alors que des militaires français continuent de combattre aux côtés des armées blanches contre les forces bolcheviques et que la France accueille sur son sol une partie de la première émigration russe contrainte de fuir sa terre natale.Cet ensemble historique long de plus de soixante années est rythmé par des moments particuliers qui en représentent autant de chapitres à la fois distincts et successifs. Parmi eux, la décennie 1870-1880 forme un tout cohérent d’un point de vue militaire. Dans les deux pays, le souvenir de la guerre de Crimée s’éloigne tout comme s’estompent les prises de positions antagonistes adoptées lors du soulèvement polonais de 1863. En France, les conséquences dramatiques de la défaite face à la Prusse en 1870-1871 accaparent les esprits. Les militaires français qui, dix ans auparavant, n’hésitaient pas à railler l’armée russe, observent dorénavant avec intérêt la réforme militaire engagée par Milûtin. Ses spécificités intriguent d’autant plus que certaines sont décrites comme d’inspiration allemande. En les analysant, les Français cherchent à comprendre leur défaite récente, à trouver des modèles nouveaux applicables afin de réformer leur armée, enfin à estimer la valeur d’une armée dont chacun sent confusément qu’elle pourrait devenir le bras armé du fameux allié de revers dont la France cherche toujours à disposer dans l’Est européen, depuis au moins le règne de François Ier.Les archives militaires rendent bien compte, dans leur ensemble, de cette situation nouvelle et changeante. Celles des seuls attachés militaires et des officiers en mission projettent sur elle l’éclairage cru, direct et précis de celui qui se rend en Russie pour voir, pour comprendre et pour informer Paris. Elles peuvent, à première vue, paraître quantitativement limitées avec environ une centaine de cartons d’archives sur la période 1860-1914. Elles le sont beaucoup moins lorsqu’on les compare aux archives de même nature consacrées à la Grande-Bretagne (environ cent dix cartons), à l’empire austro-hongrois (moins d’une trentaine de cartons) et surtout à l’Allemagne (à peine plus d’une vingtaine de cartons). Les Français que l’on découvre à travers ces archives dont ils sont les producteurs sont, de facto, parmi les rares observateurs militaires directs de l’armée et de la société russes dans leur ensemble. Ils sont représentés par douze attachés militaires et environ soixante-dix officiers missionnaires, ce qui est, à l’époque, exceptionnel, même si, au moment, le nombre des Français qui séjournent Russie doit se situer entre 8 000 et 9 000 si l’on prend comme base le chiffre de 9 500 issu du recensement russe de 1897. Les résultats de leurs observations contredisent régulièrement les apports d’une historiographie connue, historiquement marquée et souvent politiquement contrainte par la vie politique du continent européen au XXe siècle. Ils proposent aux chercheurs d’entreprendre une nouvelle réflexion méthodologique et méthodique sur la Russie de cette période, qui demeure en définitive insuffisamment connue dans sa réalité historique. Ils poussent également à envisager un examen nouveau de cette armée russe telle que la découvrent les Français et d’en dresser, avec l’aide des sources de première main disponibles en France et en Russie, un tableau nouveau, plus complexe et plus complet que ce qui est généralement connu, afin de mieux rendre compte et de mieux comprendre l’histoire militaire franco-russe au temps de l’alliance éponyme.Французские военные…
Das Militär und der Aufbruch in die Moderne 1860 bis 1890, 2003
Militaires en République, 1870-1962, 1999
L’approche d’un sujet consacré aux hautes instances de la Défense nationale sous la Troisième Rép... more L’approche d’un sujet consacré aux hautes instances de la Défense nationale sous la Troisième République semble en apparence simple dans la mesure où, depuis la loi du 25 février 1875, « le Président de la République dispose de la force armée ». En réalité, les approches possibles ont en commun avec les hautes instances le nombre et la diversité. Ceci impose la réalisation d’une typologie simplifiée comme préalable à toute réflexion. Cela permet ensuite de s’interroger sur les rapports qui ex..

Cent ans après : la mémoire de la Première Guerre mondiale, 2019
Afin de répondre à la question de comment les Français d’aujourd’hui se souviennent de la Grande ... more Afin de répondre à la question de comment les Français d’aujourd’hui se souviennent de la Grande Guerre, il faut avant tout faire la distinction entre l’histoire et la mémoire, car la mémoire par définition a un caractère plus subjectif et elle est fortement influencée par les besoins et les conditions contemporains. En observant le développement continu de la mémoire de la Première Guerre mondiale en France – la « guerre des 14 », comme on l’a longtemps appelé dans ce pays – peu de temps avant le début des manifestations du centenaire, on peut voir le passage progressif du concept de célébration (pour l’héroïsme de ceux qui sont tombés pour la patrie) à celui de la commémoration (pour les millions de victimes). Il convient également de noter le rôle croissant des voies de mémoire « privées » par rapport au(x) récit(s) mémoriel(s) officiel(s) dicté(s) par l’État. Le texte propose une analyse de ce qui précède, en présentant également les principaux événements commémoratifs de 2014 et les principaux défis actuels pour la mémoire de la Première Guerre mondiale en France.In order to answer the question of how today’s French people remember the Great War, it is first necessary to distinguish between history and memory, as memory by definition has a more subjective character and is heavily influenced by contemporary needs and conditions. Observing the ongoing development of WWI memory in France –the “war of 14”, as it has long been known in the country– shortly before the start of the centennial events, one can see the gradual passage from the concept of celebration (for the heroism of those fallen for the homeland) to that of commemoration (for the millions of victims). It is also worth noting the growing role of “private” memory routes in relation to the official memorial narrative(s) dictated by the state. The text offers an analysis of the above, presenting also the main commemorative events of 2014 and the main current challenges for WWI memory in France

Balcanica, 2019
Au début du mois de décembre 1915 le Grand Quartier Général français crée une mission militaire c... more Au début du mois de décembre 1915 le Grand Quartier Général français crée une mission militaire commandée par le général Piarron de Mondésir. Envoyée en Italie et en Albanie vers la mi-décembre elle doit principalement informer les autorités françaises sur la situation exacte de l' armée serbe. Lorsque, le 24 décembre les principaux rapports arrivent à Paris, dont le compte rendu d'un entretien direct entre le général de Mondésir et le roi Pierre Ier, le général Joffre et le gouvernement découvrent la réalité de la situation de l' armée serbe proche de l' annihilation et prennent conscience les souffrances qu' elle vient d' endurer. Ils prennent également la mesure du jeu double, mortifère pour les Serbes, joué par les Italiens. Ils décident de tout mettre en oeuvre pour sauver l' armée serbe qui représente aussi l' avenir de la Serbie en la ravitaillant et en la transportant vers l'île de Corfou.
La guerre de 1940, 2014
« Le couloir du Luxembourg, non défendu, sans destructions, menaçant à courte portée la gauche d... more « Le couloir du Luxembourg, non défendu, sans destructions, menaçant à courte portée la gauche de nos régions fortifiées et nos rocades, c'est là la direction initialement dangereuse, en face d'une attaque brusquée dans laquelle l'Allemagne mettra certainement en jeu des moyens mécaniques et motorisés supérieurs à ceux donnés au parti bleu pour l'exercice ». Général Weygand, 1933. Une défaite militaire comme celle subie par la France en mai-juin 1940 est d’autant plus difficile à analyser qu..

Http Www Theses Fr, 1994
La problematique generale tend a repondre a la question suivante : "le general weygand, vice... more La problematique generale tend a repondre a la question suivante : "le general weygand, vicepresident du conseil superieur de la guerre de fevrier 1931 a janvier 1935 fut-il un acteur, un spectateur ou un figurant sur la scene politique et militaire francaise ?". Pour ce faire, nous avons en premier lieu etudie la personnalite de weygand en la replacant dans son environnement humain, politique et militaire. Nous nous sommes ensuite interroge sur la pensee militaire de weygand afin d'en determiner les aspects novateurs et les limites. En ce qui concerne le conseil superieur de la guerre, nous avons etudie son organisation et son fonctionnement depuis sa creation, a travers les reformes qui jalonnerent son existence. Puis nous avons mesure son role et son influence relatifs, a travers l'action de son vice-president lors de toutes les reunions qui se deroulerent de 1930 a 1935. Nous avons enfin recherche dans les exercices organises par ce conseil, quelles etaient les tendances strategiques et tactiques majeures de la periode. Nous avons ensuite etendu notre recherche au role joue par weygand au profit de l'armee. Nous avons alors ete amene a determiner le poids relatif des questions economiques, financieres et budgetaires sur la modernisation de l'armee en pleine crise economique mondiale. Nous nous sommes ensuite interesse a la modernisation materielle de l'armee, a l'idee de motorisation et a sa concretisation. Nous avons enfin ouvert notre recherche aux conceptions du general weygand en matiere de defense nationale. Nous avons tout d'abord etudie l'organisation generale de l'armee comme composante de la defense nationale. Nous nous sommes ensuite interroge sur l'organisation du haut-commandement et sur la question du commandement unique. Nous avons enfin etudie les problemes lies a. . .
À la veille du 75e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale, ce livre propose un nouve... more À la veille du 75e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale, ce livre propose un nouveau regard sur la débâcle de mai-juin 1940. Les auteurs, chercheurs français et étrangers, adoptent une perspective originale : celle d’une histoire croisée et régionale, qui s’intéresse non seulement à l’Allemagne et à la France, mais aussi aux Pays-Bas, au Luxembourg et à la Belgique. C’est donc l’Europe occidentale dans sa totalité qui se trouve au centre de cet ouvrage, en tant que théâtre de cette offensive fulgurante et point de départ des vagues d’exode successives

Revue Historique Des Armees, Sep 15, 2011
Elizabeth Greenhalgh et Frédéric Guelton 1 Le 26 mars 1915, un officier supérieur français, le co... more Elizabeth Greenhalgh et Frédéric Guelton 1 Le 26 mars 1915, un officier supérieur français, le commandant de Bertier, reçoit l'ordre de rejoindre « l'armée britannique opérant dans les Dardanelles » 1 afin d'y occuper, auprès de son chef, sir Ian Hamilton 2 , la fonction d'officier de liaison. Entre cette date et la fin du mois de décembre1915, il va adresser à Paris, au colonel Hamelin, chef de la section Afrique à l'état-major de l'armée, 29lettres personnelles. Ces lettres, dont l'étude forme le coeur de cet article, présentent un avantage et un inconvénient méthodologiques majeurs. L'inconvénient est lié au métier de l'historien. Lorsque le commandant de Bertier écrit à l'attention personnelle du colonel Hamelin, il ignore que deux historiens, australien et français, auront la prétention d'étudier sa correspondance un siècle après les faits. Il noie donc involontairement, mais aussi pour le plus grand désagrément de l'historien, les informations concernant l'ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps-corps d'armée australien et néo-zélandais) en général et les Australiens en particulier, dans celles, beaucoup plus nombreuses, consacrées à l'ensemble des forces britanniques engagées dans les opérations des Dardanelles. Il impose en conséquence de procéder à un travail de dépouillement et d'analyse spécifiques et adaptés à l'approche envisagée. Néanmoins, et en dépit de cet inconvénient théorique initial, les lettres présentent un intérêt majeur dans la mesure où elles sont écrites sur le vif et où leur nature privée exempte leur auteur des précautions d'écriture que l'on rencontre dans les rapports officiels. Cette différence apparaît lorsqu'on retrouve, dans les archives, les rapports officiels rédigés par le colonel Hamelin ou l'un de ses adjoints à partir des lettres de Bertier 3. Soldats australiens de l'ANZAC vus à travers la correspondance du chef d'esca...
Das Internationale Krisenjahr 1956, 1999

The Cambridge History of the First World War
This chapter focuses on all bodies of literature to retrace the role of diplomats in the war'... more This chapter focuses on all bodies of literature to retrace the role of diplomats in the war's onset and development. It considers the three sub-periods of pre-1914, 1914-1916 and 1917-1918. A complex of changes in the pre-war period marked the most significant transformation in the system since its origins. The outbreak of hostilities plunged diplomats into a new and disturbing world. In the first big wartime secret treaty, the Straits agreement of March-April 1915, Russia obtained promises that it could annex Constantinople and the Straits. The Quai d'Orsay and Foreign Office were slower to discuss European war aims, as Grey and Theophile Delcasse feared undermining diplomatic unity and domestic consensus. The peace conference offered the foreign ministries an opportunity to reclaim influence, but they largely failed to do so. After the war, major reforms took place in many foreign services and foreign ministries.
Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 1999
Journal of Strategic Studies, 2002
The field of research into the Algerian War is vast in size, and much of it as yet un-reconnoitre... more The field of research into the Algerian War is vast in size, and much of it as yet un-reconnoitred. The writing of the military history of this war, in particular, has been making only slow progress, for the war remains technically and psychologically difficult to get to ...
Revue historique des armées, 2007
Mata Hari, de son vrai nom Margaretha Geertruida Zelle, est née le 7 août 1876 aux Pays-Bas à Lee... more Mata Hari, de son vrai nom Margaretha Geertruida Zelle, est née le 7 août 1876 aux Pays-Bas à Leeuwarden. ... Texte intégral. Signaler ce document. 1Mata Hari, de son vrai nom Margaretha Geertruida Zelle, est née le 7 août 1876 aux Pays-Bas à Leeuwarden. ...


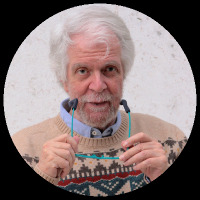








Uploads
Papers by Frédéric Guelton