Papers by Aurelie Campana
Criminologie (Montreal), 2022
Les déportations en héritage, 2010
Tatars de Crimée et musulmans de Meskhétie (ci-après indifféremment nommés Meskhètes ou Turcs Mes... more Tatars de Crimée et musulmans de Meskhétie (ci-après indifféremment nommés Meskhètes ou Turcs Meskhètes) n’ont a priori que peu en commun. Seules leur turcité et leur appartenance à l’islam les rapprochent. Pourtant, si leurs trajectoires historiques, politiques et culturelles restent spécifiques, le sort qui fut le leur entre 1944 et 1991 autorise de nombreux parallèles : dénoncés comme traîtres à la Patrie soviétique, déportés massivement et non réhabilités, ils ont résisté collectivement e..

Comment expliquer un attentat dans un cinema aux Etats-Unis, dans une mosquee a Quebec ou sur une... more Comment expliquer un attentat dans un cinema aux Etats-Unis, dans une mosquee a Quebec ou sur une promenade a Nice, en France ? Quelles sont les motivations qui poussent certains individus a commettre des actes aussi odieux que violents ? Comme une chimere, le terrorisme prend plusieurs visages en exploitant, entre autres outils, les reseaux sociaux. Mais en faisant des amalgames douteux associant radicalisme, islam et terrorisme, on occulte dangereusement les veritables causes de la violence politique pratiquee par plusieurs groupes extremistes ou par des loups solitaires… Une telle confusion entraine necessairement des rates dans la lutte contre le terrorisme, qui risque helas d’etre une bataille sans fin. La science politique apporte des eclairages utiles et essentiels a ce probleme. Elle permet de mieux cerner les interets geopolitiques obscurs qui se cachent derriere ces tragedies repetees.

Le Caucase et la Crimée ont été le théâtre de déportations massives organisées au cours de la Sec... more Le Caucase et la Crimée ont été le théâtre de déportations massives organisées au cours de la Seconde Guerre mondiale. Environ 900 000 personnes, appartenant à une dizaine de nationalités soviétiques en majorité de confession musulmane, ont été déplacées de force, alors que les combats contre l'armée allemande faisaient toujours rage. Ces régions ont pour singularité de connaître depuis l'effondrement de l'Union soviétique une actualité particulièrement mouvementée. Mosaïques ethniques situées au carrefour des civilisations et des religions, elles sont aujourd'hui considérées comme de véritables poudrières. Cet ouvrage collectif se veut une contribution à l'écriture d'une histoire qui ignore trop souvent l'actualité des peuples déportés. Il ouvre un angle jusque-là peu abordé, celui de la comparaison des déportations et de leurs impacts sur les situations politiques et sociales actuelles des peuples déportés. Une première partie présente les modalités des déportations, la vie en exil et les étapes du processus partiel de réhabilitation à partir de 1956. Suivent des études de cas abordant les décennies qui ont suivi la réhabilitation ou la non réhabilitation de six différents peuples déportés dans une perspective comparatiste. Enfin, une dernière partie examine le traitement de l'héritage stalinien dans le présent et la manière dont cet héritage, souvent encombrant, est géré par les États successeurs russe, ukrainien et géorgien. Privilégiant une approche pluridisciplinaire et rassemblant des spécialistes des questions étudiées, cet ouvrage propose de mesurer sur la longue durée les conséquences d'évènements que d'aucuns considèrent trop rapidement comme appartenant à l'ordre des mémoires. Il ouvre donc un champ d'étude encore peu abordé en France : l'actualité, le traitement, l'héritage et la mémoire des déportations dans le contexte postsoviétique
Introducing Vigilant Audiences, 2020
Studies in Conflict & Terrorism, 2020
This article discusses the trends and micro-dynamics of violence in northern Mali. Using a mixed ... more This article discusses the trends and micro-dynamics of violence in northern Mali. Using a mixed research design, we focus on the violence used by jihadist groups during the first phases of the Malian civil war (2012-2015). Integrating research on civil war and terrorism, we distinguish between direct and remote violence. Quantitative analyses show that the involvement of jihadist groups in this conflict had a strong impact on the level and intensity of violence of all warring parties. Qualitative analysis of data collected during field research done in Mali between 2016 and 2017 complements the quantitative work. It enlightens that relational dynamics strongly influence the decision to resort to violence within non-state armed groups, including jihadist ones, while local contexts often explain temporal and geographic variations in violence.
Canadian Journal of African Studies / Revue canadienne des études africaines, 2019
Censé mettre fin à la guerre civile qui déchire le Nord du Mali depuis 2012, l'Accord sur la paix... more Censé mettre fin à la guerre civile qui déchire le Nord du Mali depuis 2012, l'Accord sur la paix et la réconciliation, signé en juin 2015 entre l'État malien, les forces progouvernementales rassemblées au sein de la Plateforme, et les principaux groupes contestataires formant la Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA), est loin CONTACT Adam Sandor

Global Crime, 2019
Vigilantism is defined as collective coercive practices carried out by non-state actors and inten... more Vigilantism is defined as collective coercive practices carried out by non-state actors and intended to enforce norms (social or judicial) or to act directly to enforce such actors' views of the law. Vigilantes are involved in both societal control and the fight against crime. In this article, we analyse how societal vigilantes use digital media (Facebook) to act on immigration, national identity, ethnic boundaries, and cultural values in the province of Quebec, Canada. We show how social media practices entail performative effects that should not be considered exclusively in terms of physical expression, such as gatherings of dispersed constituencies, as in, for example, the Arab Spring, but also in relation to the construction of boundaries and increased polarisation between social groups. These latter effects have real consequences, such as separating one element of the population (Muslims) from the moral obligation social groups have towards each other in society.

International Studies Review, 2017
The complex architecture of fragmented authority in the international system remains under-theori... more The complex architecture of fragmented authority in the international system remains under-theorized. Understanding the world of separatist regions that turn into de facto states is high on the research agenda. While patron states are said to be a necessary condition, we argue that it might not be a sufficient one to explain the varying degrees of survival/ endurance of de facto states. This analytical essay is an effort to establish directions for research that would better account for the variation among cases by integrating their internal dynamics with what we already know about the role of external factors. Adopting a political sociology perspective, this article focuses on understudied aspects of internal processes and points to the role of local elites in state and nation-building during civil wars and after violence declines. We contend that such a perspective helps to account in a more comprehensive way for the processes underlying the status quo while, at the same time, analyzing the interplay between external and internal dynamics of frozen conflicts. We show that students of de facto states would gain from employing literatures on state-building and nation-building to articulate an analytical framework that would reassess the role of local elites in building a state and a nation, and analyze the societal (un)responsiveness as well as the strategies of passive or active accommodation, resistance or opposition within de facto states' populations.
Mediterranean Politics, 2016

Http Www Theses Fr, 2003
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité. Cette étude comparée a pour ... more Mention très honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité. Cette étude comparée a pour problématique le processus social et culturel de construction identitaire et pour terrains d'observation deux peuples musulmans d'ex-Union soviétique déportés en 1944, les Tatars de Crimée et les Tchétchènes. Elle s'attache à montrer, dans une perspective comparative le poids des affects sur le processus de construction identitaire. Elle se concentre sur les stratégies développées par ces deux minorités nationales pour obtenir une reconnaissance de leurs spécificités culturelles, historiques et politiques respectives. Tchétchènes et les Tatars de Crimée ont été massivement déportés en 1944 par le régime stalinien. La déportation ne signifie pas seulement déplacement forcé et dispersion sur le territoire de l'ex-URSS ; elle entraîne également une négation des spécificités identitaires et une abolition de tous droits individuels et collectifs. L'appartenance à l'Islam constitue une deuxième variable d'importance dans la mesure où les préceptes communs à cette religion imprègnent les codes culturels tatars de Crimée et tchétchènes. Enfin, la Tchétchénie et la Crimée sont caractérisées depuis 1991 par une situation conflictuelle. Si les deux configurations politiques observées diffèrent grandement de par leurs implications régionales et la nature du conflit -politique ou militaire -qui opposent d'un côté les Tatars de Crimée au gouvernement à majorité russe de la péninsule de Crimée, et d'un autre côté les Tchétchènes au gouvernement de la Fédération de Russie, elles comportent une même dimension de confrontation exacerbée et ethnicisée, à tout le moins dans le discours des acteurs. Malgré des trajectoires sociales, politiques et historiques différentes, Tatars de Crimée et Tchétchènes ont produit une semblable interprétation de la déportation. Cette similitude de significations nous a conduit à envisager les usages politiques de la mémoire de la déportation, à interroger les rhétoriques historiques produites par les acteurs sociaux et leurs conséquences sur le processus de construction identitaire après 1991. L'objectif principal de cette recherche consiste ainsi à revenir sur les motivations qui sous-tendent les processus de construction identitaire observés. Nous avons porté notre réflexion sur les divers mécanismes de mobilisation qui conduisent à la définition de frontières de groupe et de spécificités présentées comme nationales dans un contexte mouvant. La prétention symbolique des mouvements nationalistes tatar de Crimée et tchétchène à pouvoir réactiver les symboles considérés comme détruits ou altérés par la russification, la soviétisation et les destructions apportées par la déportation a particulièrement retenu notre attention. Cette illusion intrinsèque à tout mouvement nationaliste soutient l'objectif de création et d'augmentation d'une cohésion nationale autour d'un sentiment de communauté de destin. Ce sentiment apparaît comme pareillement articulé pour les Tatars de Crimée et les Tchétchènes autour de souvenirs tragiques et de ressentiments diffus nés des traumatismes engendrés par la déportation et transposés artificiellement au collectif.
Études internationales, 2007

Criminologie, 2014
Cet article porte sur les dynamiques propres aux politiques russes antiterroristes au Caucase du ... more Cet article porte sur les dynamiques propres aux politiques russes antiterroristes au Caucase du Nord et analyse leurs impacts sur le conflit. Pour ce faire, il s’appuie sur le concept de configuration tel que développé par N. Elias. Il se propose de déconstruire les interdépendances qui lient les acteurs de l’antiterrorisme et d’en examiner la nature et les logiques. Il montre qu’il existe non seulement un décalage entre les discours et les pratiques, mais également une divergence d’intérêts et de croyances, que la prédominance du clanisme, du localisme et du clientélisme, comme modes d’interactions et principes organisationnels, ne fait qu’enraciner. Il explique les échecs des politiques antiterroristes par les jeux de pouvoir, qui à Moscou et au Nord-Caucase, entravent leur bonne mise en oeuvre, par l’absence de coordination et la compétition inter-agences et par le détournement de la violence à des fins privées. Il montre ainsi que loin de contenir le conflit, ces pratiques impu...

Raisons politiques, 2008
La mobilisation des Tatars de Crimée pour leur réhabilitation : entre légalisme et rhétorique vic... more La mobilisation des Tatars de Crimée pour leur réhabilitation : entre légalisme et rhétorique victimaire L E 18 MAI 1944, les Tatars de Crimée, une minorité turcophone musulmane du sud de l'Ukraine, ont été massivement déportés par le régime soviétique. Selon un schéma éprouvé lors des déportations massives organisées dans les années et les mois précédents, 190 014 Tatars de Crimée ont été expulsés de force en trois jours et dispersés sur le territoire soviétique 1 . La minorité tatare de Crimée a été rayée de la carte des nationalités soviétiques. Dans le même temps, on les privait de leurs droits les plus élémentaires, faisant d'eux, selon la nomenclature soviétique, des « colons spéciaux ». Les effets multiples de la déportation ont été prolongés par l'exclusion de fait des Tatars de Crimée des processus de réhabilitation initiés par Khrouchtchev au lendemain du 20 e Congrès du Parti communiste de l'Union Soviétique (PCUS) en 1956. Les Tatars de Crimée recouvrent certes leurs droits à titre individuel, mais toute existence collective leur est déniée. De plus, ils sont interdits de retour en Crimée. La non-réhabilitation a provoqué une réaction parmi les 1. Les Allemands de la Volga, les Kalmouks, les Balkars, les Karatchaïs, les Ingouches ont été massivement déportés entre 1941 et mai 1944. Les Bulgares de Crimée, les Grecs de Crimée, les Coréens, les Kurdes, les Meskhètes ont été massivement déportés par la suite. recueils ont également été constitués. Enfin, lors d'un séjour de recherche en Crimée en 2002, nous avons mené des entretiens avec une quinzaine de Tatars.
L’Union européenne (ue) a joué un rôle premier comme médiateur dans la guerre qui a opposé en aoû... more L’Union européenne (ue) a joué un rôle premier comme médiateur dans la guerre qui a opposé en août 2008 la Géorgie et la Russie. Pourtant, l’ ue reste un acteur secondaire dans la région, peinant à s’immiscer dans les processus de résolution de conflit mis en place depuis la fin des différents conflits en Abkhazie, en Ossétie du Sud et au Nagorno-Karabakh. Cet article interroge l’échec relatif de l’ ue> à peser sur les processus de résolution des conflits gelés au Caucase du Sud. Il examine les logiques propres à l’ ue qui expliquent les impasses auxquelles elle doit faire face dans la région : les incertitudes et les ambiguïtés qui entourent la Politique européenne de voisinage (pev) et les autres instruments mobilisés au Caucase du Sud, les divisions et les concurrences intra-européennes.
Études internationales, 2009





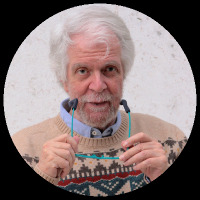





Uploads
Papers by Aurelie Campana