
IMPELLIZZERI Fabrizio
Fabrizio Impellizzeri est maître de conférences (professeur associé) en Littérature Française auprès de la Faculté de Langues et Littératures Étrangères de Raguse de l’Université de Catane. Ses domaines d’études concernent les littératures des XIXe, XXe et XXIe siècles et en particulier la psychanalyse appliquée à l’interprétation de la sublimation du désir et à la transgression dans le roman français du XXe siècle, l’engagement et son rôle politique de révolte dans le langage, les réécritures du mythe, l’intersémiotique, les réécritures de soi, l'autofiction, l'autoadaptation cinématographique, le cinéma et la sociolinguistique appliquée à l’étude des variations dans la culture française contemporaine. Il est l’auteur de trois ouvrages : L’écriture fantasmatique. La transcription du désir chez Jean Genet et Pierre Klossowski (2007), De l’écriture tactile à l’image. La figuration du désir chez Jean Genet et Pierre Klossowski (2008) et Sémiotique de l’outrage. Infractions politiques du langage, sociolectes et cinélangues chez Jean Genet et Pier Paolo Pasolini (2010). Il a publié de nombreux articles sur Jean Genet, Pierre Klossowski, Pier Paolo Pasolini (en comparaison à Genet), Colette, Willy, Pierre Jean Jouve, Maurice Sachs, Jean de Tinan, René Bazin, Carlos Batista, Samuel Benchetrit et André Téchiné. Il a dirigé Parcours variationnels du français contemporain (Repères-Dorif n°8, 2015), Les Variations linguistiques dans la littérature et le cinéma français contemporains (Classiques-Garnier, 2015) et la section « I mercati del tradurre: formazione linguistica e orientamenti professionali » au sein de Les liaisons plurilingues. Lingue, culture e professioni (Mucchi Editore, 2014). Il codirige la collection « Mercures – Studi Mediterranei di Francesistica » pour les éditions Mucchi de Modène, appartient au comité scientifique de la revue « Illuminazioni » et fait partie des comités de rédaction des revues « TICONTRE. Teoria Testo e Traduzione », du Département de Lettres et Philosophie de l’Université de Trente, depuis 2016, et « Quêtes littéraires » de l'Institut de Philologie Romane de l'Université Catholique de Lublin Jean-Paul II (Pologne) dirigée par Edyta Kociubińska, depuis 2019.
less
Related Authors
Elizabeth Stephens
The University of Queensland, Australia
Zoe Ververopoulou
Aristotle University of Thessaloniki
Terry Gunnell
University of Iceland
Martin Lefebvre
Concordia University (Canada)
Simon O'Sullivan
Goldsmiths, University of London
David Seamon
Kansas State University
Lydia Papadimitriou
Liverpool John Moores University
Armando Marques-Guedes
UNL - New University of Lisbon
Eitan Grossman
The Hebrew University of Jerusalem
Paul Arthur
University of Salento
InterestsView All (7)
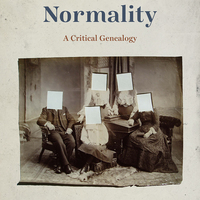
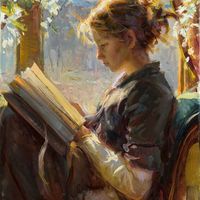





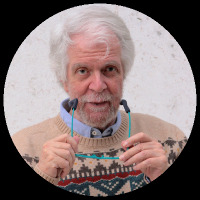


Uploads
Papers by IMPELLIZZERI Fabrizio
Pierre Klossowski (1905-2001), in most of his written and illustrated works, recounts artistically a single event: the unquestionable erotic desires of his wife Roberte, in other words Denise Morin-Sinclaire, a Protestant educator and inspector of the Censorship (The Revocation of the Edict of Nantes, 1959; Roberte, ce soir, 1954; Le Souffleur, 1965 in the trilogy of the Roberte novels Laws of Hospitality, 1995). A woman with a multiple, paradoxical, contradictory mind, divided between repression and perverse pleasure, a kind of demon that actualizes itself as a pagan goddess in continuous metamorphosis, elusive and uncommunicable just as Diana is in front of her voyeur Actaeon (Diana at Her Bath/The Women of Rome, 1956). "Impenetrable", imperturbable, Roberte gives in to pleasure by betraying her own erotic will through gestures and a face that are mostly shared between repulsion and invitation to embrace. Through solecism, Klossowski thus demonstrates Roberte's incoherence and tries to "show us" his perverse secret that the written text is limited to evoking. At the same time, Klossowski as painter reveals to us, through the diaphanous drawings sketched inside his "living pictures" (tableaux vivants), the ghosts that inhabit Roberte's body and thereby declassify his fantasies. Only the pictorial work, visible, is thus capable of showing the secrets that haunt Roberte's mind, and the body language, replacing the coded language of the conventional world and bourgeois morality, finally reveals the unfathomable.
Pierre Klossowski then realizes in the act of writing, and drawing above all, his own fantasized will. He caresses with his hand, through his pencil lead, the body that is born of his mind and his own canvas (here a large format sheet). Writing and painting are offered to the "reader-spectator-voyeur" in their complicit and complementary relationship in order to stage a "figurative" enunciation that underlies any literary work that contains in itself the essence of a secret body.
Pierre Klossowski (1905-2001), dans la plupart de ses œuvres écrites et illustrées, raconte artistiquement un seul événement : les désirs érotiques inconfessables de sa femme Roberte, autrement dit Denise Morin-Sinclaire, éducatrice protestante et inspectrice de la Censure (La Révocation de l’Édit de Nantes, 1959 ; Roberte, ce soir, 1954 ; Le Souffleur, 1965 in Les Lois de l’hospitalité, 1995). Une femme donc à l’esprit multiple, paradoxal, contradictoire, partagée entre la répression et le plaisir pervers, une sorte de démon qui s’actualise comme une déesse païenne en métamorphose continue, insaisissable et incommunicable tout comme l’est Diane devant son voyeur Actéon (Le Bain de Diane, 1956). « Impénétrable », imperturbable, Roberte cède au plaisir en trahissant sa propre volonté érotique par des gestes et un visage qui se partagent, la plupart du temps, entre répulsion et invitation à l’étreinte. À travers le solécisme, Klossowski nous démontre ainsi l’incohérence de Roberte et tente de nous « faire voir » son secret pervers que le texte écrit se limite à évoquer. Parallèlement, Klossowski peintre nous révèle, grâce aux dessins diaphanes esquissés à l’intérieur de ses « tableaux vivants », les fantômes qui habitent le corps de Roberte et déclassifie de ce fait ses fantasmes. Seule l’œuvre picturale, visible, est ainsi capable de réaliser la monstration des secrets qui hantent l’esprit de Roberte, et l’idiome corporel, en se substituant au langage codé du monde conventionnel et de la morale bourgeoise, nous dévoile finalement l’insondable.
Pierre Klossowski réalise alors dans l’acte d’écrire, et de dessiner surtout, sa propre volonté fantasmée. Il caresse de sa main, par le biais de sa mine de crayon, le corps qui naît de son esprit et de sa propre toile (ici feuille grand format). L’écriture et le tableau s’offrent au « lecteur-spectateur-voyeur » dans leur rapport complice et complémentaire dans le but de mettre en scène une énonciation « figurative » qui sous-tend toute œuvre littéraire renfermant en soi l’essence d’un corps secret.
Jean de Tinan (1874-1898), mort à seulement vingt-quatre ans, avait diagnostiqué dans son œuvre une « impuissance d’aimer », qui plus qu’être le simple signe d’une distanciation émotive, se révèle une véritable inadéquation personnelle, sinon générationnelle, à l’Amour. Les dandys fin-de-siècle montrent une nature hautaine et impénétrable cependant le sentiment romantique de certains d’entre eux, dont Tinan, fait tomber irrémédiablement leur masque. L’œuvre des écrivains dandys se fait porteuse de nombreuses crises sentimentales celées derrière des doubles qu’autorise l’autofiction narrative. Le texte est un miroir qui ne déforme aucunement la réalité mais qui offre, en revanche, un tableau complet et intime de la jeunesse fin-de-siècle qui, capitalisant les maintes rencontres, se fait prendre irrémédiablement dans le piège mortel d’une inéluctable « peau de chagrin ». C’est de part cette autodestruction amoureuse, alourdie par une nature maladive, que périt Jean de Tinan, dont l’œuvre nous renvoie un écho mélancolique.
Mots-clefs
Jean de Tinan – fiction autobiographique – dandysme fin-de-siècle – impuissance d’aimer – femmes.
Jean de Tinan (1874-1898), who died at only twenty-four years old, had diagnosed in his works a “powerlessness to love”, which, more than just being a sign of emotional distancing, is a true personal, if not generational, inadequacy to Love. The late 19th century dandies show a haughty and impenetrable nature, but the romantic feeling of some of them, including Tinan, makes their masks fall irremediably. The work of dandy’s writers carries many sentimental crises hidden behind alter ego allowed by narrative self-fiction. The text is a mirror that does not distort reality in any way but offers, on the other hand, a complete and intimate picture of the youth of the fin-de-siècle’s which, capitalizing many casual love affairs, is irreparably caught in the deadly trap of an inevitable peau de chagrin. It is through this amorous self-destruction, burdened by a sickly nature, that Jean de Tinan perished, whose work sends us back a melancholic echo.
Keywords
Jean de Tinan – autobiographical fiction – dandysm fin-de-siècle – powerlessness to love – women.
de Maurice Sachs
Maurice Sachs (1906-1945), écrivain « interdit » et volontairement négligé, est un des auteurs parmi les plus controversés que la littérature de l’entre-deux-guerres connaisse. Sa légende a fait de lui un être abject, sans talent, voué à la trahison et dont on évite bien volontiers toute sorte d’approche. Abandonné par sa famille, suite au divorce de ses parents, Sachs commence, dès son plus jeune âge, un parcours de l’errance qui commence par la recherche d’une morale, se poursuit par la quête de modèles et se termine enfin par une déchéance absolue qui le porte vers son exécution à Fuhlsbütten, le 14 avril 1945. Toute son existence s’érige ainsi sur l’être et le paraître « hors norme », sanctionné par ses parents comme le fruit d’une erreur conjugale. Juif de naissance, il se convertit d’abord au catholicisme puis au protestantisme. Il change de religion « comme de chemise » et son transformisme passe également par plusieurs travestissements, sexuels d’abord et identitaires par la suite. Sachs vit au-delà de tout tabou et les raisons de son insatiable métamorphose scellent de multiples inter-dits qui naissent d’une évidente instabilité sexuelle et d’un inévitable opportunisme lié à sa survivance. Pendant la Guerre, il ira jusqu’à franciser son nom en Saxe, ou encore il le reniera pour reprendre son patronyme, Ettinghausen, et sembler de la sorte plus « arien » et moins hébreux.
Se dire ou déclarer « autre », c’est-à-dire s’inter-dire, se nier, s’effacer, ou encore se raconter à l’intérieur de l’écriture, est ainsi le leitmotiv d’une affirmation de soi qui passe bien sûr par un geste de transposition narrative. S’écrire, se révéler, est une manière de disparaître et de renaître sous une autre forme. L’œuvre de Sachs est donc le support choisit d’une chrysalide qui ne cesse de vivre, grâce à son écriture, les raisons mêmes de son amoralité. L’inversion se traduit par la transposition sexuelle du non-dit dans Le voile de Véronique (1926), son premier roman, et se poursuit, par le biais de l’autofiction narrative, du double « Je », dans Alias (1935), autre roman. Être ignoble, à l’identité censurée, Sachs l’est surtout dans sa définition oxymorique de juif-gestapiste qui l’enferme à jamais dans un interdit de silence et d’oubli, sans doute prisonnier de ce trait d’union « hors-normes » entre le dire et l’inter-dire.
Mots clés
Transposition sexuelle, travestissement narratif, autofiction, abjection, censure, préjugés historiques
L’univers gris de la banlieue est ici recréé dans toute son humanité et s’affiche au lecteur comme le véritable décor et théâtre de l’ouvrage. L’espace suburbain compose alors l’image matricielle du texte et fonde son « architexture » autour d’un seul regard autobiographique et autofictif, celui d’un écrivain-personnage encore adolescent, Bench, impertinent et courageux face à la vie.
Le corps de Roberte est ainsi un corps que Klossowski souhaite d’abord décrire dans ses métamorphoses érotiques pour le transcrire ensuite dans ses différentes manifestations narratives, figuratives et plastiques.
Icona degli squilibri degli anni Trenta, scrittore collaborazionista-ebreo, personaggio e mostro allo stesso tempo, Maurice Sachs (1906-1945) è lo scrittore tipico della sua epoca. Scoprirne la complessità e la verità, è senza alcun dubbio lo scopo perseguito da numerosi scrittori che hanno provato a riabilitarlo nonostante tutto intraprendendo spesso il percorso, forse un po’ troppo riduttivo, di una valutazione meramente extra-letteraria. Indefinibile, indomabile, perso nel limbo del suo tempo, prigioniero della sua immagine, Sachs sembra assumere il ruolo d’intercessore tra due generazioni di scrittori, quella che si spegne all’indomani della Prima Guerre mondiale e quella che esplode con la corrente esistenzialista agli inizi degli anni 50. Tra queste due colonne, Sachs ci appare come un novello Ulisse senza domani. Modello di un’intera generazione, oggi, soltanto Alias, Le Sabbat, Au temps du Bœuf sur le toit, Chronique joyeuse et scandaleuse e La Chasse à courre sono ripubblicati.
Icon of a restless age, and collaborationist Jew, Maurice Sachs (1906-1945) is the typical writer of the Thirties. Numerous critics investigated his complexity and tried to rehabilitate him by
devoting attention only to extra-literary truths. Unclassifiable author, lost in his age, and prisoner of his image, Sachs seems to play the role of mediator between generations of writers, between writers dating back to the First World War and the existentialist writers of the Fifties. Between those pillars, Sachs appears to be a new Ulyssean figure without future. Though figuring as a role model for a whole generation, only the following works have been re-edited: Alias, Le Sabbat, Au temps du Bœuf sur le toit, Chronique joyeuse et scandaleuse and La Chasse à courre.
L’étude comparative des deux auteurs permet d’analyser un langage cinématographique dégrammaticalisé qui alterne réalité et imagination, pouvoir et plaisir.
Pierre Klossowski (1905-2001), in most of his written and illustrated works, recounts artistically a single event: the unquestionable erotic desires of his wife Roberte, in other words Denise Morin-Sinclaire, a Protestant educator and inspector of the Censorship (The Revocation of the Edict of Nantes, 1959; Roberte, ce soir, 1954; Le Souffleur, 1965 in the trilogy of the Roberte novels Laws of Hospitality, 1995). A woman with a multiple, paradoxical, contradictory mind, divided between repression and perverse pleasure, a kind of demon that actualizes itself as a pagan goddess in continuous metamorphosis, elusive and uncommunicable just as Diana is in front of her voyeur Actaeon (Diana at Her Bath/The Women of Rome, 1956). "Impenetrable", imperturbable, Roberte gives in to pleasure by betraying her own erotic will through gestures and a face that are mostly shared between repulsion and invitation to embrace. Through solecism, Klossowski thus demonstrates Roberte's incoherence and tries to "show us" his perverse secret that the written text is limited to evoking. At the same time, Klossowski as painter reveals to us, through the diaphanous drawings sketched inside his "living pictures" (tableaux vivants), the ghosts that inhabit Roberte's body and thereby declassify his fantasies. Only the pictorial work, visible, is thus capable of showing the secrets that haunt Roberte's mind, and the body language, replacing the coded language of the conventional world and bourgeois morality, finally reveals the unfathomable.
Pierre Klossowski then realizes in the act of writing, and drawing above all, his own fantasized will. He caresses with his hand, through his pencil lead, the body that is born of his mind and his own canvas (here a large format sheet). Writing and painting are offered to the "reader-spectator-voyeur" in their complicit and complementary relationship in order to stage a "figurative" enunciation that underlies any literary work that contains in itself the essence of a secret body.
Pierre Klossowski (1905-2001), dans la plupart de ses œuvres écrites et illustrées, raconte artistiquement un seul événement : les désirs érotiques inconfessables de sa femme Roberte, autrement dit Denise Morin-Sinclaire, éducatrice protestante et inspectrice de la Censure (La Révocation de l’Édit de Nantes, 1959 ; Roberte, ce soir, 1954 ; Le Souffleur, 1965 in Les Lois de l’hospitalité, 1995). Une femme donc à l’esprit multiple, paradoxal, contradictoire, partagée entre la répression et le plaisir pervers, une sorte de démon qui s’actualise comme une déesse païenne en métamorphose continue, insaisissable et incommunicable tout comme l’est Diane devant son voyeur Actéon (Le Bain de Diane, 1956). « Impénétrable », imperturbable, Roberte cède au plaisir en trahissant sa propre volonté érotique par des gestes et un visage qui se partagent, la plupart du temps, entre répulsion et invitation à l’étreinte. À travers le solécisme, Klossowski nous démontre ainsi l’incohérence de Roberte et tente de nous « faire voir » son secret pervers que le texte écrit se limite à évoquer. Parallèlement, Klossowski peintre nous révèle, grâce aux dessins diaphanes esquissés à l’intérieur de ses « tableaux vivants », les fantômes qui habitent le corps de Roberte et déclassifie de ce fait ses fantasmes. Seule l’œuvre picturale, visible, est ainsi capable de réaliser la monstration des secrets qui hantent l’esprit de Roberte, et l’idiome corporel, en se substituant au langage codé du monde conventionnel et de la morale bourgeoise, nous dévoile finalement l’insondable.
Pierre Klossowski réalise alors dans l’acte d’écrire, et de dessiner surtout, sa propre volonté fantasmée. Il caresse de sa main, par le biais de sa mine de crayon, le corps qui naît de son esprit et de sa propre toile (ici feuille grand format). L’écriture et le tableau s’offrent au « lecteur-spectateur-voyeur » dans leur rapport complice et complémentaire dans le but de mettre en scène une énonciation « figurative » qui sous-tend toute œuvre littéraire renfermant en soi l’essence d’un corps secret.
Jean de Tinan (1874-1898), mort à seulement vingt-quatre ans, avait diagnostiqué dans son œuvre une « impuissance d’aimer », qui plus qu’être le simple signe d’une distanciation émotive, se révèle une véritable inadéquation personnelle, sinon générationnelle, à l’Amour. Les dandys fin-de-siècle montrent une nature hautaine et impénétrable cependant le sentiment romantique de certains d’entre eux, dont Tinan, fait tomber irrémédiablement leur masque. L’œuvre des écrivains dandys se fait porteuse de nombreuses crises sentimentales celées derrière des doubles qu’autorise l’autofiction narrative. Le texte est un miroir qui ne déforme aucunement la réalité mais qui offre, en revanche, un tableau complet et intime de la jeunesse fin-de-siècle qui, capitalisant les maintes rencontres, se fait prendre irrémédiablement dans le piège mortel d’une inéluctable « peau de chagrin ». C’est de part cette autodestruction amoureuse, alourdie par une nature maladive, que périt Jean de Tinan, dont l’œuvre nous renvoie un écho mélancolique.
Mots-clefs
Jean de Tinan – fiction autobiographique – dandysme fin-de-siècle – impuissance d’aimer – femmes.
Jean de Tinan (1874-1898), who died at only twenty-four years old, had diagnosed in his works a “powerlessness to love”, which, more than just being a sign of emotional distancing, is a true personal, if not generational, inadequacy to Love. The late 19th century dandies show a haughty and impenetrable nature, but the romantic feeling of some of them, including Tinan, makes their masks fall irremediably. The work of dandy’s writers carries many sentimental crises hidden behind alter ego allowed by narrative self-fiction. The text is a mirror that does not distort reality in any way but offers, on the other hand, a complete and intimate picture of the youth of the fin-de-siècle’s which, capitalizing many casual love affairs, is irreparably caught in the deadly trap of an inevitable peau de chagrin. It is through this amorous self-destruction, burdened by a sickly nature, that Jean de Tinan perished, whose work sends us back a melancholic echo.
Keywords
Jean de Tinan – autobiographical fiction – dandysm fin-de-siècle – powerlessness to love – women.
de Maurice Sachs
Maurice Sachs (1906-1945), écrivain « interdit » et volontairement négligé, est un des auteurs parmi les plus controversés que la littérature de l’entre-deux-guerres connaisse. Sa légende a fait de lui un être abject, sans talent, voué à la trahison et dont on évite bien volontiers toute sorte d’approche. Abandonné par sa famille, suite au divorce de ses parents, Sachs commence, dès son plus jeune âge, un parcours de l’errance qui commence par la recherche d’une morale, se poursuit par la quête de modèles et se termine enfin par une déchéance absolue qui le porte vers son exécution à Fuhlsbütten, le 14 avril 1945. Toute son existence s’érige ainsi sur l’être et le paraître « hors norme », sanctionné par ses parents comme le fruit d’une erreur conjugale. Juif de naissance, il se convertit d’abord au catholicisme puis au protestantisme. Il change de religion « comme de chemise » et son transformisme passe également par plusieurs travestissements, sexuels d’abord et identitaires par la suite. Sachs vit au-delà de tout tabou et les raisons de son insatiable métamorphose scellent de multiples inter-dits qui naissent d’une évidente instabilité sexuelle et d’un inévitable opportunisme lié à sa survivance. Pendant la Guerre, il ira jusqu’à franciser son nom en Saxe, ou encore il le reniera pour reprendre son patronyme, Ettinghausen, et sembler de la sorte plus « arien » et moins hébreux.
Se dire ou déclarer « autre », c’est-à-dire s’inter-dire, se nier, s’effacer, ou encore se raconter à l’intérieur de l’écriture, est ainsi le leitmotiv d’une affirmation de soi qui passe bien sûr par un geste de transposition narrative. S’écrire, se révéler, est une manière de disparaître et de renaître sous une autre forme. L’œuvre de Sachs est donc le support choisit d’une chrysalide qui ne cesse de vivre, grâce à son écriture, les raisons mêmes de son amoralité. L’inversion se traduit par la transposition sexuelle du non-dit dans Le voile de Véronique (1926), son premier roman, et se poursuit, par le biais de l’autofiction narrative, du double « Je », dans Alias (1935), autre roman. Être ignoble, à l’identité censurée, Sachs l’est surtout dans sa définition oxymorique de juif-gestapiste qui l’enferme à jamais dans un interdit de silence et d’oubli, sans doute prisonnier de ce trait d’union « hors-normes » entre le dire et l’inter-dire.
Mots clés
Transposition sexuelle, travestissement narratif, autofiction, abjection, censure, préjugés historiques
L’univers gris de la banlieue est ici recréé dans toute son humanité et s’affiche au lecteur comme le véritable décor et théâtre de l’ouvrage. L’espace suburbain compose alors l’image matricielle du texte et fonde son « architexture » autour d’un seul regard autobiographique et autofictif, celui d’un écrivain-personnage encore adolescent, Bench, impertinent et courageux face à la vie.
Le corps de Roberte est ainsi un corps que Klossowski souhaite d’abord décrire dans ses métamorphoses érotiques pour le transcrire ensuite dans ses différentes manifestations narratives, figuratives et plastiques.
Icona degli squilibri degli anni Trenta, scrittore collaborazionista-ebreo, personaggio e mostro allo stesso tempo, Maurice Sachs (1906-1945) è lo scrittore tipico della sua epoca. Scoprirne la complessità e la verità, è senza alcun dubbio lo scopo perseguito da numerosi scrittori che hanno provato a riabilitarlo nonostante tutto intraprendendo spesso il percorso, forse un po’ troppo riduttivo, di una valutazione meramente extra-letteraria. Indefinibile, indomabile, perso nel limbo del suo tempo, prigioniero della sua immagine, Sachs sembra assumere il ruolo d’intercessore tra due generazioni di scrittori, quella che si spegne all’indomani della Prima Guerre mondiale e quella che esplode con la corrente esistenzialista agli inizi degli anni 50. Tra queste due colonne, Sachs ci appare come un novello Ulisse senza domani. Modello di un’intera generazione, oggi, soltanto Alias, Le Sabbat, Au temps du Bœuf sur le toit, Chronique joyeuse et scandaleuse e La Chasse à courre sono ripubblicati.
Icon of a restless age, and collaborationist Jew, Maurice Sachs (1906-1945) is the typical writer of the Thirties. Numerous critics investigated his complexity and tried to rehabilitate him by
devoting attention only to extra-literary truths. Unclassifiable author, lost in his age, and prisoner of his image, Sachs seems to play the role of mediator between generations of writers, between writers dating back to the First World War and the existentialist writers of the Fifties. Between those pillars, Sachs appears to be a new Ulyssean figure without future. Though figuring as a role model for a whole generation, only the following works have been re-edited: Alias, Le Sabbat, Au temps du Bœuf sur le toit, Chronique joyeuse et scandaleuse and La Chasse à courre.
L’étude comparative des deux auteurs permet d’analyser un langage cinématographique dégrammaticalisé qui alterne réalité et imagination, pouvoir et plaisir.
Léon Bloy never tires of stressing the apparent paradox of a century which has killed off God and yet ceaselessly pursues a warped phantom of God. Although it seems evident to him that late XIXth century France has chosen irreligion, it is also clear that the absence of religion in no way forbids the presence of the religious, a word which at once signifies the defeat of traditional religions and the permanent value of the symbolic element within them. In a time when Max Weber foresaw secularisation as the inevitable fate of of all modern societies, Bloy prides himself on seeking out which make up the social cement of the new order established by homo saecularis. The essentially diffused religious manifests through various symbols which fill the void left by an absent God, a phenomenon upon which the writer relies to question the very idea of modernity as it could be conceived by contemporary ideologies influenced by notions of progress and rationalism. The other side of secularisation, in fact, is the unconscious exacerbation of magical thought. As a keen hunter, Bloy tracks down what he believes to be the false currencies in use at the time, which thrive and underpin an infernal value system, which he strongly contests. This article aims to examine the way Bloy deconstructs and destroys these new idols.